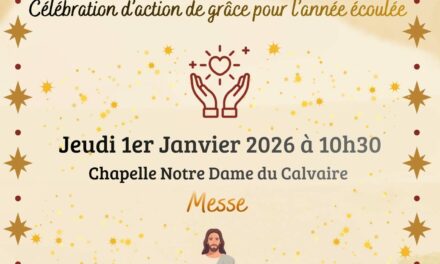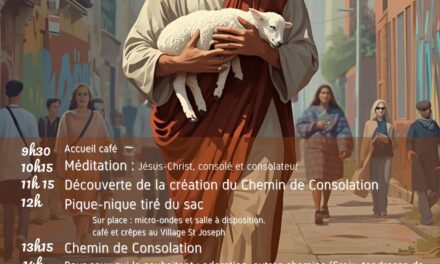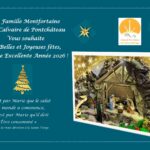Construction du Calvaire de Pontchâteau
D’après la revue « l’AMI DE LA CROIX »
Sans le remarquable travail du Frère Michel Le Gall (Frère de Saint Gabriel), cette page de chroniques n’aurait jamais vu le jour. Qu’il en soit ici sincèrement remercié.

NOTRE GRAVURE
Les pèlerins, qui ont visité souvent le Calvaire, pourraient, sans doute, se rendre compte de la pensée qu’elle exprime; mais nous devons la faire connaître et l’expliquer à nos lecteurs.
Nous avons pensé qu’il leur serait agréable d’avoir sous les yeux, tout à la fois, et le théâtre des travaux du B. de Montfort, et le cadre dans lequel doivent se réaliser les projets qu’il avait conçus.
Sur le premier plan, à droite, apparaît le nouveau monument, représentant le Prétoire de Pilate, auquel donne accès la Scala Sancta. Tout près, le bouquet d’arbres qui entoure la fontaine dite du P. de Montfort, et dont nous aurons occasion de parler. De la lande s’élève insensiblement jusqu’au Calvaire que l’on aperçoit dans le lointain, à gauche.
Une voie, à demi tracée sur la lande, relie le Prétoire au Calvaire. Ce sont les deux points extrêmes de la Lande de la Madeleine. La distance qui les sépare est de cinq à six cents mètres et diffère peu de celle qui se trouve, à Jérusalem, entre le vrai Prétoire et le Golgotha. La largeur du terrain destiné au pieux pèlerinage est à peu près égale, et peut présenter une superficie de sept ou huit hectares. On voit que ce serait déjà un grand travail d’enclore de murailles, comme on en a le dessein, celle autre Jérusalem.
Mais, revenons à notre gravure. On voit le Bienheureux debout au pied de la Scala, montrant de la main son Calvaire ou plutôt la plaine qui s’étend devant lui, comme pour inviter à continuer le travail commencé.
Bien des fois, à cette place même, il a dû faire entendre sa voix, exhorter, animer ses chers travailleurs. C’est là, nous l’avons dit ailleurs, qu’ils se réunissaient d’ordinaire pour prendre leur frugal repas, n’ayant pour se désaltérer que l’eau de la fontaine. C’est là que plus d’une fois eut lieu, en faveur de ses chers pauvres, la multiplication des pains, et, en particulier, entre les mains de Jeanne Guégan, la pauvre veuve qu’il avait établi sa pourvoyeuse générale. C’est de là qu’on parlait en récitant le Rosaire ou en chantant un cantique de circonstance, pour aller reprendre les travaux interrompus un instant.
Certes, Montfort, du haut du Ciel, doit être heureux de voir ce qui a été fait sur ce coin de terre, en particulier, pour reprendre son œuvre et le glorifier lui-même, en même temps que Jésus crucifié.
Au dire de tous, le monument du Prétoire, que notre gravure met sous les yeux est un beau début, digne de servir de point de départ à l’œuvre projetée. Et puis tant d’actes de dévotion, de piété touchante y ont été accomplis déjà, sous les regards des Anges de la Passion qui ont été placés là, comme pour en être les témoins.
C’est tous les jours, que de nombreux et pieux fidèles font l’ascension de la Scala, à genoux. Chaque dimanche, l’empressement est tel, que pendant des heures, il n’y a pas de place inoccupée sur les marches du Saint Escalier.
Et que de prières ferventes répandues devant ce groupe de la Flagellation, qui fait l’admiration des connaisseurs! Mais, il y a quelque chose de mieux à en dire, c’est que sa vue a déjà touché bien des cœurs, et que les pieds du divin Flagellé ont été arrosés de bien des larmes. Nous en avons été plus d’une fois témoin.
On doit comprendre maintenant ce que dit Montfort, du pied de la Scala, où nous l’avons placé. Devant lui, en face, la voie douloureuse montant jusqu’au Calvaire. Elle doit se peupler, s’animer par la représentation aussi vivante que possible des différents stations du Chemin de la Croix. Une de ces stations, et non la moins touchante, doit être déjà à l’étude, chez l’auteur du groupe de la Flagellation.
Mais ce Chemin de Croix monumental n’est pas tout. L’Apôtre de Jésus crucifié a été, en même temps, l’Apôtre du Rosaire. Lui-même avait déjà fait élever autour de son Calvaire, trois petits monument ou chapelles rappelant les mystères du Rosaire. Il devait y en avoir quinze, selon le nombre des mystères. Les historiens ont noté cette particularité, qu’à côté de ces monuments ou chapelles il y avait une cellule, sans doute pour permettre au pèlerin de s’y arrêter dans la contemplation du mystère qui lui offrirait plus d’attraits.
L’espace qui s’étend à gauche de la Scala, dans la direction de la nouvelle Chapelle du Pèlerinage, semble tout disposé pour recevoir la représentation des Mystères joyeux. On y verra tout d’abord et prochainement, nous l’espérons, une reproduction exacte de la Santa Casa de Lorette, ou maison de la Sainte Vierge, dans laquelle s’est accompli le grand mystère de l’Incarnation.
A droite de la Scala, le terrain va s’élevant jusqu’à une espèce de crête ou ceinture de rochers. Tout y est à souhait pour qu’on puisse y figurer le jardin des Oliviers, avec la grotte de Gethsémani, commençant la série des Mystères douloureux.
Enfin, du même côté, à la hauteur des rochers, dont l’un est déjà désigné comme devant être le rocher de l’Ascension, se développerait la série des Mystères glorieux.
Tel est le plan dont notre gravure met imparfaitement, sans doute, le cadre sous les yeux, et dont Montfort, du pied de la Scala, semble demander l’exécution prompte et fidèle.
Nous n’en doutons pas, la voix de l’excellent Prédicateur du Mystère de la Croix et du Très Saint Rosaire sera entendu.
En guise de préambule- par Jean des Landes
Le Prétoire et la Scala Sancta
Le premier numéro de l’Ami de la Croix parut au commencement d’octobre 1891. La bénédiction du Prétoire et l’inauguration de la Scala Sancta avaient eu lieu le 24 juin précédent. C’est pourquoi notre revue n’a pas parlé de ce premier travail. Nous allons y suppléer.
C’est dans la seconde partie de l’année 1889 que je formai le projet d’ériger, près de la fontaine dite du Père de Montfort, le Prétoire et la Scala Sancta. J’avais songé d’abord au Saint-Sépulcre. J’en parlai au révérend Père Tissot, que Mgr Lecoq avait envoyé passer quelques jours au Calvaire, entre les deux retraites ecclésiastiques de Nantes. Le Révérend Père me fit remarquer avec raison que ce n’était pas la place naturelle du Saint-Sépulcre, que c’était trop loin du Calvaire. Je renonçai sans peine à ce premier projet. La pensée me vint alors d’établir en ce lieu la première station d’un chemin de croix qui se terminerait au Calvaire.
Quelques jours après, j’allai à Saint-Guillaume dans le but de recueillir des anciens ce qu’ils avaient appris de leurs ancêtres touchant le Calvaire. Je me rendis d’abord au presbytère. M. l’abbé Nicol m’offrit aussitôt de me procurer des charrettes pour transporter les pierres nécessaires à la construction du Saint-Sépulcre. Je le remerciai, lui donnant la raison qui m’avait fait changer d’avis, et je lui parlai de mon projet de chemin de croix. Le bon curé me conduisit chez une bonne ancienne, âgée de 93 ans, et jouissant pleinement de ses facultés intellectuelles. Chemin faisant, il me dit que cette bonne ancienne, tertiaire de Saint-François, méritait toute confiance ; qu’à sa connaissance, elle avait obtenu deux miracles du bienheureux de Montfort.
L’une de ses petites nièces était mourante ; elle la prend dans son tablier et l’emporte au Calvaire. Elle la dépose au pied de la croix, en disant : « Bon Père de Montfort, guérissez ma petite nièce. » — Elle fut exaucée à l’instant ; elle rapporta à la maison l’enfant complètement guérie. La petite qui tout à l’heure était sans mouvement se levait debout dans le tablier de sa tante pendant que celle-ci fait le chemin de la croix autour de la montagne. Cette enfant est maintenant mère de famille. Elle habite le village de la Berneraie. C’est la femme Joalland1.
La bonne ancienne vient d’être elle-même l’objet de la seconde faveur. Elle ne pouvait marcher qu’à l’aide d’un bâton. A la vue des nombreuses guérisons opérées au Calvaire par le bienheureux de Montfort depuis sa béatification, elle se dit : il faut que j’aille lui demander la faveur de marcher sans bâton. Avec son bâton, elle se met en route pour le Calvaire. La faveur fut accordée. Le bâton fut laissé au Calvaire et depuis lors, elle marche sans appui et facilement.
Dès que j’eus fait connaître à la bonne tertiaire l’objet de ma visite, elle nous dit : « Je n’ai rien entendu, mais j’ai vu. J’avais alors de 17 à 18 ans. Je gardais les troupeaux dans le bas de la lande du Calvaire. Nous étions plusieurs ensembles. J’avais alors 18 ans. Nous avons vu bien des fois la lande, de la fontaine au Calvaire, couverte d’une immense multitude.» — « Que faisaient ces personnes, lui demandai-je ? — Elles montaient au Calvaire en passant à côté du moulin, et disparaissaient ensuite. » — « Voici votre chemin de croix, dit vivement M. l’abbé Nicol. » — « Je n’en sais rien, mais il est certain que c’est bien extraordinaire. » — Je venais pour la première fois de parler de mon projet de chemin de croix, en me rendant chez la bonne tertiaire, et je n’avais rien dit devant Elle. En ce moment le chemin de croix est érigé et pieusement suivi par des foules de fidèles. Nous avons vu aussi, à l’occasion de nos fêtes du Centenaire, la lande couverte d’une foule immense de la fontaine au Calvaire. Mais alors j’étais loin de soupçonner ce que nous avons vu ces dernières années.
Je soumis ce fait comme les autres, dont j’ai parlé dans les derniers numéros de l’Ami de la Croix, à Mgr Lecoq, Evêque de Nantes. Sa Grandeur me répondit : « Sans me prononcer sur ces faits, je vous autorise à commencer le Chemin de Croix dont vous me parlez. C’est une œuvre de nature à exciter la foi et la piété dans la région. »
Je reçus une réponse semblable du Très Révérend Père Maurille et je me mis à l’œuvre.
Je ne me faisais pas illusion sur les difficultés à surmonter. Mais ayant la certitude que Dieu voulait cette œuvre, j’étais plein de confiance. Il fallait d’abord acquérir les terrains nécessaires à la construction du Prétoire. La Fontaine et le terrain qui l’entourent étaient alors censés la propriété de la Fabrique de Pontchâteau, qui pour le moment, croyait de son devoir de faire opposition à la nouvelle œuvre. J’achetai le terrain qui l’entoure. Je n’avais alors pas un centime, mais la Providence me vint en aide. M. l’abbé Joseph Guiot, alors vicaire à Saint-Laurent-sur-Sèvre, maintenant Mgr Guiot, me fit savoir qu’une personne se chargeait des frais nécessaires à ce premier achat.
Mais il y avait une autre difficulté à résoudre. Comment aller de notre maison à la nouvelle construction?
Le terrain qui longe le jardin des Sœurs nous appartenait. Plein de confiance dans le Bienheureux qui voulait cette œuvre, je fais l’avenue le long du mur du jardin des Sœurs. Puis je fais combler le fossé qui sépare ce champ de celui du voisin qu’il nous fallait traverser !
« Que veut donc le Père Barré, dit le propriétaire ; pourquoi a-t-il fait combler son fossé? — Comment, tu ne vois pas, lui répondit-on, il veut passer sur ton terrain ! — Pour cela, jamais, alors même qu’il voudrait me le payer cent francs le sillon. »
Cette parole peu encourageante m’est rapportée. Je vais néanmoins faire ma demande à la famille. Refus poli, mais refus absolu. Je retourne quelques semaines après, même refus. J’attends l’heure de Dieu avec patience ; je n’eus pas à attendre longtemps.
Dans la matinée du jour de Noël, m’arrive en toute hâte, l’un des jeunes gens de la maison. —« Venez vite, mon Père, me dit-il, et apportez les saintes huiles, ma mère se meurt. » — « Je me rends chez vous immédiatement, lui répondis-je, mais sans emporter les Saintes Huiles, car votre mère n’est pas mourante. » « Quelques instants après, j’étais dans la maison de la malade. Elle se croyait en effet sur le point d’aller paraître devant Dieu; le mari et les enfants la croyaient aussi à l’extrémité. — « Mon Père, me dit-elle, nous avons refusé le Père de Montfort, et Dieu nous punit. Nous avons perdu une vache, et je vais mourir. » — « Je peux vous assurer d’abord, ma bonne, que vous n’êtes pas en danger de mort et que vous ne mourrez pas de cette maladie. » Connaissant la nature de la maladie, je pouvais le dire avec assurance et je ne manquai pas de le faire. — « Mon Père, poursuivit-elle, voici mon mari et mes enfants, nous vous accordons tous, de tout cœur, ce que vous nous avez demandé, faites la route quand vous le voudrez et arrangez les choses comme vous l’entendrez. — « J’accepte avec reconnaissance, lui répondis-je, nous ferons un échange à votre profit. Mais je vous assure de nouveau que vous n’êtes pas en danger et que je ne peux pas vous donner l’Extrême-onction. » — Je ne me trompais pas. Il y a de cela vingt-quatre ans et la femme Guihéneuf est toujours de ce monde. Elle a vu mourir son mari et ses deux fils qui ont laissé des enfants. Mais, pour elle, elle vit toujours. Elle habite en ce moment chez sa fille devenue la mère d’une nombreuse et intéressante famille.
Je vais le soir même à Saint-Guillaume et le bon Curé convoque ses hommes pour le lendemain. Le surlendemain, l’avenue traversant le terrain Guihéneuf était terminée. Les fils Guihéneuf étaient au nombre des travailleurs.
Les travaux du Prétoire commencèrent aux premiers beaux jours. Nos bons villageois des paroisses voisines rivalisèrent de zèle pour nous amener la pierre. Les hommes de Saint-Joachim vinrent creuser les fondations. Mais il nous fut impossible de trouver le solide. Il nous fallut aller à une grande profondeur, recourir au béton, placer au-dessus de fortes et larges pierres de Nozay, croisées les unes sur les autres. Et l’on put bâtir solidement. Les fondations absorbèrent une énorme quantité de pierres.
Nous étions sur une nappe d’eau. Pour n’être pas submergés, il fallut recourir à une forte pompe et la faire manœuvrer nuit et jour, même le dimanche, jusqu’à ce que nos fondations soient sorties de terre.
Nous voulions avoir la cérémonie de la Bénédiction de la première pierre du monument le 8 septembre, il fallait se hâter. Le monument proprement dit, partait du sommet de l’escalier, c’est-à-dire de quatre mètres de hauteur. C’est là que fut placée la première pierre dont la Semaine religieuse de Nantes annonça la bénédiction pour le 8 septembre.
« Le Calvaire du B. Montfort » (projet)
La méditation de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et des diverses circonstances du sanglant sacrifice émeut toujours profondément les âmes. C’est à Jérusalem surtout, sur les traces même du divin Sauveur, que ce souvenir parle à la piété et fait couler les larmes.
Mais un pèlerinage aux Lieux-Saints est le privilège d’un petit nombre de chrétiens.
C’est pourquoi le Bienheureux Montfort conçut autrefois le projet de-transporter pour ainsi dire les Lieux-Saints en France, au moyen d’une exacte reproduction.
C’est à Paris, pendant les cinq mois qu’il passa parmi les ermites du mont Valérien, au commencement de l’année 1704, que Dieu lui fournit l’occasion de former ce grand dessein. « Il y avait alors sur cette montagne, dit le premier historien du Bienheureux, plusieurs chapelles un peu éloignées les unes des autres où les mystères de la Passion étaient représentés d’une manière très dévote par des statues de grandeur naturelle, où les pèlerins allaient faire leurs stations.
« Monsieur de Montfort ne manquait pas d’y aller tous les jours méditer les mystères des souffrances du Sauveur, pour lesquels il avait un attrait tout particulier. »
Dès 1707, durant son séjour à Saint-Brieuc, il voulut mettre à exécution son noble projet en faisant sculpter un grand Christ en bois destiné à être placé sur la croix de son calvaire ».
Il choisit d’abord pour cela sa ville natale. Les travaux du Calvaire et des chapelles commencèrent. Mais bientôt survint un ordre du duc de la Trémouille, seigneur de Montfort, défendant de poursuivre l’entreprise.
L’intrépide missionnaire reprit son projet en 1709, dans la lande de la Madeleine, en Pontchâteau.
Il commença par le Calvaire. C’était la station principale, mais ce n’était qu’une station. Les quinze chapelles qui devaient border le sentier jusqu’au sommet du mont Calvaire, étaient les chapelles du Rosaire. Les chapelles du Chemin de Croix devaient être placées en dehors de l’enceinte, et entre chacune d’elle devait être gardée la distance parcourue par notre divin Maître dans la Voie douloureuse. Avant d’arriver au Prétoire, les pieux fidèles devaient passer par le jardin des Olives.
L’exécution du plan du bienheureux Montfort ferait du pèlerinage de Pontchâteau le plus touchant des pèlerinages, après celui de Jérusalem.
Le Bienheureux n’avait rien plus à cœur que la réussite de ce projet ; il en a même prédit la réalisation et célébré la gloire, ajoutant toutefois : « Il faut d’autant plus de travaux, d’attente et de prières et de croix, que cet œuvre doit être grand. »
Les enfants du Bienheureux, encouragés par Monseigneur l’Evêque de Nantes, assurés du précieux concours de tous les amis de Montfort, viennent de jeter les fondements du Chemin de Croix monumental dont le Calvaire, restauré lui-même suivant les plans de son auteur, sera la station principale.
Ce pieux monument offrira aux yeux des fidèles l’exacte reproduction de la façade du Prétoire avec la fidèle représentation en statues de grandeur naturelle des scènes du jugement, de la flagellation, du couronnement d’épines de notre divin Sauveur et de l’Ecce Homo. Au milieu se trouvera la Scala Sancta.
La cérémonie de la bénédiction de la première pierre est fixée au lundi 8 septembre. Elle aura lieu à deux heures de l’après-midi et sera faite par Mgr l’Evêque du Cap-Haïtien, délégué à cet effet par Mgr l’Evêque de Nantes.
Tous les amis du bienheureux Montfort sont invités à y assister.
Après la bénédiction de la première pierre, une quête sera faite pour l’érection du monument. »
« L’Espérance du Peuple » annonçait en même temps notre fête : le projet du Calvaire du Bienheureux Montfort
L’intention du Bienheureux Montfort était de transporter pour ainsi dire Jérusalem en France, en faisant l’exacte reproduction des diverses scènes de la douloureuse Passion de l’Homme-Dieu. C’est ce qu’il faisait chanter à ses chers travailleurs dans la lande de la Madeleine :
Tâchons d’avoir cette sainte Montagne
Par un divin transport
Dans notre cœur et notre campagne.
Il voulait représenter, au Jardin des Olives, l’Homme-Dieu en proie aux cruelles angoisses de l’agonie, les Apôtres s’abandonnant à un lâche sommeil, le traître Judas livrant son divin Maître par la plus infâme des trahisons, Jésus indignement garrotté comme un criminel et lâchement abandonné par ses trop timides disciples. Son but était de nous faire suivre ensuite Jésus pas à pas et de reproduire d’une manière saisissante, par des statues de grandeur naturelle, les scènes les plus émouvantes de la douloureuse Passion. Il aurait gardé, autant que possible, entre chacune des stations du Chemin de Croix, la distance parcourue réellement par Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Le premier historien de l’illustre missionnaire nous dit qu’il conçut ce projet grandiose, dès le commencement de l’année 1704, pendant les quelques mois qu’il séjourna parmi les Ermites du Mont-Valérien, à Paris. Il y avait alors sur cette montagne un Chemin de Croix monumental, érigé dans le courant du 17e siècle, par un nommé Hubert. Voici en quels termes le Père Picot de Clorivière parlait de ce Chemin de Croix en 1780 : « Avant d’arriver au sommet du Mont-Valérien, on rencontre plusieurs chapelles où les divers mystères de la Passion sont représentés en relief, et d’une manière très expressive, par des figures de hauteur humaine, ce qui attire en cet endroit un grand nombre de pèlerins qui viennent faire leurs stations à ces chapelles. »
Au témoignage de M. Grandet qui fit imprimer à Nantes, en 1724, sa Vie du Bienheureux, « M. de Montfort ne manquait pas d’y aller tous les jours méditer les mystères des souffrances du Sauveur pour lesquels il avait un attrait tout particulier. »
Depuis lors il ne cessa pas de chercher un lieu propre à son dessein. Il crut l’avoir trouvé près de sa ville natale.
Je cite les paroles du Père de Clorivière : « Ses concitoyens étaient entrés dans ses pieux desseins et chacun d’eux se faisait une joie d’y contribuer selon son pouvoir. L’homme de Dieu avait fait choix, pour planter la croix, d’une éminence qui lui parut très propre pour cela, parce que la croix y eût été aperçue de très loin. Il avait conçu le projet de faire ! Bâtir, de distance en distance, des chapelles ou les images de la Passion devaient être représentées. Déjà le sommet de la butte était aplani, quand survint un ordre du duc de la Trémouille, seigneur de Montfort, qui défendait de poursuivre une entreprise, qui non-seulement eût réveillé la piété dans l’esprit des habitants de la ville, mais encore eût contribué à embellir la ville elle-même, et à la rendre plus florissante par le concours des pèlerins qu’elle y aurait amenés. »
L’intrépide missionnaire que rien ne peut décourager reprit l’exécution de ce projet dans la lande de la Madeleine, en 1709. Il commença par le Calvaire, c’était la station principale, mais ce n’était qu’une station. Le long du sentier qui montait en spirale jusqu’au sommet du Mont Calvaire devait être construit, il est vrai, 15 chapelles dont chacune devait avoir sa cellule et son petit jardin, 4 étaient déjà bâties. Mais c’étaient les chapelles du Rosaire dans lesquelles les Mystères devaient être représentés par des statues de grandeur naturelle. Les chapelles du Chemin de la Croix devaient être placées en dehors de l’enceinte du Calvaire.
Le projet du Père de Montfort est un projet gigantesque. La réalisation ferait du Pèlerinage de Pontchâteau, comme pèlerinage à la Passion, le plus beau des pèlerinages du monde, après celui de Jérusalem. L’on verrait alors affluer les pèlerins dans la lande de la Madeleine, comme à l’époque du Bienheureux, venant non seulement de toute la France, mais de toutes les parties du monde.
Nous en avons le ferme espoir, désormais ce jour tant désiré ne se fera pas longtemps attendre. Encouragés par Mgr l’Evêque de Nantes, les Enfants de Montfort viennent de reprendre l’exécution du plan de leur Père. Le succès en est assuré. Ce n’est pas en vain en effet que l’illustre missionnaire a mis dans la bouche de Jésus ces paroles qui semblent tenir de l’inspiration et qui ont été tant de fois répétées avec enthousiasme par ses chers travailleurs :
Oui, je le veux, il y va de ma gloire,
Et du haut de la Croix
Je chanterai dans ce saint lieu : victoire !
Oui,
Dieu le veut et Montfort est l’écho de sa voix.
Jésus, qui dans la personne de son apôtre a été si profondément humilié en ce lieu, y recevra une glorification en rapport avec ses humiliations. Dieu le veut !
La Béatification de Montfort, ses éclatants miracles opérés dans le monde entier, et surtout les nombreuses et insignes faveurs dont il se plaît à combler chaque jour ceux qui vont le prier à son Calvaire, sont pour nous l’expression de la volonté divine. En prédisant la gloire de cette Œuvre, le Bienheureux a dit : « Il faut d’autant plus de travaux, d’attente, de prières et de croix, que cet œuvre doit être grand. »
Le temps de l’attente est passé, c’est l’heure de nous approprier ce que chantaient nos ancêtres en travaillant sous la direction de l’illustre Missionnaire :
Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous ;
Grands et petits, de tout sexe, de tout âge.
Dès maintenant le concours de tous est assuré à cette grande entreprise appelée à devenir Tune des plus grandes gloires de notre contrée et à être pour nous tous une source de précieuses bénédictions.
L’heureuse nouvelle de la bénédiction de la première pierre du premier monument va être accueillie avec une grande joie par tous les habitants de la contrée.
Cette cérémonie aura lieu le 8 septembre prochain. Elle sera faite par Monseigneur l’Evêque du Cap-Haïtien que Monseigneur l’Evêque de Nantes a délégué à cet effet.
J. Barré.
1Cette femme est décédée depuis plusieurs années.
Bénédiction de la Première Pierre du Prétoire et de la Scala Sancta
La cérémonie de la bénédiction de la première pierre du Prétoire et de la Scala Sancta eut lieu, comme elle avait été annoncée, le 8 septembre 1890. Voici en quels termes l’Espérance du Peuple rend compte de cette cérémonie : « Pour perpétuer le souvenir des merveilles du Calvaire, les Fils de Montfort ont résolu de réaliser dans toute sa magnificence le projet conçu par le Bienheureux. Il s’agit de reproduire dans la lande de la Madeleine, le chemin de la Croix avec la plus grande exactitude : les quatorze stations seront représentées avec les personnages de grandeur naturelle ; la distance qui existe à Jérusalem entre chacune d’elles sera observée autant que possible ; Jérusalem sera pour ainsi dire transportée dans la lande bretonne et les chrétiens auront la consolation de suivre la Voie douloureuse parcourue par le Sauveur.
Ce projet grandiose a reçu un commencement d’exécution et hier 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge, a eu lieu la bénédiction de la première pierre du Prétoire de Jérusalem où Notre-Seigneur comparut devant Pilate. La bénédiction a été faite avec une grande solennité par Mgr Kersuzan, évêque du Cap-Haïtien.
La paroisse de Crossac venue en pèlerinage le matin avec son clergé, sa croix, sa bannière et sa musique instrumentale, assistait à la cérémonie qui eut lieu dans l’après-midi. D’autres pèlerins étaient venus isolément de divers lieux ; Mgr Kersuzan était assisté du R. P. Barré, supérieur des Missionnaires, de M. le Curé de Pontchâteau, de M. le chanoine Brelet, de M. le Curé de Port-au-Prince, de M. le Curé de Férel, de M. le Curé de Campbon, de M. le Curé de Crossac et de nombreux ecclésiastiques. Parmi les laïques on remarquait M. le marquis de Montaigu, M. Corbun de Kérobert, conseiller général, M. du Bois, conseiller d’arrondissement, M. de la Rochefoucauld. M. de Beaudinière, M. Fraboulet, architecte de l’élégante chapelle des Pères, chargé de l’exécution des monuments projetés.
Le R. P. Barré, du haut de l’échafaudage, a exposé l’idée du Bienheureux qu’il se propose de réaliser. Le Prétoire, dit-il, est placé près de la fontaine où se sont opérés tant de prodiges, dans la partie inférieure de la lande ; l’étendue du terrain permettra à des foules immenses d’assister au Saint Sacrifice de la Messe, et le plan doucement incliné rendra facile à tous la vue de l’autel où le prêtre montera, comme au prétoire de Pilate, par vingt-huit marches.
Cet escalier rappellera la Scala Sancta gravie deux fois par Notre-Seigneur. La façade du monument aura 21 mètres de longueur et présentera cinq arcades. Sous l’arcade du milieu sera dressé un autel où sera célébré le Saint Sacrifice : les deux arcades de droite représenteront l’une le Jugement, l’autre le Couronnement d’épines ; les deux arcades de gauche, la Flagellation et l’Ecce-Homo.
Ainsi sera glorifié Notre-Seigneur, ainsi sera rempli le vœu du bienheureux Montfort. Mgr l’Evêque de Nantes encourage les fidèles à entreprendre cette grande œuvre qui sera pour le diocèse une source de grâces et de bénédictions. Le Bienheureux a annoncé lui-même que des faveurs sans nombre récompenseraient les adorateurs de Jésus crucifié :
Oh ! Qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Que de conversions !
De guérisons, de grâces sans pareilles.
Faisons un calvaire ici,
Faisons un calvaire.
Après l’allocution du R. P. Barré, Mgr Kersuzan a parlé aux pèlerins avec beaucoup de piété et d’onction. Il a développé ce texte de l’apôtre saint Paul : Hoc sentite in vobis quod et in Christo Jesu. Soyez pénétrés au-dedans de vous-mêmes des sentiments qui animent le cœur de Jésus. Or, ces sentiments se résument en un seul : l’amour, et l’amour poussé jusqu’à l’immolation. C’est encore la parole de l’apôtre : « Dilexit me, et tradidit semétIpsum pro me ». Chrétiens, voilà notre modèle. Aimons-nous aussi, et sachons faire pour Dieu tous les sacrifices qu’exige le devoir. Un vil et repoussant égoïste abaisse aujourd’hui les âmes et leur enlève tout ressort.
Dilatons nos cœurs, retrempons à la véritable source l’énergie de notre caractère, et alors nous serons capables de tous les héroïsmes. Aimons Dieu, aimons les hommes, aimons la Sainte Eglise, le chef-d’œuvre de Dieu et la grande patrie des âmes. En assurant ainsi notre sanctification personnelle, nous aurons servi la société de la manière la plus noble et la plus utile. Nous aurons aidé nos frères à parvenir à l’éternelle félicité.
Après cette émouvante instruction, Sa Grandeur a procédé à la bénédiction solennelle de la première pierre du monument. Puis le vénérable prélat, armé d’un marteau orné de rubans pour la circonstance, a frappé sur la première pierre. A sa suite, les nombreux ecclésiastiques et les notables de la contrée ont défilé tour à tour pour donner aux missionnaires et à leur œuvre un témoignage public de leur sympathie.
Avec l’assistance divine le grain de sénevé deviendra, n’en doutons pas, un arbre aux dimensions colossales.
L’exécution du projet du bienheureux Père de Montfort sera, en même temps, la réalisation de la prophétie faite à ce sujet par le saint missionnaire en ce même lieu. Admirable disposition de la divine Providence ! Après deux siècles, l’heure de la justice a enfin sonné, excepté pour quelques âmes d’élite, le P. de Montfort demeurait, pour ainsi parler, sous le poids d’une sorte d’anathème ; mais voilà que la voix infaillible de Léon XIII le place au rang des bienheureux ; et tout aussitôt c’est la réhabilitation publique qui s’affirme, et la justice, pour avoir été tardive, n’en a été que plus complète. Toutefois ce qui achève vraiment ce triomphe, c’est qu’il éclate aux lieux mêmes qui furent le théâtre des humiliations les plus profondes de l’homme de Dieu. Aussi peut-on dire de lui ce qui a été dit de l’étendard de Jeanne d’Arc : Il a été à la peine, il est juste qu’il soit à l’honneur.
Mais l’honneur, pour notre grand Montfort, c’est l’honneur de Dieu, l’honneur de l’Eglise, l’honneur de la famille religieuse qu’il a fondée, et enfin celui de nos populations chrétiennes, qui lui sont, en grande partie, redevables de la conservation de la foi et des bonnes mœurs.
Sous la direction de M. Fraboulet, l’architecte de notre chapelle, et de M. Astruc, entrepreneur, le travail fut mené activement. Le granit était préparé dans plusieurs carrières à la fois, à Nantes, à Bas et à Saint-Lyphard. C’est M. l’Abbé Bertrand, curé de Saint-Lyphard, qui se chargea de nous faire préparer les belles marches de granit bleu de la Scala Sancta et de nous les faire amener par ses paroissiens. Ces chrétiens dévoués acceptèrent avec joie de faire ce travail pour l’amour de Dieu et du Père de Montfort.
Pendant la construction du Prétoire, M. Gabriel Gouraud, rédacteur de l’Espérance du Peuple, vint assister à la fêle de notre Bienheureux. Ce fut pour lui l’occasion d’un nouvel article qui trouve ici sa place :
Au Calvaire du Bienheureux Montfort
« Je désire que ce lieu, que cette chapelle soit un foyer d’où rayonne continuellement sur toute la contrée et même au loin, la lumière bienfaisante d’une foi vive et d’un ardent amour de Dieu. »
Ainsi s’exprimait, l’année dernière, Mgr l’Evêque de Nantes, dans la chapelle des Pères de la Compagnie de Marie, devant 3.000 pèlerins accourus pour célébrer la fête du bienheureux Montfort.
Le vœu du vénérable prélat s’est accompli cette année, l’empressement des fidèles ne s’est pas manifesté avec moins d’éclat, leur nombre était plus considérable encore.
Au milieu des pèlerins appartenant à toute la contrée voisine, se faisaient remarquer plusieurs paroisses venues processionnellement à la suite de leur clergé.
La paroisse d’Ambon, du diocèse de Vannes, faisait un pèlerinage d’actions de grâces pour remercier le bienheureux Montfort des guérisons obtenues l’année dernière dans la chapelle du Calvaire.
La messe du pèlerinage fut célébrée par M. le Curé de Pontchâteau, et dans l’après-midi les pèlerins se rendirent processionnellement au Calvaire, où M. l’abbé Pellerin, curé d’Herbignac, développa magistralement ces deux points : Le bienheureux Montfort a glorifié la Croix ; la Croix a glorifié le Bienheureux.
La dévotion des populations envers le bon Père Montfort n’attend pas les jours de pèlerinage pour se manifester publiquement. Chaque fois qu’un appel leur est adressé au nom du saint missionnaire, on les voit accourir avec empressement. L’érection du nouveau Chemin de Croix fournit à toutes les paroisses voisines une nouvelle occasion de montrer leur zèle et leur reconnaissance.
Le Calvaire de la Madeleine ne devait pas rester isolé : le bienheureux Montfort se proposait d’établir sur la lande qui l’entoure un Chemin de Croix monumental, destiné à reproduire exactement les différentes scènes de la Passion. Les persécutions dont il fut l’objet ne lui permirent pas de mettre ce projet à exécution.
Mgr Jacquemet, évêque de Nantes, qui avait une âme si vaillante dans un corps si débile, conçut aussi le désir de compléter et d’embellir le Calvaire. Mais cet honneur était réservé à l’un des enfants du Bienheureux, à l’un des héritiers de son zèle infatigable poulie salut des âmes.
Le R. P. Barré, supérieur du séminaire de Pontchâteau, soutenu par les bienveillants encouragements du premier pasteur du diocèse, s’est mis courageusement à l’œuvre et le plan du P. Montfort est en voie d’exécution.
Déjà, sous l’habile direction de M. Fraboulet, architecte de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, s’achève le Prétoire de Pilate sous les arcades duquel seront représentées les premières scènes de la Passion.
En confiant à M. Vallet l’exécution de ce travail considérable, le R. P. Barré a eu le bonheur de rencontrer un de ces « maîtres habiles » auxquels songeait Mgr Jacquemet.
Les fondations du Prétoire et de la Scala Sancta ont été creusées au mois de juillet dernier par les habitants de Saint-Joachim. Les pierres, qui représentent une masse énorme, ont été transportées par les habitants de Pontchâteau, de Saint-Guillaume, de Crossac, de Sainte-Reine, de Missillac, de Saint-Lyphard, de la Chapelle-des-Marais.
La semaine dernière, trois cents hommes de Missillac traçaient à travers la lande une large voie pour le pèlerinage qui doit inaugurer la première station de la Voie Douloureuse. Rien de plus touchant que le spectacle offert par ces braves gens. Ils passent au Calvaire une journée tout entière, commencée par la messe dans la chapelle des Missionnaires et terminée par le salut du Très Saint-Sacrement donné par M. le Curé.
A l’exemple de leurs pères au temps du P. Montfort, ils se délassent du travail par le chant des cantiques et la récitation du chapelet et se contentent du morceau de pain qu’ils ont apporté le matin et de l’eau qu’ils puisent à la fontaine de la Madeleine. Travailleurs volontaires et désintéressés, ils abandonnent leurs travaux et donnent généreusement la fatigue de leurs bras et la sueur de leurs fronts pour l’amour de Dieu et du P. Montfort.
Le dévouement est si grand dans toute la contrée que les femmes se plaignent que leur concours n’ait pas été accepté jusqu’ici. Que ces généreuses chrétiennes se rassurent, le moment viendra bientôt où les femmes aussi pourront apporter au Calvaire du Bienheureux leur pierre ou leur charge de terre. L’œuvre entreprise est assez considérable pour faire place à tous les dévouements.
Ceux que l’éloignement empêche de se joindre aux travailleurs, trouveront une autre façon de contribuer à l’exécution d’un plan qui doit glorifier l’Apôtre de nos provinces de l’Ouest, aux lieux mêmes où il fut si cruellement humilié.
Les scènes du Prétoire
Pendant que M. Fraboulet construisait le Prétoire, les artistes nantais préparaient les scènes qui devaient en faire l’ornement. M. Vallet travaillait au groupe de la Flagellation et M. Potet aux statues qui devaient être placées au-dessus du monument. Voici les articles publiés au sujet de ces divers travaux d’art.
La Flagellation
Tandis que l’on presse à Pontchâteau l’achèvement du Prétoire, M. Vallet donne la dernière main à l’une des scènes qui doivent le décorer. La Flagellation, telle que la représente le statuaire nantais, est un drame saisissant destiné à produire l’impression la plus salutaire.
Au premier rang des nombreux visiteurs qui ont voulu voir, même avant son entier achèvement, la nouvelle œuvre de M. Vallet, nous devons signaler Monseigneur l’Evêque de Nantes. Sa Grandeur, complètement satisfaite, n’a pas épargné à l’habile imagier les félicitations et les éloges.
Ce bas-relief monumental comprend seize personnages, tous de grandeur naturelle. Le Christ a la taille légendaire de 1 mètre 84 et cependant nous n’avons sous les yeux qu’une partie du tableau. La scène terrestre doit être complétée par une scène céleste, dont l’importance sera plus considérable encore.
Bornons-nous à dire un mot de la partie achevée. Elle est grandiose et magistralement exécutée.
Au premier plan, la divine Victime sur laquelle trois soldats romains transformés en bourreaux assouvissent leur rage impie. En arrière, une troupe de curieux, pharisiens, scribes, commerçants, et trois femmes portant des enfants dans leurs bras. Hélas ! Quand il s’agit de satisfaire une curiosité cruelle, on voit toujours des femmes. La guillotine du Bouffay avait son cortège de tricoteuses et tout dernièrement encore, quand des milliers de personnes passaient la nuit sur la place Viarmes dans l’attente d’une exécution capitale, les femmes n’étaient ni les moins nombreuses ni les moins empressées.
Ces Juifs qui se repaissent des souffrances de Jésus portent sur leur visage le reflet des passions qui les animent.
L’attitude du premier dénote l’orgueil que les leçons du Christ ont froissé. Cet autre dont les doigts crochus personnifient la rapacité et l’avarice est sans doute un de ces vendeurs impies que Jésus chassa du Temple. Celui-ci est un débauché. Ce vieillard édenté, qui a déjà un pied dans la tombe, ricane ; il s’applaudit des humiliations et des souffrances de Celui qui osait se dire le Fils de Dieu.
L’expression de ces physionomies est saisissante ; c’est bien le type juif : les bourreaux, au contraire, offrent le type romain.
Ceux-ci ont été choisis parmi les plus vigoureux de la cohorte ; les muscles énergiquement accusés indiquent une force peu ordinaire. Deux d’entre-eux frappent avec des lanières et le troisième avec des verges. Ses coups ont été si violents que son faisceau de verges s’est détaché. Le soldat baisse un genou en terre, répare l’accident en écoutant les conseils que lui adresse un des assistants.
Jésus est grand, il est fort : il lui reste assez de vigueur pour rompre ses liens et se débarrasser de ses bourreaux. Mais, victime volontaire, il veut souffrir, il veut verser son sang jusqu’à la dernière goutte pour relever l’homme déchu. D’un côté, résignation et douceur ; de l’autre, fureur bestiale. Quel contraste !
Tous les personnages sont vivants et vigoureusement traités ; on sent que la structure du corps humain n’a aucun secret pour l’artiste. Les costumes sont d’une exactitude rigoureuse et la colonne a les dimensions et la forme de celle du Prétoire. On sait, du reste, que les draperies et les vêtements, pierre d’achoppement pour tant de sculpteurs de mérite, sont le triomphe de M. Vallet.
La Flagellation (second article)
A l’occasion d’une précédente exposition, un de nos collaborateurs écrivait que M. Vallet est dans toute la plénitude de son talent. Sa nouvelle œuvre montre bien que le talent de notre compatriote progresse constamment. C’est une page éloquente qui donne une idée de ce que sera, après son achèvement complet, la Voie douloureuse de Pontchâteau.
Pour être un bon sculpteur, disait Chapu, il faut être mouleur, charpentier, menuisier et serrurier.
Notre honorable compatriote réunit-il toutes ces qualités ? Nous l’ignorons ; il est du moins ingénieur et mécanicien. Son atelier, l’un des plus importants qui existent, est aussi le mieux outillé. Les statues s’y comptent par centaines et d’innombrables bas-reliefs tapissent les murailles. Un outillage perfectionné — de l’invention de M. Vallet — simplifie le travail en réduisant les frais. Grâce à un procédé très ingénieux, les ouvrages les plus considérables sont transportés en quelques minutes du fond de l’atelier à la sortie.
Après avoir examiné le bas-relief de Pontchâteau, Monseigneur l’Evêque a voulu visiter l’atelier, dont l’installation et l’outillage l’ont vivement intéressé.
Ils intéresseront aussi nos lecteurs qui ne laisseront pas partir la Flagellation sans visiter ce beau spécimen de sculpture religieuse.
Quelques semaines après ce premier article, « l’Espérance du Peuple » en publiait un second.
La Flagellation
C’est au milieu de la semaine que le bas-relief de M. Vallet part pour Pontchâteau. Ceux de nos lecteurs qui désirent le voir feront bien de se hâter.
Ainsi que nous l’avons dit, l’œuvre du sculpteur nantais comporte deux parties ; une scène terrestre, une scène céleste. Nous avons décrit la première. La seconde, à laquelle l’artiste met la dernière main, est plus idéale, plus poétique que la première. Elle représente l’émotion produite par la Passion du Christ au milieu des milices célestes.
Trois anges planant dans l’espace établissent une sorte de transition entre la terre et le ciel. Ils contemplent les bourreaux, exécutant les ordres barbares du gouverneur romain ; leurs visages reflètent une douloureuse compassion. Le premier étend la main droite pour arrêter le bras du bourreau qui va frapper, tandis que de la main gauche il essaie de protéger la divine Victime. N’est-ce pas un mouvement instinctif? Ce détail peu important en apparence nous prouve que chez M. Vallet l’étude du modelé n’exclut pas l’observation attentive de la nature. Les deux autres Anges ont vu les lanières s’abattre sur les épaules du Fils de Dieu, enlever les lambeaux de sa chair et faire jaillir son sang : ils sont abîmés dans la douleur.
Plus haut nous apparaît la Cour céleste dans une enceinte de légers nuages. Dieu le Père est assis sur un trône où l’on remarque vides les places des deux autres personnes de la Trinité. L’Esprit-Saint est représenté sous la forme d’une colombe, et Dieu le Fils est sur la terre livré aux humiliantes tortures qui auront pour dénouement le supplice du Calvaire.
Autour du trône se pressent d’innombrables multitudes d’anges. Ceux du premier plan supplient l’Eternel de délivrer son Fils et attendent l’ordre de châtier les bourreaux. Quand Judas pénétra dans le jardin des Olives, à la tête d’une bande soudoyée par les juifs, Pierre, tirant son épée, en frappa le serviteur du Grand Prêtre. Jésus lui dit : Remettez votre épée dans le fourreau. Si je priais mon Père, il m’enverrait plus de douze légions d’anges. Mais comment s’accompliraient les Ecritures qui ont annoncé toutes ces choses.
Dieu le Père écoute impassible les supplications des Esprits célestes; son œil plonge dans l’immensité, suivant le déroulement des siècles, et contemple les miracles d’héroïsme et de vertu qu’opérera jusqu’à la fin Ides temps la vertu toute puissante du sang de Jésus, Christ.
Comment s’accompliront les Ecritures ? Dieu refuse le faire le signe qu’attendent les Anges, il laisse s’accomplir les tortures de la Voie douloureuse et du Calvaire, Il veut racheter les hommes même, en livrant son Fils à la mort ignominieuse de la croix. Cette scène grandiose présentait des difficultés sérieuses, dont l’artiste a heureusement triomphé. Malgré la variété des attitudes, l’harmonie de l’ensemble est parfaite.
La scène céleste est bien le complément de cette scène terrestre que Mgr le Coq apprécie en ces termes : « Ce groupe de la Flagellation, vrai chef-d’œuvre d’un artiste nantais ».
Nous aurions mauvaise grâce de rien ajouter après un éloge aussi flatteur et aussi autorisé.
Au Calvaire de Pontchâteau
Dans un voyage que nous faisions ces jours derniers à Pontchâteau, nous avons vu l’heureux commencement de la grande œuvre entreprise par le R. Père Barré, supérieur des Missionnaires du Calvaire.
A environ 200 mètres du Calvaire, près de la source miraculeuse, s’élève un magnifique monument d’ordre composite, qui atteint jusqu’à 16 mètres de hauteur ; le soubassement de forme rectangulaire a environ 30 mètres de longueur sur 7 de largeur. Ce monument représente le Prétoire dans lequel fut jugé le Christ. On y monte par deux larges escaliers qui donnent accès à un vestibule diptère, de mêmes dimensions que le soubassement ; l’escalier principal a 5 mètres de largeur. C’est la Scala Sancta qui rappelle celui que descendit le Christ condamné se rendant au Calvaire. On monte par 28 degrés à l’arcade principale qui supporte un fronton sur lequel sont sculptées en relief les armoiries de la Communauté ; une couronne d’épines dans laquelle sont artistement entrelacés le fouet et le roseau.
Un autel sera dressé sous ce péristyle, de chaque côté duquel s’élèvent quatre arcades contiguës et de plein-centre s’appuyant sur des pieds droits décorés de colonnes d’ordre corinthien, supportant l’entablement. Ces colonnes sont surmontées de huit magnifiques chapiteaux.
La sculpture en est remarquable ; chaque clef voussoir est revêtue d’une acanthe d’un galbe souple et énergique. Chacune de ces arcades, de 4 mètres de diamètre, est surmontée de voûtes cylindriques ou coupoles renforcées de 4 arcs-doubleaux dont les huit nervures viennent s’amortir sur des culots-consoles sculptés dans le même brio que les ornements précédents. Les bernes divergentes de ces voûtes à compartiments dont la douelle est enrichie de peintures et de sculptures donnent naissance, à leur point d’intersection, à 5 clefs de voûte pendantes de style néo-grec ; elles sont ornées de cul-de-lampe sur lesquels sont sculptées les armes du Pape, de différents évêques et de la communauté. Chaque arcade a une contre-arcade murée, destinée à recevoir des bas-reliefs représentant : le jugement, la flagellation, le couronnement d’épines et l’Ecce Homo. Sur la frise de l’entablement sont gravés ces mots en regard avec chaque sujet :
Apprehendit Pilatus Jesum, Et flagellavit. Pectentes coronam de spinis. Imposuerunt capti ejus. Tradidit ut crucifigeretur.
La corniche de couronnement supporte une balustrade à jour qui termine le monument et est d’un très bel effet.
Le plan de ce magnifique monument est dû à un de nos architectes distingués. M. Fraboulet ; nous avions depuis longtemps apprécié cet habile architecte, nous le félicitons de nouveau d’avoir fait une innovation dans ce genre religieux en sacrifiant le style romain dont on abuse tous les jours, et d’avoir su cependant donner un cachet en même temps religieux et poétique à ce monument qui rappelle tant soit peu les temples grecs ou romains.
M. Astruc, de Pontchâteau, à qui fut confiée l’exécution de cet important travail, mérite aussi tous nos éloges pour le soin qu’il y a apporté.
Au reste, rien ne saurait mieux caractériser l’art religieux et expliquer d’une manière plus vivante les mystères de la Passion que les Anges qui couronnent l’édifice. Leur attitude, leurs gestes, leur expression expriment parfaitement le sentiment de la douleur.
Le premier à gauche, le regard fixé dans l’infini, enveloppe d’une main le bois de la lance dans les plis de son manteau, tandis que de l’autre, il la tient serrée contre lui. Le second semble accablé sous le poids de l’ignominie que dut ressentir le Christ en se voyant dépouillé de ses vêtements, pour subir le supplice de la flagellation dont l’ange porte les instruments. Avec quelle hardiesse l’artiste a gravé ce regard de compassion que jette ce séraphin sur la couronne d’épines qu’il tient si pieusement de ses deux mains. Rien n’est plus simple, plus expressif que cet ange qui, s’abandonnant tout entier à sa douleur, regarde sans les voir, les yeux voilés par les pleurs, les clous et le marteau qu’il tient à la main. Excellent d’allure celui qui, détournant les regards du vase d’amertume qu’il semble vouloir éloignerai enveloppe dans les plis de son châle le bois de la lance auquel est fixée l’éponge. On se sent pénétré de douleur à la vue de l’abattement de cet autre qui drape comme d’un suaire, dans les longs plis de son long manteau, cette croix en laquelle il cherche l’appui qui lui est nécessaire dans sa douleur; de sa main gauche, qu’il laisse retomber, s’échappe l’écriteau que dans leur haine dérisoire les juifs apposèrent au haut de cette croix.
Les anges, au nombre de six, de grandeur naturelle, ainsi que l’ornementation sculpturale de ce monument, sont l’œuvre de M. Potet, artiste consciencieux, dont le talent seul fait la réputation.
Le Christ du Bienheureux de Montfort
Nous avons le bonheur de posséder au Calvaire le Christ que le Bienheureux avait placé sur la principale croix. Je demandai à Monseigneur à le faire porter triomphalement par les hommes le jour de la bénédiction du Prétoire. — « C’est une excellente idée, me répondit Sa Grandeur, cette cérémonie sera d’un grand effet et nous attirera beaucoup de monde. »
Pour la préparer, le Révérend Père Grolleau publia l’article suivant dans la Semaine religieuse de Nantes.
Le Christ du B. Montfort au Calvaire de Pontchâteau
Nous avons annoncé déjà qu’on préparait, pour le 24 juin, une grande fête au Calvaire de Pontchâteau, et qu’on devait y porter en triomphe un Christ, le Christ du bienheureux Père de Montfort.
Nous croyons être agréable à nos lecteurs en faisant passer sous leurs yeux les différents souvenirs qui se rattachent à cette relique insigne.
Ceux d’entre eux, et le nombre en est grand, qui comptent assister à cette belle manifestation religieuse, présidée par Mgr l’Evêque de Nantes, y trouveront un aliment à leur piété.
Le Christ, de grandeur naturelle, sans être une œuvre d’art, ne manque pas d’expression, et cette expression c’est celle de la bonté et de la miséricorde infinies, qu’on lit dans tous les traits, et que disent aussi les bras largement étendus.
On sait que l’hérésie jansénienne s’appliquait à donner à l’image du Rédempteur une expression toute différente.
Nous sommes en 1707, en pleine lutte du jansénisme contre l’Eglise.
Montfort, encore au début de sa vie apostolique, fait partie, à Saint-Brieuc, d’une compagnie de missionnaires qui ne semble pas avoir résisté suffisamment aux influences de la secte. Celui qui a reçu ordre du Souverain Pontife lui-même, de courir partout sus à l’affreuse hérésie, ne restera pas longtemps dans cette société. Il en sera bientôt exclu sous un prétexte futile.
Or, la commande du Christ dont nous parlons, avait été faite à un artiste de la ville, par cette Compagnie elle-même. On a dit que Montfort, artiste lui aussi avait mis la dernière main à celte œuvre.
Ce qui est au moins hors de doute, c’est que le sculpteur de Saint-Brieuc avait travaillé sous son inspiration.
Les mêmes raisons qui amenèrent l’exclusion de Montfort de la Société, firent que celle-ci refusa, presque en même temps, le travail qu’elle avait commandé.
Montfort fait une quête dans la ville et réunit 80 livres qui, selon l’intention des pieux donateurs, le rendent possesseur du Christ rejeté.
Quelques semaines après, le saint missionnaire était obligé de quitter le diocèse de Saint-Brieuc. Son Christ l’accompagnait. Ce n’est que le commencement des exils et des proscriptions que doivent subir ensemble le maître et le serviteur, en attendant le triomphe.
Vers la fin de la même année 1707, le vaillant apôtre évangélisa sa ville natale, Montfort, au diocèse de Saint-Malo.
Il croit le moment venu d’exécuter le monument qu’il a conçu, en l’honneur de Jésus crucifié, pendant son séjour au Mont-Valérien.
Les travaux sont, un moment, poussés avec vigueur, mais bientôt interrompus, avant que s’élève la croix d’où son Christ eût dominé l’humble cité qui a vu naître notre Bienheureux. Les mêmes influences qui l’ont éloigné du diocèse de Saint-Brieuc ne lui permettent pas de rester plus longtemps dans le diocèse de Saint-Malo ; et il en sort avec son Christ, dont sa ville natale elle-même n’a pas voulu.
Une année s’écoule encore. C’est le diocèse de Nantes qui est le théâtre des missions de Montfort. Nulle part, sa voix ne trouve plus d’écho qu’à Pontchâteau. C’est cette voix qui assemble et qui anime, sur la lande déserte de la Madeleine, ces milliers d’ouvriers volontaires, pour accomplir le travail immense que l’on sait. Montfort est là, mais il y est avec son Christ. Dès le commencement des travaux, il l’a fait placer dans une grotte souterraine, où on ne le voit qu’à la lueur d’une faible lampe. Chaque soir, après les rudes fatigues de la journée, la grande récompense pour les pieux travailleurs, est de pouvoir s’agenouiller, les uns après les autres, devant la pieuse image, dont la seule vue fait naître les sentiments les meilleurs et couler bien des larmes.
Cependant le jour est venu, où le Christ apparaît sur la croix monumentale élevée au-dessus de la sainte montagne, d’où elle domine toute la contrée. On est à la veille de cette grande fête, préparée de longue main par le saint missionnaire, et à laquelle accourent de toutes parts des foules qui glorifieront, qui acclameront son Christ, (l’est à cette heure-là même que, d’après un ordre arraché à la Cour par les jansénistes, défense est faite à Montfort de bénir sou Calvaire. Ce n’est pas assez. Quelques jours après, ordre était donné de le détruire tout entier.
Il faut recourir à la force armée.
Toute une compagnie de soldats entoure la sainte montagne. On a réquisitionné dans les alentours tous les hommes valides.
Ce que l’on demande à ces braves gens c’est de renverser ce que leurs mains pieuses-ont édifié avec tant d’ardeur.
Ils ne s’y décideront jamais. Pendant trois jours, injures, menaces, mauvais traitements même sont employés en pure perte. C’est alors que le commandant s’avise d’un stratagème. Il ordonne aux soldats de scier le pied de la croix. Le Christ vénéré va être brisé dans la chute. C’est alors que les bons paysans s’offrent pour le descendre eux-mêmes. Alors aussi a lieu la scène la plus touchante.
Pendant que les uns remplissent pieusement l’office de Joseph et de Nicodème, tous les autres sont à genoux, prosternés sur la lande, la plupart fondant en larmes. Le commandant lui-même ne peut maîtriser son émotion. « Jamais, dit-il, on ne vit représentation plus vraie de la grande scène du Calvaire ».
Peu de temps après on ordonne au saint missionnaire, à qui tout ministère est interdit dans le diocèse de Nantes, de faire venir de Pontchâteau, où on les a déposés chez un saint prêtre, M. de la Carrière, son Christ et ses autres statues du Calvaire. Sans doute, on voulait lui ôter tout prétexte de reparaître dans la contrée.
Montfort, toujours obéissant, charge de la commission son frère Nicolas, et lui remet une lettre pour M. de la Carrière. Il y dit formellement, avec l’assurance du prophète, que si l’obéissance exige que son Christ soit transporté à Nantes, ce ne sera que pour retourner avec plus de gloire au Calvaire, lorsque la chapelle sera bâtie.
Toutefois, M. de la Carrière ne se rendit pas aux instances de cette lettre. L’homme de Dieu dut venir lui-même chercher son Christ, quatre ans après, en octobre 1714. Il le fit transporter avec les autres statues, en charrette, jusqu’au bord de la Loire. C’est là que, ne pouvant se faire aider par les bateliers qui ne lui répondaient que par des injures et des railleries, on le vit seul, dans un marais où il y avait de l’eau et de la boue jusqu’à mi-jambe, porter, sur ses épaules, jusqu’à la barque, son pieux fardeau.
A Nantes, Montfort fait déposer son Christ dans sa chapelle de Notre-Dame du Calvaire, aux Incurables. Il y est entouré de la vénération des fidèles ; mais ce n’est pas la glorification prédite et qui l’attend.
Une quinzaine d’années plus tard, à la suite d’une mission donnée à Saint-Similien, le Père Mulot, premier successeur de Montfort, obtient d’emporter son Christ à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Vingt ans après, les fils de Montfort viennent donner une mission à Pontchâteau, ils entreprennent la restauration de l’œuvre de leur Père. Le Père Mulot y trouve dans la population le même élan qu’y avait trouvé Montfort lui-même. Mgr de la Muzanchère, aux applaudissements de tous, ordonne le transfert des statues de Sainte Madeleine et des deux Larrons, pour l’ornement du Calvaire restauré. Bien plus, d’après ses intentions les missionnaires doivent avoir là une résidence. La chapelle qu’ils doivent desservir est déjà construite au pied du Calvaire.
Il semblerait un moment que l’heure de la glorification prédite est venue. Mais non ! La secte jansénienne n’a point désarmé. Elle poursuit de sa haine les fils, comme elle a poursuivi le Père, et les force bientôt à s’éloigner.
Descendues dans la chapelle du Calvaire, les statues deviennent la proie des flammes en quatre-vingt-treize. Le Christ seul est sauvé à Saint-Laurent. Enfin, en 1821, M. Gouray, curé de Pontchâteau, entreprend et mène à fin, avec un zèle admirable, une seconde restauration du Calvaire du bienheureux Montfort. A sa prière le R. P. Deshayes, supérieur général des Communautés de Saint-Laurent, consent à ce que le précieux Christ aille y reprendre sa place.
Prévoyait-il que les temps approchaient où les enfants de Montfort allaient définitivement être commis à sa garde. C’est en 1866 que Mgr Jacquemet fonda au Calvaire une résidence de Pères de la Compagnie de Marie. Des circonstances spéciales en font bientôt un établissement considérable.
Montfort a non seulement là ses fils, mais aussi ses Filles de la Sagesse.
Le jour à lui où le serviteur de Dieu a été placé sur les autels. De tous côtés, des fêtes solennelles ont lieu en son honneur.
Mais Monseigneur l’Evêque de Nantes, dont la protection et la bienveillance sont depuis si longtemps déjà acquises à la double famille du Bienheureux, a voulu que nulle part, s’il était possible, le nom de Montfort ne fut plus acclamé, plus glorifié, qu’au pied de ce Calvaire, où il avait été abreuvé de tant d’humiliations.
Le souvenir des fêtes tout à la fois si pieuses et si grandioses de 1888 est encore présent. La journée du 24 juin les continuera.
Avec quelle joie, du haut du ciel, le bienheureux de Montfort verra le commencement de la glorification de son Christ, produite pour lui avec tant d’assurance.
Puissent des projets, hardis sans doute, mais qui ne peuvent manquer de réussir, encouragés et bénis par l’autorité épiscopale, bénis aussi, du haut du ciel, par Montfort, se réaliser bientôt ; et cette glorification sera complète.
L. GROLLEAU.
Le Prétoire et la Scala Sancta
Après l’article sur le Christ du Bienheureux de Montfort, la Semaine religieuse de Nantes en publia un second sur le Prétoire et la Scala Sancta. Nous allons le reproduire.
Au Calvaire de Pontchâteau – Le Prétoire et la Scala Sancta
La soirée de la fête du 24 Juin, au Calvaire de Pontchâteau, verra, nous l’avons dit, le triomphe du Christ du B. Montfort, dont nous avons parlé dans notre dernier numéro.
La matinée du même jour sera remplie par la bénédiction solennelle d’un nouveau monument que nous devons faire connaître à nos lecteurs.
Le Prétoire de Pilate fut, on le sait, pour N.-S. J.-C, la première station de sa voie douloureuse. C’est là qu’il fut interrogé, puis flagellé, couronné d’épines, et condamné à mort. C’est là que le gouverneur romain le montra au peuple en disant : Voilà l’homme, Ecce Homo.
Le nouveau monument, construit pour représenter le Prétoire de Pilate, s’élève au bas de la lande de la Madeleine, non loin de la fontaine bien connue des pèlerins.
La distance qui le sépare du Calvaire est la même qui se trouve à Jérusalem, entre les ruines de l’ancien Prétoire et le Golgotha.
La façade, en style grec, se compose de cinq grandes arcades de six mètres d’élévation et présente un aspect vraiment imposant. Le toit forme une terrasse entourée d’une balustrade du plus bel effet. Au-dessus de cette balustrade et sur chacun des piliers des arcades, six anges présentent les divers attributs de la Passion.
La croix domine tout, sur un léger fronton ; et dans le tympan de ce fronton est sculptée la couronne d’épines avec le roseau et les fouets.
Dans l’arcade du milieu, ou plutôt, sous la coupole qui y correspond, est placé l’autel du pèlerinage, dans des conditions telles qu’en supposant les plus grandes foules, tous pourront suivre des yeux les cérémonies de la sainte messe.
Sous les quatre autres coupoles, doivent être représentées en groupes sculptés, de grandeur naturelle, les grandes scènes dont nous avons parlé plus haut : l’interrogatoire, la flagellation, le couronnement d’épines, la condamnation à mort. Le jour de la fête, on ne pourra voir que le groupe de la flagellation.
La Scala Sancta véritable n’est autre que l’escalier qui donnait accès au Prétoire de Pilate. II se composait de vingt-huit marches, toutes conservées à Rome précieusement. N.-S. les monta pour être jugé. Il les descendit pour aller au Calvaire.
L’escalier monumental qui monte au nouveau Prétoire compte aussi vingt-huit marches, en beau granit bleu, et auxquelles seront attachées les mêmes indulgences qu’on peut gagner à Rome en montant à genoux les degrés de la véritable Scala Sancta.
Tel est le monument, unique en son genre, croyons-nous, qui, dans la matinée du 24 Juin, recevra une consécration solennelle des mains de Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Nantes, avant qu’il y célèbre lui-même les saints mystères.
Ce n’est, on le voit, que le commencement d’exécution d’un vaste plan, qui remonte au Bienheureux Montfort lui-même.
On verra marqué, par de simples croix, l’emplacement des autres monuments qui, selon sa parole prophétique, doivent faire de la lande de la Madeleine une autre Jérusalem, où viendront, en foule, ceux qui ne peuvent traverser les mers, pour faire le pèlerinage des Saints Lieux.
On sait quel élan et quelle générosité trouva Montfort, dans cette contrée, chez les ancêtres. On croit pouvoir compter sur le même élan et la même générosité, chez les descendants, qu’il n’a jamais cessé de protéger.
Une quinzaine de jours avant la Bénédiction du Prétoire et l’Inauguration de la Scala Sancta, Monseigneur l’Evêque de Nantes adressa la Lettre suivante au Clergé et aux Fidèles de son Diocèse.
Lettre Circulaire de Monseigneur l’Evêque de Nantes
annonçant un nouveau pèlerinage au Calvaire de Pontchâteau
† Jules-François Lecoq,
par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège Apostolique,
Evêque de Nantes, assistant au trône pontifical, comte romain.
Au Clergé et aux Fidèles de notre Diocèse,
Salut et Bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Le Calvaire de Pontchâteau, Nos Très Chers Frères, ne vous est pas inconnu, Plus d’une fois sa touchante et dramatique histoire vous a été racontée. Dans le cours de son existence, qui ne compte pas encore deux siècles, que d’étonnants contrastes !
Une première fois il se dresse majestueusement aux applaudissements d’une foule ravie ; bientôt après, au milieu de la désolation universelle, il est violemment renversé. Dans la suite, comme dès son début, il aura ses heures de joie et ses heures de deuil, ses jours d’humiliation et ses jours de gloire. C’est l’un de ces jours sereins et radieux, qui, nous l’espérons, va bientôt se lever de nouveau sur la Sainte colline. La Sainte colline ! Qu’elle mérite bien ce nom ! Sainte en effet dans son principe générateur, sainte dans la matière même dont elle fut formée, sainte dans sa sublime destination. Ce n’est pas aux forces de la nature que nous la devons, mais bien au génie inspiré et prodigieusement fécond du Bienheureux Louis-Marie de Montfort. De sa parole ardente et vive comme la flamme, il sut électriser les populations d’alentour. A son appel, toutes se levèrent et accoururent au lieu indiqué. Qu’il fut beau le spectacle de ces vaillants chrétiens groupés, en légions pacifiques, autour de l’intrépide Missionnaire, pour le seconder dans l’accomplissement de son gigantesque dessein ! Avec quel élan on se mit à l’œuvre ! Aucun obstacle ne parut insurmontable. Aucune fatigue ne sembla trop pénible. Du matin au soir, sous la pluie, sous les frimas, au bruit de l’orage et parmi les rudes assauts de la tempête, on travaillait sans relâche, on priait sans cesse, on chantait toujours ; et les anges écoutaient, et la colline, couches par couches, s’élevait ; mais chacune de ces assises était successivement et abondamment trempée de cette sueur de bon ouvrier que Dieu, notre commun et tendre père, ne voit jamais couler sans en être ému, et qu’il place, dans son estime, immédiatement après le sang héroïque versé par le martyr et le soldat pour la défense de la foi et de la patrie.
La voilà maintenant debout, cette colline tant désirée ! De tous les points du large horizon qui l’entoure on peut aisément l’apercevoir. C’est le magnifique piédestal sur lequel doit bientôt apparaître la croix !
Ce coin de terre, jadis obscur, sera désormais célèbre. Il n’a à redouter ni l’indifférence, ni l’oubli. Tout doit changer à ses côtés : les institutions, les idées et les mœurs. Il n’en restera pas moins un lieu manifestement favorisé du ciel. Le peuple chrétien l’entourera constamment de sa vénération. Des multitudes d’âmes sont venues y prier avec ferveur, surtout aux époques les plus sinistres et les plus douloureuses ; et de nos jours, N. T. C. F., si la béatification du Père de Montfort a pour jamais illustré son tombeau, n’a-t-elle pas aussi fait briller d’un plus vif éclat son grand et immortel calvaire ? Ah! Son calvaire ! Comme il l’aima! Il ‘aime toujours. Pourrait-on croire que du haut du ciel, il ne regarde pas d’un œil de complaisance, tout ce qui se fait encore pour réaliser pleinement son idéal et compléter une œuvre si chère à son cœur ? Oui, c’est avec une sorte d’allégresse que du sein même de l’éternel bonheur, il contemple et cette Scala Sancta, monument grandiose, d’une si noble architecture ; et ce groupe de la flagellation, vrai chef-d’œuvre d’un artiste nantais, et ces anges de la passion, d’une attitude et d’une physionomie si expressive ; et enfin cette voie, souvenir de la voie douloureuse suivie par Notre-Seigneur allant du Prétoire au Golgotha, mais qui, transfigurée par la loi et l’amour, va devenir une voie triomphale.
Vous viendrez aussi nombreux que possible, N. T. C. F., inaugurer solennellement avec nous toutes ces pieuses merveilles. Ensemble nous parcourrons les diverses stations où Jésus eut à subir quelque nouvel outrage ou quelque nouveau tourment, en se rendant au lieu de son supplice : nous nous croirons à Jérusalem, pour y compatir, avec la Très Sainte Vierge Marie, aux ineffables douleurs de Jésus battu de verges, de Jésus couronné d’épines, de Jésus abreuvé de fiel, de Jésus percé de clous, de Jésus outragé, de Jésus abandonné de Dieu et des hommes, de Jésus enfin expirant sur la croix. C’est à ses pieds que nous nous arrêterons, pour y recueillir quelques gouttes de ce sang qui a sauvé le monde. C’est là que nous redirons, d’une même voix et d’un même cœur : O crux ave, spes unica. Salut, salut, ô croix, vous êtes notre unique espérance. Sans vous et loin de vous, il n’y a que ténèbres, illusions, désordre, misères profondes, chutes lamentables et irréparables malheurs. O crux, ave, spes unica.
O croix ! Vous êtes le flambeau destiné à guider notre marche à travers les flots sombres et tumultueux. Heureux celui qui s’avance les yeux toujours fixés sur vous; il passera, sans s’y briser, au milieu des écueils et arrivera heureusement au port.
O croix ! Vous êtes l’étendard du Roi des Rois. Vexilla Régis prodeunt, A l’ombre de vos plis glorieux, les armées du Christ, les Justes, les Saints ont combattu et remporté la victoire. Abrités par vous, nous lutterons à notre tour ; fermes et courageux, nous saurons triompher aussi du siècle pervers, de sa mollesse, de ses attraits, de ses perfidies, de ses trompeuses promesses comme de ses menaces vaines et impuissantes. In hoc signo vinces.
O croix ! O plaies de Jésus ! Vous êtes la source largement ouverte d’où coulent les eaux limpides et pures dont la fraîcheur peut seul apaiser la soif du voyageur qui traverse, haletant et épuisé, le désert aride de la vie. Haurietis aquas in gaudio de fontibus salvatoris.
Plus la croix sera connue, aimée, adorée, et plus l’homme aura le sentiment de sa valeur personnelle et de sa propre dignité ; plus il trouvera conséquemment en lui de vigueur morale et de puissante énergie pour se dégager des étreintes du mal et faire fleurir librement dans son âme les grandes et solides vertus.
Plus la croix sera connue, aimée, adorée, et plus le foyer domestique sera calme et honnête; plus les classes sociales, trop souvent hostiles, se rapprocheront dans les liens de la concorde et de la paix. Ah ! C’est de la croix et uniquement de la croix que descend la vraie fraternité. Au riche, elle inspire le détachement, l’esprit de sacrifice, la tendresse généreuse envers tous ceux qui travaillent, qui souffrent et gémissent au-dessous de lui. Le pauvre, de son côté, quand il regarde avec foi sur la croix son Sauveur et son Dieu, sent expirer ou au moins s’apaiser peu à peu au fond de sa poitrine en feu, les ardentes cupidités et les formidables colères. Il se résigne plus facilement à porter son lourd fardeau, en voyant comment Jésus a consenti à porter joyeusement le sien, quoique bien plus lourd encore. Jésus, proposito sibi gaudio sustinuit crucem.
Qu’on y songe et qu’on le comprenne bien, N. T. C. F. ; ni les découvertes de la science, ni le progrès matériel, ni les combinaisons les plus heureuses de l’économie politique, ni les lois les plus sages, ni la force qui réprime, ni le glaive qui se dresse, non, rien ne remplacera dans l’œuvre de la pacification des cœurs la vertu de la croix. Elle seule, avec ses suaves et divines effusions, peut, en effet, pénétrer jusqu’aux racines du mal et le guérir. In cruce infusio supernæ suavitatis.
Que penser donc de ces hommes qui méprisent la croix, qui la détestent, qui la proscrivent, qui voudraient en faire disparaître jusqu’aux derniers vestiges ? Ces hommes-là, saint Paul les connaissait déjà bien. Il les signalait aux fidèles ; en les signalant et les flétrissant il pleurait ; car, disait-il, ils vont à leur perte. Ajoutons, N. T. C. F., qu’ils sont, sans le savoir peut-être, les pires ennemis de leurs pays, de leurs semblables et de l’humanité ! Multi ambulant quos sæpe dicebam vobis, nunc autem et flens dico, inimicos crucis Christi : quorum finis interitus, quorum deus venter est, qui terrena sapiunt. (Phil., III, 18).
Pour vous. N. T. C. F., vous êtes par la grâce de Dieu, des chrétiens sincères. Dès votre enfance, vous avez connu et adoré la croix ; avec votre mère, vous vous êtes agenouillés devant elle. Elle est le plus auguste objet de votre foi où s’alimente votre charité.
Vous voulez qu’elle soit entre vos mains défaillantes, à l’heure de votre agonie ; vous voulez qu’elle protège vos tombes comme elle a protégé vos berceaux. C’est donc bien entrer dans vos vues que de vous dire : attachez-vous de plus en plus à la croix : multipliez en son honneur les pèlerinages et les fêtes, saluez-la toujours comme le soldat salue son drapeau, chantez ses triomphes ; faites des vœux pour que nos missionnaires puissent la porter au-delà des montagnes, au-delà des déserts, au-delà des océans, sur toutes les plages du monde. Jésus crucifié ne sera pas insensible à de tels hommages. Du haut de son calvaire il vous bénira ; et avec cette bénédiction, vous partagerez volontiers ses opprobres et ses souffrances.
Et après avoir bu à son calice amer, vous boirez à longs traits au calice de son éternelle gloire et de ses éternelles félicités.
A ces Causes :
Après en avoir conféré avec nos vénérables Frères, les Dignitaires, Chanoines et Chapitre de notre Eglise Cathédrale.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article premier. — Le mercredi 24 juin, à l’occasion de l’inauguration solennelle de la Scala Sancta, un pèlerinage, auquel sont invités les prêtres et les fidèles du diocèse, aura lieu au calvaire de Pontchâteau.
Art. 2. — L’organisation et la direction de ce pèlerinage, comme aussi de tous les pèlerinages qui se feront ultérieurement à ce même calvaire, est et demeure exclusivement confiée au Supérieur de la Maison des Pères de la Compagnie de Marie, ces dignes enfants du Bienheureux de Montfort, héritiers de son esprit, gardiens naturels de ses œuvres et de ses traditions.
Art. 3. — Pour assurer l’ordre et la dignité de ces pèlerinages, que nous désirons voir se multiplier de plus en plus, aucune paroisse ne devra se rendre processionnellement au calvaire avant que M. le Curé de cette paroisse n’ait préalablement averti le Père Directeur du jour et de l’heure de son arrivée.
Art. 4. — MM. les Curés qui ne pourront prendre part au pèlerinage du 24 juin sont autorisés à faire, ce même jour, à l’heure jugée la plus opportune, chacun dans leurs paroisses respectives, une procession à l’une des croix érigées dans le voisinage de leur église. Pendant cette procession on chantera l’hymne Vexilla régis et quelques cantiques appropriés à la circonstance.
Art. 5. —Au retour de cette procession, on donnera avec l’ostensoir la bénédiction du Très Saint-Sacrement, et immédiatement avant le chœur du Tantum ergo, on récitera cinq Pater et cinq Ave aux intentions du Souverain Pontife et en union avec les pieux pèlerins.
Et sera notre présent Mandement, ainsi que la Lettre circulaire qui le précède, lu et publié dans toutes les églises et chapelles publiques de notre diocèse, le dimanche qui en suivra la réception.
Donné à Nantes, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contreseing du Secrétaire général de notre Evêché, en la solennité de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le dimanche 7 juin de l’an de grâce 1891.
† JULES. Evêque de Nantes.
Par Mandement de Monseigneur :
J. BOSSÉ. Ch. Sec. gén.
Fête du 24 juin 1892
Au Calvaire du Bienheureux de Montfort.
Annonçant à tout son diocèse le pèlerinage du 24 juin1, Monseigneur l’Evêque de Nantes rappelait que dans sa touchante et dramatique histoire, qui ne compte pas encore deux siècles, le Calvaire du Bienheureux de Montfort avait eu ses heures de joies et ses heures de deuil, ses jours d’humiliation et ses jours de gloire. Puis il ajoutait : c’est l’un de ces jours sereins et radieux qui, nous l’espérons, va bientôt se lever sur la sainte colline. »
Cette espérance, nous l’avions tous. Mais elle devait pourtant avoir son moment d’épreuve, lorsque dans la soirée du 23 juin, tandis qu’on activait, avec le plus d’ardeur, les préparatifs de la fête du lendemain, nous vîmes tout à coup les nuages s’amonceler de tous les points de l’horizon, au-dessus de la lande de la Madeleine. L’orage éclate bientôt et fait entendre ses sourds grondements, suivis d’une pluie torrentielle, qui ne semble pas devoir finir.
Cependant Monseigneur est arrivé au Calvaire ; et quelques heures après, le temps s’est suffisamment éclairci pour lui permettre de remonter au haut de la lande et d’y allumer le feu de joie préparé pour son arrivée.
De là, la lueur des flammes pétillantes est vue au loin ; elle annonce à toutes les populations d’alentour la présence du premier Pasteur. Détail imprévu, mais qui s’explique, parce qu’on est à la veille de la fête de saint Jean-Baptiste, de nombreux autres feux semblent répondre, des divers points de l’horizon, au signal donné du Calvaire.
Le lendemain, le soleil se lève vraiment radieux. L’orage de la veille ne paraît être venu que pour rafraîchir le sol. Nous n’aurons pas à craindre les nuages de poussière, et l’on peut voir que les décorations n’ont aucunement souffert.
Le parcours de la grande procession forme un vaste cercle embrassant tout l’espace qui sépare le nouveau monument du calvaire. C’est la voie triomphale. Elle portera désormais ce nom, par opposition à la voie douloureuse qui va plus directement du Prétoire au Calvaire.
Elle est marquée, en ce moment, par des mâts vénitiens plantés de distance en distance, et au sommet desquels flottent au vent des flammes multicolores.
Nous voudrions pouvoir compter tous les arcs de triomphe dont elle est ornée et n’en omettre aucun.
Toute la décoration si gracieuse et si remarquée de cette allée que va suivre Sa Grandeur, pour se rendre au nouveau monument, est due à la paroisse de Saint-Lyphard.
Sur la même voie, tout près de la Fontaine légendaire, Crossac a élevé ses deux arcs de triomphe, dont l’élégance et le bon goût décèlent la main d’un artiste.
Sur la grande voie, voici les arcs de triomphe de Saint-Joachim, de Campbon, de Missillac, de Sainte Reine, de Saint-Guillaume. Il en est d’autres que l’on doit à la piété discrète de plusieurs familles de Pontchâteau.
Sur le point le plus élevé de la lande, se dresse fièrement une porte de château moyen-âge, avec ses deux tours crénelées. On lit sur un écusson, ces simples paroles : Haïti à Montfort. C’est une prière que les futurs apôtres de cette île, abrités au Calvaire, font monter aujourd’hui vers le Ciel au milieu de la crise nouvelle que traverse leur chère mission. Puisse-t-elle être exaucée !
N’oublions pas la décoration de la chapelle du pèlerinage, dont toutes les lignes architecturales si élégantes sont marquées aujourd’hui par des guirlandes de feuillage d’une légèreté aérienne.
Quant au nouveau monument, dont on a déjà lu la description, il apparaît au bas de la lande sans autre parure que celle que lui ont faite la main et le ciseau des artistes, parure dont la blancheur immaculée resplendit, en ce moment, aux rayons du soleil levant.
L’office du matin a été fixé à 9 heures 1/2. Dès 9 heures, le son du clairon annonce l’arrivée d’une paroisse qui la première, conduite par son clergé avec sa croix et sa bannière, se dirige par la voie triomphale, vers la Scala Sancta. Bientôt une seconde la suit, puis une troisième, puis vingt autres. Nous les compterons plus facilement, ce soir, au triomphe du Christ, où aucune ne manquera.
1Voir le numéro d’Avril dernier.
Dans tous les rangs, ce sont les cantiques du Bienheureux P. de Montfort : Vive Jésus ! vive sa Croix! Chers amis tressaillons d’allégresse…, ou quelqu’un des chants nouveaux, composés en son honneur, que l’on redit avec un entrain et un enthousiasme indescriptibles.
Bientôt, c’est une foule de quinze à vingt mille personnes rangées en ordre autour du nouveau Prétoire.
C’est alors que, par l’autre voie dont nous avons parlé, apparaît Sa Grandeur, escortée d’environ deux cents prêtres, en habits de chœur. Monseigneur est assisté par M. l’abbé Marchais, vicaire général, MM. Brelet et Guihar, chanoines de la Cathédrale de Nantes.
On remarque dans le cortège le R. P. Chasserieau, premier assistant de la Compagnie de Marie, représentant le Supérieur général, M. le Curé de Saint-Nicolas de Nantes, M. le Curé de Pontchâteau, M. le Curé de Château-Chinon.
Le diocèse de Rennes est représenté par M. l’abbé Gendron, chanoine de la Cathédrale, M. le Curé de Redon et plusieurs autres prêtres. Du diocèse de Luçon, le R. P. Rigaudeau, curé de Saint-Laurent-sur-Sèvre et gardien du tombeau de notre Bienheureux, M. le Curé des Essarts, etc. Du diocèse de Vannes, M. le doyen de la Roche-Bernard et un grand nombre d’autres prêtres. On compte aussi plusieurs Pères de la Compagnie de Jésus, des Pères Eudistes, des Missionnaires de l’Immaculée-Conception de Nantes.
Les rangs de la foule s’inclinent sous la main bénissant de l’Evêque et s’ouvrent pour laisser passage au cortège qui monte les degrés de cet escalier monumental, qu’on ne gravira plus désormais qu’à genoux.
C’est dans un religieux silence qu’on entend la voix de l’Evêque, prononçant les paroles liturgiques, et qu’on le voit asperger tour à tour le monument, la Scala Sancta, et le groupe de la Flagellation.
Le Saint Sacrifice de la Messe commence aussitôt.
Les chants sont soutenus, d’un côté, par la musique instrumentale de la paroisse de Crossac; de l’autre, par celle des Frères de l’Instruction chrétienne de Redon. Notons, en particulier, après l’Elévation, le chant du beau cantique : O l’Auguste Sacrement… dans lequel Montfort a su résumer admirablement, comme Saint Thomas d’Aquin dans le Lauda Sion, toute la doctrine de l’Eglise touchant le grand mystère Eucharistique.
Ce sont des milliers de voix qui s’unissent avec un ensemble parfait, et nous ne croyons pas qu’on puisse entendre un acte de foi plus expressif, plus ému.
Le Saint Sacrifice de la Messe s’achève. Du haut de la Scala, Monseigneur a béni solennellement la foule.
Lecture est faite en latin et en français du Bref de Léon XIII, accordant aux pèlerins du Calvaire les mêmes indulgences que peuvent gagner les pèlerins de Rome, en montant à genoux les marches de la Scala Sancta.
Toutes les voix chantent alors le cantique : O Montfort, O Bienheureux Père… Puis le silence se fait pour entendre la parole du R. P. Nauleau, de la Compagnie de Jésus.
Nous ne pouvons que rappeler quelques traits de ce beau discours :
Le Prétoire… Ce monument est un commencement d’exécution de la grande pensée du Bienheureux Montfort, qui voulait faire de cette lande une autre Jérusalem, où seraient représentées toutes les scènes de la Passion, depuis la maison de Pilate jusqu’au Calvaire
Cette pensée, ses enfants la reprennent aujourd’hui, et ils la réaliseront, sûrs de trouver chez les descendants le même zèle, la même ardeur que Montfort trouva, dans cette contrée, chez les ancêtres.
Nous sommes au Prétoire ! Mais, au lieu de la foule en délire qui demande à grands cris la mort de l’Homme-Dieu, je vois ici une foule qui l’acclame, qui célèbre ses louanges, et qui est venue au Calvaire pour fortifier encore sa foi et s’animer à la pratique de la vertu.
Que peut-il y avoir de meilleur pour atteindre ce but que les souvenirs mêmes du Prétoire de Jérusalem? C’est-là que Jésus a été flagellé, couronné d’épines, mis en parallèle avec Barabbas, condamné à mort. La voix de l’orateur fait vraiment revivre toutes ces grandes scènes devant l’immense auditoire qui partage son émotion et flétrit avec lui, tour à tour, la haine aveugle des Juifs, la lâcheté de Pilate, et la rage insensée des bourreaux.
Le peuple déicide fit entendre au Prétoire ce cri : « Que son sang retombe sur nous ». Nous pouvons la redire, cette parole. Mais qu’il retombe aujourd’hui sur nous, ce sang, en rosée de bénédictions, sur tous ceux qui assistent à cette fête, qui viendront prier à ce Prétoire, ou qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à son érection !
La multitude se disperse alors, sous l’impression de cette parole, en attendant la cérémonie du soir. Il faut bien prendre quelque réfection et quelque repos.
Toutefois, il ne faudrait pas croire que, dans cet intervalle, la piété ne sait pas trouver son compte. Rien de plus édifiant peut-être, dans cette grande et belle journée, que l’empressement avec lequel la foule se montre avide, dès le premier moment, de gagner les indulgences en montant à genoux les marches de la Scala Sancta. D’un autre côté, on se presse à la chapelle, autour de l’autel du Bienheureux.
A la maison des Pères, à la fin du banquet fraternel qui réunit les prêtres autour de leur Evêque, le R. P. Barré, Supérieur, se lève pour remercier Sa Grandeur, non seulement d’avoir bien voulu présider cette fête, mais aussi de tous les témoignages de protection et de haute bienveillance qu’Elle ne cesse de donner à l’Œuvre du Calvaire.
Il exprime aussi sa reconnaissance à tous ceux qui l’ont aidé, encouragé, et d’une manière spéciale, aux
Curés des paroisses voisines qui, à l’exemple de leurs prédécesseurs du temps de Montfort, voient dans l’Œuvre du Bienheureux l’Œuvre de toute la contrée. L’architecte du monument, l’entrepreneur qui a conduit habilement les travaux, les artistes qui l’ont décoré ne sont point oubliés.
Monseigneur prend la parole à son tour. S’il ne nous appartient pas de louer cette parole, nous pouvons dire, au moins, que ceux qui travaillent à la réalisation complète de la pensée du Bienheureux Montfort ne pouvaient compter sur une récompense plus douce et plus aimable pour les travaux accomplis déjà, et sur des encouragements meilleurs pour ce qui reste encore à faire.
Cependant, on a ouvert le grand portail qui donne accès dans le jardin des Pères.
C’est là qu’apparaît sur son lit d’honneur le Christ du Bienheureux Montfort, dont les lecteurs de la Semaine savent déjà l’histoire. Disons que ce lit d’honneur, dont on admire la richesse et les proportions, est l’œuvre de M. le Curé de Saint-Lyphard.
Il se compose de trois gradins superposés, ornés de tentures de velours rouge, richement brodées et frangées d’or. Au-dessus du Christ s’élève un léger dais, orné de la même manière. Sur le second gradin, des Anges, rangés autour du Christ, semblent être là pour lui faire une escorte d’honneur. Il en aura bientôt une autre.
On fait, en ce moment, l’appel des vingt-deux paroisses qui ont tenu à honneur de fournir leur escouade de vingt-quatre hommes pour porter le Christ.
C’est un groupe de plus de cinq cents hommes, tous ayant une décoration spéciale, rangés sur quatre lignes, en attendant le moment de courber leurs épaules sous le pieux fardeau.
Mais il faut assister auparavant au défilé de l’immense procession formée par toutes les paroisses, marchant à la suite de leurs bannières.
Nous les comptons au nombre de trente, et nous craignons d’en omettre quelqu’une : St-Guillaume, Ste-Reine, Crossac, St-Joachim, St-Lyphard, Missillac, Campbon, Herbignac, St-Malo-de-Guersac, Donges, Besné, Prinquiau, la Chapelle-Launay, Ste-Anne-de-Campbon, Guenrouët, Fégréac, Avessac, St-Nicolas-de-Redon, Bouvron, Vay, Drefféac, St-Herblain, la Chapelle-des-Marais, du diocèse de Nantes : St-Dolay, Férel, Nivillac, Marzan, Camoël, du diocèse de Vannes ; Redon, du diocèse de Rennes.
On voit encore la bannière du pèlerinage des Vendéens à Rome, et celle du Comité catholique du diocèse de Nantes.
La musique instrumentale de Crossac a pris la tête de la procession. Celle des Frères de Redon marche un peu en avant du lit d’honneur du Christ, que précède immédiatement un groupe d’hommes portant de larges et magnifiques étendards, et aussi un groupe gracieux d’enfants qui sèment le chemin de fleurs.
Le clergé escortant Sa Grandeur termine cette marche triomphale. La procession fait d’abord l’ascension du Calvaire, puis contourne la colline pour reprendre bientôt la grande voie tracée sur la lande.
Sur tout ce long parcours, des milliers de voix redisent à l’envi : Vive Jésus ! Vive sa Croix !… Priez pour nous Bienheureux Montfort…. Cependant la foule s’est rangée de nouveau autour du Prétoire. Elle a presque doublée, depuis ce matin. On l’évalue, en ce moment, à près de 30.000 personnes.
Monseigneur a pris place, avec le clergé, sous les coupoles du monument. Le lit d’honneur est déposé un peu en avant de la Scala Sancta.
C’est alors que M. l’abbé Jarnoux, de la Collégiale de Saint-Donatien, fait entendre à toute la foule cette parole : Digitus Dei est hic, le doigt de Dieu est là.
Nous n’essaierons pas une pâle analyse de ce discours. Nous croyons savoir que la Semaine en donnera le texte à ses lecteurs.
Disons seulement qu’en entendant ce récit émouvant des épreuves du grand missionnaire, envoyant revivre sous ses yeux les grandes scènes dont cette lande fut témoin en 1709 et en 1710, où apparaît si grande et si noble la foi des aïeux, l’immense auditoire était visiblement ému. Volontiers, il se fut écrié avec l’orateur en terminant : O Christ, à vous nos cœurs, à vous nos vies ! Continuez votre marche glorieuse, achevez votre triomphe. Et nous, sur votre passage royal, à genoux dans l’adoration, ou bien serrés autour de votre croix, I comme des soldats prêts à combattre, prêts à mourir, nous redirons : Vive Jésus ! Vive sa Croix !
Le salut du Saint-Sacrement est donné par Sa Grandeur du haut de la Scala Sancta. On reporte le Christ à la maison des Pères.
La fête est terminée. Grande et belle journée, dont tous les pèlerins garderont un pieux souvenir, journée qui a été, nous le savons, pleine de consolations pour le cœur du premier Pasteur du diocèse, et d’encouragements pour ceux qui travaillent à la réalisation complète de l’Œuvre du Bienheureux de Montfort.
Discours prononcé au Calvaire du B. Montfort par l’Abbé Jamoux le 24 juin 1892.
Digitus Dei est hic
Le doigt de Dieu est là
Quel spectacle ! Que peut donc être la voix d’un homme comparée à cette éloquente manifestation ! !
Ah ! Que n’ai-je une voix de tonnerre, s’écriait en pareille circonstance le Bienheureux Montfort !
Ce désir, ce serait aussi le mien, alors que je voudrais vous montrer à grands traits les desseins de Dieu sur ce Christ, vous dire comment ces desseins se révèlent dès l’origine de son histoire, — comment ces desseins, longtemps combattus, entrent aujourd’hui dans la période du grand et définitif triomphe.
O Christ, inspire-moi !
O Bienheureux Montfort, donnez à mon cœur vos saintes émotions de missionnaire et que ma parole soit ici-même l’écho de votre puissante parole !
1. — Les origines extraordinaires de ce Christ annoncent le dessein de Dieu.
Vers 1707, à Saint-Brieuc, ordre est donné, de la part des Jansénistes, de sculpter une image du Christ mourant sur la Croix, un Christ au visage sombre, aux bras raccourcis.
Pourquoi l’ouvrier, qui tailla ce Christ dans un chêne breton, oublia-t-il les intentions et les ordres de ces hommes qu’une doctrine aux sévérités apparentes avait séduits, et qui ne comprenaient pas que l’amour de Dieu, plus que la crainte, peut opposer au sensualisme corrompu une digue infranchissable ?
Est-ce instinct du sens chrétien, est-ce habitude ou tradition de l’art religieux ?
Disons plutôt que Dieu lui-même guida à son insu la main de cet homme ; Dieu lui-même répandit sur cette face mourante une bonté sans mesure ; Dieu lui-même élargit les bras de la victime de l’universalité du genre humain.
Dès lors cette œuvre d’inspiration si franchement catholique, des mains souillées par l’hérésie devaient-elles, pouvaient-elles la recevoir ?
Aussi Dieu avait amené à Saint-Brieuc l’apôtre de la Croix et de Jésus crucifié. Le missionnaire eût-il déjà la céleste intuition des grandes destinées de cette figure que l’ouvrier allait jeter au rébus. C’est à croire.
Mais comment de l’atelier du maître, passera-t-elle en la possession de Montfort ? Le pauvre prêtre n’a pas le moindre argent pour payer le travail, il tend la main, il mendie à toutes les portes, et voici ou j’aperçois encore le doigt de Dieu : La charité s’émeut, et c’est la charité, ce principe de tous les dons de Dieu, qui cache et révèle Dieu lui-même, c’est la charité qui donne ce Christ à Montfort, et par Montfort à la Bretagne.
La Bretagne ! La terre des Calvaires ! Sculptés dans le chêne, taillés dans le granit, ils s’élèvent partout, sur les landes monotones, et à l’entrée des champs, entre les maisons de nos villages, sur les places de nos grandes villes, sur le sable des grèves et jusque sur les rochers de l’Océan. Et nous, nous en jalonnons encore les routes que la civilisation ouvre de toutes parts. Par leur calvaire, nos ancêtres ont merveilleusement écrit sur le sol breton leur foi tout d’abord, avec leur foi leur histoire faite de joie et de douleurs, et enfin leurs espérances éternelles.
Où donc sera élevé ce Christ, œuvre et don de Dieu ?
Le missionnaire, dont l’âme est restée patriote, se hâte vers son pays natal, vers Montfort, et veut lui faire là, en pleine Bretagne, un gigantesque piédestal.
Ce n’était pas la volonté de Dieu ; et les intrigues de l’hérésie comme la rage du démon, ne triomphèrent si facilement des efforts du Bienheureux que parce que ce territoire n’était pas celui où la Providence voulait dresser ce sublime trophée de la miséricorde et de l’amour.
Où donc est la terre choisie ? Voyez : — Entre la Bretagne et le pays Nantais, proche de la mer, inspectant de loin vers les rives de la Loire, s’étend une vaste lande solitaire entourée de vingt paroisses où vivent des familles de travailleurs aux mœurs simples, à la foi robuste, aux cœurs généreux, capables de tous les dévouements parce qu’ils sont restés purs et croyants.
Sur cette lande, Montfort indique l’endroit où doit s’élever la montagne de son Calvaire.
A ce signe qui est le signe de Dieu, tout s’ébranle. Pourquoi de tous coins de l’horizon ce concours d’ouvriers ? Pourquoi ce mélange sans confusion de tous les âges, de toutes les conditions, de presque toutes les nationalités ? Qui retient ces travailleurs qu’on ne paie pas, qu’on ne nourrit pas ? Pourquoi ce joyeux labeur d’esclave ? Comment expliquer ce mont qui s’élève au chant des cantiques et des Ave Maria ?
Le prestige lui-même d’un saint n’y suffirait. Où donc trouver le secret de cette merveille Mes frères, Dieu le veut ! Dieu le veut, et Montfort n’est que l’écho de sa voix.
Tout est prêt pour Ie triomphe ; les populations sont en marche, les étendards sont préparés et flottent déjà ; on s’encourage, on se félicite, on se dit : C’est demain ! Eh bien ! Non, Dieu a manifesté son dessein. Ce Christ doit régner ici. Cela suffit quant à présent. C’est maintenant, comme dans le grand drame de la Passion, l’heure de la puissance des ténèbres. Pourquoi ? Ne vous troublez pas. âmes faibles, impatientes, âmes ignorantes, les efforts du démon et du mal sont aux œuvres de Dieu ce qu’est à vos chênes l’orage impétueux qui fait pénétrer plus avant leurs racines dans le sol et assure dans l’avenir à leurs branches une majesté, une force inébranlable.
II — La ressource commune du démon contre le Christ, contre ses œuvres, contre ses saints, c’est la calomnie.
La calomnie s’éleva donc de l’Enfer comme le nuage malsain qui monte de vos marais, nuage qui voilà pour un temps la vérité aux yeux mêmes des Supérieurs ecclésiastiques, nuage qui aveugla à ce point le pouvoir public qu’on fit croire à ce dernier que ces douves, que cette montagne, cette croix enfin étaient un travail de rebelles, un danger pour l’Etat.
Nos Calvaires, ce sont des montagnes d’où descendent la paix et la douce fraternité. La Croix, c’est encore le meilleur sceptre de justice et de gouvernement. Nos Christs sur leur chaire de pierre ou de bois, ils prêchent la fidélité, l’obéissance jusque dans la mort.
Ces calomnies d’ailleurs et ces haines contre la croix ne sont pas d’hier, et je ne m’étonne pas que la sinistre toile, crié pour la première fois sur une place de Jérusalem, ait encore retenti sur cette lande. Alors apparut combien était profonde en l’âme de nos Pères l’amour pour le Christ de Montfort.
Abattez la Croix, commande la force appuyée par des troupes de soldats !
Non! répondirent nos aïeux, intrépides devant les menaces, intrépides devant la mort. Arrachez ce Christ ! — Non ! Non ! Détruisez ce Calvaire ! — Non! Non! — Et parmi ces braves gens, il n’y eût pas un lâche, pas un traître, pas un vendu, pas un Judas !
Oh ! Le brave et noble entêtement breton qui n’a point encore disparu, que vous acclamez ! Ce non, éclos aux lèvres de nos martyrs nantais, renforcé par les voix de quinze générations, nous le jetons encore fièrement nous, les fils, nous les derniers venus, à toutes les tyrannies, à toutes les impiétés. Non, nous ne briserons pas nos Croix ! Non, nous ne détruirons pas nos traditions. Non, nous n’apostasierons pas ! Non ! Non !
Quand les soldats se mirent à scier le bois de la Croix, quand l’image sainte allait se briser en tombant de sa hauteur, à genoux, les bras tendus, au milieu des sanglots, comme autrefois au Calvaire, nos pères la recevaient et l’emportaient pour lui donner en leurs maisons une sûre hospitalité.
L’enfer ne se contenta pas de ce premier succès. Les fidèles reviendront, dès demain peut-être, recommencer une œuvre qui doit être anéantie à tout prix.
On vit alors le Bienheureux Montfort obligé de venir lui-même prendre la sainte relique. Est-ce pour lui chercher une autre montagne? Certes, il ne manquait pas de populations dévouées, au milieu desquelles un troisième essai avait chance de réussir.
Non, la patrie de ce Christ, ce n’est pas à Nantes, ce n’est pas sur le sol Vendéen, c’est ici, c’est sur la lande de la Madeleine. «Où qu’on le porte, écrit le Saint, divinement inspiré, ce ne sera que pour revenir à Pontchâteau. »
Ce premier exil dura plus de 30 années, et voilà que les fils de Montfort reconstruisent avec nous la Montagne abattue, l’Evêque de Nantes visite et bénit les travailleurs. Par son ordre, le Christ revient, reparaît aux applaudissements de tous les gens de bien.
Est-ce enfin le triomphe? Non. La calomnie arme à nouveau l’autorité seigneuriale, et les disciples de Montfort, attendant une époque meilleure, vont déposer leur Christ à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
L’âme et les ossements du Saint qui avait terminé là sa carrière apostolique, durent tressaillir à cette soudaine apparition.
Ils me haïssent, ils me persécutent, ils veulent me détruire, disait l’emblème sacré. Me voici venu me reposer en paix auprès de toi ; tu m’as porté, bon et fidèle serviteur, sur tes épaules, tu as veillé sur moi. Maintenant je veux m’abriter près de ta tombe pour attendre l’heure de la résurrection et du triomphe.
C’est le second exil, exil où m’apparaît encore la volonté de Dieu. L’impiété se nuit à elle-même ; en cette circonstance, elle fait sans le vouloir et sans le savoir comme toujours, l’œuvre de la Providence.
En effet, les mauvais jours approchent. Ici, ce qui reste de statues, de croix, d’images saintes, tout est brisé, jeté aux flammes révolutionnaires !
Que fût-il advenu, si votre Christ eût été ici? — Non, le Christ est dans le bocage vendéen, en sûreté dans ce pays où l’on se bat, où l’on meurt pour la Croix, inspirant peut-être, de cette humble vallée de la Sèvre, les héroïsmes gigantesques et les martyrs de la Vendée.
III. — A tout considérer,
l’œuvre du Calvaire ne courut jamais un danger plus grand. Autour de votre Christ, l’amour des enfants du Père de Montfort, la présence des reliques du Missionnaire, la foi enfin du pays vendéen formaient un triple rempart.
Or, quand la grande idée du siècle précédent reprend vie dans le cœur du curé de Pontchâteau, quand, à son signal et à son exemple, par le travail de toute la contrée, les douves se creusent encore, la montagne se relève, le triple rempart s’abaisse de lui-même, et comme s’il n’eût pas réellement existé, le Christ revient, de même que l’exilé reprend spontanément, après les grands troubles finis, sans que les étrangers veuillent le retenir, le chemin de la Patrie.
Comment! Enfants de Saint-Laurent, vous laissez partir cette insigne relique de votre père, sans regret, sans résistance I Comment ! Vous ne l’élevez pas sur l’une de vos ravissantes collines, à deux pas de la tombe de votre fondateur !
Ah ! Vraiment, le doigt de Dieu est là manifestement, de Dieu qui abaisse sans effort les plus hautes montagnes, de Dieu, dont les desseins, assez longtemps combattus, doivent enfin triompher.
Le temps des luttes est en effet passé. Plus de vaines terreurs politiques, plus de dissidences religieuses. C’est tout un peuple, présidé par son Evêque, qui acclame dès 1821 cette belle aurore du grand triomphe.
Car ce n’était qu’une aurore. Ne convenait-il pas que la mémoire du Père de Montfort se leva d’abord glorieuse pour que cette gloire projetât sur le Christ lui-même une clarté bien vive, bien indiscutable ? Ne convenait-il pas que l’emplacement prédestiné s’entourât de gardiens et de serviteurs ?
Tandis que tout cela se prépare, s’accomplit avec la lenteur majestueuse des Œuvres de Dieu, le Christ attend dans l’ombre de la solitude souvent troublée par d’éclatants témoignages de piété et d’amour.
Mais Léon XIII a parlé et proclamé Bienheureux l’ouvrier du Calvaire : tout s’anime vers la lande déjà peuplée, avec l’heure où commence le grand triomphe.
Le voilà : les peuples venus de loin, les acclamations, l’enthousiasme, les cantiques, les prêtres, le Pontife lui-même, des milliers de voix unies dans l’amour et l’adoration. Oui, vraiment, c’est le grand triomphe! Singulière coïncidence ! Le Christ apparaît à une heure solennelle de l’histoire. De toutes parts, on s’avoue qu’il n’y a plus de salut que dans la Croix. Tous les autres remèdes sont essayés, la force, la politique, la science, les mille inventions. Malgré tout cela, et sans doute parce que tout cela est en dehors de Dieu et souvent contre Dieu, les sociétés semblent arrivées à une impasse où l’on devra s’égorger pour savoir qui seront les maîtres.
Il me souvient, Monseigneur, qu’un soir du dernier Congrès où vous présidiez les catholiques de l’Ouest, après d’émouvants discours qui mettaient à nu la plaie sociale, vous vous êtes levé, portant dans votre grande âme d’Evêque les soucis du présent et de l’avenir, nous laissant entrevoir dans votre geste la lumière et l’espérance, et vous avez dit devant la foule : Le Salut, c’est vous, ô mon Jésus crucifié. — Cette parole, je m’en empare, Monseigneur, et je la crie en votre nom à tous : Le Salut, c’est Jésus crucifié.
Que cela soit !
O Christ triomphant, nous vous acclamons, nous acclamons vos victoires passées, votre victoire présente, vos victoires prochaines !
Il semble que cette lande tressaille, que les ancêtres ressuscitent, ceux qui ont travaillé, qui ont chanté, qui ont prié, souffert ici. Ils ont droit d’être à l’honneur, ayant été à la peine. Ne sentez-vous point passer en vos âmes leur amour, leur enthousiasme ? Je crois entendre leurs voix, leurs acclamations, que domine la voix du Bienheureux, et toutes ces voix, tous ces hommages, venus du passé, venus du Ciel, je les unis à vos voix, à vos hommages, et je les dépose, ô Christ, humblement, à vos pieds adorables!
O Christ ! A vous nos cœurs, à vous nos vies ! Continuez votre marche glorieuse ! Intende, prospere procede et regna. Achevez votre triomphe! Et regna ! Et nous, sur votre passage royal, à genoux dans l’adoration, ou bien serrés autour de votre Croix comme des soldats prêts à combattre, prêts à mourir, nous crions et nous crierons toujours : Vive Jésus ! vive sa Croix !
— Une immense acclamation répondit à ces paroles, et par trois fois la foule enthousiasmée s’écria: Vive Jésus ! Vive sa Croix !
L’AMI DE LA CROIX
OCTOBRE 1891 – 6 JUIN 1940
L’Ami du Calvaire
N° 3 décembre 1891
Nouveaux travaux au Calvaire (Jardin des Oliviers)
Ceux qui ont lu notre Notice sur le Calvaire (Guide du Pèlerin) savent que dans le plan conçu par notre Bienheureux, il y avait une place pour le Jardin des Oliviers. Il voulait mettre sous les yeux les souvenirs que rappelle ce premier théâtre de la Passion du Divin Maître. Et quels souvenirs ! Ses dernières recommandations à ses chers apôtres, sa prière prolongée pour nous, dans sa divine agonie, cette sueur de sang dont le sol fut inondé dans la grotte de Gethsémani ; puis la trahison et le baiser de Judas, et enfin l’amour d’un Dieu qui le fait se livrer lui-même à ses bourreaux pour nous !
Il y a quelques jours, nous recevions, ici, un pèlerin de Jérusalem qui naguère encore avait le bonheur de s’agenouiller dans chacun de ces lieux sanctifiés par les souffrances de Notre-Seigneur. Aidés par ses souvenirs encore si récents, et ayant sous les yeux le plan de Jérusalem, nous avons fixé, sur la pente de la lande de la Madeleine, l’emplacement qui paraît le plus convenable pour figurer le Jardin des Oliviers.
Il y aura là évidemment une somme de travaux considérables, puisqu’il s’agit d’abord de faire une enceinte au jardin, puis de creuser ensuite la grotte de l’agonie. Cette grotte, pour représenter celle de Gethsémani, devra atteindre d’assez grandes proportions, puisque celle-ci peut contenir, dit-on, jusqu’à cent personnes, et qu’elle occupe une surface de douze à treize mètres de diamètre.
Nous ne parlons pas encore de creuser le torrent du Cédron que Notre-Seigneur dut traverser, pour se rendre au Jardin des Oliviers.
Mais, en annonçant ces travaux, nous avons l’assurance que la nouvelle en sera bien accueillie par les fils des anciens travailleurs du Calvaire de Montfort. Nous savons qu’ils ont la même bonne volonté, la même ardeur que leurs ancêtres, qu’il suffira de faire un appel auprès d’eux pour qu’il soit entendu, et que tous seront heureux de mêler leurs sueurs à cette terre qui leur rappellera celle arrosée du sang d’un Dieu.
Ces travaux doivent commencer incessamment, et nous savons qu’ils seront poussés activement, de sorte que l’année ne se passera pas sans que nous puissions offrir une station nouvelle et des plus touchantes à la piété des pèlerins du Calvaire.
N° 5 Février 1892
Continuations des travaux du Jardin des Oliviers
En commençant le compte-rendu des journées du 10 et du 17 décembre, qui ont inauguré les travaux entrepris pour la représentation du jardin des Oliviers et de la grotte de Gethsémani, sur la lande de la Madeleine, bien des réflexions se présentent à notre pensée. Nous serions tentés, en particulier, d’inviter ceux qui redisent trop facilement peut-être avec nos ennemis que la foi a disparu, surtout parmi les hommes, de venir voir ici la foi en acte, transportant sinon les montagnes, du moins les collines, sans s’arrêter devant les blocs de rocher les plus énormes.
Mais rien ici ne peut valoir le simple exposé des faits.
Il parut bon, pour diverses raisons, d’adresser la première invitation à la paroisse de Crossac, toujours si bien disposée quand il s’agit de la gloire de notre Bienheureux. La mission de Crossac apparaît dans sa vie, comme une de ses missions les plus victorieuses. Ce fut, dans toute la population, un véritable renouvellement d’esprit chrétien, qui s’y est conservé jusqu’à nos jours.
Le vendredi 4, j’accompagnais le P. Supérieur dans sa visite au presbytère de Crossac, où M. le Curé nous recevait avec sa bonne grâce habituelle. Il nous parut satisfait de ce que ses paroissiens avaient été choisis pour marcher en avant, et voulut bien se charger lui-même de leur transmettre notre invitation, au prône de la messe du dimanche. Au jour fixé, le jeudi 10 décembre, dès qu’il fait jour, les premiers groupes de travailleurs apparaissent au bas de la lande, la pioche ou la pelle sur l’épaule. Le P. Supérieur est là pour leur souhaiter la bienvenue. Ils sont bientôt au nombre de cent cinquante, prêts à commencer le travail qui leur sera demandé. Quelques mots suffisent à le leur expliquer. Et c’est en chantant à pleine voix : Vive Jésus, vive sa Croix! que tous se rendent au lieu désigné.
Là, les uns s’occupent à dégager le rocher principal auquel doit être adossée la grotte, les autres commencent un mur d’enceinte. D’autres enfin, en plus grand nombre, déracinent d’abord des blocs énormes à moitié enfouis dans la terre, et les traînent ensuite autour du rocher central, où ils seront employés à former les parois de la grotte. Tel de ces blocs oppose de temps en temps une assez longue résistance, même aux efforts des cent cinquante hommes réunis. Mais, enfin, il finit par céder. Et c’est alors que se fait entendre avec plus d’élan l’un des refrains populaires :
Priez pour nous
Bienheureux Montfort !
Conduisez-nous
Au céleste port.
A midi, les travaux sont suspendus, pour faire un repas bien frugal. Chacun déploie le linge ou le papier qu’il portait le matin sous le bras et qui contient les petites provisions.
Avant de recommencer les travaux, tous montent au Calvaire en chantant : Chers amis, tressaillons, d’allégresse. Une courte allocution rappelle les souvenirs du passé et fait comprendre à tous la beauté de l’œuvre à laquelle ils prêtent leurs bras. Et c’est encore en chantant qu’on retourne au chantier ouvert dans la matinée.
M. le curé de Crossac n’avait pu accompagner ses chers travailleurs dès le matin ; mais au grand contentement de tous, il apparut quelques instants dans l’après-midi. Notons un détail : En allant de groupe en groupe et distribuant çà et là quelques paroles d’encouragement, il s’arrêta étonné, en fixant des jeux l’un des travailleurs, et laissa échapper ces mots : « Vous, ici ! » « Eh bien, oui. M. le Curé, dit simplement cet homme, moi aussi, je suis venu travailler, pour que le P. de Montfort me guérisse. » Ce fut tout. Quelques pas plus loin, l’excellent Curé nous disait que trois ou quatre jours seulement auparavant, celui qu’il avait interpellé avait éprouvé un de ces accidents qui sont l’indice d’une poitrine bien compromise et qui demande les plus grands ménagements. La journée n’était pas belle. La brume était épaisse, lourde et froide. Il ajouta : « On ne peut pourtant pas leur faire un crime d’avoir trop de foi et de confiance. » Cette journée de travail se termina par la bénédiction solennelle du Très Saint-Sacrement et le baisement de la relique du Bienheureux. C’est là le salaire bien apprécié de tous.
†
Dans cette semaine même, nous recevions la visite du vénérable Curé de Saint-Joachim, qui, lui-même nous exprima le désir de voir marcher ses hommes immédiatement après ceux de Crossac. L’appel qu’il fit le dimanche fut entendu. Le 17, dès le matin, malgré la distance plus grande, qui doit être, pour la plupart, de trois lieues, les hommes de Saint-Joachim fournissent sur la lande un groupe de travailleurs en nombre égal à celui que nous avions vu la semaine précédente.
Il s’agissait de continuer le même travail et dans le même ordre. Ce fut aussi la même ardeur, la même activité, le même entrain. C’était merveille d’entendre les chants, de voir la facilité avec laquelle se déracinaient et roulaient les plus gros rochers. Disons que nous avions là, parmi nos travailleurs, d’anciens contre-maîtres et ouvriers des Chantiers de la Loire, habitués à manier le cric et le vérin et à soulever des poids énormes.
Dès la matinée, le câble, très fort cependant, qui avait servi jusqu’alors, vint à se rompre jusqu’à deux fois. Tout le monde était d’avis qu’il fallait le remplacer par une chaîne de fer, qui ne se laisserait pas entamer comme le câble, par les aspérités de la pierre. Mais cette chaîne, on ne l’avait pas… Un des travailleurs se rappelle soudain que la longue chaîne qui lui servait pour amarrer son bateau était sans emploi, depuis que le bateau lui-même ne marchait plus. Vite, un char-à-bancs est attelé, et deux heures après la chaîne était à la disposition des travailleurs. Elle fit merveille toute la soirée. Ajoutons qu’à la fin du travail le propriétaire fit savoir au Père Supérieur que, n’ayant pas encore eu l’occasion de faire de cadeau au bon P. de Montfort, il était heureux de lui offrir celui-là, s’il voulait bien l’accepter.
L’un des vicaires de Saint-Joachim, M. l’abbé Pabois, dans toute l’après-midi, n’avait pas quitté un instant les travailleurs, et s’était fait honneur de tirer, lui aussi, à la chaîne. Ce fut lui qui, à la fin de la journée, donna la bénédiction solennelle du Très Saint-Sacrement et fit vénérer les reliques du Bienheureux.
Au départ, tous les visages rayonnaient de contentement. La journée avait été vraiment belle et bonne. Le temps lui-même s’était mis de la partie, et, ce qui est rare dans celte saison, avait été constamment clair et beau.
†
Aujourd’hui, mardi 22 décembre, nous avons le bonheur de recevoir notre Supérieur général, le R. P. Maurille. Nous n’avons pas à parler de démonstrations plus intimes, à l’intérieur de la Communauté. Mais c’est aussi le jour où ont été convoqués les hommes de la Chapelle-des-Marais, pour la continuation des travaux du Jardin des Oliviers et de la grotte de Gethsémani. Nous connaissions leur bonne volonté et même leur désir d’être invités à marcher à la suite des travailleurs de Crossac et de Saint-Joachim. M. le Curé, nous le savons, du haut de la chaire, dimanche dernier, les a engagés chaleureusement à répondre à cette invitation. Les voilà qui arrivent nombreux, malgré la rigueur du froid. Us montent, en chantant, la colline, et se dirigent vers le champ du travail, et paraissent pleins d’entrain et d’ardeur.
Après le dîner, le B. P. Maurille veut bien aller les encourager un instant par sa présence. Le Père Supérieur le présente aux travailleurs comme le représentant et le successeur de celui que leurs ancêtres ont connu et entendu, et à qui ils ont voué eux-mêmes un culte si reconnaissant. C’était le moment où, après avoir pris leur légère réfection et fait une courte visite à la Scala, ils venaient reprendre leur travail en chantant : Chers amis, tressaillons d’allégresse… Nous saluons au milieu d’eux M. le Curé de la Chapelle-des-Marais et son vicaire. Chacun reprend le poste qui lui avait été assigné dans la matinée.
Nous sommes obligés de nous arrêter, et nous n’en pouvons dire davantage, aujourd’hui. Mais nous en avons dit assez pour montrer sur quelle ardeur et sur quelle bonne volonté nous pouvons compter ; et que tout fait espérer la prompte et heureuse réalisation des nombreux projets entrepris à la gloire de Jésus crucifié et de son humble serviteur Montfort.
N° 6 Mars 1892
Les travaux du Jardin des Oliviers
Nos lecteurs qui s’intéressent à ces travaux doivent se rappeler que, vers le 7 ou 8 janvier, il y avait eu suspension forcée à cause de la neige et du mauvais temps.
Mais, voici que dès le 26 au matin, une belle journée s’annonce. Nous entendons, dans le lointain, un chœur de voix bien nourri. C’est l’air d’un de nos cantiques bien connu. Les voix se rapprochent de plus en plus du Calvaire. Ce sont les hommes de Drefféac, qui, n’ayant pu venir à un premier jour fixé, nous font cette surprise.
Il paraît que l’excellent Curé s’était contenté de leur dire : « Au premier beau jour ! » Et les voilà au nombre de plus d’une centaine, chiffre énorme relativement à la population.
Qu’ils soient les bienvenus! Tous sont bientôt à l’œuvre, avec ardeur. Les uns achèvent les travaux préparatoires pour la construction de la grotte de Gethsémani, les autres travaillent au nivellement du terrain qui entoure le Prétoire. C’est le même entrain que nous avons déjà vu, la même piété dans la visite au Calvaire, au milieu de la journée.
Lorsque le vénérable Curé de Drefféac apparaît dans la soirée, accompagné de son vicaire, il y a une explosion de joie et de contentement bien significative, et qui montre bien l’union qui existe entre le Pasteur et le troupeau.
M. le Curé nous fait remarquer lui-même, parmi les travailleurs, deux vieillards de 75 et 76 ans que n’ont point arrêtés ni la longueur de la route, ni les fatigues de la journée.
Il paraît visiblement heureux, le soir, montant à l’autel pour donner à ses chers travailleurs la bénédiction du T. S. Sacrement, et faisant aussi vénérer à chacun les reliques de notre Bienheureux. Les chants joyeux du matin reprennent au départ.
C’est le lendemain de cette journée, mercredi 27 janvier, que nous avons l’honneur de recevoir M. A. Gerbaud, en compagnie de M. le Curé de Missillac, lui-même si dévoué à notre Œuvre. Nous l’attendions, et c’est lui qui veut bien, avec un dévouement dont nous ne saurions lui être assez reconnaissants, prendre en main la direction des travaux de notre Jardin des Oliviers et de notre grotte de Gethsémani.
En visitant les Saints-Lieux, il y a déjà quelques années, pouvait-il prévoir qu’il serait appelé à diriger un travail de ce genre? Toujours est-il qu’au Jardin des Oliviers, en particulier, après avoir satisfait sa piété, il songea, comme bien d’autres pèlerins, à emporter quelques souvenirs. Il recueillit de sa main quelques graines d’arbustes croissant non loin de la grotte de l’Agonie. De ces graines semées à son retour en France, une seule a germé. C’est aujourd’hui un petit arbuste déjà haut de 50 à 60 centimètres. M. Gerbaud a voulu l’apporter et l’offrir au Calvaire, dès sa première visite ; et il aura certainement une place de choix dans l’ornementation de notre futur Jardin des Olives.
Il ne nous appartient pas de faire connaître, à l’avance, les plans arrêtés par le nouveau Directeur de la pieuse entreprise, dans l’étude qu’il fit sur place, ce jour-là même, du terrain et des matériaux mis à sa disposition.
Mais, ce que nous pouvons dire, c’est que dès le lendemain matin, il faisait manœuvrer sans hésitation le nombreux bataillon de travailleurs volontaires que lui fournit Saint-Guillaume.
On reconnaît, à première vue, celui qui a commandé, sur un autre champ, d’autres manœuvres. Du reste, quand même on eût ignoré au Calvaire le passé de M. Gerbaud, il devait se rencontrer, comme nous le verrons, parmi les travailleurs, des braves qui ne pouvaient manquer de saluer, en le voyant, l’ancien officier aux Zouaves pontificaux.
Mais parlons de Saint-Guillaume et des travaux de cette journée. Saint-Guillaume, c’est presque le Calvaire. Les bons paroissiens de Saint-Guillaume sont nos excellents et plus proches voisins. Aussi les a-t-on toujours vus au premier rang, quand il s’est agi de faire quelque chose pour le Calvaire. Il en était ainsi dès le temps du Bienheureux.
Ils auront, encore cette fois, l’honneur d’avoir placé la première et principale pierre des assises de la grotte de Gethsémani.
C’est un bloc énorme, et qui sans doute, fixé où il était par la main de Dieu, semblait bien devoir y dormir toujours.
Cependant, à force de patience et de travail, au moyen des crics et de la chaîne, glissant insensiblement sur des rouleaux, il est venu prendre la place qui lui était préparée, et se dresser droit en face de l’entrée de la grotte, non sans être salué par les bruyantes acclamations de tous les travailleurs.
Il gardera le nom de pierre de Saint-Guillaume.
Dans cette même journée, furent aussi faits des travaux de nivellement considérables au Prétoire. Nous ne serions pas complets, si nous ne disions qu’un certain nombre d’hommes des villages de la paroisse de Pontchâteau les plus rapprochés du Calvaire, s’étaient joints d’eux-mêmes, ce jour-là, aux travailleurs de Saint-Guillaume. La journée se termina pieusement comme à l’ordinaire par le salut du T. S.-Sacrement donné par M. le Curé.
Vendredi, 29 janvier.
Le lendemain, vendredi 29 janvier, il n’y avait pas de paroisse convoquée; et cependant, il y avait quelques déblaiements urgents à faire au fond de la grotte, pour préparer les travaux plus considérables de la semaine suivante.
Honneur et merci aux habitants des villages de la Moriçais, de Beaulieu, de la Salmonais, de Pie, de Malabris, des Caves de Beaumare, d’Epars et du Calvaire, tous de la paroisse de Pontchâteau, qui, sur un simple, avis donné la veille au soir, se trouvèrent au poste dès le lendemain malin!
Mardi, 9 février.
Ce sont les mêmes paroles que nous avons à dire, les mêmes remerciements que nous avons à adresser aux hommes des villages de la Cacognais, de la Madeleine, du Haut-Bodio (paroisse de Pont-Château) et de Montmara (paroisse de Sainte-Reine), venus ce jour-là, au premier signal, prendre la place d’une paroisse qui avait dû remettre à plus tard sa journée de travail.
Mercredi, 3 février. — Saint-Gildas-des-Bois.
Entre les deux dates que nous venons d’indiquer, nous avons eu encore une belle journée. Au mois d’octobre dernier, la paroisse de St-Gildas toute entière nous avait donné le spectacle d’un pèlerinage on ne peut plus édifiant. Bien édifiant aussi a été le spectacle donné par les hommes seuls, dans leur journée de travail, le 3 février.
Ils ont à leur tête, pendant tout le jour, le Vicaire délégué par M. le Curé, qui, à son grand regret, n’a pu venir. L’ordre est parfait. Ils arrivent en chantant un de ces cantiques qui marquent le pas. C’est, assure-t-on, un moyen d’abréger la longueur de la route. Ils en useront ce soir encore, au départ.
Ce jour-là, les travaux d’aplanissement autour du Prétoire avancent considérablement. De beaux blocs de pierre sont amenés à pied d’œuvre, au Jardin des Oliviers. St-Gildas pourra choisir celle qui portera son nom.
Notons un détail: Le R. P. Supérieur, en faisant sa convocation, proposait le jeudi. M. le Curé y vit des difficultés et le mercredi fut fixé. Le mercredi, temps superbe. Le lendemain, jeudi, pluie torrentielle. Jusqu’à présent, malgré la saison si variable, il n’y a pas eu un seul jour où les travaux aient été interrompus par le mauvais temps.
Nos lecteurs savent maintenant quelle part la piété a toujours dans chacune de ces journées, et en particulier, le soir. Nous ne le répéterons pas.
Mercredi, 10 février. — Missillac
M. le Curé de Missillac nous a enlevé jusqu’à présent l’honneur de donner l’hospitalité de nuit à M Gerbaud. C’est donc avec les travailleurs de la journée que celui-ci nous arrive aujourd’hui.
L’excellent Pasteur de Missillac, qui porte un si vif intérêt à notre Œuvre, a eu la bonne pensée de partager sa grande paroisse en plusieurs sections, de manière à procurer plusieurs journées de travail. Du reste, il eut été difficile d’occuper tous les bras qui se seraient présentés à un même appel. La seule section d’aujourd’hui fournit sa centaine de travailleurs. M, l’abbé Landeau, vicaire, dirige la marche avec son entrain ordinaire.
Dès le commencement de la journée, il est décidé que celui-ci s’occupera, avec une bonne partie des travailleurs, d’amener au chantier une pierre remarquable entre les autres par sa longueur, et pour laquelle M. Gerbaud a une place désignée. Cette pierre d’un poids considérable était presque au milieu de la lande, sur un plan incliné. Il fallait d’abord la charger sur un traîneau roulant, et lui faire gravir ensuite la pente. Il serait difficile de donner une idée de la somme de travail et d’efforts dépensés pour arriver au résultat désiré. Dix fois, lorsque, tout semblait fini, tout fut à recommencer. Mais, enfin, à force de constance, la pierre s’ébranla, monta la pente, au milieu de hurrahs enthousiastes, et arriva enfin au lieu marqué. Il fallut la voir debout, à la place qu’elle occupe, au milieu de la vaste ouverture de la grotte, qui aura ainsi sa porte d’entrée, et sa porte de sortie.
Il était nuit, mais tous s’en allaient contents et joyeux.
Jeudi, 11 février. — Crossac.
C’est déjà la seconde fois que nous trouvons le nom de cette paroisse sur le registre de nos travaux. Mais à la première convocation, il n’était venu personne d’un certain nombre de villages très écartés, et qui, il faut le dire, ont beaucoup moins de rapports avec le Calvaire, et même avec l’église paroissiale, que les autres habitants de Crossac. Une invitation spéciale leur fut adressée. On avait demandé une trentaine d’hommes. Ils sont venus au nombre de 67, bien comptés. Tous excellents travailleurs ! Nous avons remarqué un bon vieillard bien infirme et qui ne voulait céder son rang à personne, persuadé que la fatigue de cette journée, bien loin d’aggraver son mal, lui apporterait quelque soulagement.
Nous savons que ces braves gens des villages de Mandrais, de Quémené, de la Brionniôre, de Hault, de la Pelletraie et des Eaux, sont repartis enthousiasmés. Moins habitués que d’autres à ce qui se passe au Calvaire, ils ont raconté aux villages plus éloignés encore, que le Père missionnaire était resté toute la journée avec eux, leur avait fait chanter des cantiques, les avait prêches, leur avait raconté de belles histoires, etc., etc. Ces villages plus éloignés nous viendront bientôt, eux-mêmes.
Vendredi, 12 février. — Campbon
Ce sont les Campbonnais ! vraiment, ils vont au travail, comme à la bataille. Et c’est la marche d’une compagnie d’élite. Je comprends que le vénérable et digne Curé ait tenu à marcher en tête en traversant la ville de Pontchâteau. C’est aujourd’hui que M. Gerbaud retrouve de ses connaissances de Rome, au régiment des Zouaves pontificaux ! Comme ces braves sont heureux de lui serrer la main !
Nous nous informons auprès de M. le Curé, du nombre de zouaves fournis par la paroisse de Campbon.
— Trente-huit, nous répond-il, en y comprenant, il est vrai, quelques volontaires de l’Ouest, qui ont combattu sous Cathelineau.
Au travail, faut-il le dire, M. Gerbaud eut, plus d’une fois, besoin de modérer sa troupe, faisant remarquer, qu’en tirant trop vivement un bloc de rocher, ils couraient risque d’en renverser un autre déjà placé, et qu’ainsi la besogne n’avancerait pas. Mais en réalité la besogne avança et se fit bien.
Vers la fin de la journée, nous eûmes sous les yeux un spectacle qui rappelait, sans qu’on y eût songé, un fait de la vie de notre Bienheureux, à sa mission de Campbon (1709). Voulant faire disparaître un abus, qui allait à transformer les églises en cimetières, il fit rester, un jour, les hommes seuls, après son instruction. Puis, leur ayant expliqué, en quelques mots, son dessein de rendre leur église plus convenable et les voyant bien disposés: « Allons, mes enfants, leur dit-il, mettez-vous huit sur chaque tombe, quatre sur celles qui sont moins pesantes, et deux sur chaque pavé. » Cet ordre fut exécuté, sur le champ. Maintenant, ajoute-t-il, « prenez la pierre sur laquelle vous êtes placés et la portez dans le cimetière. » Ce fut fait dans un instant, et dans une demi-heure au plus, l’église fut débarrassée.
M. Gerbaud, lui, fit placer d’abord ses Campbonnais, armés de leurs pioches et de leurs pelles, sur deux lignes, se faisant face; un peu au-dessous du Jardin des Oliviers. Puis passant entre les rangs, faisant avancer ceux-ci, rentrer un peu ceux-là, les lignes de droites qu’elles étaient devinrent sinueuses. « Et maintenant, dit-il, que chacun, avec son instrument, enlève la première couche de terre qui est devant lui. » En un moment, le cours du torrent de Cédron fut dessiné sur le sol. Il n’y aura qu’à creuser plus profondément son lit.
Mardi, 23 Février. — Férel
Après une semaine employée toute entière au Calvaire, à des occupations bien différentes, les travaux du Jardin des Olives reprennent aujourd’hui. Mais, c’est la dernière limite qui nous est donnée pour terminer ce compte-rendu.
Saluons la première paroisse du Morbihan, qui veut bien nous apporter son concours. C’est Férel situé sur les bords de la Vilaine à cinq lieues d’ici. Pour arriver à pied, avant huit heures, il en est qui se sont mis en route à trois heures et demie du matin. Et au moment de ce départ nocturne, la pluie tombait en abondance sur Férel. L’excellent Curé est arrivé le premier, pour procurer à ses paroissiens l’avantage d’entendre la sainte messe, dans la chapelle du pèlerinage, avant de commencer les travaux. Quel courage et quel dévouement de la part de tous ! Ils en ont été récompensés par une journée très belle, ensoleillée, et admirablement remplie par le travail et la piété.
Tous nous quittent, le soir, en nous assurant qu’ils reviendront plus nombreux.
†
Nos lecteurs comprendront sans peine que l’élan généreux de nos travailleurs volontaires nous a entraînés plus loin que nous ne pensions, et que nous renvoyons à plus tard certains sujets que nous pensions aborder aujourd’hui.
A la dernière heure le R. P. Supérieur reçoit une lettre de Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes, où il est dit: Je vois avec un vrai bonheur que les travaux pieux dont vous vous occupez, avec tant de zèle, sont toujours eu bonne voie.
N° 7 Avril 1892
Les travaux du Jardin des Oliviers
Une longue et difficile tâche nous est encore imposée aujourd’hui par les travailleurs qui se sont succédé au Calvaire, depuis un mois, parce qu’eux-mêmes ont accompli de beaux et grands travaux. Disons que maintenant les contours de la grotte sont terminés, cimentés, et qu’on va incessamment commencer le travail de la voûte.
Mercredi, 24 février. — Paroisse de Missillac – (2e Section).
C’est Missillac qui a l’honneur d’ouvrir cette nouvelle série de travaux. Et c’est la partie de cette grande paroisse qui porte le nom de Frèrie de Ste-Luce, qui a sa chapelle particulière sous ce vocable, et où l’on dit chaque dimanche une messe matinale.
C’est à cette messe que M. l’abbé Landeau a convoqué chaleureusement pour aujourd’hui les braves habitants de Ste-Luce, et cette convocation a été renouvelée par M. le Curé, à la grand’messe.
Les voilà, au nombre de quatre-vingts. M. le Curé et M. le Vicaire, qui ne les quittent pas de toute la journée, doivent être contents d’eux. Ils ont chanté avec entrain et travaillé de même.
Ce jour-là, nous avions la visite de M. J. Vallet, l’artiste nantais à qui nous devons le beau groupe de la Flagellation. Il était venu examiner notre grotte de Gethsémani, à un point de vue particulier que l’on devinera sans peine. Il ne pouvait se lasser d’exprimer sa satisfaction du spectacle qu’il avait sous les yeux. Le Salut fut donné par M. le Curé. Jeudi,
25 février. — Paroisse de Donges.
Nous ne blesserons personne en disant que nous avions tout particulièrement à cœur devoir les paroissiens de Donges venir prendre part à nos travaux. Un grand nombre d’entre eux habitent des villages très éloignés de l’église, où ils ne paraissent que très rarement. Cependant, nous savions qu’ils gardaient religieusement le souvenir du bon Père de Montfort.
Le R. P. Supérieur est allé les visiter dans leurs maisons, pour raviver ce souvenir, et a reçu partout le meilleur accueil.
Au jour fixé pour venir au Calvaire, ils sont là plus de cinquante. Et si le temps n’avait été très pluvieux le matin, ils auraient dépassé la centaine. Du reste, la journée est belle, tout s’y passe admirablement, non seulement pour le travail, mais pour le chant des cantiques, la récitation du chapelet, le Salut du soir. Nul doute que le vénérable, Curé de Donges n’en ait emporté une vraie consolation et de bonnes espérances.
Quant aux travailleurs, ils expriment hautement, au départ, leur désir d’être convoqués une autre fois, pour revenir plus nombreux.
Vendredi, 26 février. — Paroisse de St-Dolay.
C’est la seconde paroisse morbihannaise qui vient prendre part à nos travaux. Les paroissiens de St-Dolay, souvent évangélisés par les Fils de Montfort, connaissent bien et aiment son Calvaire. Aussi c’est au nombre de cent qu’ils nous viennent sous la conduite des deux Vicaires. L’un d’eux dit, en arrivant, la sainte messe, à laquelle tous assistent. L’autre fait chanter le beau cantique : Je suis Chrétien, qu’on ne se lasse jamais d’entendre répéter par des voix d’hommes, avec cet accent de conviction.
Nous ne dirons rien des travaux, sinon qu’ils se firent de manière à satisfaire pleinement celui qui les dirige; et c’est le meilleur éloge que nous en puissions faire.
Au milieu du jour, c’est un délassement pour les travailleurs, après avoir satisfait leur piété au Prétoire, de monter sur la plate-forme, d’où l’on découvre toute la partie du Morbihan qui se trouve en deçà de la Vilaine.
Mardi, 1er mars. — Paroisse d’Herbignac
C’est à M. le Curé-Doyen d’Herbignac qu’appartient l’excellente pensée d’inviter ses paroissiens à faire de cette journée, employée si mal et si follement par tant d’autres, un jour consacré à la piété et au travail en l’honneur de Jésus agonisant. Cent cinquante hommes ont répondu à son appel et nous arrivent avant huit heures, bien que la distance soit de quatre lieues. Tous assistent à la sainte messe, dite par M. le Doyen, dans la chapelle des pèlerinages. M. l’abbé Paquelet, vicaire, dirige admirablement les chants. Le travail va ensuite à merveille.
Les historiens du Calvaire font remarquer que lors des travaux dirigés par Montfort, il n’y avait pas de distinction entre le seigneur et le paysan quand il s’agissait de porter la hotte. Nous constatons aujourd’hui que M. A. de la Chevasnerie, qui habite un château sur la paroisse d’Herbignac, tient à conserver cette tradition, et ne cède sa place à personne quand le moment est venu de tirer à la chaîne. Il ne s’épargnera pas davantage, dans la soirée, à la plantation des arbres de l’allée qui monte du Prétoire au Jardin des Oliviers. Il est aidé dans ce travail par M. le Doyen, tandis que M. l’abbé Paquelet reste au milieu de ceux qui continuent les travaux de la grotte. Là une des pierres monumentales placée à droite, en entrant, restera comme souvenir de cette journée.
Avons-nous besoin de dire que c’est avec bonheur que, le soir, l’excellent Pasteur donna la bénédiction à ses chers travailleurs.
Tous rentrent dans leur famille le cœur plus content et plus joyeux assurément que ceux qui, plus tard dans la nuit, rentreront du cabaret.
2 mars — Mercredi des Cendres.
Nous ne pouvions, ce jour-là, convoquer une paroisse. Nous avions fait seulement appel aux hommes de quelques villages assez rapprochés du Calvaire, la Cossonnaie, Coimeux, Quinta, la Bassinaie et L’Ornaie, de la paroisse de Crossac. Tous sont venus assister pieusement à la Cérémonie des Cendres, dans notre chapelle. Ils vont ensuite avec ardeur au travail. Sans nul doute, cette journée leur comptera pour beaucoup dans ce qu’ils doivent faire pour Dieu, pendant la sainte Quarantaine.
3 mars — Saint-Malo-de-Guersac.
Population de marins et aussi d’ouvriers des Chantiers de la Loire. C’est dire que nous ne pouvions compter là sur le grand nombre. Ils sont une cinquantaine au plus, mais des hommes habitués à braver toutes les intempéries des saisons. Le froid piquant qu’il faisait ce jour-là ne les a point arrêtés. Ils sont habitués aussi à remuer les plus lourds fardeaux. Un simple hasard nous fait connaître, travaillant au milieu des manœuvres, un ancien entrepreneur retiré des affaires et qui a dirigé les travaux les plus importants à Saint-Nazaire et ailleurs. M. le Curé reconnut lui-même une dizaine de capitaines retraités. Avec de tels hommes, le travail ne pouvait manquer d’aller très bien. Aussi, M. Gerbaud crut-il devoir les féliciter chaudement à la fin de la journée. Du côté religieux, tout fut aussi parfait.
4 mars, Vendredi — Ste-Anne-de-Campbon.
Certes, la paroisse de Sainte-Anne-de-Campbon a montré de la bonne volonté. C’est au nombre de deux cents que ses travailleurs arrivent sous la conduite de M. le Vicaire, chantant des cantiques. Tous ne pouvaient être occupés en même temps aux pierres de la grotte. On résolut de transporter la terre du lit du Cédron pour faire des terrassements derrière la grotte même. Pour cela, il fallait un certain nombre de charrettes. Au premier signal, nos bons voisins des villages de la Pintaie, des Métairies, de la Berneraie, nous les amenèrent. Le temps était un peu dur.
Le vénérable Curé de Ste-Anne passa toute la journée, au milieu des travailleurs, et leur donna le Salut du soir.
†
Le samedi, 5 mars, quelques hommes du Buisson-Rond, convoqués seulement la veille au soir, vinrent avec la meilleure bonne volonté, continuer les travaux.
†
La semaine suivante M. Gerbaud, l’infatigable directeur de nos travaux, prenait un congé.
Du reste, si on se le rappelle, le temps devint tel que la continuation des travaux de la grotte eût été impossible. Toutefois, dans cette semaine de froides giboulées, il y eut un jour plus doux, accordé, pensons-nous, aux prières des pieuses Briéronnes de St-Joachim.
Le Bienheureux Montfort, en élevant son Calvaire faisait chanter autrefois :
Travaillons tous, à ce divin ouvrage
Dieu nous bénira tous
Grands et petits, de tout sexe et tout âge.
Bref, les paroissiennes de St-Joachim témoignaient hautement le désir de renouer la tradition sur ce point. Un jour leur fut fixé, le mercredi, 9 mars. Elles se trouvèrent quatre cents, dès huit heures du matin, à la messe que dit leur vénérable Curé, dans la chapelle du pèlerinage. On se rendit sur la lande, en récitant le chapelet. Le travail qui leur fut demandé, pour être facile, n’en était pas moins méritoire.
On les vit, spectacle curieux, suivant chacune son sillon, recueillir, les unes dans des paniers, les autres dans leur tablier, tous les petits cailloux, qu’on trouve, ici, en abondance, dans les champs. Toutes portaient leur cueillette au tombereau qui attendait sur le chemin et transportait les cailloux autour du Prétoire, pour faire un drainage qui rendra le monument bien plus abordable en tout temps.
Un certain nombre étaient occupées de la même manière au transport du sable qui devait être étendu sur les cailloux.
Nous ne dirons pas que, pendant tout le travail, la lande de la Madeleine resta silencieuse, mais on y eut toujours le spectacle d’une réunion pieuse accomplissant un acte de foi.
Au milieu du jour, la visite au Calvaire apparut comme une véritable procession, montant les longs escaliers. Le Rosaire, en entier fut récité dans la journée, bien des cantiques chantés et, le soir, le salut fut très solennel.
†
Il nous reste encore à redire les faits et gestes de la seconde semaine de Carême, jusqu’au jour de la fête de S. Joseph.
Dès le lundi, M. Gerbaud nous est arrivé, pour préparer avec quelques hommes seulement le travail de la semaine.
Mardi, 15 mars. — paroisse d’Assérac
A leur allure vive, à leur chant bien nourri, nous reconnaissons les habitants des bords de la mer. Il en est qui viennent de la pointe de Pennebé (fin de la terre). Nous ne les verrions pas à une heure si matinale, si tous les véhicules de la paroisse n’avaient été requis à l’avance, de manière à permettre à tous de faire en voiture une partie de la route qui, pour le plus grand nombre, est de 6 à 7 lieues.
Tous assistent à la messe dite par M. le Curé. On y chante de beaux cantiques. Rappelons qu’on désigne assez souvent Assérac en disant : C’est la paroisse où tout le monde chante aux offices, hommes et femmes ; et où, même aux vêpres, les hommes sont toujours aussi nombreux que les femmes.
Quels excellents auxiliaires M. Gerbaud trouva, toute la journée, dans cette troupe d’élite, composée en majeure partie de jeunes gens, d’après le conseil qu’avait donné M. le Curé lui-même. Nous ne pouvons entrer dans le détail des travaux qui furent faits. L’excellent pasteur exprimait bien haut la satisfaction qu’il éprouvait. Si nous ne craignions d’être indiscret nous pourrions citer des paroles montrant bien qu’il n’échangerait pas facilement pour d’autres ses paroissiens. Et nous savons que, d’autre part, ses paroissiens tenaient un langage analogue.
Le soir, en se quittant, on se disait de tout cœur : Au revoir !
Mercredi, 16 mars
Fidèles et dévoués habitants de Crossac, toujours prêts à venir prendre la place d’une paroisse, qui, pour une cause imprévue, fait défaut. C’était le cas, ce jour-là. Mais nous ne pouvions nous attendre à vous voir si nombreux, n’ayant convoqué que les villages de la Gaine, de la Giraudaie, du Souchay, de Rault et delà Bussonnaie!
Le Bienheureux Montfort ne peut manquer de vous continuer cette protection, qui a paru si spéciale, que les autres ont pu s’en montrer jaloux.
Jeudi, 17 mars — Paroisse de Sévérac.
Sévérac a répondu grandement à l’appel qui lui a été fait. Ils sont venus, près de deux cents hommes, exprimant le regret que nous partagions nous-mêmes, de n’avoir pas, à leur tête, leurs prêtres retenus par le ministère. La journée a été édifiante et bien remplie. Le lit du Cédron a été creusé plus profondément. Les terres qui en ont été extraites, transportées pour faire des terrassements derrière la grotte, par des charrettes amenées des villages de la Madeleine, de la Plaie, de la Noë et de Travers. La grotte elle-même a été remplie d’une grande quantité de rondins de bois, qui tiendront lieu d’échafaudage pour la construction de la voûte.
Vendredi, 18 mars — Paroisse de Prinquiau.
Prinquiau situé dans une direction opposée, nous envoie, des bords de la Loire, une cinquantaine de travailleurs bien décidés.
La grande partie de la journée fut occupée à déraciner, et à transporter à une assez grande distance une pierre énorme, qui fut dressée ensuite à la manière des pierres levées ou menhirs des anciens druides. D’après quelques explications entendues dans la journée, les bons travailleurs de Prinquiau avaient compris qu’outre la grotte de Gethsémani, il entrait dans les plans de marquer, dans le jardin, l’emplacement de diverses scènes de la Passion. Leur pierre une fois dressée, quelqu’un demande si ce ne serait pas la pierre des Apôtres. On fit remarquer qu’elle n’était pas disposée pour cela, les Apôtres s’y étant étendus pour dormir. Pourvu, du moins, que ce ne soit pas la pierre de la trahison de Judas! s’écrièrent ensemble plusieurs voix. M. Gerbaud s’empressa de rassurer tout le monde; et en attendant, ce sera la pierre de Prinquiau qui jouit, au contraire, d’un renom bien mérité de fidélité aux bonnes et anciennes traditions.
Samedi, 19 mars. — Fête de Saint-Joseph.
Notre excellent directeur des travaux nous dit lui-même qu’il a attendu ce jour pour la pose d’une pierre importante dans sa construction.
Le pilier, qui est à peu près au centre de la grotte, est formé par trois gros blocs reliés ensemble, et atteint déjà une certaine hauteur.
Mais il faut le surélever encore, en y ajoutant une pierre d’un mètre de haut, au moins, et d’une pesanteur considérable. Là, le nombre et la force des bras ne suffiraient pas.
Par une coïncidence remarquée, c’est un excellent maître charpentier de Crossac qui prête l’instrument nécessaire, et que M. Gerbaud laisse commander la manœuvre. Les préparatifs demandent quelque temps. Mais lorsque tous les câbles sont bien amarrés, que la pierre elle-même est bien fixée dans sa ceinture de fer, on la voit s’élever doucement, sans secousse, et enfin se poser comme d’elle-même, à la place marquée. Il n’y a plus qu’à la cimenter et le tout paraît d’une solidité parfaite.
Puisse saint Joseph, dont nous célébrons aujourd’hui la fête avec toute la solennité possible, joindre sa haute protection à celle de notre Bienheureux, et nous continuerons d’être préservés dans nos travaux de tout accident fâcheux.
N° 8 Mai 1892
Bénédiction de la Grotte de Gethsémani au Jardin des Oliviers
Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Nantes a bien voulu en fixer la date au lundi, 6 juin, par la lettre suivante que nous nous empressons de communiquer aux lecteurs de l’Ami de la Croix.
ÉVÊCHÉ DE NANTES le 22 avril 1892.
Mon bon Père,
Je suis extrêmement heureux d’apprendre que les travaux de la Sainte Grotte sont très avancés. Le lundi de la Pentecôte me semble tout désigné pour l’inauguration du pieux monument. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour présider cette grande et touchante cérémonie. Je ne doute pas que ce jour-là surtout Notre-Seigneur ne se plaise à répandre ses plus précieuses bénédictions sur toute l’assistance, mais très spécialement sur ces milliers d’hommes qui sont venus, avec tant de zèle et de foi, travailler à la construction d’un édifice sacré entre tous, et dont chaque pierre redira aux générations futures que même à la fin de notre XIXe siècle il s’est rencontré dans nos régions, de fermes et vaillants chrétiens dont le cœur ne s’est laissé ni troubler, ni amollir par le souille mauvais de l’impiété contemporaine. On ne saurait trop les en féliciter.
Agréez, mon bon Père, l’assurance de mon affectueux dévouement en N–S.
† JULES, Ev. de Nantes.
Le Jardin des Oliviers et la Grotte de Gethsémani
Voici venir l’anniversaire de la grande nuit des souffrances et des humiliations de l’Homme-Dieu, et qui commence au Jardin des Oliviers. A cette heure même, les dernières pierres de notre Grotte de l’Agonie seront peut-être posées. Ce soir-là, dans mille églises chrétiennes la voix du prédicateur fait revivre pour l’auditoire ces grands souvenirs, et jamais, sans toucher les cœurs.
Mais quel avantage ne sera-ce pas d’en avoir, ici, la représentation fidèle sous les yeux ; ce torrent du Cédron que Jésus franchit, en prononçant les dernières paroles de son beau et si louchant discours après la Cène. — L’entrée du Jardin de. Gethsémani, où il dit à ses Apôtres : Reposez-vous là, pendant que je vais moi-même prier… prier pour vous.
Un peu plus loin dans l’intérieur du Jardin, c’est jusque-là qu’il a permis à Pierre, Jacques et Jean de le suivre. Voilà le rocher sur lequel tous les trois se sont endormis, malgré la recommandation du Maître, qui leur adresse ce doux reproche : « Vous n’avez pu veiller une heure avec moi ».
Et c’est à la distance seulement d’un jet de pierre que s’ouvre la sombre grotte où Jésus agonise. Le voilà prosterné, inondant la terre, non seulement de ses larmes, mais aussi de son sang, redisant la même prière : « Mon Père, s’il est possible, que ce calice s’éloigne de moi ! » Voici l’Ange descendant du ciel pour le consoler, le conforter, dit l’Evangile, et la grande parole qui décida du salut du monde : «Non pas ma volonté, ô mon Père, mais que la vôtre se fasse, » est dite. Et il se relève, prêt à tout souffrir pour nous.
Et déjà le traître qui doit le livrer à ses bourreaux vient de pénétrer par une entrée plus secrète dans le Jardin.
Voici la place où après avoir terrassé d’une parole les soldats qui viennent pour l’arrêter, et reçu le baiser de Judas, il se livre lui-même, pour être conduit à la mort du Calvaire.
A l’heure, où nous commençons ces lignes, pour continuer de rendre un hommage mérité à tous ceux qui prêtent un si généreux concours à la création de notre Jardin des Oliviers, nous ne pouvions nous défendre de rappeler ces grands souvenirs.
Et maintenant, tout d’abord, que M. Gerbaud reçoive, ici, de nouveau, l’expression de notre reconnaissance pour s’être dépensé, ainsi qu’il l’a fait, dans la direction du travail grandiose, dont il a bien voulu se charger.
22 Mars. — La Chapelle-Launay
C’est, croyons-nous, la vingtième paroisse qui répond à l’appel qui lui a été fait de venir concourir à l’exécution des projets conçus par le Bienheureux lui-même, et qui lient à montrer qu’elle n’a point dégénéré depuis le passage de Montfort dans la contrée.
Les travailleurs sont au nombre de quatre-vingts. C’eût été un grand bonheur pour l’excellent Pasteur d’être à leur tête. Mais retenu par une indisposition, il est remplacé par M. le Vicaire, qui dit la sainte messe, dès que tous sont réunis dans la Chapelle du Pèlerinage. On ne peut s’empêcher d’être touché de l’attitude recueillie de ces braves chrétiens, de l’accent de foi avec lequel ils redisent les refrains que le grand missionnaire apprit autrefois à leurs Pères.
Au travail, tout se passe dans un ordre parfait. M. l’abbé passe la journée entière au milieu, ou plutôt, au nombre des travailleurs.
Une particularité de cette journée fut une première plantation au Jardin des Oliviers. Nous n’avons guère l’espoir d’acclimater, ici, l’olivier lui-même. L’essai cependant en sera fait. Mais en attendant, la pensée est venue de faire un petit massif de chênes-verts, dont la feuille cendrée imite assez bien celle de l’olivier. Si les plants ne réussissaient pas, ce ne serait point que les travailleurs de la Chapelle-Launay n’auraient pas suffisamment fouillé la lande. Certes là, comme ailleurs, ils tenaient à bien faire.
Le même jour, des charrettes de la Viotterie, des Métairies, du Buisson-Rond transportaient des pierres autour du Prétoire.
23 Mars. — Paroisse de Férel
C’est la seconde fois que nous inscrivons le nom de cette paroisse morbihannaise.
On n’a pas oublié, peut-être, que la première fois, une averse terrible qui menaçait de se prolonger, n’avait point arrêté M. le Curé et bon nombre de ses paroissiens. Mais aussi un bon nombre d’autres exprimaient hautement leur regret de n’avoir pas fait partie de la première expédition. Voilà comment les paroissiens de Férel sont ici aujourd’hui, près d’une centaine. Ils sont conduits par le Vicaire, M. l’abbé Guyot, nom cher aux congrégations fondées par le Bienheureux de Montfort, C’est lui qui dit, le matin, la messe des travailleurs et qui les accompagne partout dans la journée. Comme ancien pèlerin de Jérusalem, il s’intéresse particulièrement à tous les détails de la pieuse entreprise. Le travail est actif autour du Prétoire et autour de la Grotte.
M. le Curé, si dévoué à notre œuvre, a dû être content le soir, en apprenant comment la journée avait été si bien remplie.
Nous n’oublions pas, ici, le cantique si bien chanté de Notre-Dame-de-Bon-Garant, dont la légende est si gracieuse et que tous les habitants de Férel invoquent comme leur protectrice spéciale.
†
Ce même jour, plusieurs villages de la paroisse de Pontchâteau ont fourni des charrettes pour le transport des pierres et du sable. Ce sont les villages de la Jouberaie, de Beaulieu, d’Epart et de Cottrais.
27 Mars. — Paroisse de Saint-Roch
Les habitants de Saint-Roch sont fidèles aux anciennes traditions. Ils aiment le Calvaire et sont pleins de confiance dans l’intercession du Bienheureux.
Aussi se sont-ils empressés de répondre à l’appel qui leur a été fait. Saint-Roch qui est aujourd’hui une belle et bonne paroisse faisait partie, il y a peu de temps encore, de celle de Pontchâteau. Il ne faut pas s’étonner si nos travailleurs d’aujourd’hui fraternisent si bien, avec les habitants de quelques villages de la paroisse de Pontchâteau même, qui sont venus se joindre à eux. Ce sont les villages de la Moriçais, de Beaumare, de Beaulieu, des Caves, qui ont amené leurs attelages pour transporter le sable et la pierre.
Le travail est actif partout, mais semble s’animer encore, quand apparaît, dans l’après-midi, M. le Curé de Saint-Roch, non seulement pour encourager ses paroissiens, mais pour mettre avec eux la main à l’œuvre.
Bonne journée pour nous sans doute, mais aussi, nous le savons, pour le Pasteur et pour le troupeau.
31 Mars. — Paroisse de Donges
Nous avions salué, avec une satisfaction particulière, dans notre dernier numéro, les travailleurs de Donges. Ils étaient venus nombreux, malgré le temps qui paraissait menaçant le matin ; et ils s’en étaient retournés si contents et si joyeux! Mais combien d’autres hommes de cette grande paroisse exprimaient hautement leurs regrets de n’avoir pas été de cette journée. Il a fallu une nouvelle convocation. Et voici un nouveau bataillon de Dongeois, aussi nombreux que le premier, arrivant sous la conduite de M. l’abbé Dautais, vicaire de la paroisse.
C’est aujourd’hui qu’on va pouvoir juger de l’effet que produira la voûte de notre Grotte. La première partie est terminée.
Les travailleurs emploient la matinée à retirer la quantité énorme de bois qui a tenu lieu d’échafaudage. Il faudra tout le replacer, ce soir, pour l’exécution de la seconde partie. Ce travail est accompli, par les Dongeois, dans un ordre parfait.
M. Gerbaud a pu constater que rien ne manque à la solidité de sa construction, et tous le félicitent en jugeant par ce que l’on a déjà sous les yeux de ce que sera l’ensemble.
On remarque parmi les travailleurs plusieurs vieillards, dont l’un a présents tous les souvenirs de la dernière restauration du Calvaire en 1821, qu’il rappelle en détail. C’est ainsi que se conservent les traditions. La paroisse de Donges qui avait pris part aux travaux de 1821, en souvenir du bon Père de Montfort, vient de s’assurer de nouveau sa protection, par les deux excellentes journées qu’elle nous a données.
5 Avril. — Paroisse de Nivillac.
C’est la grande paroisse morbihannaise de ce côté de la Vilaine. Aussi a-t-elle tenu à être bien représentée. Deux cents travailleurs ! Un bon nombre a fait la route à pied, et même quelques-uns à jeun (six lieues). Et ils sont là, dès le matin à sept heures, entendant la messe dite par M. le Recteur. M. l’abbé Lelarge est aussi venu apporter le précieux concours de sa voix pour le chant des cantiques, et en même temps le concours de ses bras pour le travail. Car on chante et on travaille, et avec une ardeur qui ne laisserait pas supposer la fatigue de la longue route faite le matin.
Mentionnons pourtant ce fait : Vers onze heures, on vit un des travailleurs s’appuyer péniblement sur un des rochers qui entourent la Grotte. Croirait-on que ce brave breton rentré tard, la veille, d’un autre voyage, à la maison, n’ayant pas dormi, de peur de manquer le départ pour le Calvaire fixé à deux heures, puis arrivé ici, suivant les autres à la Chapelle pour entendre la messe et ensuite sur la lande, était resté à jeun jusqu’à cette heure?
Nous ne saurions dire tout le travail accompli. Le cours du Cédron est prolongé, plusieurs énormes blocs de pierre mis en place. M. le Directeur des travaux témoigne sa satisfaction. Le vénérable Recteur, de son côté, paraît enchanté de cette journée.
Le soir, au salut solennel, on n’entend pas sans émotion ces deux cents voix d’hommes chanter ce refrain qu’ils ont redit bien des fois :
Je n’ai qu’une âme
Et je veux la sauver !
7 Avril. — Paroisse de Crossac
Après une première convocation générale de sa paroisse, et deux autres partielles déjà faites, M. le Curé a bien voulu encore une fois faire appel au bourg et à quelques villages, la Haie, Bosla, etc. C’est avec la même bonne volonté que ses paroissiens y ont répondu. Sa visite, dans la soirée, est accueillie avec la satisfaction la plus marquée. Il est là quand ses braves travailleurs dégagent la seconde partie de la Grotte dont la voûte est terminée; et comme on peut désormais juger de l’ensemble, l’appréciation qu’il en fait ne peut être indifférente ni à M. le Directeur des travaux, ni à nous.
Quant aux paroissiens de Crossac, nous n’avons qu’à leur souhaiter pour récompense de continuer d’être les privilégiés du bon Père de Montfort, comme ils aiment à se nommer.
11 Avril. — Paroisse de Missillac.
C’est un nom déjà inscrit sur notre liste. C’est la troisième section de cette grande paroisse convoquée par M. le Curé.
Des travailleurs, nous dirons tout en affirmant qu’ils se sont montrés, en tout, dignes de leurs devanciers des deux premières sections.
Personne n’ignore dans la contrée quelle union existe à Missillac, pour le bien de tous, entre l’autorité religieuse et l’autorité civile.
Nous remercions M. le marquis de Montaigu et M. le Curé, d’avoir bien voulu montrer, en venant ensemble prendre part à cette journée, qu’ils étaient aussi unis dans les mêmes sentiments de sympathie pour notre œuvre.
12 Avril. — Paroisse de S.-Joachim
Quels vaillants hommes que ces bons Briérons de S.-Joachim. Voyez-les plutôt, commandés par M. l’abbé Pabois, qui certes ne ménage pas sa voix, tirer à la chaîne avec ensemble. Il n’y a pas de rocher qui puisse résister.
S’ils sont au travail dignes d’éloges, ils n’édifient pas moins par leur foi et leur piété.
A la visite, qui se fait après-midi au Prétoire, ils demandent eux-mêmes à monter tous ensemble la Scala Sancta à genoux. C’est l’avant-veille du jour où Jésus teignit de son sang les degrés de l’escalier de Pilate.
Quels sentiments profonds de dévotion à la Passion du divin Maître, Montfort a su imprimer dans les âmes, autour de son Calvaire !
Tout le monde remarque dans cette journée un bon vieillard de 81 ans. Il a fait, ce matin, trois lieues à pied et ne reste pas inactif. Quand on l’aborde il tire en souriant de sa poche un petit livre bien maculé, bien usé. La date d’impression est du milieu du siècle dernier, mais le vieillard tient à montrer une note, où l’auteur du livre déclare qu’il l’a écrit près du tombeau de Notre Seigneur à Jérusalem en 1654. Le petit livre est illustré de vieilles gravures sur bois qui n’ont rien d’artistique. Mais avec quel contentement son heureux possesseur vous montre la grotte de Gethsémani, le torrent de Cédron, la pierre des Apôtres ! Surtout, avec quel accent de foi, il ajoute : « C’est mon petit livre à moi, je n’en lis pas d’autres. Mais dès que j’ai un peu de temps, je prends mon petit livre. C’est si beau de voir là, tout ce que le bon Dieu a fait pour nous ! »
N° 9 Juin 1892
Fête du 6 Juin 1892 au Calvaire de Pontchâteau : Bénédiction de la Grotte de l’Agonie
Les lecteurs de l’Ami de la Croix, savent que le Bienheureux Montfort avait conçu lui-même le projet de transformer la lande de la Madeleine, à Pontchâteau, en une autre Jérusalem, où seraient représentés tous les grands faits de la Passion de l’Homme-Dieu. L’année dernière, presque à la même époque, avait lieu l’inauguration du monument représentant le Prétoire de Pilate, où l’on voit le groupe de la Flagellation, œuvre du sculpteur nantais J. Vallet, qui fait l’admiration de tous les connaisseurs. Cette année, c’est une représentation du Jardin des Oliviers, avec sa Grotte de l’Agonie qui va être offerte à la piété des pèlerins. On y verra le Torrent du Cédron, le Rocher des Apôtres, où Pierre, Jacques et Jean s’endormirent, pendant que leur Maître priait, l’emplacement de la trahison de Judas.
La Grotte, nouvellement construite, est une reproduction aussi fidèle que possible de la vraie Grotte de Gethsémani. Elle a environ douze mètres de profondeur, sur cinq ou six de largeur. Trois gros piliers soutiennent la voûte.
Elle semble creuser dans le flanc de la colline; mais toutes les pierres qui en forment les parois et dont plusieurs sont des blocs énormes, ont été amenées et placées là, à force de bras, sans qu’on ait eu recours aux machines perfectionnées.
Tout ce grand travail a été dirigé avec autant d’habileté que de dévouement par un excellent chrétien de la Ville de Nantes, M. A. Gerbaud, ancien zouave pontifical, ancien pèlerin de Jérusalem.
Trente paroisses environ y ont pris part, et nous ont envoyé tour-à-tour plus de trois mille travailleurs volontaires. Ceux qui ont été témoins de ce qui s’est passé, ici, depuis plusieurs mois, ont pu se croire transportés aux jours où Montfort lui-même animait de sa grande voix celte solitude et y construisait son Calvaire. C’était le même élan, la même ardeur, la même foi. C’était le chant des mêmes cantiques, qu’il composa ici-même, et qu’il faisait redire à ses travailleurs. C’était la récitation du Rosaire telle qui l’apprit autrefois aux habitants de cette contrée. C’est ce spectacle qui inspirait à Sa Grandeur Mgr l’Évêque de Nantes, fixant la date de notre fête au 6 juin, la pensée d’écrire ces lignes :
« Je ne doute pas que ce jour-là surtout Notre-Seigneur ne se plaise à répandre ses plus précieuses bénédictions sur toute l’assistance, mais très spécialement sur ces milliers d’hommes qui sont venus, avec tant de zèle et de foi, travailler à la construction d’un édifice sacré entre tous et dont chaque pierre redira aux générations futures que même à la fin de notre XIXème siècle il s’est rencontré dans nos régions do fermes et vaillants chrétiens dont le cœur ne s’est laissé ni troubler, ni amollir par le souffle mauvais de l’impiété contemporaine. On ne saurait trop les en féliciter. »
Ceux qui ont été au travail et à la peine, doivent être aussi à l’honneur.
A la grande procession du 6 juin, tous les travailleurs, portant une décoration spéciale (Croix rouge de Jérusalem sur fond blanc), formeront une escorte d’honneur à la statue de Jésus agonisant qui sera portée triomphalement à la novelle Grotte de Gethsémani.
DISPOSITIF DE LA FÊTE
Toutes les paroisses, qui ont pris part aux travaux du Jardin des Oliviers, tiendront à venir à la fête du 6 juin avec croix et bannières.
Le matin, à 10 heures 1/2.
Messe à la Scala Sancta.
Allocution par le R. P. Cerisier, missionnaire de l’Immaculée-Conception de Nantes.
Bénédiction des deux statues de Jésus agonisant et de l’Ange consolateur.
Le soir, à 1 heure 1/2.
Procession générale.
Les deux statues sont portées en triomphe de la Scala à la Grotte.
Allocution par le R. P. Breny, de la Compagnie de Marie.
Bénédiction de la Grotte.
On retournera à la Scala pour le salut du Très Saint-Sacrement.
N. B. On imprime, en ce moment le petit Manuel du Pèlerin, spécial pour la fête du 6 juin. Outre le dispositif de la Fête, il contient tous les cantiques qui seront chantés tant à la cérémonie du matin, qu’à celle du soir. Deux de ces cantiques ayant pour titre : Le Cœur de Jésus agonisant, et Jésus au Jardin des Olives, dont les paroles sont du P. Montfort lui-même, ne se trouvent pas dans les autres recueils.
Travaux au Jardin des Oliviers
Nous tenons à rendre hommage à toutes les paroisses qui ont apporté à cette œuvre un si généreux concours.
C’est bien là que les derniers invités ont les mêmes droits que ceux qui ont été appelés les premiers.
Nous le disons surtout pour ceux qui voudront bien répondre à notre appel jusqu’au dernier moment. Notre grande fête du 6 juin approche ; et il reste encore beaucoup à faire.
Nous avons dès aujourd’hui à enregistrer les noms de trois paroisses qui n’avaient pas encore paru : Besné, Guenrouët et Bouvron.
21 Avril. — Paroisse de Besné.
Besné n’est pas très éloigné du Calvaire. Ses habitants peuvent y venir sans perdre de vue leur clocher qu’ils aiment bien et qu’ils ont bien des raisons d’aimer. Si le Calvaire a son Bienheureux,
Besné a ses saints, Saint Friard et Saint Second, dont il garde les tombeaux, depuis des siècles.
La paroisse de Besné travaille en ce moment même à la construction d’une église, véritable monument qui attestera aux âges suivants sa piété et sa reconnaissance envers ses saints protecteurs. Mais, un appel fait à cette religieuse paroisse, au nom du B. Père de Montfort, ne devait pas moins être entendu.
M. le maire de Besné, lui-même, était à la tête de l’escouade de travailleurs qui nous arriva le 21 avril.
Le travail fut très actif, dans toute la journée.
Dans la soirée, M. le Curé parut au grand contentement de tous, et voulut bien donner lui-même, avant le départ, le salut du Très Saint-Sacrement.
25 Avril. — Paroisse de Guenrouët.
Encore une paroisse qui a de grands sacrifices à faire, en ce moment, pour la construction de son église, après avoir déjà construit ses écoles libres, et qui cependant a voulu apporter son concours à nos travaux du Calvaire.
Il y a 20 kilomètres de Guenrouët au Calvaire. M. l’abbé Avenard les avait franchis, à pied, de bonne heure, pour être prêt à offrir le Saint Sacrifice de la Messe, dans notre chapelle, à l’arrivée dos travailleurs. On le verra, pendant toute la journée, au fort de la mêlée. Certes, il se fit ce jour-là, un travail considérable.
Il faut dire aussi qu’il fut facilité par la venue d’un certain nombre de bons paroissiens de Sainte-Reine, du village de Cusia, qui avaient amené jusqu’à cinq charrettes pour transporter les terres extraites du lit du Cédron, autour de la Grotte.
M. le Curé de Guenrouët donna le dernier complément à cette bonne journée, en présidant à la Chapelle, le pieux exercice du soir.
26 Avril. — Bouvron.
Bouvron est trop éloigné du Calvaire, pour qu’on ait pu songer à y venir à pied pour donner une journée de travail. Quelques-uns ont pris le chemin de fer, jusqu’à la ville de Pontchâteau. Le reste arrive en vingt chars-à-bancs requis dans toute la paroisse à cet effet, pour cette journée.
Les deux vicaires sont à la tête de cette vaillante troupe. L’un d’eux dit la Sainte Messe, dès que tous sont réunis.
Tous les deux paient grandement de leur personne pendant la journée entière.
On devine aisément quel travail dut se faire. De beaux blocs de pierre vinrent compléter la façade de la Grotte. Le lit du Cédron fut creusé plus profondément. Sainte-Reine nous avait encore envoyé du secours, ce jour-là. C’étaient les bons habitants du village de l’Organais, qui avaient amené leurs charrettes pour transporter la terre.
Un épisode de cette journée demande à être rappelé.
Dans l’après-midi, à l’heure où le travail était le plus actif autour de la Grotte, l’attention de ceux qui s’y trouvaient fut attirée vers le Calvaire. Un groupe d’une trentaine de jeunes hommes, ayant à leur tête quelques ecclésiastiques, y montaient en chantant l’Hymne à la Croix. Après une courte station sur la plate-forme, on les vit descendre à la Chapelle du pèlerinage, puis à la Scala, et de là se diriger vers le Jardin des Oliviers.
Or, voici ce qui se passait, au moment même où ils arrivaient. Les travailleurs de Bouvron avaient chargé sur un chariot à roues basses, une énorme pierre. Puis se mettant aux câbles, ils l’avaient amenée, sans trop de difficultés, à environ cent mètres de la Grotte. Mais, là, ne faisant pas attention que la terre était fraîchement remuée, et qu’on venait d’y combler un fossé, ils voient tout à coup le chariot s’enfoncer, les roues disparaissant presque à moitié. Vains sont les efforts réitérés pour sortir de là. Celui qui marchait à la tête du groupe dont nous venons de parler n’eut qu’à faire un signe. Soixante mains vigoureuses de plus avaient saisi les câbles. L’obstacle était franchi, et en un clin d’œil, l’énorme pierre se trouvait à la place qui lui avait été marquée.
Plus tard seulement, nous apprîmes que ces jeunes hommes appartenaient à l’élite de la société nantaise. Pourquoi et comment ils se trouvaient là, nous n’avons pas à le dire. Celui qui les conduisait n’était autre que le R. P. du Lac, de la Compagnie de Jésus.
Excellente journée, qui se termina comme à l’ordinaire, à la Chapelle, par la piété.
†
Depuis la fête de notre Bienheureux, notre Directeur des travaux prend un congé de quinze jours. C’est avec la pensée de remettre la main à l’œuvre, avec plus d’activité que jamais, après cette suspension momentanée.
Mais en attendant cette reprise des travaux, dont nous ne pourrons rendre compte désormais, qu’après notre fête du 6 juin, nous ne pouvons passer sous silence la bonne volonté dont a fait preuve une paroisse, qui, du reste, s’est toujours montrée très dévouée à l’Œuvre du Calvaire. Nous voulons parler de la Chapelle-des-Marais.
M. le Curé avait bien voulu convoquer son monde, pour le mercredi 4 mai. Mais, ce jour-là, la pluie tombait en abondance le matin, et semblait devoir continuer à tomber. L’avis presque général fut de renvoyer à un autre jour. Mais, une dizaine de braves vinrent au Calvaire et fournirent, dans la soirée, une tâche considérable. Le lendemain, il n’y avait pas de convocation nouvelle, que fallait-il faire? Une nouvelle escouade d’une dizaine de travailleurs vint offrir ses bras; et il en fut de même le surlendemain.
Mais nous savions que les habitants de la Chapelle-des-Marais attendaient un second appel. Il leur a été fait. Ils sont aujourd’hui au nombre de soixante. Ils ont l’honneur d’ouvrir cette dernière campagne dans laquelle, nous l’espérons, les travaux seront menés à bonne fin et achevés pour le jour de l’inauguration du Jardin des Oliviers.
N° 10 Juillet 1892
Fête au Calvaire de Pontchâteau – 6 Juin 1892
C’est le jour annoncé, attendu au Calvaire, pour le triomphe de Jésus agonisant, et qui doit être aussi un jour de triomphe pour son pieux serviteur Montfort.
Les Préparatifs
Rien n’a été négligé dans la précédente semaine pour compléter les préparatifs de ce triomphe.
Il faut voir tout d’abord notre Jardin des Oliviers, qui attend aujourd’hui même son Hôte divin. Il nous a été permis de mettre à contribution les bois voisins, et nous avons pu lui donner ainsi cette ceinture verdoyante qui l’a fait changer d’aspect. Sur les flancs de la colline à laquelle est adossée la grotte de l’Agonie surgissent comme par enchantement de jeunes pins dont la verdure fait mieux ressortir les contours sévères des rochers. A l’intérieur, et à l’extérieur même de la grotte, quelques touffes de mousse et de sedum, semées çà et là, lui donnent déjà un certain air de vétusté qui lui sied bien.
Dans la vallée, le torrent du Cédron, inachevé encore, fait cependant bonne figure avec ses bords et son lit caillouteux, qui rappellent ce paysage de pierres, dont parle Chateaubriand, dans son itinéraire à Jérusalem. On ne s’étonnera pas de le trouver desséché, dans les jours où nous sommes, si l’on se rappelle ce que les relations nous disent du vrai Cédron. Des joncs marins, quelques iris aux longues feuilles, des arums lui donnent une fraîcheur suffisante.
L’entrée du jardin est marquée par deux stèles ou colonnes de près de cinq mètres de hauteur. Les inscriptions qu’on y lit ne sont autres que la traduction en français de l’Evangile de St Luc, où est retracée toute la scène du jardin des Oliviers, depuis l’entrée de Jésus avec ses apôtres jusqu’à sa sortie après la trahison de Judas, alors qu’il s’est livré lui-même aux mains de ses bourreaux.
St. Luc est le seul des Evangélistes qui nous parle de l’Apparition de l’Ange et de la sueur de sang. Les cadres qui portent cette inscription, en bois de bouleau brut, s’harmonisent très bien avec les rochers de la Grotte et du Cédron.
De là, le regard embrasse d’un seul coup-d’œil toute l’étendue de la lande entourée d’une double rangée de mâts surmontés d’oriflammes qui indiquent le parcours de la grande procession du soir. Aux deux extrémités, le Prétoire et le Calvaire sont également pavoises.
Sur la route, les deux entrées de la voie de procession sont ornées d’ares de triomphe. Le premier dresse ses tours aux baies ogivales presque en face de la maison des Pères. C’est seulement avec le buis, la bruyère et la mousse que les enfants de l’Ecole Apostolique sont venus à bout de ce travail plein d’élégance et de fraîcheur.
L’autre arc de triomphe, plus sévère, apparaît non loin du légendaire Moulin de la Madeleine. Ses tours crénelées qui semblent noircies par le temps rappellent bien une des entrées sinon de la Jérusalem antique, du moins de Jérusalem conquise et fortifiée par les Croisés. C’est l’œuvre du Grand-Séminaire d’Haïti.
Tous les préparatifs dont nous venons de parler s’achevaient avec beaucoup de joie et d’entrain, lorsque nous fut apportée une nouvelle qui ne laissa pas que d’exciter dans tous les cœurs les plus vifs regrets. Monseigneur l’Evêque de Nantes, d’après l’ordre formel des médecins, partait pour les eaux de Royat : « A mon très grand regret, écrivait-il lui-même, je serai privé du bonheur de présider voire belle cérémonie à laquelle je souhaite tout l’éclat et tout le succès possible. »
Il ajoutait quelques mots attestant sa grande confiance dans l’intercession de notre Bienheureux, demandant qu’on le priât bien pour lui. Ce ne sont pas seulement ceux à qui s’adressait plus particulièrement cette demande, mais tous ses chers diocésains réunis si nombreux le 6 juin au Calvaire, qui ont prié, de tout cœur, pour l’affermissement complet d’une santé si chère.
C’est M. l’abbé Marchais, vicaire-général, que Monseigneur a bien voulu déléguer lui-même pour le représenter au milieu de nous.
L’arrivée des paroisses.
L’heure de la cérémonie du matin n’est pas encore venue; mais déjà les diverses processions des paroisses, croix et bannières en tête, arrivent sur tous les chemins qui aboutissent au Calvaire. Elles se sont annoncées par leurs chants ; car c’est chantant et en récitant le Rosaire que toutes ont l’ait deux, trois, quatre lieues et plus.
Les paroisses les plus éloignées ne sont pas en retard. Ainsi Férel occupe, une des premières, la chapelle du Pèlerinage pour vénérer les reliques du Bienheureux. Férel est suivi de près par Nivillac, autre paroisse du Morbihan. Il était beau, tout à l’heure, de voir les longues files de sa procession serpenter entre les blés, dans le chemin qui relie la grande route de la Roche-Bernard à celle de Guérande. Nivillac clôturait hier une grande mission. Les RR. Pères Rédemptoristes qui l’ont prêchée ont voulu prendre part à la joie de ce beau lendemain et marchent au milieu des rangs de la procession avec le clergé de cette excellente paroisse. Qu’ils soient les bienvenus au milieu de nous !
Par une autre voie, voici Crossac précédé de sa musique instrumentale habilement dirigée par M. le Vicaire. Toute la paroisse est là. Il n’y a, nous dit-on, que trois ou quatre personnes restées à la garde de chaque village.
Saint-Joachim suit de près avec sa longue, très longue procession. C’est cette paroisse qui offre à Jésus agonisant, pour qui elle a une dévotion spéciale, son Ange consolateur.
D’un autre côté c’est Campbon, Besné, la Chapelle Launay, puis encore la Chapelle-des-Marais, Drefféac, Missillac qui s’avance comme une petite armée, au son de ses tambours et de ses clairons.
Nous ne pouvons signaler ici, toutes ces processions partielles qui n’en formeront qu’une seule ce soir. Toutes vont se masser, sans se confondre grâce au groupement qui se fait autour des bannières, dans le vaste rectangle tracé en face de la Scella. La foule déborde bien au-delà.
Messe à la Scala
C’est alors qu’apparaît, descendant de la Chapelle des Pères à la Scala, le cortège officiel précédé par la musique de Crossac. Il se compose seulement des élèves de l’Ecole apostolique, d’un groupe nombreux de Filles de la Sagesse, du Grand-Séminaire d’Haïti et des prêtres venus en dehors des processions de paroisses.
M. le Vicaire-Général est assisté par le T. R. P. Maurille, supérieur général de la Compagnie de Marie et des Filles de la Sagesse, par M. le Curé de Saint-Nicolas de Nantes et plusieurs chanoines.
Dès que tous ont pris place sous les coupoles du Prétoire, M. le Curé de Campbon monte à l’autel.
C’est un grand et beau spectacle que le Saint-Sacrifice de la Messe, offert ainsi en plein air devant une foule qu’on peut évaluer à dix ou douze mille personnes, toutes unies dans les sentiments de la même foi. Au son de l’humble clochette, tous les fronts s’inclinent, les mains se lèvent en même temps pour tracer le signe de la croix. L’altitude de tous est profondément recueillie. Le temps aussi est à souhait, très calme et légèrement couvert.
Au commencement de la messe, nous entendons un premier chant en l’honneur du Bienheureux P. de Montfort ; mais bientôt c’est lui-même, c’est sa parole que nous entendons dans son beau cantique : O l’auguste Sacrement... qu’on n’a pas craint de comparer au Lauda Sion de Saint Thomas d’Aquin. C’est la même précision théologique, le même bonheur et la même simplicité d’expressions, malgré la hauteur du sujet, la même onction. C’est sans contredit l’un des plus remarquables et des plus populaires que notre Bienheureux nous ait laissés. Tous l’ont chanté aux jours de la première communion. Nul ne l’a oublié. Il est facile de s’en apercevoir lorsque sur divers points, en même temps, quelques voix en ont fait entendre les premières paroles. C’est vraiment toute la foule qui chante. Dans ce concert de milliers de voix, la mesure, sans doute, est mal gardée ; mais l’effet d’ensemble est beau et saisissant. Ce sont des vagues sonores qui, comme à certains jours celles du bord des mers, se poursuivent, se mêlent, s’entrecroisent sans se briser, et viennent l’une après l’autre expirer doucement au pied de l’Autel eucharistique.
Allocution du R. P. Cerisier
Le Saint-Sacrifice de la Messe terminé, le R. P. Cerisier apparaît au sommet de la Scala. Je comprends qu’il ne sente pas le besoin de recourir à un texte pour indiquer son sujet, il n’a qu’à tendre la main et à montrer à la foule le groupe saisissant qui est là sous ses yeux : l’Agonie de Jésus.
Prenant le premier la parole dans cette journée, il croit devoir commencer par rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette magnifique fête. Honneur et gloire à celui qui le premier a conçu le projet de reproduire en ces lieux les scènes si touchantes de la Passion du Sauveur. Honneur et gloire au Bienheureux Montfort ! Honneur à ses fils, si fiers de se conformer aux désirs du bien-aimé Père ! Honneur à cet homme si intelligent et si dévoué qui, après avoir combattu pour l’Eglise et pour la France, est heureux de consacrer, ici, ses loisirs à glorifier Jésus crucifié ! Honneur à tous ceux qui l’ont aidé, à ces vaillantes populations qui n’ont craint ni peine ni fatigues, pour transporter les blocs énormes qui forment la sainte grotte ! Honneur à l’artiste qui a tiré de ses mains et surtout de son cœur le chef-d’œuvre que nous avons sous les yeux ! Honneur enfin à la famille1, à la paroisse qui ont fait don des deux statues.
L’orateur rappelle alors d’après l’Evangile les phases diverses de l’agonie du divin Sauveur, les sentiments de crainte, d’ennui, de douleur et de tristesse qui envahissent son âme, au point qu’il dit lui-même : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; tristesse qui étreint tellement son cœur qu’elle détermine cette sueur de sang dont le sol de la grotte de Gethsémani est inondé.
Il tient à faire ressortir surtout les causes de cette tristesse, de cette douleur. Ces causes ne sont autres que nos péchés, nos ingratitudes, ainsi que le dit lui-même le B. Montfort dans ce cantique, que tous ont entre les mains et chanteront aujourd’hui :
Jésus voit la mort affreuse….
L’enfance, l’adolescence, la jeunesse, l’âge mûr, la vieillesse ont eu leur part dans ces douleurs, dans cette tristesse. Il n’est donc personne qui ne doive en être touché, y compatir. Et, de fait, nous ne croyons rien pouvoir dire de meilleur à l’éloge du prédicateur, sinon qu’il nous semble bien être interprète fidèle, lorsqu’au nom de tous il fait amende honorable au Cœur de Jésus agonisant.
Il rappelle en terminant comment autrefois Montfort faisait acclamer la croix dans ces lieux et demande à la foule émue de l’acclamer avec lui : Vive la Croix !
Bénédiction des Statues
Ensuite, au milieu d’un religieux silence, M. le Vicaire général revêtu de la chape bénit solennellement les deux statues de Jésus agonisant et de l’Ange consolateur.
La cérémonie du matin est terminée. Pendant que le clergé rentre au Séminaire, la foule se disperse.
Chez les Pères
A midi, les Pères offraient l’hospitalité au Clergé, et à quelques invités. M. l’abbé Marchais, vicaire général, avait à sa droite M. Pahier, maire de Pontchâteau, à sa gauche, M. le Curé de Saint-Nicolas de Nantes. Le T. R. P. Maurille, faisant les honneurs de la table avait à sa droite M. Le Cour, conseiller général de Savenay, à sa gauche M. Corbun de Kérobert, conseiller général d’Herbignac. Nommons encore M. Dubois, conseiller d’arrondissement et adjoint de Pontchâteau, M. le comte de Baudinière, MM. de la Chevasnerie, Gerbaud, Vallet, et, parmi les ecclésiastiques, M. l’abbé Grimaud, supérieur de l’Institution Saint-Charles, au diocèse de Rennes, accompagné à nos fêtes par deux jeunes Haïtiens qui font leurs études dans sa maison et qui nous ont édifiés pendant plusieurs jours par leur piété et leur excellente tenue.
A la fin du repas, le R. P. Barré, supérieur du Séminaire, prend la parole, et prie M. le Vicaire Général de vouloir bien transmettre à sa Grandeur ses regrets, les regrets de tous, en même temps que leurs vœux pour le parfait et complet rétablissement de sa santé. Puis, il adresse ses remerciements à M. l’abbé Marchais lui-même, à M. Pahier, maire de Pontchâteau, à tous MM. les Curés de la contrée. Il tient à dire bien haut à ceux-ci, que l’Œuvre du Calvaire est leur œuvre, puisque ce sont eux qui la réalisent, en venant ici, comme on les a vus venir, dans le courant de cette année, à la tête de leurs chrétiennes et vaillantes populations. Il félicite aussi M. Gerbaud, l’habile et dévoué directeur des travaux de la Grotte, M. Vallet, l’éminent artiste.
M. le Vicaire Général exprime les regrets que Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes éprouve de ne pas assister â cette belle fête. Mais sa pensée plane ici partout, dit-il, dans cette journée, et y préside en réalité.
Puis, s’adressant en particulier au R. P. Supérieur, il le remercie à son tour d’avoir préparé avec tant de zèle, de nous avoir procuré à tous le spectacle si réconfortant que nous avons sous nos yeux. Parfois, aux jours où nous sommes, on serait tenté de douter de l’avenir. Les contrées les meilleures, sans doute, ne sont pas complètement à l’abri du vent de scepticisme et de matérialisme qui souffle partout, menace de tout envahir et défaire disparaître l’antique foi. Mais non, le fonds n’est pas atteint. Ce n’est à la surface, qu’une poussière. Un jour, le souffle de Dieu passe et emporte cette poussière et l’on voit que les fils ne sont pas dégénérés de leurs pères.
M. l’abbé Marchais s’unit ensuite au R. P. Supérieur pour remercier, dans les termes de la plus exquise délicatesse, tous ceux qui ont concouru à l’éclat de cette fête, directeur des travaux, artiste, simples travailleurs. Et il porte un toast à l’épanouissement complet, au plein succès de l’Œuvre du B. Montfort au Calvaire.
Nous n’avons pas à louer la parole de M. le Vicaire-Général, mais c’est un devoir pour nous de dire qu’elle a été, à plusieurs reprises, vivement applaudie.
1La statue de Jésus agonisant est un don de Mme la Comtesse de Montaigu.
La Procession.
Au dehors, déjà s’organise la grande procession. Le point de départ est la Scala Sancta où reste exposé le magnifique brancard sur lequel apparaît le groupe de Jésus agonisant. C’est là que se réunit le clergé qui doit le suivre immédiatement. En même temps, les paroisses se sont groupées autour de leurs bannières, d’après l’ordre indiqué, dans tout l’espace qui s’étend de la Scala à la maison des Pères et sur la route qui monte au Calvaire, tandis que les hommes portant la décoration des travailleurs se sont aussi réunis par paroisses, en arrière de la Scala, pour être appelés successivement à l’honneur qui leur est réservé.
Au signal donné, tout s’ébranle. La fanfare de Missillac, la musique instrumentale de Crossac jettent leurs notes vibrantes dans les airs, le chant des cantiques pieux retentit partout à la fois, les croix brillent au soleil, les bannières et les oriflammes flottent au vent. Quarante hommes, et ce sont les travailleurs de Pontchâteau qui les premiers sont appelés à cet honneur, ont soulevé sur leurs épaules le brancard de Jésus agonisant. Vingt autres l’entourent, portant de riches étendards. C’est un spectacle vraiment grand, surtout édifiant, car tout y porte le cachet d’une foi vraie, d’une piété profonde. Ce spectacle a quelque chose de particulièrement intéressant quant au Calvaire on voit ce fleuve humain monter et descendre sans interruption les soixante-deux marches des longs escaliers.
Nous avons signalé les étendards ou bannières qui entourent Jésus agonisant. Il en est une qui attire particulièrement les regards, portée par M. Gerbaud, au milieu d’un groupe de travailleurs. Elle a son histoire, que nous nous faisons un devoir de donner textuellement d’après l’Espérance du Peuple, qui l’a recueillie avant nous : C’est la reproduction exacte de la célèbre bannière du Sacré-Cœur qui, au champ de Patay, a si fièrement flotté devant l’ennemi. Cette nouvelle bannière a été brodée par Mlle Henriette de Charette et donnée par le Général à son ancien zouave, en témoignage particulier d’estime et de reconnaissance. Il y a trois ou quatre ans, lors du premier pèlerinage français à Rome, M. Gerbaud avait porté cette bannière dans la basilique de Saint-Pierre, et le cardinal Langénieux avait attiré sur elle l’attention du Saint-Père, qui, en souvenir des zouaves pontificaux, a daigné la bénir et la baiser.
M. Gerbaud était là à l’honneur. C’était juste et il était juste que ses travailleurs y fussent tous aussi. Cependant le cortège de Jésus agonisant avait atteint les hauteurs de la lande et approchait du but.
C’est alors que le Père chargé de régler les pauses et le changement des porteurs se voit pressé de réclamations nombreuses apportées soit par un notable de la paroisse, soit par le Pasteur lui-même : « Nous n’avons pas encore été appelés, notre tour ne viendra pas. »
Il fallut, en effet, multiplier les pauses pour satisfaire l’empressement, le désir de tous. Et quand on arriva à l’entrée de la Grotte, deux mille hommes, au moins, avaient courbé leurs épaules sous le pieux fardeau. Un grand nombre d’autres durent se contenter de l’honneur équivalent de porter tour à tour les bannières du cortège.
Au Jardin des Oliviers. — Sermon du R. P. Brény.
La foule s’est accrue notablement depuis ce matin. On le voit, ici surtout, maintenant qu’elle remplit toute la vaste enceinte du Jardin des Oliviers. Un curieux bien placé près du Calvaire disait tout a l’heure : « J’ai compté, à diverses reprises, combien de personnes, par minute, descendent cet escalier. J’arrive toujours, approximativement, à la centaine, et voilà cinq quarts d’heure que cela dure, et ce n’est pas encore fini. » Ce seraient donc huit mille personnes environ qui auraient fait processionnellement l’ascension du Calvaire. Nous ne croyons pas exagérer en fixant à peu près au même chiffre le nombre de ceux qui formaient la haie sur tout le parcours et de ceux qui, pour diverses raisons, sont restés au pied du Calvaire. C’est cette double foule qui est réunie, en ce moment, au Jardin des Oliviers. Le sommet même de la Grotte est envahi. Le R. P. Brény a peine à se frayer un passage pour y arriver. C’est de là que nous allons l’entendre.
Rappelant le monument élevé par Josué après le passage du Jourdain, l’orateur se pose à lui-même la question que Josué avait prévue de la part des descendants d’Israël : Quid sibi volunt lapides isti! Que veulent dire ces pierres, les rochers qui forment cette grotte?
Il y voit : Un souvenir, un témoignage, une promesse.
Ce souvenir est fait des paroles tombées des lèvres divines, dans cette dernière soirée au Jardin de Gethsémani, après la Cène, dernières instructions du Maître à ses chers disciples et qui résument tout le dogme, toute la morale évangélique. Ce souvenir est aussi fait de l’exemple de toutes les vertus donné là, par le môme Maître divin : Humilité, patience, douceur, soumission à la volonté de son Père, charité incompréhensible envers le traitre lui-même. Enfin ce souvenir c’est celui du Bienfait suprême. C’est là qu’est accepté le calice cl y est assurée définitivement notre rédemption.
Au souvenir du Maître divin l’orateur ne craint pas de joindre le souvenir de l’humble mais fidèle serviteur. Montfort n’a-t-il pas trouvé, ici même, son jardin de Gethsémani, où il accepta héroïquement un calice des plus amers?
Ces pierres sont, en second lieu, un témoignage, Elles témoignent du dessein de Dieu sur ce coin de terre, sur cette lande, dessein révélé autrefois à Montfort : Dieu veut que la Passion de son divin Fils soit, ici, spécialement glorifiée — Dieu le veut ! Ces pierres témoignent aussi et témoigneront dans la suite des âges de la foi bretonne qui en a fait ce pieux monument. C’est là que le R. P, Brény rend à son tour un hommage aussi senti que mérité, à nos vaillantes phalanges de travailleurs, à leur vaillant chef, M. Gerbaud.
Enfin, il y a là une promesse : Promesse du secours de Dieu pour la continuation de cette Œuvre grandiose. Car le doigt de Dieu est là ! Digitus Dei est hic.
Appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent el doivent y concourir.
Promesse aussi de nouvelles grâces. La Grotte de Gethsémani est une source nouvelle ouverte pour l’effusion de ces grâces et bénédictions sur toute la contrée.
On comprendra que nous regrettons de ne pouvoir donner qu’une analyse bien pâle d’un discours dans lequel l’ardent missionnaire a dépensé si largement intelligence et cœur pour une Œuvre qui lui est chère à plusieurs titres, et à laquelle il s» montre si dévoué.
†
Nos lecteurs auront remarqué que nous nous sommes contentés d’enregistrer les éloges adressés à l’artiste qui nous a donné, après le groupe de la Flagellation, celui de l’Agonie de Jésus, objet extérieur du triomphe de cette journée. Nous voulions le voir, à la place qui lui était destinée. Il y est, et plus on le considère, plus on voit que l’artiste chrétien a médité, approfondi son grand sujet. On sait les termes accumulés par les Evangélistes pour exprimer les sentiments du Divin Agonisant : Cœpit pavere et tœdere… Contristari et mœstus esse… La crainte, l’ennui mortel, la douleur amère, la tristesse qui étreint le cœur, tous ces sentiments ont passé sur ce visage adorable ; mais celui qui y est empreint à cette heure, c’est cette tristesse profonde, vaste comme la mer, selon l’expression d’un prophète, et qui va jusqu’à l’abattement. Le Divin Agonissant s’est affaissé sur le rocher, sa tête est retombée sur l’un de ses bras, la main reste pendante. C’est le moment où Dieu le Père envoie du Ciel son Ange. Il apparaît au fond de la Crotte, les ailes déployées. D’une, main, il montre le ciel: Oportuit pati Christum…
Il faut que le Christ souffre, non seulement pour entrer dans sa gloire, mais pour y faire entrer avec lui cette multitude des élus que, de son autre main, penchée vers la terre, l’Ange semble montrer.
Ajoutons que la tristesse empreinte sur tous les traits de Jésus agonisant est divinement touchante, nous allions dire, attirante.
Trois jours après l’inauguration, un jeune pèlerinage accomplissait ses dévotions au Calvaire. C’était un petit pensionnat dirigé par les Sœurs de Sr-Gildas à l’Immaculée-Conception de St-Nazaire. Nous étions à la Grotte lorsque ces enfants y entrèrent. Rien ne les empêchait d’approcher le groupe de très près. Au premier mouvement nous vîmes passer sur tous les fronts l’expression du sentiment de compassion qu’on éprouve à la vue de la tristesse et de la souffrance. Puis, les deux plus rapprochées, des plus jeunes, (7 ou 8 ans), instinctivement avaient saisi l’une des mains du Divin Agonisant et la couvraient de leurs baisers.
Rien ne manque à la nouvelle Grotte pour être un sanctuaire on ne peut plus favorable au recueillement et à la prière. Elle a son autel, don de M. Gerbaud, où pourra être offert, de temps en temps, le Saint-Sacrifice. Il est certain, dès maintenant, en y voyant l’affluence et la piété des pèlerins que la journée du 6 juin a fait faire un grand pas à la réalisation des projets de Notre B. Père de Montfort.
Chronique du mois
Après le récit de notre grande fête, bien peu d’espace nous reste. Nous devons en user tout d’abord pour rendre justice et hommage aux paroisses qui ont répondu avec tant de générosité à notre appel, jusqu’au dernier moment, alors que leur concours nous était d’autant plus nécessaire que le terme approchait.
Le lundi 16 mai, Assérac nous envoyait, des bords de la mer, une nouvelle phalange de travailleurs qui ne le cédait en rien à celle que nous avions vue il y a quelques mois. Elle était dirigée par M. le Vicaire, en l’absence du vénéré Pasteur.
Le mardi 17, Drefféac, si dévoué à l’Œuvre du B. de Montfort, a voulu revenir en aussi grand nombre que la première fois.
Le mercredi 18, deux paroisses limitrophes fraternisaient ensemble. Théhillac avait à sa tête son excellent Recteur. Missillac, nommé pour la quatrième fois, était conduit par M. l’abbé Landau, vicaire, qui, d’après les habitudes que nous lui connaissons, se dépensa largement au milieu de ses braves travailleurs. Le vendredi 19, c’est Herbignac. Nous avons déjà vu les travailleurs d’Herbignac à l’œuvre, M. le Doyen étant présent. Aujourd’hui il a dû déléguer l’un de ses vicaires. De plus, M. Corbun de Kérobert, maire nouvellement réélu, son fils et M. de la Chevasnerie sont là, prenant part à tous les travaux de la journée.
Le lundi 23, deux paroisses, Saint-Dolay, du diocèse de Vannes, et Saint-Lyphard, du diocèse de Nantes, rivalisent d’ardeur pour l’achèvement de nos travaux. Toutes les deux ont déjà beaucoup fait pour notre Œuvre.
Signalons, outre la présence de MM. les vicaires de Saint-Dolay et Saint-Lyphard, celle de l’ancien vicaire de cette dernière paroisse, M. l’abbé Le Cerf, aujourd’hui vicaire à Soudan, heureux de se retrouver au milieu de ceux dont il avait partagé les travaux l’année dernière, au Calvaire. Plusieurs villages de Pontchâteau étaient déjà venus prendre part à nos travaux. Le lundi 28, c’est la ville elle-même qui est représentée par une escouade de travailleurs pleins de bonne volonté.
Plusieurs autres Pontchâtelains n’ayant pu venir ce jour-là, nous ont très opportunément apporté le secours de leurs bras, au moment des derniers préparatifs de la fête.
Le mardi, 31 mai, a été la dernière et incontestablement une des plus belles de ces grandes journées de travail volontaire consacrées à Jésus agonisant.
A quelle heure les cent vingt volontaires de Marzau avaient-ils franchi la Vilaine, distante au moins de quatre lieues? Ils étaient ici dès 5 heures 1/2, pour entendre la messe dite par M. le Recteur.
De son côté, M. le Curé de Besné arrivait, un peu plus tard, également à la tête d’une centaine de travailleurs. Partout, quel entrain et quelle ardeur ! De plus, une paroisse plus éloignée, Massérac accomplissait au Calvaire un pèlerinage de piété, ce jour-là même, sous la conduite de M. le Curé et de trois autres ecclésiastiques. Travaux, prières et chants pieux formaient sur la lande un ensemble des plus édifiants.
Ici se termine le récit de cette campagne glorieuse des travailleurs du Jardin des Oliviers.
Un dernier mot : Le soir même de la fête, entrant dans la Grotte de l’Agonie, après que la foule se fût écoulée, nous aperçûmes un ex-voto déjà scellé presqu’en face de Jésus agonisant. La plaque de marbre portait ces simples mots : Action de grâces. 6 juin 1892. Et pour toute signature : la petite croix de Mentana. Nous comprîmes tout sans peine.
C’était l’accomplissement d’une promesse faite dès le commencement par notre excellent Directeur des travaux, si tout allait bien, sans accident. Et Dieu sait que dans plus d’une circonstance, il eût été difficile de ne pas voir une protection spéciale sur nos bons travailleurs.
†
Notre registre des recommandations et des actions de grâces est là, ainsi que notre correspondance. Les récits intéressants de guérisons, de conversions ne manquent pas. Nous sommes obligés de renvoyer tout à plus tard.
†
La fête terminée, M. le Vicaire général de Nantes adressait au R. P. Supérieur cette question, qui, du reste, était sur bien des lèvres : « Et l’année prochaine, que nous donnerez-vous ? » « Nous ne demandons pas mieux, fût-il répondu, que de marcher en avant et d’entreprendre la voie douloureuse ; mais pour cela des ressources sont nécessaires. » Les lecteurs de l’Ami de la Croix, en faisant connaitre de plus en plus autour d’eux l’Œuvre, les projets de notre Bienheureux Père de Montfort, peuvent certainement beaucoup pour nous les procurer. Ils n’y manqueront pas.
N° 14 Novembre 1892 – La conque du P. de Montfort
Nous aurions dû dire, peut-être, la Corne du P. de Montfort, puisque c’est le terme dont on se sert le plus souvent pour désigner l’objet dont nous voulons parler. Mais, en réalité, c’est une véritable conque marine, gros coquillage univalve, largement évasé. D’une teinte rosée à l’intérieur, l’extérieur est d’une couleur plus sombre.
Le côté opposé à l’ouverture naturelle, et qui se termine en pointe, a été coupé ou limé de manière à former une seconde ouverture dans laquelle un doigt peut pénétrer. C’est en soufflant par cette seconde ouverture qu’on obtient un son bien nourri, et qui, prolongé surtout, se fait entendre au loin.
Aujourd’hui, dans les plus petits ports, c’est le sifflet de la chaudière, un jet de vapeur qui avertit les passagers du moment de l’embarquement. Mais, nous nous rappelons avoir embarqué autrefois, sur une simple chaloupe, dont le patron se servait d’un instrument semblable à celui que nous avons sous les yeux. Quel marin fit cadeau de cette conque au saint missionnaire? Dans quelles circonstances en devint-il propriétaire? La tradition ne nous dit rien à ce sujet. Mais il est certain qu’il s’en est servi, et, notamment ici, pendant la construction de son Calvaire.
Dans cette lande déserte, il n’y avait pas autrefois de cloche pour marquer le commencement, l’interruption, la reprise des travaux; pour annoncer que le missionnaire allait parler ou qu’il allait entonner un cantique. La conque servait à tout cela. Puis, l’ardent missionnaire, pendant les quinze mois que durèrent les travaux du Calvaire, n’avait pas interrompu le cours de ses missions. De Missillac, d’Herbignac, de Camoël, d’Assérac, où il prêcha, dans cet intervalle, il venait, dès qu’il avait un jour libre, visiter et encourager ses chers travailleurs. La conque annonçait qu’il était là, qu’on était sûr de l’y voir et surtout de l’entendre. Enfin, tous savent que Montfort ne prêchait pas l’seulement dans les églises et les lieux consacrés, mais sur les places publiques, sous les halles, dans une grange vide lorsqu’il s’en rencontrait. Traversait-il un village, quelques sons de sa conque en avaient bientôt averti tous les habitants qui se pressaient pour entendre quelque bonne parole d’exhortation ou d’encouragement.
Après cela, il est facile de comprendre que les gens de la contrée tinrent à garder précieusement un objet qui rappelait de tels souvenirs.
En 1748, lors de la première restauration du Calvaire, il est probable que la conque du bon P. de Montfort fut remise entre les mains du P. Audubon, qui, pour surveiller les travaux, séjourna près de deux ans à la maison voisine du Deffais. Il est probable qu’il s’en servit lui-même.
Puis, elle resta déposée dans la chapelle bâtie à cette époque à côté du Calvaire. On l’y voyait encore aux jours qui précédèrent la grande Révolution.
Nous avons raconté ailleurs qu’un jour, pendant la Terreur, des misérables vinrent mettre le feu à cette chapelle. C’est dans cet incendie que disparurent toutes les statues que Montfort avait fait sculpter pour son Calvaire, à l’exception du Christ qui avait été transporté à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Quant à la conque, nous ne savons si des mains pieusement prévoyantes l’avaient mise auparavant en sûreté, ou si elle fut retirée des décombres après l’incendie. Elle avait déjà passé en plusieurs mains, lorsque M. Vergé, curé de Sainte-Reine, la retrouva dans une maison voisine du Calvaire, au petit village des Métairies. C’était peu de temps avant l’établissement de la résidence actuelle des Pères de la Compagnie de Marie. M. Vergé, qui avait contribué plus que personne à cette fondation, s’empressa d’offrir la précieuse relique aux Enfants du Bienheureux, dès leur arrivée au Calvaire.
Nous la gardons pieusement. De temps en temps, des pèlerins sollicitent la faveur de la voir et même de l’entendre. C’est ainsi qu’elle a dû résonner plusieurs fois, le jour où nous avions le bonheur de posséder les pèlerins de Saint-Laurent-sur-Sèvre.
†
Voici que le temps approche où les travaux devront recommencer sur la lande de la Madeleine. Il y a encore beaucoup à faire au Jardin des Oliviers, et surtout au torrent du Cédron. Et puis, l’on songe à tracer, à élever au-dessus du sol la Voie douloureuse.
Nous sommes assurés à l’avance de la bonne volonté de tous. Sous quelque forme qu’il soit fait, l’appel sera entendu. Mais, au besoin, nous n’en doutons pas, quelques sons de la conque du bon P. de Montfort, jetés du haut du Calvaire aux échos d’alentour, suffiraient à donner courage aux timides, à réveiller les endormis, s’il ne s’en trouvait jamais.
P.-S. — Nous avons fait allusion à la reprise prochaine de nos travaux. Voici qui montre bien que la bonne Providence ne nous oublie point.
Le R. P. Jérôme, vicaire custodial de Terre-Sainte, depuis quelque temps en France, nous annonce sa visite pour les premiers jours de Novembre. C’est un témoignage de sympathie pour notre œuvre, dont nous lui sommes reconnaissants à l’avance. Nous serons heureux aussi de profiler des conseils, qu’avec sa haute compétence, il voudra bien nous donner, pour l’exécution de nos projets.
Bien des personnes qui s’intéressent au Calvaire, seraient heureuses, nous le savons, d’entendre le Révérend Père nous parler de la Terre-Sainte.
Dès que nous serons fixés sur les jours qu’il peut nous donner, surtout s’il s’y trouve un dimanche, nous ferons de notre mieux pour en donner avis, an moins dans les environs.
N° 15 décembre 1892
Visite au Calvaire du R. P. Jérôme, Vicaire Custodial de terre Sainte
Cette visite, nous l’annoncions à la fin de notre numéro de Novembre. Nul de nos lecteurs n’aura eu de peine à comprendre que nous y attachions un haut prix, une réelle importance.
Le R. P. Jérôme nous est arrivé le Lundi 6 Novembre, au soir. Il était accompagné du R. P. Norbert, lui aussi franciscain de Terre-Sainte et Gardien du Couvent de Tibériade.
C’est après avoir rempli les fonctions de Gardien du Couvent de son Ordre à Bordeaux d’abord, puis à Paris, qu’il y a huit ans, le P. Jérôme était appelé à la charge importante de Vicaire custodial des Saints Lieux.
La Custodie franciscaine de Terre-Sainte compte environ quatre cent cinquante religieux. C’est un véritable gouvernement, dont le siège est au Couvent de Saint-Sauveur, à Jérusalem. Une soixantaine de religieux ont là leur résidence. Ce sont les Gardiens du Saint-Sépulcre, autour duquel, ils veillent jour et nuit. C’est l’usage que tout religieux franciscain arrivant en Terre-Sainte y fasse un nouveau noviciat, qui consiste à demeurer quatre mois entiers au Saint-Sépulcre, sans sortir de la Basilique. Les autres gardiens se relèvent, tous les huit jours.
C’est au couvent de Saint-Sauveur que se trouve l’Eglise paroissiale catholique de Jérusalem. La grande hôtellerie de Casanova, pour les pèlerins latins, y est aussi annexée, et est desservie par les Frères franciscains.
Les autres religieux dépendant de la Custodie sont dispersés sur toute la surface de la Palestine, en un certain nombre de couvents, où ils ont la garde de divers sanctuaires, à Bethléem, à Nazareth, à Tibériade, au Mont-Thabor, etc., etc.
Il est bon de remarquer, en passant, que ce titre de Gardiens donné aux Pères Franciscains de Terre-Sainte, n’est pas pour eux un titre simplement honorifique. Il s’agit, là, d’une garde très effective, qui tient ceux qui la montent, continuellement en alerte, et en éveil, et où l’occasion s’est présentée souvent et se présente encore de faire le sacrifice de sa vie.
Depuis la fondation de la Custodie de Terre-Sainte, l’Ordre de Saint-François compte quatre mille martyrs qui ont répandu leur sang sur cette Terre de Palestine arrosée du sang de Jésus-Christ, et que le Saint Patriarche d’Assise avait tant désiré arroser lui-même de son propre sang. Et tout ce sang a été versé pour assurer aux fidèles la liberté de prier sur le tombeau du Divin Maître, et dans les divers sanctuaires qui rappellent son passage sur la terre.
Depuis longtemps, ce n’est plus du fanatisme musulman, que les Gardiens des Saints Lieux ont surtout à souffrir, ce n’est plus le cimeterre qu’ils ont à redouter. Ce sont surtout les empiétements des schismatiques grecs qu’ils ont à combattre. De ce côté, la lutte est toujours ardente, continue, acharnée. Et, de nos jours encore, on le sait, cette lutte va jusqu’à l’effusion du sang.
Il nous serait facile d’ajouter, ici, bien d’autres détails sur la situation actuelle des Saints Lieux, sur la Ville Sainte en particulier, d’après les communications si intéressantes, qu’ont bien voulu nous faire nos hôtes de quelques jours. Nous y reviendrons peut-être.
Mais le R. P. Jérôme et son compagnon étaient venus ici, pour notre Œuvre à nous, pour notre nouvelle Jérusalem; et c’est d’elle encore plus particulièrement, qu’il a été question, pendant leur court séjour au milieu de nous.
Le P. Jérôme avait eu déjà connaissance de notre projet, ou plutôt du projet de notre Bienheureux Père, par la petite brochure : Le Calvaire du B. Montfort, qui lui était parvenue à Jérusalem même. Il s’y était intéressé par ce qu’on lui en avait dit, depuis son séjour de quelques mois en France. Lui, chargé de recevoir là-bas, nos pèlerins et, en particulier, nos beaux pèlerinages de pénitence, qui malgré tout ce qu’on peut faire ne seront jamais suivis que par un petit nombre de privilégiés, se sentait disposé mieux que personne à accueillir l’idée de faire participer un plus grand nombre d’âmes aux grâces incomparables attachées à la visite des Saints Lieux.
En arrivant ici, il a été frappé de voir comment le site du Calvaire, l’espace dont nous pouvons disposer, les matériaux que nous avons sous la main, tout se prêtait admirablement pour l’exécution du plan qui a été conçu.
Il a donné ensuite son approbation à ce qui est déjà fait. Les distances sont bien gardées. Notre grotte de Gethsémani est aussi ressemblante que possible. Notre Jardin des Oliviers n’a qu’à être entouré et orné de fleurs ; car le Jardin des Oliviers à Jérusalem est aujourd’hui un beau parterre. Le Prétoire qui sert maintenant de caserne aux soldats musulmans, devait présenter autrefois au regard, la belle façade que nous lui avons donnée.
Puis de là, le R. Père nous indique avec une très grande précision, la direction de la Voie douloureuse vers le Calvaire, tous ses détours dans les rues de Jérusalem, l’emplacement de chacune des stations, et ce qui signale chacune d’elles.
Cette voie, il la connaît si bien ! Il l’a parcourue tant de fois! Il rappelle à cette occasion, que tous les vendredis, entre deux et trois heures, les Pères du couvent de Saint-Sauveur, toujours accompagnés d’un certain nombre de fidèles, se rendent au Prétoire, pour faire le Chemin de Croix. Pendant qu’on est à genoux devant la première station qui est dans la cour même de la Caserne musulmane, les soldats gardent un respectueux silence. Bien que les autres stations soient, pour la plupart, dans des rues relativement étroites, le pieux exercice se fait toujours au milieu d’un grand calme et avec, grande édification. Pendant ce temps, toutes les cloches des églises de Jérusalem, font entendre le glas funèbre.
C’était déjà beaucoup pour nous que toutes ces indications si précises et si sûres. Mais, le R. P. Jérôme tient à faire plus pour notre Œuvre. Il nous laisse dès maintenant des Reliques précieuses. Il nous en promet d’autres encore plus insignes. Il nous enverra une pierre de chacune des stations de la Voie douloureuse, qui sera enchâssée, d’une manière très apparente dans chacun des monuments qui représenteront ces mêmes stations sur la lande de la Madeleine. Les quatorze croix aux quelles seront attachées les indulgences de notre Via Crucis, seront faites du bois précieux des oliviers qui, d’après la tradition, ont été témoins de l’Agonie de Notre-Seigneur.
Avant le départ, le R. P. Vicaire Custodial nous dit et nous répète que son grand désir est de voir notre Pèlerinage devenir véritablement une succursale, une annexe du grand Pèlerinage de Jérusalem. II ne doute pas que nous n’obtenions prochainement la faveur de toutes les indulgences si nombreuses, attachées à la visite des Saints Lieux.
Encore un détail avant de terminer : Plusieurs Revues franciscaines datent déjà d’assez loin ; mais la Custodie de Terre-Sainte n’avait pas jusqu’à ces derniers temps d’organe spécial. La Revue de Terre-Sainte, qui comble cette lacune, a commencé à paraître l’année dernière, précisément à la même époque que notre petit Ami de la Croix. Il y aura échange entre nous. La Revue de Terre-Sainte nous apportera, chaque mois, des nouvelles de Jérusalem qui nous intéresseront toujours vivement, et que nous pourrons parfois communiquer à nos lecteurs. Et le R. P. Jérôme en ouvrant l’Ami de la Croix, voudra bien se souvenir du Calvaire du B. Montfort.
Qu’il veuille bien encore nous permettre de lui offrir, ici, de nouveau, l’expression de notre vive reconnaissance, pour les précieux encouragements que nous a laissés son passage au milieu de nous I —
Les RR. PP. Jérôme et Norbert, en ce moment se sont embarqués à Marseille, pour retourner à leur glorieux poste de combat.
Reprise des travaux au Jardin des Oliviers
Après de tels encouragements, personne ne s’étonnera de nous entendre dire que la reprise de nos travaux est pleine d’entrain et de confiance. Elle a lieu aujourd’hui même 22 novembre.
La paroisse de Crossac a toujours été en première ligne pour son dévouement au Calvaire. Il y a deux ans, les hommes de Crossac travaillaient des premiers aux fondations du Prétoire. L’année dernière, ce sont eux qui ont remué les premières pierres qui servent d’assise à la Grotte de Gethsémani. Ce sont eux qui ont encore l’honneur d’ouvrir la série des travaux de cette année.
M. le Curé les avait invités, Dimanche dernier, du haut de la chaire. Ce matin, dès huit heures, ils remplissent notre chapelle pour assister au saint sacrifice de la messe, au nombre de près de cent cinquante. En les voyant ensuite monter au pas la côte du Calvaire, tous la pelle ou la pioche sur l’épaule, tous chantant à pleine voix un air de marche, on se croirait vraiment en présence d’un bataillon redoutable, si on ne le savait pas si pacifique.
Ils offrent un spectacle plus beau peut-être encore, quand après le court repas de midi, on les voit faire le tour de la colline du Calvaire, non plus leurs outils sur l’épaule, mais le chapelet à la main qu’ils récitent tous ensemble, à haute voix.
Mais, il faut aussi les voir au travail. Il s’agissait d’entourer d’un large fossé le Jardin des Oliviers. Là, la terre est facile à remuer, mais de distance en distance, un bloc de pierre se présente en travers. Aucun obstacle ne résiste. Et le soir, le fossé, sur une longueur d’au moins deux cents mètres est terminé, le talus planté d’acacias épineux, qui, au printemps, nous l’espérons, formeront une clôture impénétrable à la pieuse enceinte. La récompense, c’est le beau Salut du Très Saint-Sacrement, donné, le soir, par l’excellent Pasteur lui-même, qui fait aussi vénérer à tous les Reliques du Bienheureux.
N° 16 Janvier 1893
Chronique du mois
Depuis la fête du 6 Juin, jour de l’inauguration et de la bénédiction de notre Grotte de Gethsémani, nous ne pourrions donner une idée de toutes les démonstrations de piété dont elle a été témoin. Il faut dire cependant que, depuis quelques semaines, les pieux pèlerins, en y arrivant, éprouvaient une certaine déception.
Ils n’y voyaient plus Jésus agonisant et l’Ange consolateur. Les deux statues qui étaient simplement moulées en plâtre ont dû disparaître. Elles ont été transportées pour servir de modèles, dans l’atelier de l’artiste qui, en ce moment, sculpte dans la pierre le groupe qui nous restera définitivement.
Mais, la Providence pourvoit à tout. Un désir a été seulement exprimé ; et aussitôt, un pinceau bien connu dans toute la contrée a fait revivre sur la toile, la scène si touchante de la Grotte de Gethsémani.
C’est le moment le plus solennel de la divine Agonie. Le divin Sauveur a prié longtemps, prosterné la face contre terre, et bien qu’affaissé encore sous le poids de la douleur, il s’est relevé sur ses genoux. L’Ange debout à sa droite montre le calice, ce calice de souffrance et d’amertumes qui n’est autre que la croix de demain apparaissant à demi-voilée dans l’ombre de la grotte. Il semble entendre tomber des lèvres du divin Agonisant les paroles de, notre salut: « Non mea voluntas, sed tua fiat. Non pas ma volonté, ô mon Père, mais que la vôtre se, fasse. »
En affirmant à l’avance que cette toile, œuvre do premier jet, fera beaucoup méditer, prier et pleurer, nous croyons en faire l’éloge le meilleur, et celui qu’agréera plus facilement le pieux et excellent artiste.
Ajoutons que notre Grotte va être enrichie prochainement d’une riche grille, en fer forgé, fermant la double entrée. C’est la même main généreuse qui a donné le plan, et en fait tous les frais.
†
Nous avons à remercier d’autres bienfaiteurs.
Ceux qui ont visité le Calvaire, savent que l’élévation de terrain figurant pour nous la montagne des Oliviers était dénudée comme le reste de la lande, sans aucun arbre, sans aucun arbuste.
Sur ce point, il fallait une transformation complète. C’est sous de frais ombrages que nous nous représentons Notre-Seigneur, vers la fin d’une, journée chaude et fatigante, se retirant à Gethsémani, pour prendre quelque repos avec ses chers disciples, et plus souvent pour prier à l’écart.
Nous n’ignorons pas que surtout quand il s’agit d’ombrages à créer, il faut savoir attendre et compter sur le temps. Mais, grâce à la générosité de Mr D… nous croyons pouvoir offrir sur ce point, quelque satisfaction à nos pèlerins dès le printemps prochain.
Il nous a laissé puiser si largement dans ses plants et pépinières de toute sorte d’essences!
Mentionnons en particulier de très beaux sycomores, puisqu’au moins c’est un nom biblique, bien que, croyons-nous, ce ne soit pas le même arbre qui croît en Palestine et dont il est parlé dans nos Livres saints.
Les sujets qui ont été plantés ces jours-ci, ont déjà un développement considérable, et toutes les précautions ont été prises, pour qu’ils n’aient pas trop à souffrir du changement de terrain.
La transformation de notre Gethsémani, se complétera bientôt, nous l’espérons, par une nouvelle plantation d’arbres verts.
Nous devions déjà à M. D… les bouquets d’arbres qui entourent le Prétoire, et la belle allée qui part de là, pour aller au Jardin des Oliviers. Que Dieu récompense sa pieuse générosité!
†
Nous avons aussi un devoir de reconnaissance à remplir envers ceux qui, pendant ce mois, nous ont apporté si généreusement le concours de leurs bras, pour la continuation de nos travaux.
Mardi 29 Novembre. — Paroisse de Drefféac.
Ce sont les hommes de Drefféac, qui, pour cette campagne, ont été invités, après ceux de Crossac, à prendre la seconde place sur la liste de nos travailleurs.
De loin, leurs chants se font entendre sur la route de Pontchâteau, et témoignent de la joie avec laquelle, ils répondent à l’invitation qui leur a été adressée. A huit heures, ils sont tous réunis au nombre de cent à la Chapelle, où ils entendent pieusement la sainte Messe.
Dans la journée, ils achèvent d’enclore le Jardin des Oliviers. Ils préparent le terrain par les plantations qui doivent avoir lieu bientôt. Ils transportent aussi les premières pierres qui doivent servir d’assises au pont du Cédron.
C’est une journée bien remplie, qui se termine par le Salut du Très S.-Sacrement et la vénération des reliques du Bienheureux. Tous partent content. Les chants qui ce matin, annonçaient l’arrivée reprennent au départ, et se perdent peu à peu dans le lointain.
Jeudi 1er Décembre. — Paroisse de Saint-Joachim.
De St-Joachim, nous savons que c’est toujours le petit nombre de ceux qui désireraient venir travailler au Calvaire, qui peuvent se procurer cette satisfaction. Bien des fois, des regrets nous ont été exprimés à ce sujet. La grande majorité des hommes de St-Joachim est engagée dans les chantiers de la Loire et ne peut disposer d’une journée.
Malgré cet obstacle, la paroisse est bien représentée, puisque nous comptons nos travailleurs jusqu’au chiffre de cent trente.
Ils sont très heureux de voir au milieu de la journée leur nouveau Curé, qui passe avec eux le reste de la soirée.
Comme preuve de la bonne volonté de ses paroissiens, il nous dit en passant, qu’ayant eu la bonne pensée de faire quelques réunions spéciales pour les hommes, pendant le mois d’adoration, c’est au nombre de sept cents que la veille au soir, après une journée de travail pénible, ils remplissaient son église.
Nos travailleurs de St-Joachim ont placé les premières assises du pont du Cédron. Elles sont solides; tous pourront passer sans crainte. Ce jour-là aussi, un premier envoi des plants d’arbres dont nous avons parlé, avait été fait. Ils ont été tous mis en place avec soin. La journée s’est terminée pieusement à la chapelle du Pèlerinage.
Mardi 6 décembre. — Paroisse de Ste-Reine.
Ste-Reine est toujours la paroisse dévouée à la mémoire du saint Missionnaire, qui, en passant dans la contrée, a laissé là des souvenirs tout particuliers.
Par suite d’un oubli, l’heure de la messe des travailleurs n’avait pas été indiquée. Plusieurs sont arrivés à une heure un peu tardive, mais pour tous la journée a été bonne et bien remplie. Les travaux du Cédron ont considérablement avancé.
C’est un plaisir, ces jours-là, de rencontrer quelques-uns de ces bons vieillards qui gardent précieusement les souvenirs du passé et aiment à les rappeler. Il y en a deux aujourd’hui, qui vont atteindre 80 ans. Ils racontent aux jeunes, comment ils étaient là, dès 1821, alors qu’on relevait la colline du Calvaire, dont il ne restait presque plus rien après la grande révolution.
Vendredi 9 décembre. — Paroisse de la Chapelle-des-Marais.
Le matin de ce jour, pluie et tempête soudaine, au moment même où nos travailleurs de la Chapelle-des-Marais doivent se disposer à partir pour venir au Calvaire. Ici, nous en avons pris notre parti. Il ne faut pas y compter. Ils ne se mettront pas en chemin.
Mais, là-bas, les météorologistes (il y en a un peu partout aujourd’hui), soutiennent que ce n’est qu’un grain, occasionné par le coucher de la lune, s’il vous plaît. Pas d’hésitation ! Voilà que tout le monde nous arrive un peu trempé, sans doute, mais nullement découragé.
Et de fait, à peine le travail est-il commencé, que le soleil se montre et fait disparaître en quelques instants, tous les mauvais effets de l’averse. On se félicite mutuellement. Les travaux vont à merveille. C’est une bien belle et bonne journée.
Le vénéré Pasteur de la Chapelle-des-Marais voyant le courage de ses paroissiens n’avait pas voulu rester en arrière. Lui aussi était venu sous la pluie. Il est heureux, le soir, de donner lui-même à ses braves et chers travailleurs la bénédiction du T. S.-Sacrement.
Mardi 13 décembre. — Bergon en Missillac.
Les Bergonnais forment une section importante de la grande paroisse de Missillac. Ils sont heureux d’avoir été convoqués les premiers et de marcher en avant.
Ils ont montré, ce jour-là, que non seulement ils étaient prompts et ardents au travail pour le bon Dieu, mais- qu’ils tenaient singulièrement à ne pas laisser sur le chantier une besogne commencée. Il s’agissait, dans la soirée, d’amener au Cédron une énorme pierre, devant former à elle seule, ce qu’on peut appeler l’arche du pont, ses deux extrémités reposant sur les piles solides établies de chaque côté.
Cette pierre se trouvait à une assez grande distance. Il fallut du temps pour la placer sur une espèce de chariot. Il en fallut aussi pour mettre le chariot en mouvement. Un incident survint, qui grâce à Dieu et à la protection du B. Montfort, ne fut pas un accident.
Cependant, l’heure à laquelle finissent les travaux dans cette saison était passée. Vainement l’observation en fut faite à plusieurs reprises. Vainement rappelait-on à ces courageux Bergonnais qu’ils avaient deux grandes lieues à faire pour rejoindre leur village. Les bras ne consentirent à se reposer que lorsque la pierre fut venue à l’endroit marqué. A cette heure tardive, ils ne voulurent pas néanmoins partir sans avoir reçu la bénédiction du Saint-Sacrement qui leur fut donnée par un de MM. les Vicaires de Missillac.
Jeudi 15 Décembre. — Paraisse de Saint-Guillaume.
Les paroissiens de Saint-Guillaume sont nos plus proches et excellents voisins, chez qui nous trouvons toujours le même bon accueil, la même bonne volonté.
Ce sont eux qui, ce jour-là, plantent l’avenue de sycomores qui conduit au pont du Cédron. Ce sont eux aussi qui mettent en place la pierre qui a coûté tant d’efforts aux travailleurs de Bergon.
M. le Curé et son Vicaire passent la journée sur le chantier, s’intéressant à tout, présidant, quand le moment est venu, à la récitation du chapelet, au chant des cantiques, et aussi à la cérémonie du soir, en notre chapelle.
†
Nous achevons d’écrire ces lignes, quand nous arrive une heureuse surprise. C’est la visite de l’excellent M. Gerbaud. Nous sommes persuadés que plusieurs de nos lecteurs auraient été étonnés de ne pas trouver son nom dans les premières pages de ce compte-rendu sur la reprise de nos travaux. Il n’a pas pu nous venir plus tôt. Il était retenu dans une autre partie du diocèse par un travail pressé, tout de dévouement, cela va sans dire : c’était une construction de Calvaire.
Mais, il nous reste toujours, et nous pouvons compter sur lui, pour la campagne qui sera désormais la campagne de 93. Car il faudra bien que 93, malgré son mauvais renom, donne à notre Jérusalem nouvelle son monument nouveau.
N° 17 Février 1893
Chronique du mois
Au moment où s’ouvre notre chronique, il est grandement question de la reprise des travaux interrompus depuis près d’un mois. Elle ne sera pas close, nous l’espérons, sans que nous avions à signaler la présence de plusieurs vaillantes troupes de travailleurs, invités pour la dernière quinzaine de janvier. Mais, pour ne pas nous exposer à un oubli regrettable, disons, dès à présent, un mot de la journée du :
Mardi 20 décembre. — Paroisse de Missillac.
A la Frairie de Saint-Guy, en Missillac, était échu l’honneur de donner la dernière journée de travail au Jardin de Gethsémani, dans l’année quatre-vingt-douze. Nous n’en rappellerons qu’un fait, mais qui montre bien avec quelle abnégation, nos chers Bretons se dévouent, se dépensent pour L’Œuvre de Montfort.
Dans la matinée, après quelques travaux préparatoires, la troupe presque entière, dirigée par le R. P. Supérieur lui-même, était allée à une certaine distance, dans le but de dégager d’abord, puis de charger et d’amener ensuite un bloc de pierre qui semblait nécessaire pour l’achèvement du pont du Cédron. Le travail se prolongea et devint tellement animé, que personne ne songea que l’heure de dîner était venue. En vain la cloche de la chapelle avait tinté l’Angélus, elle ne fût pas entendue. Tous manœuvraient de plus belle, aux leviers ou à la chaîne. Ce fut seulement quand la pierre eût été déposée à l’endroit voulu, qu’en regardant les montres on s’aperçut qu’elles marquaient deux heures de l’après-midi.
Personne ne songea à se plaindre. Et ils étaient partis du village, le matin à cinq heures, n’ayant pris que très peu de chose. Après une légère réfection, tous reprenaient joyeusement le travail pour le reste de la soirée, pendant laquelle ils furent heureux de voir au milieu d’eux leur excellent Curé, et l’un de leurs vicaires, M. l’abbé Landau.
Et maintenant, en attendant l’heure de féliciter les nouveaux travailleurs volontaires, qui doivent nous venir bientôt, qu’il nous soit permis de faire une excursion…
La reprise des travaux
Elle était fixée au 16 janvier. Nos invitations étaient faites. M. Gerbaud était arrivé de Nantes, avec tout l’attirait d’un petit chemin de fer Decauville, pour accélérer et rendre plus faciles les terrassements projetés. Nous avions eu un peu trop confiance dans la clémence de l’hiver. Après lui avoir abandonné, sans même essayer la lutte, toute la première quinzaine de janvier, nous pensions qu’il aurait été gracieux pour nous dès le commencement de la seconde. Il n’en a pas été tout-à-fait ainsi. Le lundi 16, et le mardi 17, le temps était tel que nos invités de Férel et de Saint-Dolay, ne purent pas songer un instant à se mettre en chemin. Il était trop évident d’ailleurs, que tout travail était impossible au Calvaire. Certes, ce n’est ni la bonne volonté, ni le courage qui manquaient à nos braves Morbihannais, et nous savons bien qu’ils sont décidés à en donner la preuve au premier jour favorable.
†
Mais, dès le mercredi 18, le dégel s’est assez prononcé dans la matinée, pour qu’il soit question de tenter un essai. A 11 heures, deux messagers rapides partent et font une tournée dans les villages les plus rapprochés de nous, et qui sont de la paroisse de Pontchâteau. A 1 heure, les travailleurs sont là en nombre suffisant.
Les uns piochent la terre, les autres chargent les wagonnets, d’autres enfin les font rouler, ou les déchargent à l’arrivée. Tout se fait avec beaucoup d’ordre et d’activité, sans difficulté, sans encombre. Nous n’avons pas à signaler quelques déraillements peu sérieux et surtout peu dangereux.
Le soir contentement général, et félicitations de la part de M. le Directeur des travaux.
Reste à nommer les villages de Pontchâteau qui ont pris part à l’inauguration de notre Decauville. Ce sont les villages de Beaulieu, de la Madeleine, du Sabot d’Or, de Montmara, de Malabrit, de la Salmonais-de-Pie, de la Moriçais, de la Bichardais, des Caves et de Beaumare.
Jeudi 19 janvier. — Paroisse de Besné.
Les volontaires de Besné sont fidèles au rendez-vous. Plusieurs comptant sur le bac pour traverser le Brivet qui en ce moment est très débordé ont été trompés dans leur attente. Le bac était coulé. Il leur a fallu pour nous venir faire un détour qui a considérablement allongé leur route.
Ils n’en sont pas moins ardents et dispos.
Le travail est le même qu’hier. Mais comme les bras sont plus nombreux, il a fallu établir une nouvelle voie parallèle et ouvrir une nouvelle tranchée.
M. le Curé de Besné fait grand plaisir à tous, en passant une partie de la soirée sur le chantier.
Inutile d’ajouter que le travail comme par le passé est accompagné des actes de dévotion accoutumés: Chant de cantiques, récitation du chapelet, visite à la Scala. Et le soir, bénédiction du Très Saint-Sacrement et vénération des reliques.
Nous n’avions pas de paroisses convoquées pour ces deux derniers jours de la semaine. Mais pour que les travaux ne soient pas interrompus, et pour suppléer à ce qui a manqué, les deux premiers jours, il a suffi de faire un appel à quelques gros villages.
Le vendredi, c’est le village d’Herr, de la paroisse de Donges, et le village des Eaux, de la paroisse de Crossac, qui répondent généreusement à cet appel, fraternisent ensemble et nous donnent une excellente journée. Nous remarquons, un moment, quelques jeunes, tentés d’imprimer une allure vraiment trop vive aux wagonnets chargés. Mais, ils se rendent facilement aux observations des anciens qui sont là pour les modérer.
Le samedi, nous reconnaissons nos bons ami des villages de la Brionnière et de Quémené, eu Crossac. Plusieurs paraissent déjà pour la seconde fois, dans cette nouvelle campagne. Mais c’est toujours avec la même bonne volonté, le même entrain, la même reconnaissance et le même dévouement envers celui qu’ils reconnaissent comme leur Protecteur, et qu’ils appellent toujours le Bon Père, ou encore notre Saint, bien que l’Eglise ne lui ait donné jusqu’à ce jour que le titre de Bienheureux.
18 Mars 1893
Chronique du mois
Fête du dernier dimanche de Janvier
Dans bien des familles chrétiennes, où chacun a son jour de fête, suivant le nom qu’il a reçu au baptême, on tient en outre, à ne pas laisser passer inaperçu l’anniversaire de la naissance du chef de famille, en particulier.
Désormais, c’est l’usage au Calvaire. En attendant le 28 avril, notre Bienheureux a sa fête secondaire de fin janvier. Il est vrai que nous avons ici, des raisons spéciales de célébrer cet anniversaire, puisque c’est au même jour que se rattache le souvenir de la merveilleuse apparition des croix et des étendards au-dessus de l’emplacement occupé aujourd’hui par le Calvaire.
C’est après avoir rappelé en quelques mots bien sentis ces touchants souvenirs, que le B. P. Payrat nous a montré Montfort conduisant les âmes à Jésus par Marie. Nul doute que son auditoire, si attentif, l’entendant parler avec tant d’onction du saint Esclavage de Jésus en Marie, n’ait formé le sincère désir d’entrer de plus en plus dans la pratique de cette pieuse dévotion.
Le temps très doux permet de faire la procession autour de la plus large enceinte du Calvaire. La statue du Bienheureux y est portée triomphalement sur son brancard, par nos apostoliques.
Le soir venu, le sommet du Calvaire et la plateforme du Prétoire, apparaissent couronnés de lanternes vénitiennes. De temps en temps des torches enflammées font ressortir admirablement les grandes arcades du monument grec. Des deux points que nous venons d’indiquer, deux chœurs font entendre tour à tour des chants et des acclamations sans fin, en l’honneur de Montfort, en l’honneur de la Croix par lui plantée en ces lieux, et qu’il a tant aimée.
†
Après ces quelques mots au sujet de cette fête de famille, en l’honneur de notre Bienheureux, nous avons hâte d’exprimer notre reconnaissance à tous ceux, qui, depuis un mois, sont venus en si grand nombre l’honorer d’une autre manière, en lui offrant leur journée de travail. La liste que nous avons sous les yeux est tellement longue, et l’espace dont nous disposons tellement restreint, que nous ne pourrons donner qu’une bien courte mention, à chaque paroisse.
Lundi 23 janvier. — Paroisse de Marzan
Marzan, situé au-delà de la Vilaine, est à vingt kilomètres du Calvaire.
Un défilé de voitures attire toujours la curiosité, même en ville. Celui que nous vîmes ce jour-là, sur la rampe de notre colline était vraiment beau. La voiture de M. le Recteur, tenait la tête de file. Elle était suivie de trente autres, bien comptées, s’avançant dans un ordre parfait. Ce n’étaient pas, sans doute, des voitures de gala ; mais chacun de ces modestes chars-à-bancs, était monté par cinq ou six braves Bretons, tous munis de leurs instruments de travail : au total, près de deux cents hommes. Pensez-vous que l’excellent Recteur n’avait pas le droit d’être un peu fier d’une semblable escorte ? Il n’eut aussi qu’à se féliciter avec nous, pendant toute la journée, de la bonne volonté, de l’ardeur au travail, de la piété de ses bons paroissiens, qui nous ont laissé les meilleurs souvenirs.
Mardi 24 janvier. — Paroisse d’Herbignac
M. l’abbé Paquelet remplace M. le Doyen a qui n’a pu venir. Nous revoyons d’anciennes et excellentes connaissances : M. Corbun de Kérobert, conseiller général et maire d’Herbignac, est là avec son fils, ainsi que M. de G. de la Chevasnerie et M. X…, président du Conseil de Fabrique. Ces Messieurs nous rappellent que l’an dernier, ils ont eu à s’occuper de la plantation des arbres de la grande allée, qui va du Prétoire au Jardin de Gethsémani. Et précisément, aujourd’hui encore, ils vont avoir à diriger la plantation de la même allée, continuée vers le Calvaire. Ils sont secondés de la même manière par d’ardents travailleurs. Tous font remarquer que l’année, dernière, la plantation s’était faite un peu tardivement. Et cependant elle a parfaitement réussi. Nous ne pouvons donc avoir que de bonnes espérances pour celle-ci, qui se fait dans des conditions meilleures.
M. l’abbé Paquelet et M. le Président de Fabrique nous confient que, pour eux, ce pèlerinage de travail, à la Jérusalem nouvelle, est une préparation au grand pèlerinage de la Jérusalem ancienne. Tous les deux sont inscrits pour le pèlerinage eucharistique du mois d’avril prochain.
Mercredi 25 janvier. – Paroisse de Guenrouët
Guenrouët est séparé de nous par une grande distance. Mais, notre Bienheureux y est bien connu. Il y est invoqué avec confiance. Et récemment plusieurs personnes de cette paroisse sont venues, ici, en pèlerinage d’action de grâces, pour le remercier de précieuses faveurs obtenues, par son intercession. Nous pouvons citer, en particulier, un bon vieillard dont les plaies variqueuses qui semblaient incurables ont disparu, après qu’il eut promis un voyage au Calvaire. De plus, M. l’abbé Avenard, vicaire, est si plein de zèle pour l’Œuvre du Calvaire. Il nous amène aujourd’hui, une troupe de travailleurs d’élite, qui tous manifestent leur joie de pouvoir donner cette journée au bon P. de Montfort. A voir leur entrain et leur ardeur, on ne se douterait pas que plusieurs ont fait à pied, ce matin, une si longue route.
Jeudi 26 janvier. — Paroisse de Saint-Gildas
Chaque année, la paroisse de Saint-Gildas nous édifie par son pieux pèlerinage, où tous chantent et prient avec tant de ferveur. Les travailleurs qu’elle nous envoie aujourd’hui, sont animés du même esprit de foi. M. le vicaire est au milieu d’eux et tient à payer de sa personne. Les bons Frères de la Doctrine chrétienne ont voulu aussi nous donner leur jeudi. C’est d’un bon effet de voir, dans chaque groupe, un travailleur en soutane dont la pioche ou la pelle ne chôme certes pas plus que les autres.
Lundi 30 janvier. — Férel et Camoël
Camoël évangélisé autrefois par le B. P. de Montfort, mais encore plus éloigné de nous que Férel a tenu à se joindre à cette dernière paroisse qui nous était déjà venue, l’année précédente.
Les deux bons Recteurs n’ont pas eu de peine à s’entendre pour organiser cette pieuse expédition. Pasteurs et troupeaux fraternisent ensemble admirablement. M. Gerbaud, que nous attendions est là pour diriger ces braves Morbihannais, qui tous accomplissent leur tâche, aussi docilement que courageusement. C’est avec un élan remarquable que tous répondent aux couplets de cantiques connus, que chante avec tant d’âme M. le Recteur de Férel.
Mardi 31 janvier. — Paroisse de Saint-Roch
Nous savons quel bon accueil avait reçu l’invitation faite à Saint-Roch. Mais c’est une journée d’averses presque continuelles surtout dans la matinée. Les plus éloignés, en particulier, ne peuvent songer à se mettre en chemin. Cependant une troupe de vaillants a bravé tous les obstacles, et tient à montrer pendant toute la soirée son courage et son dévouement. Dans cette troupe se trouve un vieillard disant bien haut qu’il serait venu tout seul, s’il l’eut fallu. Menacé l’an dernier, de perdre totalement la vue, il n’y voyait presque plus, quand il a invoqué le bon Père de Montfort et lui a promis un voyage au Calvaire. Ses yeux lui ont été rendus, et il croit qu’il n’en pourra jamais trop faire pour témoigner sa reconnaissance à notre. Bienheureux.
Mercredi 1er février. — Paroisse de Missillac
C’est la troisième section de cette excellente paroisse, composée en grande partie, croyons-nous, du bourg même de Missillac. M. l’abbé Landau est là soufflant partout l’ardeur avec son entrain ordinaire.
C’est un des jours où les déraillements sont plus fréquents, peut-être un peu, à cause du trop d’empressement de ceux qui dirigent les wagonnets. Mais, on ne se décourage pas pour si peu. Les wagons sont déchargés, remis sur la voie, puis rechargés et atteignent enfin le but marqué.
†
Le vendredi de la même semaine, quelques villages de Crossac, la Cassonnais, Coimeux, Quinta, l’Arnais et Bosla viennent au premier signal, pour quelques travaux qui semblent pressés.
Lundi 6 février. — Paroisse de Sévérac
Monsieur le Curé de Sévérac nous arrive à la tête de 150 hommes. C’est assurément une des belles journées de cette campagne de travail. Tout se passe dans un ordre parfait. Nous en voyons qui jalonnent un fossé avec la sûreté de coup d’œil de vrais géomètres.
Voici un vieillard de 73 ans qui, craignant d’arriver en retard, est parti de chez lui, à deux heures du matin. Pour ne pas se charger, il n’a pas pris de pain, pensant faire sa provision en passant à Pontchâteau. Mais, il doit attendre longtemps que les boulangeries s’ouvrent. Sans ce retard, il arrivait le premier au Calvaire.
Le cœur du Pasteur devait éprouver de la joie, le soir, en bénissant ses chers travailleurs.
Mercredi 8 février. — Paroisse de Nivillac
C’était aussi un beau bataillon d’hommes qui avait suivi, ce jour-là, M. le Recteur de Nivillac, accompagné d’un de ses vicaires, M. l’abbé Gourier. Malheureusement le temps a été peu favorable. La journée a dû être abrégée. Mais la grande paroisse de Nivillac n’en a pas moins montré sa bonne volonté et son attachement au Calvaire du B. Montfort
Jeudi 7 février. — Paroisse de Donges
En revoyant M. le Curé de Donges, nous ne pouvons-nous empêcher de lui dire qu’il a rajeuni depuis l’an dernier. C’est qu’il est encore sous l’impression de la mission si fructueuse qu’il vient de faire donner à sa paroisse. Nul doute que ses paroissiens qui l’ont suivi aujourd’hui au Calvaire, pour donner au bon Dieu et au P. de Montfort cette excellente journée de travail, ne s’en retournent plus décidés encore à garder leurs bonnes résolutions.
Jeudi 16 février. — Paroisse de Crossac
La semaine de la Quinquagésime devait rester libre ; mais pour répondre à un désir plus d’une fois exprimé, les femmes de Crossac ont été convoquées pour le jeudi, lendemain des Cendres. La matinée est pluvieuse, mais ce n’est qu’un léger retard. Dès dix heures, le temps s’est élevé. Sur divers chemins apparaissent des groupes de vingt, de trente s’avançant en bon ordre. A midi, les travailleuses sont environ deux cents réunies. Dans la soirée, le temps est à souhait. Sans doute, on a ménagé pour ce jour-là quelques travaux faciles, plantations d’arbustes et de fleurs au jardin de Gethsémani, démarcation d’allées par des pierres de moyenne grosseur, placées les unes à côté des autres et formant chapelet, etc.
Mais les travailleuses de Crossac montrent bien que des tâches plus pénibles ne les effraient pas. Toutes sont venues avec des instruments de travail repassés à neuf.
On raconte, à ce sujet, que, les jours précédents, la boutique du forgeron de Crossac était littéralement encombrée de clientes demandant à faire aiguiser, qui sa tranche, qui sa pelle. Et savez-vous quelle était la réponse invariable de ce bon ouvrier quand on lui demandait : Combien sont-ils ?
— C’est pour le bon Dieu et pour le P. de Montfort, ça suffit.
Nous ne pouvons pas ne pas noter l’ensemble parfait de ces deux cents voix aux chants liturgiques de la Bénédiction du T. S. Sacrement, qui est donnée par l’excellent Pasteur de Crossac. On comprend qu’un peuple aime à fréquenter l’Eglise, quand les offices y sont ainsi chantés.
†
Dans la première semaine de Carême, nous arrivent le Lundi, la paroisse de la Chapelle-Launay ; le Mardi, la paroisse de Drefféac. Mais, nous ne pourrons rendre compte de ces deux journées, que dans notre prochain numéro.
†
A côté de ces démonstrations collectives en faveur de notre Œuvre, il en est de particulières bien touchantes, que nous ne pouvons mentionner qu’en petit nombre.
Quelle lettre charmante écrit ici, un jeune soldat du 21e chasseur, en garnison à Pontivy. Il se rappelle que l’an dernier, à la grande fête du 6 juin, il était au nombre des porteurs du brancard de Jésus agonisant, et qu’auparavant, au mois d’avril, il était venu prendre part aux travaux de la Grotte. Ne pouvant donner cette année, sa journée il en envoie le prix, la modique somme de deux francs, comptant, dit-il, que le bon père Montfort, voudra bien continuer de le protéger, comme il l’a fait jusqu’à présent, dans sa nouvelle vie de soldat.
†
Pouvons-nous taire le zèle du R. P. Brény, qui nous envoie encore une liste de vingt abonnés nouveaux à l’Ami de la Croix, de Coron (Maine-et-Loire). Le succès de la mission qu’il vient de donner dans cette paroisse a dépassé toutes les espérances. La clôture marquée par l’érection d’un nouveau Calvaire paroissial, a été un véritable triomphe pour la Croix. Il y a eu, pour la circonstance, création d’un nouveau corps de cavalerie : les Lanciers de la Croix, qui n’ont pas peu contribué à rehausser l’éclat de la Cérémonie. L’espace nous manque pour les détails.
N° 19 Avril 1893
Travaux et projets
I. – A Gethsémani
Le temps est venu, ce nous semble, de donner à nos lecteurs une vue d’ensemble des résultats de notre campagne d’hiver.
Dès leur arrivée au Calvaire, les pèlerins qui ne nous ont pas visités, depuis l’an dernier, peuvent voir, au premier coup d’œil que cette campagne a été aussi féconde que laborieuse. Cette grande allée, large de dix mètres, qui s’ouvre sur la grande route, dans la direction de Gethsémani, n’existait pas. Elle est aujourd’hui bordée de beaux châtaigniers, dont nous attendons incessamment le feuillage. En la suivant, vous verrez apparaître bientôt de larges plantations d’arbres et d’arbustes divers, tant en deçà qu’au-delà du Cédron. Sans doute, sur ce point même, tout n’est pas fait. Il en est qui exprimeront peut-être le regret de voir que toute une partie de notre Gethsémani, ne présente encore aux regards qu’une surface dénudée. La réponse est bien simple : il faut savoir attendre, tout ne peut passe faire d’une seule fois.
Mais, ce qui est fait suppose un travail considérable, dont nous ne saurions trop féliciter tous ceux qui y ont pris part. C’est aussi l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à d’autres bienfaiteurs. Et tout d’abord, à M. Delozes qui nous a fourni si généreusement tant de beaux plants de peupliers, de platanes, d’acacias, de châtaigniers, de sycomores. Nous devons ces pins déjà si élancés, à M. le comte de Bodinière. La forêt voisine de la Madeleine, avec la permission gracieuse de M. le comte de la Villeboisnet a été aussi mise à contribution.
Nous voici arrivés au pont du Cédron, dont les travaux ont été dirigés par M. Gerbaud. On y reconnaîtra, du reste, le cachet de son excellent goût. La forme antique qu’il lui a donnée est bien celle qui convient. Construit comme la grotte avec des blocs énormes, il s’harmonise parfaitement avec elle.
La grotte elle-même a reçu quelques modifications légères, mais très heureuses qui lui donnent encore quelque chose de plus mystérieux.
Tout est donc disposé là maintenant, pour exciter la piété du pèlerin.
L’Evangile à la main, il peut, pour ainsi dire, suivre pas à pas la divine Victime, dans cette soirée à jamais mémorable qui précéda le jour de la grande immolation du Calvaire.
Le discours après la Cène, ce suprême entretien du divin Sauveur avec ses apôtres n’était pas terminé, quand il leur dit : « Levez-vous, sortons. » Et, il continua de parler en se dirigeant vers Gethsémani.
Il arrivait sur les bords du Cédron, quand, les yeux levés vers le ciel, il fit à son Père pour les siens, cette prière si touchante, recueillie des lèvres divines, par l’Apôtre bien-aimé.
A peine a-t-il franchi le Cédron que se tournant vers ses apôtres, il leur dit : a Reposez-vous, tandis que je vais là pour prier. » C’est donc là, sur la gauche, à l’entrée môme du jardin que s’arrêtèrent les apôtres, à l’exception do Pierre, de Jacques et de Jean, auxquels Jésus permet de le suivre un peu plus avant dans le jardin. A peine a-t-il fait, en prenant à droite une cinquantaine de pas, que l’ennui, une tristesse mortelle ont envahi son âme.
Il le dit aux trois privilégiés : « Mon âme est triste jusqu’à la mort. » Et il ajoute : « Attendez-moi, ici, et veillez. » Voici le rocher sur lequel ils s’étendent pour dormir bientôt d’un profond sommeil, tandis que leur maître, à une petite distance, dans un endroit plus caché, qui n’est autre que la grotte de Gethsémani elle-même, est tombé la face contre terre et entré dans sa terrible agonie. Trois fois il se relève, et revient vers les siens. La première et la seconde fois les trouvant endormis, il se contente de leur adresser un doux reproche.
A la troisième il leur dit : « Donnez maintenant et reposez-vous, l’heure est venue. » Puis soudain : « Levez-vous, marchons! Voici que celui qui me livre est proche. » En face au fond du jardin, on voit à la lueur des torches, briller les armes des misérables qui ont à leur tête Judas. Jésus s’avance de ce côté. Voici le lieu où il reçoit le baiser du traître! C’est là aussi que pour montrer une fois encore sa toute-puissance et bien faire voir que s’il le voulait, ils ne pourraient rien sur lui, il terrasse d’une seule parole tous ceux qui sont venus pour l’arrêter. Mais, il se livre lui-même et se laisse garrotter. Voici le chemin creux et raboteux, par lequel ses ennemis l’entraînent.
Ce chemin descend au Cédron. Mais là, il n’y a pas de pont. Quelques pierres qui émergent au fond du torrent, et sur lesquelles s’appuie le pied, permettent seules de le passer. D’après la tradition, le divin Sauveur, poussé par des soldats grossiers, aurait fait une chute dans le torrent. Au de la, le chemin se continue et conduit par divers détours, d’abord chez Anne, puis chez Caïphe, et enfin au Prétoire de Pilate. La troupe qui s’est emparé de Jésus l’a choisi pour éviter les grandes voies, où eût pu se rencontrer quelque rassemblement du peuple, dévoué encore alors au Fils de David, parce qu’il n’avait pas encore été trompé par les Scribes et les Pharisiens.
On le voit, dès maintenant, dans notre Gethsémani, le pieux pèlerin, peut suivre pour ainsi dire, pas à pas, comme s’il les avait sous les yeux, les grands faits que nous venons de rappeler, d’après l’Evangile.
II – La voie douloureuse
Seules, les saintes femmes qui accompagnaient Marie, sa divine mère, et aussi la courageuse Véronique apparaissent sur le chemin du Calvaire, pour offrir au divin Sauveur quelque adoucissement, quelque consolation. Un groupe nombreux de Filles de Jérusalem se montre aussi, et lui témoigne de la compassion. De là est venue la pensée de réserver plus particulièrement les travaux de notre Voie douloureuse, aux femmes chrétiennes des paroisses environnantes. Et, de fait, elles seules y ont mis la main jusqu’à ce jour.
Nous n’oublions pas non plus que notre Bienheureux voulait que tous eussent part aux travaux de son Calvaire :
Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous,
Grands et petits, de tout sexe et tout âge.
Mais, en quoi consistent les travaux de cette voie douloureuse et où en sont-ils ?
A Jérusalem, la Voie douloureuse, que parcourent avec tant de piété les pèlerins des Saints-Lieux, est formée d’une suite de rues étroites et mal pavées, qui conduisent par divers détours, de l’ancien Prétoire de Pilate, à l’Eglise du Saint-Sépulcre. Nous avons déjà dit que notre Prétoire est, à peu de chose près, à la même distance du Calvaire, que l’est à Jérusalem, l’ancien prétoire, du Golgotha. Avec un plan très exact à la main, il n’a pas été difficile de tracer sur la lande cette même voie avec ses détours, et de marquer d’une manière très précise l’emplacement de chaque station.
On lui a donné une largeur de quatre mètres, ce qui est la largeur moyenne des rues de Jérusalem.
Voici maintenant le travail exigé pour la construction de cette voie. Il suffit de relever de chaque côté, sur la bande large de quatre mètres une certaine quantité de terre pour lui donner une hauteur de 70 à 80 centimètres.
Puis, sur cette terre, on place de manière à les faire se toucher l’une à l’autre, des pierres de moyenne grosseur, de forme arrondie plutôt que plates, et qui font ainsi une espèce de pavé assez ressemblant, dit-on, au pavé des rues de Jérusalem. Disons-le tout de suite, cette voie n’est pas faite pour être fréquentée. Elle est destinée uniquement à recevoir les statues des divers personnages qui figurent à chaque station. Mais, de plus, de chaque côté, sont tracées deux autres allées parallèles, larges chacune de dix mètres, et qui permettront aux foules les plus nombreuses, de suivre aisément, quand il aura lieu, l’exercice du Chemin de Croix.
Comme il est facile de le comprendre, il s’agit d’un travail à la portée des femmes et même des enfants, et déjà très avancé, au bout de quelques journées seulement, sur une longueur d’environ 120 mètres. C’est déjà l’espace demandé pour les trois stations de Jésus chargé de la Croix, Jésus tombant sous le poids de la Croix, et Jésus rencontrant sa sainte Mère. Il n’est donc pas à craindre que les travaux à exécuter sur place, soient en retard. Nos préoccupations sont d’un autre côté. Nous voudrions, cette année même, pour le premier pèlerinage présidé par Mgr Laroche, l’inauguration des trois stations que nous venons de nommer, tout à l’heure. Non pas que nous ayons la pensée d’avoir immédiatement ces trois stations au complet.
Cela dépasserait de beaucoup trop nos ressources.
Mais nous nous contenterions des quatre statues principales qui doivent y figurer : Jésus chargé de sa Croix, Jésus tombé sous sa Croix, et enfin Jésus et sa sainte Mère. L’accompagnement des soldats et des juifs, et la suite de Marie viendraient plus tard.
L’achat de ces quatre statues, en fonte ciselée, un peu plus grandes que nature, pour qu’elles puissent mieux ressortir, représente une somme déjà considérable, mais que nous ne désespérons pas d’atteindre, si nous sommes aidés.
Nos lecteurs verront plus loin que nous faisons un appel à tous les amis du Calvaire de Montfort, sous une forme qui n’est pas nouvelle dans l’histoire des Œuvres qui n’ont d’autre budget que celui de la charité. Nous avons la confiance que cet appel sera entendu de tous ceux qui ont à cœur la gloire de Jésus crucifié et du Bienheureux, son fidèle serviteur.
Nos travailleurs volontaires
Lundi 20 février. — La Chapelle-Launay
Monsieur le Curé est visiblement heureux et fier de se voir à la tête d’un si beau groupe de travailleurs. Il ne quitte pas de la journée, ses chers paroissiens. Il est avec eux à la récitation du chapelet, au chant des cantiques, au travail. Il les bénit le soir. C’est un de ces jours où notre excellent directeur des travaux voit avancer, à son gré, le pont du Cédron, et en témoigne hautement sa satisfaction.
Mercredi 22 février. — Paroisse de Fégréac
M. le Doyen de Fégréac avait bien le droit d’être aussi satisfait à la fin de la journée qu’il nous a donnée, avec ses paroissiens. Le travail est très animé. Nous ne pouvons pas ne pas noter au passage M. de Barmon, camérier de cape et d’épée de S. S. Léon XIII, adjoint au maire de Fégréac, et visiblement très sympathique à ses administrés. A un moment donné nous le voyons, à la tête d’une colonne, descendre la côte au pas de course, en venant à la maison. Il fallait environ une corde de bois pour étayer le pont en construction sur le Cédron. Chacun après lui, prend, dans le tas, le premier morceau qui se présente, et le met sur son épaule, puis la côte est remontée du même pas.
Il eut fallu du temps pour atteler, charger et décharger un chariot. En un clin d’œil, la corvée était faite. Dans la soirée, à un moment favorable, M. de Barmon prend la photographie du Jardin, de la Grotte et du groupe des travailleurs présents. Nous en avons reçu une épreuve très bien réussie.
Lundi 27 février. — Paroisse d’Assérac
Nous ne saurions trop louer le courage et le dévouement des paroissiens d’Assérac, et de leur excellent Curé, qui par un temps défavorable, nous sont venus, ce jour-là, de si loin et jusque des bords de la mer. Malgré la pluie, nombreux comme ils l’étaient, ils ont accompli dans cette journée une tâche assez considérable.
Signalons cette attention délicate : Ils avaient apporté un certain nombre de plants de chênes-verts et de pins, pour servir à l’embellissement de notre ville de Gethsémani.
†
Nous avons déjà fait remarquer, que pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans un travail, qui doit se continuer, tous les jours, comme le pont du Cédron, nous n’avons qu’à faire un appel aux villages les moins éloignés.
Nous avons à donner aujourd’hui, de ce chef, une liste assez longue. Nous prions nos amis de croire que s’il y a quelque oubli, ce ne peut être, de notre part, qu’un oubli tout-à-fait involontaire.
Le vendredi, 24 février, nous comptons vingt hommes des Métairies, de Cala et du Buissonrond, tous de la paroisse de Saint-Guillaume.
Le samedi, 25 février, un nombre égal de la Plaie, de Hinguet, de la Porcheraie, de la Lauraie, et de la Berneraie, encore de la paroisse de Saint-Guillaume.
Le mercredi, 1er mars, les villages de la Gaine, de la Giraudaie, de Bault, du Soucher, tous de la paroisse de Crossac, nous envoient soixante travailleurs.
Le vendredi, 7 mars, ce sont les villages de Travers, de Lanoë, de la Buronnerie, de la Tasnière, en Sainte-Reine, qui sont représentés.
Le samedi, 4 mars, c’est le seul mais important village de Cusia, aussi de la paroisse de Sainte-Reine. Pas une maison qui n’ait envoyé un ou plusieurs des siens.
†
Il nous reste maintenant à parler des journées de Travailleuses volontaires.
Vendredi 23 février. — Paroisse de St-Joachim
Les femmes de Saint-Joachim, qui, dès l’année dernière, ouvrières de la première heure, étaient venues si nombreuses, ne pouvaient manquer à l’appel fait par leur nouveau pasteur lui-même. Aussi, n’avons-nous pas été étonnés de les voir remplissant, à la lettre, la Chapelle du Pèlerinage, à la messe dite par M. le Curé, dès 8 h.1/2. Et après, quelle joie, et quel entrain au travail ! La grande allée est, en peu de temps, nivelée, aplanie. Elle reçoit sa bordure de pierres, disposées en chapelet.
Les vaillantes travailleuses n’hésitent point à se mettre à la chaîne pour amener à pied d’œuvre, un des gros blocs de pierre, réclamés pour la construction du Cédron.
Beaucoup de cantiques sont chantés. Mais nous constatons, surtout, avec plaisir, au Salut du soir, qu’à St-Joachim aussi, les hymnes liturgiques sont chantés et bien chantés, par toute l’assistance.
Jeudi 2 mars. — La Chapelle-des-Marais.
C’est après leur désir, plus d’une fois exprimé, que les femmes de la Chapelle-des-Marais ont été invitées à venir ce jour-là. Elles sont au nombre d’environ deux cents.
Après avoir entendu pieusement la sainte messe, ce sont elles qui les premières, mettent la main aux travaux de la Voie douloureuse. Nous avons dit plus haut en quoi consistent ces travaux. Parmi les travailleuses, les unes relèvent la terre de chaque côté de la voie, qui, au préalable a été exactement tracée. Les autres vont çà et là, chercher les pierres ou cailloux qui doivent la paver.
Mais toutes s’occupent avec la même ardeur. De temps en temps, se fait entendre sur toute la ligne, le Bénissons à jamais… ou bien Par l’Ave Maria...
Le soir, beau salut du T. S.-Sacrement. Puis, au moment du départ, une demande faite avec un tel ensemble et de telles instances, qu’il est vraiment impossible de la refuser. C’est la faveur de revenir dans huit jours, le jeudi suivant. Et c’est ainsi que les pieuses paroissiennes de la Chapelle-des-Marais, nous donnent encore la journée du jeudi, 9 mars. Nous n’en dirons rien de particulier, sinon que plus nombreuses encore que la première fois, elles font paraître en tout le même dévouement, le même esprit de foi.
Jeudi 16 mars. — Paroisse de Sainte-Reine.
Deux fois, les travailleuses de la Chapelle-des-Marais ont été vues, entendues, traversant le bourg de Sainte-Reine en chantant les cantiques du Calvaire. N’était-ce pas assez, trop peut-être, pour exciter un peu l’envie ou du moins un vif désir de venir aussi travailler à l’Œuvre du bon Père de Montfort. Ce désir a été satisfait le jeudi, 16 mars.
Les femmes de Sainte-Reine, ont bien montré, ce jour-là, que leur paroisse reste toujours attachée, entre toutes les autres, à la mémoire et au culte de notre Bienheureux; lui dont la première pensée fut d’élever son Calvaire à côté de la chapelle de Sainte-Beine, aujourd’hui église paroissiale.
Cette journée a fait avancer considérablement les travaux de la Voie douloureuse. Le mouvement est donné. Demain même, c’est toute une section de la paroisse de Missillac qui doit nous arriver.
†
Signalons, en terminant, un fait d’initiative privée, qui n’a pas été sans nous être fort agréable. Dans les anciens souvenirs, la grande paroisse de Montoir de Bretagne, est indiquée, comme une de celles qui donna le concours le plus actif à notre Bienheureux, lorsqu’il entreprit la construction de son Calvaire ; et sans se rendre compte du pourquoi, il semblait douteux que cette tradition pût être aujourd’hui renouée.
Or, voici qu’un brave chrétien, ancien capitaine au long-cours, prend sur lui de faire appel à son entourage. Il nous arrive le jeudi, 9 mars, à la tête d’un groupe bien décidé, et déjà assez nombreux. Ces braves travaillent toute la journée, au jardin de Gethsémani, pendant que les femmes de la Chapelle-des-Marais, sont occupées à la Voie douloureuse.
Le soir, tous nous disaient : La preuve est faite, le doute n’existe plus. Il nous faut une convocation générale et officielle.
La date en a été fixée à la semaine de la Quasimodo
N° 20 Mai 1893
Mercredi 22 mars – Frairie de Sainte-Luce, en Missillac
La Frairie de Sainte-Luce et de Bergon, n’est qu’une section de la paroisse de Missillac. Mais évidemment, personne n’a voulu rester en arrière. On dirait une paroisse entière, tant sont nombreuses les vaillantes chrétiennes qui ont voulu faire leur part du travail de la voie douloureuse. Elles occupent presque toutes les places disponibles dans notre chapelle, pour y entendre pieusement la sainte messe.
Nous n’avons pas à redire l’emploi de la journée qui se partage entre la piété et le travail, le chant des cantiques et le maniement de la bêche ou de la pelle. Tout cela forme un ensemble vraiment beau et édifiant.
Dès le matin, M. l’abbé Landau était là pour encourager et diriger le travail. Dans la soirée la visite de M. le Curé est accueillie par tout le monde, avec bonheur.
C’est un petit groupe de pieuses personnes de notre voisinage, appartenant à la paroisse de Pontchâteau, qui ont voulu, ce jour-là, montrer, en particulier, leur zèle et leur bonne volonté.
Elles ont surtout semé et planté. Dans cette contrée ce sont les femmes qui font ordinairement les semailles. Une des grandes allées parallèles à la voie douloureuse, a été semée de gazon, et le talus de la voie douloureuse planté, des deux côtés, d’une espèce de sedum très vivace. Si, malgré la sécheresse, nous avons, au mois de juin, un peu de fraîcheur sur la lande, nous leur en serons redevables.
Mardi 28 mars et mardi 18 avril. — Paroisse de Prinquiau
La paroisse de Prinquiau mérite une mention toute spéciale. Nous l’inscrivons sous deux dates différentes et l’on va voir pourquoi.
Le 28 mars qui était le mardi de la semaine sainte, son vénérable Pasteur, accompagné de son vicaire, nous venait à la tête d’un beau bataillon d’hommes, pour travailler à l’achèvement du jardin de Gethsémani. Ils ont, ce jour-là, en particulier, transporté une énorme pierre, qui marque l’emplacement où s’arrêtèrent les huit apôtres, qui durent rester à l’entrée, près du Cédron, pendant que N.-S. s’avançait plus loin, avec Pierre, Jacques et Jean.
M, le Curé de Prinquiau ne se trompait point assurément, quand il disait que c’était là une excellente préparation pour ses paroissiens à la célébration des grandes fêtes prochaines. Aussi est-ce avec une joie bien visible qu’il bénissait, le soir, ses chers travailleurs.
Mais, dès ce moment, il avait dû promettre à ses paroissiennes non moins zélées qu’elles auraient aussi leur jour, pour travailler à la voie douloureuse. C’est le mardi, 18 avril, qu’elles nous sont venues nombreuses et pleines d’ardeur. Prinquiau est bien loin d’ici. Il y avait quelques voitures, sans doute, mais bien insuffisantes pour satisfaire tous les désirs. Beaucoup ont fait la route à pied, et dans ce nombre de bonnes anciennes qui comptent 70, 75 ans. D’autres au départ, nous assure-t-on, voyant qu’elles ne pouvaient trouver de place dans les voitures, et ne se sentant vraiment pas la force d’affronter une si longue route, versaient des larmes. Belle et édifiante journée !
Jeudi 13 avril. — Paroisse de Drefféac.
Nous pouvons bien dire la même chose de la journée, que nous avaient donnée la semaine précédente, les pieuses chrétiennes de Drefféac. A Drefféac, on aime tant et on invoque si souvent le bon P. de Montfort! Il n’y a pas de villages, presque pas de maisons où l’Ami du la Croix ne soit reçue, lu en famille. Aussi chaque famille était-elle représentée, ce jour-là, pour avoir sa part aux travaux de la Voie douloureuse. Il y avait une bonne vieille de 84 ans, venue à pied au Calvaire, fin 1821, elle avait déjà de 11 à 12 ans. Elle avait accompagné ses parents et porté sa bottée de terre pour aider à relever la sainte colline, vers laquelle se dirige la voie qu’on trace aujourd’hui.
Vendredi 14 avril. — Frères de S.-Gildas.
Nous terminons par un pèlerinage de travail qui devait avoir et qui a eu son cachet particulier. Dans tous les autres, sans doute, l’ordre règne et la ferveur est grande. Mais, ce jour-là, c’était la régularité et la ferveur religieuses.
Les bons Frères de la Communauté de S.-Gildas avaient pris eux-mêmes les devants et demandé qu’ont voulût bien leur assigner un jour.
Ils étaient tous, quarante environ, venus de très bonne heure au Calvaire, pour entendre la sainte messe. Et quel spectacle édifiant, ils nous ont donné, pendant toute la journée! La prière en commun, le chant pieux des cantiques, ce travail si bien dirigé et accompli avec une exactitude si parfaite. On sentait partout l’esprit de foi d’hommes vraiment heureux de mêler leurs sueurs à une terre qui leur rappelait celle qui fut, un jour, arrosée du sang d’un Dieu.
Nous remercions la belle et si prospère Communauté de S.-Gildas, de nous avoir rappelé une fois de plus, et d’une manière si délicate, les liens de parenté qui l’unissent à la famille religieuse de Montfort.
P.-S. — Aujourd’hui même, jeudi 20 avril, les femmes de la paroisse de S.-Guillaume, qui trouvaient que le jour de convocation pour travailler à la voie douloureuse se faisait bien attendre, sont à l’œuvre. Et, avec quelle ardeur, elles ratissent, aplanissent cette voie dont l’inauguration ne peut désormais se faire attendre longtemps !
Où en sont nos projets pour la Voie douloureuse !
Il nous semble que nos lecteurs nous adressent eux-mêmes cette question. Nous leur avons fait part, dans notre dernier numéro, du désir que nous avions d’en voir inaugurer une partie notable, dès cette année. Ce serait l’objet de la fête du premier grand pèlerinage que doit présider au Calvaire Mgr Laroche. Après le triomphe du Christ de notre Bienheureux, et le triomphe de Jésus agonisant, ce sera le triomphe de Jésus portant sa Croix.
Eh bien ! nous avons hâte de le dire, depuis un mois, le projet a marché et fait des progrès, au-delà de nos espérances.
Tout d’abord, grâce au zèle et à l’activité des travailleuses volontaires, les préparatifs qui étaient à faire sur la lande, sont plus avancés même qu’il n’est besoin pour le moment. Nous nommons ailleurs les paroisses dont les femmes chrétiennes, désireuses de faire revivre les traditions du passé, sont venues prendre part à ces travaux qui leur étaient réservés. Dès aujourd’hui, à peu de chose près, la voie douloureuse est achevée jusqu’à l’emplacement de la septième station, qui est la seconde chute de Notre-Seigneur sur le chemin du Calvaire. C’est plus de la moitié de son parcours; car les dernières stations sont beaucoup plus rapprochées l’une de l’autre. Les deux grandes allées parallèles ou latérales sont aussi aplanies.
Seulement, ici, comme en beaucoup d’endroits sans doute, nous demandons instamment un peu de pluie, pour que le gazon qu’on y a semé puisse germer et nous donner, au lieu de poussière, un tapis de verdure pour le jour de nos grandes fêtes.
Mais, ce travail préparatoire n’est pas tout. Et, les statues artistiques, en fonte ciselée qui doivent animer cette voie douloureuse et la rendre si parlante, les aurons-nous? Oui, dès ce moment, nous pouvons en donner l’assurance, et nous les aurons même en plus grand nombre que nous l’avions annoncé tout d’abord.
Notre appel a été entendu. Zélateurs et zélatrices se sont offerts pour présenter les listes de notre loterie ou tombola. C’est ce dernier terme, paraît-il, qu’il est mieux d’employer. Quoi qu’il en soit, nous savons que partout ils ont été favorablement accueillis. Il en est plusieurs qui en nous rapportant une première liste remplie, en ont demandé une seconde. La liste générale n’est point close. Nous connaissons certains centres, mêmes assez voisins, où l’occasion ne s’est pas encore présentée de faire connaître la bonne œuvre, et qui entreront dans le mouvement, dès qu’il leur en sera parlé.
Mais, dès aujourd’hui, nous atteignons un chiffre qui a permis de faire la commande non seulement des quatre statues dont nous avions parlé, savoir : Jésus chargé de sa Croix, Jésus tombant pour la première fois, et Jésus et sa sainte Mère, mais aussi de Simon le Cyrénéen aidant Jésus à porter sa Croix. Nos zélateurs et zélatrices pensent bien qu’avec leur généreux concours, nous ne refuserons pas d’aller plus loin. Qu’ils reçoivent dès maintenant l’expression de notre bien vive reconnaissance !
Cette reconnaissance, nous la devons aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont envoyé des objets pour être donnés en lot. Il nous a été donné, ces jours-ci, à l’occasion d’un déballage, de voir ce qui n’est évidemment qu’une faible partie de l’exposition qui se prépare. Il y avait là nombre de statues et statuettes, plusieurs Notre-Dame de Lourdes, un charmant groupe de la Sainte Famille, puis des bibelots de tout genre, de jolis chapeaux et autres coiffures pour enfants, des chaînes avec breloques, de nombreuses boîtes garnies de dragées et de bonbons de choix, etc., etc. On nous a montré une garniture de lit, brodé au crochet, d’une valeur réelle. Nous savons que, de divers côtés, d’autres envois sont préparés.
Incessamment, nous devons recevoir la première de nos statues, Jésus chargé de sa Croix. Bien que la pose définitive ne doive avoir lieu que plus tard, nous pourrons bientôt juger à l’avance, sur place, de l’effet produit. Nos lecteurs seront certainement contents d’apprendre, que dans le grand atelier de Paris, où il lui était donné, ces jours-ci, une dernière préparation, cette statue faisait l’admiration de tous les visiteurs.
N° 21 Juin 1893
Travaux sur la Voie douloureuse
Ce mois de Mai, a vu encore deux de ces belles journées de travail volontaire, données à Dieu et au P. de Montfort, par les femmes chrétiennes de la contrée. Leur convocation était motivée par le succès inespéré de l’appel fait pour l’achat des premières statues de la Voie douloureuse.
On sait qu’au début, nous ne comptions guère aller au-delà de la quatrième station : Rencontre de la Sainte Vierge, mais dès ce moment, il a été évident que nous pouvions aller plus loin.
Mardi 9 mai. — Paroisse de Donges
Les femmes de Donges bien que fort éloignées du Calvaire sont venues en grand nombre.
C’était le moment où tous les regards se tournaient vers le Ciel pour demander la pluie. Et, de fait, apparurent ce jour-là quelques nuages plus ou moins menaçants.
Nous en fîmes l’observation, en passant, à quelques-unes de nos braves travailleuses : « Ah ! dirent-elles, nous avons demandé, de tout notre cœur, ce matin, au Bon Dieu et au P. de Montfort de faire nos deux ou trois lieues, ce soir, trempées d’eau, puissions-nous être exaucées. »
Les pieuses paroissiennes de Donges se rappelleront que ce sont elles qui ont fait les derniers préparatifs sur la Voie douloureuse pour recevoir le groupe de Jésus aidé par Simon le Cyrénéen à porter sa croix.
Le Maître aussi s’en souviendra.
Mardi 16 mai. — Paroisse de Sainte-Anne de Campbon
Les travailleuses de Sainte-Anne s’annoncent, de bonne heure, par leurs chants. Elles ont devancé l’heure fixée pour entendre la Sainte Messe, et dès 7 h. 1/2, elles remplissent notre chapelle. Quel beau rôle que celui de Sainte Véronique sur le chemin du Calvaire, et avec quelle piété, quel courage elle le remplit ! Nous sommes persuadés que les paroissiennes de Sainte-Anne partageaient ses sentiments, en faisant sur la Voie douloureuse les derniers préparatifs, pour l’emplacement de la sixième station. Elles peuvent compter aussi avoir part à la récompense de Sainte Véronique.
M. le Curé et son vicaire vinrent visiter les travaux, et ce fut M. le Curé qui donna le salut du soir.
Le 6 Juin, fête semblable présidée par M. l’abbé Marchais, vicaire général, pour l’inauguration et la bénédiction de la Grotte de Gethsémani, au Jardin des Oliviers.
La lande de Pontchâteau avait revu les merveilles d’autrefois. Pendant toute la saison d’hiver, les travailleurs volontaires étaient venus par centaines, au chant des cantiques et récitant le chapelet, offrir leur temps et leurs sueurs, pour la construction de cette Grotte de l’Agonie de Jésus. Et, au jour de la fête, ils étaient plus de trois mille, tous décorés de la Croix de Jérusalem, et se disputant l’honneur de porter en triomphe, sur leurs épaules, Jésus agonisant.
Cet élan ne s’est point ralenti. Non seulement, depuis l’année dernière, les travaux du Jardin des Oliviers ont été complétés, mais la Voie douloureuse, qui, à l’imitation de celle de Jérusalem, doit relier le Prétoire au Calvaire, est plus d’à moitié achevée. Nous n’avons pas à décrire, ici, ce travail. Nous dirons seulement, qu’en souvenir du rôle des saintes femmes de l’Evangile, au Calvaire et sur le chemin du Calvaire, ce travail, qui leur semblait réservé, a été accompli entièrement par les femmes chrétiennes de la contrée.
Au moins six des grandes et belles statues en fonte ciselée, qui doivent rendre notre voie douloureuse si vivante et si animée, seront placées pour le 24 juin: Jésus chargé de sa Croix, Jésus tombant pour la première fois, Jésus et sa sainte Mère, Jésus aidé par Simon le Cyrénéen.
Ces statues seront bénites solennellement par Sa Grandeur Mgr Laroche, qui a bien voulu accepter de présider le pèlerinage, au lendemain même des fatigues de sa première visite pastorale.
MM. les Curés des paroisses voisines nous ont déjà fait savoir que nous pouvions compter sur eux, comme pour les précédentes fêtes. D’autres plus éloignés viendront certainement avec un groupe plus ou moins nombreux de leurs paroissiens.
Le 24 juin 1891
vit le triomphe du Christ du B. Montfort. Le 6 juin de l’année dernière, ce triomphe a été renouvelé, en l’honneur de Jésus agonisant. Cette année, c’est la statue de Jésus chargé de la Croix qui sera portée triomphalement, à la grande procession du soir.
Ces lignes sont écrites au moment où se manifestent des inquiétudes, des craintes de plus en plus vives au sujet des récoltes compromises par la sécheresse continue. On entend dire de toutes parts, que le Ciel semble irrité contre nous. Il en est, sans doute, qui verront un excellent moyen de le fléchir, dans la résolution prise à l’avance de concourir au triomphe de Celui qui, en chargeant un jour sur ses épaules la Croix, a pris aussi sur lui les péchés du monde tout entier.
†
L’invitation qu’on vient de lire est générale ; mais, comme nous l’avons dit, nous devons à nos chers lecteurs de l’Ami de la Croix quelque chose de plus spécial. Combien nous serions heureux de les voir tous ce jour-là réunis au Calvaire ! N’y ont-ils pas tous leur place marquée ?
Ce sont eux qui auront préparé cette fête, qui l’auront rendue possible et plus belle que nous l’osions espérer.
C’est grâce à l’empressement avec lequel ils ont accueilli notre projet que la tombola a si bien réussi. Zélateurs et zélatrices se sont mis en campagne et partout ont fait merveille. Là, si nous voulions citer tous les traits édifiants, nous ne finirions pas.
†
Un jour, le P. Supérieur fait la remarque qu’une paroisse de la contrée, assez distante du Calvaire, n’a probablement pas connaissance encore de ce qui se fait pour l’achat des statues de la Voie douloureuse. A qui s’adressera-t-il, pour y faire parvenir une liste ?
Sur une des bandes d’abonnements à l’Ami de lu Croix, il avise un nom et envoie à tout risque.
Trois semaines après, le P. Supérieur se voit abordé par un brave homme dont le visage est rayonnant de joie et qui lui présente sa liste bien remplie : « J’aurais voulu venir plus tôt, lui dit-il, mais, je n’ai que le dimanche, et il m’a fallu trois dimanches pour finir. » « Vous ne me connaissez pas, mon Père, ajoute-t-il, mais, croiriez-vous que pendant que mes enfants lisaient le dernier numéro de l’Ami de la Croix, où il était question de ces listes, j’avais demandé au P. de Montfort de m’en envoyer une pour que j’eusse le plaisir de faire quelque chose pour lui. Et justement votre liste m’est arrivée, la voilà ! »
Cet homme est un bon et simple cultivateur resté veuf avec six enfants jeunes encore, qu’il élève dans la crainte de Dieu et dans une confiance sans bornes au B. P. de Montfort dont le nom est invoqué tous les jours dans cette maison.
†
Voici une de ces bonnes Sœurs du tiers-ordre, si zélées pour tout bien et qui rapporte, je crois, sa seconde liste. Elle a dû faire bien des pas et des démarches, parcourir bien des villages éloignés les uns des autres. Elle croit pouvoir faire connaître la pieuse intention, qui la soutenait, quoique bien faible, au milieu de ses fatigues. On sait que malheureusement, même dans les contrées les plus chrétiennes, le respect du saint nom de Dieu n’est pas toujours gardé, et qu’il existe, sur ce point, des habitudes déplorables : « Eh bien ! dit cette pieuse fille, j’ai un petit neveu qui grandit. Tous les jours je demande au bon Dieu de le préserver de ce malheur ; et toutes mes fatigues je les ai offertes au P. de Montfort pour obtenir par son intercession, que jamais un blasphème ne sorte de la bouche de cet enfant. »
†
Tandis que les plus humbles bourses s’ouvraient pour y puiser les vingt-cinq centimes, prix d’un billet de la Tombola, nous apprenions que quelques personnes avaient eu la bonne inspiration d’offrir des dons plus considérables.
†
Il y a quelques semaines, une lettre de MM. Delin, frères, sculpteurs à Paris, donnait ici cet avis : Un noble visiteur s’est présenté à notre atelier, demandant à voir la statue de Jésus chargé de sa Croix. Après l’avoir examinée, il nous a dit qu’il se chargeait d’en faire le paiement et que nous pouvions en avertir qui de droit.
Quelques jours après, nous apprenions que le noble visiteur et généreux donateur n’était autre que M. Jules de Lareinty, marquis de Tholozan et Député de la Loire-Inférieure, dont le nom restera attaché à la seconde station de notre Voie douloureuse.
Nous croyons de plus pouvoir compter sur sa présence à notre fête du 24 juin.
†
Presqu’en même temps, une pieuse chrétienne de la paroisse de Frossay, pleine de reconnaissance pour une faveur qu’elle attribue à l’intercession du B. Père de Montfort offrait le prix de la statue de Marie rencontrant son divin Fils sur le Chemin du Calvaire.
Pourquoi le tairions-nous? Nous avons confiance que de si nobles et si généreux exemples trouveront des imitateurs.
†
En attendant, nous n’avons qu’à exprimer notre bien vive reconnaissance à tous ceux qui sont entrés avec tant de zèle dans les vues de notre Bienheureux P. de Montfort.
L’envoi de lots pour la tombola se multiplie toujours. Peut-être y a-t-il eu oubli d’accusés de réception. Je me crois obligé, en particulier, de signaler l’envoi d’un très beau lapis brodé, de la maison de Braqueville-Toulouse.
Le jour du tirage n’est point encore fixé. Tout fait prévoir que nous serons obligés de le renvoyer après la grande fête du24 juin. Ce sera une seconde fête, moins solennelle sans doute que la première, mais qui ne manquera pas d’intérêt pour ceux qui voudront en être témoins.
Dispositif de la fête du 24 Juin 1893 au Calvaire de Pontchâteau
Cérémonie du matin
Bénédiction des Statues de la Voie douloureuse
Les Paroisses venant en Procession se rangeront devant le Prétoire dans l’ordre qui leur sera indiqué.
A 10 heures 1/4, Monseigneur sera conduit processionnellement à la Scala Sancta.
Chants pendant la Marche :
Dieu le veut. — Vive Montfort.
A 10 heures 1/2, Messe dite par M. le Curé de Pontchâteau.
Chants pendant la Messe :
Premier Credo de Dumont.
Après l’Élévation : 0 l’auguste Sacrement.
Avant le Sermon : Vive Jésus, vive sa Croix.
Sermon par M. l’abbé Bouter, Supérieur du Petit Séminaire de Guérande.
Bénédiction des Statues.
Le Clergé reconduit Sa Grandeur à la Maison des Pères de la Compagnie de Marie. Chant : 0 Montfort, ô bienheureux Père.
CÉRÉMONIE DU SOIR
Triomphe de Jésus chargé de sa Croix.
A 1 heure 1/2, les Paroisses se mettront en Procession dans l’ordre qui leur sera indiqué.
Les divers groupes de porteurs se rangeront dans le Jardin des Pères.
Chants pendant la Procession :
1° Vive Jésus, vive sa Croix.
2° Vive Montfort, l’Apôtre du Rosaire.
3° Dieu le veut…., etc.
A la « Scala Sancta »
Allocution.
Salut du Très Saint-Sacrement donné par Sa Grandeur.
Chant : Bénissons à jamais…
La fête du 24 juin 1893 au Calvaire de Pontchâteau
Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Cette prédiction faite autrefois par le Bienheureux Montfort à ses chers travailleurs du Calvaire reçoit de plus en plus visiblement son accomplissement. Aux manifestations déjà si éclatantes dont la lande de la Madeleine a été le théâtre, il faut maintenant ajouter celle du 24 juin de cette année. La cérémonie de la bénédiction des statues du chemin de la croix, annoncée déjà dans la Semaine Religieuse, s’est accomplie au milieu d’un grand concours de peuple, et ne le cède en grandeur et en magnificence à aucune des fêtes précédentes.
Les préparatifs de la fête
Dès la veille il était facile de remarquer que la décoration de la chapelle et du parcours de la procession s’harmonisait admirablement avec le double caractère de la fête du lendemain. Les élèves de l’Ecole apostolique étaient chargés de la chapelle. Au fond du chœur courent de larges banderoles sur lesquelles on lit : Calix meus inebrians quam præclarus est ! Ite et vos in vineam meam, et quod justum fuerit dabo vobis. C’est que le lendemain en effet, la première cérémonie de la journée non donnera le spectacle si émouvant d’une ordination de missionnaires.
Le nouvel autel du Bienheureux, dû à la générosité de M. le marquis de Montaigu, attire tous les regards. Deux tableaux d’une remarquable fraîcheur y représentent le B. Montfort encourageant ses travailleurs du Calvaire, et s’entretenant avec la Sainte Vierge. Depuis plusieurs semaines, les séminaristes d’Haïti consacraient leurs moments libres aux décorations extérieures. En Orient, les peuples, pour perpétuer le souvenir d’une victoire ou d’un fait remarquables, élevaient de hautes colonnes de pierre sur lesquelles on gravait l’événement à signaler. C’est le genre de décoration qu’offrait la lande du Calvaire cette année. Quatorze stèles sur lesquelles un titre de chaque station du chemin de la Croix avait été inscrit, et correspondant aux quatorze stations, orneront un des côtés du parcours de la procession, et de l’autre, sur chaque stèle correspondante, les noms des paroisses qui concourent par leur dévouement à l’œuvre du Bienheureux Montfort.
Réception de Monseigneur
Tout est prêt pour la grande fête du lendemain, et voici qu’en effet déjà, de divers côtés, de nombreux cavaliers arrivent au Calvaire. Sous la direction de M. de Kérobert fils, ils forment bientôt un escadron de vrais chevaliers de la Croix, dont ils portent tous à la main, et sur la poitrine, le signe sacré. Ils se dirigent vers la gare, heureux et fiers d’aller faire escorte à Sa Grandeur. Après une brillante réception à Pontchâteau et le salut donné à l’église, Monseigneur entouré de son cortège triomphal part pour le Calvaire. Sur la route, Sa Grandeur doit s’arrêter jusqu’à trois fois pour allumer des feux de joie préparés spontanément par les braves habitants des villages d’alentour. C’était comme le prélude des nombreux feux qui devaient, à la nuit tombante, éclairer tout l’horizon. Ce sera la réponse joyeuse et l’accueil de toute la contrée au signal donné par monseigneur du haut de la lande du Calvaire. Soudain la cloche annonce l’arrivée du premier pasteur du diocèse. Le R. P. Barré, Supérieur du Calvaire, lui souhaite la bienvenue. Il lui exprime tout le bonheur qu’ont ressenti les enfants de Montfort, surtout ceux du Calvaire, à la nouvelle que le diocèse de Nantes allait l’avoir pour Evoque, puis en quelques mots fait connaître à Sa Grandeur les œuvres qui fleurissent ici. Monseigneur répond et remercie dans les termes les plus aimables et les plus délicats. Il est heureux de venir encourager les œuvres du Calvaire; il rappelle l’allusion faite par le R. P. Supérieur à la croix qui brille dans ses armes, et en donne les raisons. Monseigneur daigne manifester l’intérêt particulièrement affectueux qu’il porte aux Pères de la Compagnie de Marie et rappelle que c’est un de ses membres, le R. P. Blin, qui sut le premier discerner en lui le germe de la vocation ecclésiastique. — Sa Grandeur confère ensuite le Sacrement de confirmation à une dizaine d’élèves de l’Ecole apostolique, et M. le chanoine Briand, qui l’accompagne, donne la bénédiction du T. S. Sacrement. Après le souper, Monseigneur visite pieusement la grotte du jardin des Oliviers si favorable à la prière et si habilement construite par M. Gerbaud, le médaillé de Montana, et tous les travailleurs volontaires de l’an passé. Il y admire aussi les statues de Jésus en agonie et de l’ange consolateur, œuvres de M. Vallet, l’éminent artiste nantais.
Le matin de la fête. — Cérémonie de l’ordination
Nous sommes au matin du grand jour. Dès l’aube, les pèlerins affluent. Beaucoup sont partis de grand matin, pressés par leur religieux désir d’assister à l’ordination. En effet, de bonne heure, Monseigneur, que n’arrête aucune fatigue, daigne ordonner, en faveur de la mission d’Haïti, vingt-six séminaristes dont six prêtres qui partiront dans quelques semaines dépenser leur vie pour le salut des âmes qui les attendent là-bas.
La sainte messe. — Cérémonie de la bénédiction des statues
Pendant cette cérémonie les paroisses, dont plusieurs viennent de très loin, arrivent processionnellement. Bientôt tous les chemins aboutissant au Prétoire sont couverts de pèlerins qui viennent se ranger en ordre devant la Scala Sancta. A 10 h 1/4, au chant des cantiques, Monseigneur se rend processionnellement à la Scala Sancta précédé de l’Ecole apostolique, du grand séminaire et d’un nombreux clergé. Monsieur le Curé de Pontchâteau commence aussitôt le Saint-Sacrifice. Les chants pendant la messe, le Credo, les cantiques : O l’auguste Sacrement, Vite Jésus, vive sa croix, sont exécutés par les 10,000 fidèles présents, avec beaucoup d’ensemble et de piété. On a particulièrement remarqué l’ardeur et l’assurance avec lesquelles ce peuple de foi a affirmé ses croyances. Puis M. l’abbé Bouyer, supérieur du petit Séminaire de Guérande, prend la parole. Malheureusement vers le milieu de ce discours si éloquent et de nature à produire une si profonde impression, une pluie malencontreuse est venue distraire un peu l’attention de l’auditoire pourtant si recueilli.
Après le Saint-Sacrifice, Monseigneur, précédé de l’Ecole apostolique et du clergé, bénit solennellement les statues qui animent déjà la première partie de la voie douloureuse.
En même temps qu’elle accomplît les rites liturgiques, Sa Grandeur admire, avec les 120 prêtres présents, le talent artistique de MM. Delin frères, de Paris, chargés du chemin de croix monumental dont nous n’avons que les premières statues. Toutes fidèles qui se pressent à la suite de Monseigneur rendent à Jésus chargé de sa croix, à Jésus tombant sous le poids de sa croix, à Jésus rencontrant sa sainte Mère, à Jésus aidé par Simon le Cyrénéen, à Jésus consolé par sainte Véronique, les premiers des nombreux hommages qu’il doit recevoir dans ces lieux. En même temps le clergé et la foule chantent avec ardeur : Vive Jésus, vive sa croix.
Quelques instants après, une gracieuse hospitalité réunissait dans la maison des RR. Pères Missionnaires, autour de Monseigneur, MM. les curés des paroisses représentées et quelques invités parmi lesquels nous remarquons le T. R. P. Maurille, supérieur général, M. le chanoine Nail, M. le Curé de Saint-Josse-de-Bruxelles, M. Jules de Lareinty, député, qui a offert la première statue de Jésus chargé de sa croix, MM. Ginoux de Fermon, Henri Le Cour, Corbun de Kérobert et de Faouëdic, conseillers généraux, M. Deloze, ancien conseiller général, MM. le Gouvello, de Baudinière, Pahier, maire de Pontchâteau, Dubois, conseiller d’arrondissement, M. Delin, M. Anthime Ménard, etc.
Au dessert, le R. P. Barré, supérieur, exprime sa reconnaissance à Monseigneur pour l’intérêt tout spécial qu’il porte à l’œuvre du Calvaire et dont il donne aujourd’hui un si éclatant témoignage. Il remercie MM. les Curés et tous les travailleurs du généreux concours qu’ils y ont apporté. Le R. P. a un mot délicat pour chacun des convives qui ont un titre particulier à sa gratitude.
Après lui, M. de Lareinty, député, se lève et dans un noble langage explique sa présence à cette manifestation, après avoir salué en Sa Grandeur le guide autorisé des catholiques de ce religieux diocèse. Il vient comme catholique et il a pensé qu’ayant l’honneur de représenter à la Chambre cette chrétienne population, sa place était toute marquée à cette fête. Il rend hommage à la grande, intelligence du Souverain Pontife Léon XIII et à sa paternelle sollicitude pour notre chère France. Sa Grandeur félicite les RR. PP. du zèle infatigable qu’ils déploient pour mener à bon terme l’œuvre de leur B. Père et maintenir la foi dans ces chrétiennes populations. Notons enfin que l’excellente musique du Pensionnat de N.-D. de Toutes-Aides, qui déjà, à la cérémonie du matin, avait été si remarquée à cause de la parfaite exécution de ses morceaux et qui tout-à-l ‘heure encore, à la procession du soir, va contribuer si puissamment au triomphe de Jésus chargé de sa croix, est venue charmer les convives pendant la fin du repas.
Procession du soir. — Triomphe de Jésus chargé de sa croix.
Mais déjà la cloche annonce la cérémonie du soir et voici que la statue si expressive de Jésus chargé de sa croix apparaît (dans le jardin des Pères) su son brancard monumental, magnifiquement décor avec velours rouge et entouré de 20 oriflammes. Les hommes qui doivent la porter se groupent à la suite, pendant que les paroisses se réunissent autour de leurs croix et bannières, à la place qui leur a été assignée. Bientôt la procession se met en marche. En tête, c’est Missillac avec ses clairons, puis viennent les paroisses morbihannaises de Péaule, Marzan, Férel, Nivillac dont les enfants de Marie portent la statue du bon Père Montfort. Soudan, avec sa musique, jeune encore il est vrai, mais qui donne se si belles espérances, est bien là, au milieu de la procession, pour exciter encore si c’est possible, l’élan de la multitude.
Suivent Guenrouët, S.-Guillaume, Campbon, la Chapelle-Launay, Vay, Besné, Prinquiau, Herbignac, Méans, Ste-Reine, Nozay, Paimbœuf, Blain, la Chapelle-des-Marais, S.-Joachim. Les Filles de la Sagesse, filles aussi de l’Amant passionné de la croix, avaient tenu à venir en grand nombre honorer Jésus chargé de sa croix. Enfin c’est le clergé et Monseigneur que précède le brancard porté par 40 hommes.
La procession contourne le Calvaire, puis se développe sur la hauteur de la lande. Bientôt les premières paroisses arrivent à la Scala Sancta. De là le spectacle est vraiment grandiose. Ce qui touche le plus, c’est toute cette multitude répandue sur le parcours, qui chante et qui prie avec la plus vive ardeur et la plus grande piété. Devant le Prétoire, chaque paroisse continue à chanter et à prier jusqu’au moment où arrive Jésus chargé de sa croix avec son cortège triomphal. Il s’avance majestueusement, dominant la foule. On sent qu’il est vraiment roi de tout ce peuple qui l’acclame avec enthousiasme, de tous ces cœurs qui l’honorent avec tant d’empressement.
Aussi, après le salut donné par M. le Chanoine Nail, est-ce l’éloge de la foi bretonne qui jaillit des lèvres de Monseigneur, dans l’allocution chaleureuse qu’il adresse à ces quinze mille auditeurs si avides de recueillir ses paroles. Il félicite tous les témoins de cette belle fête de ce magnifique acte de foi : ils s’honorent ainsi en méprisant le respect humain qui fait aujourd’hui tant d’esclaves. Il les félicite d’être venus honorer Jésus chargé de croix, car la croix est l’expression la plus éclatante de l’amour de Dieu pour l’homme. Il les félicite enfin d’être venu honorer Montfort, le héraut zélé du mystère de la croix. Il leur promet, comme fruit de cette journée, des grâces de choix et leur en donne le gage par sa bénédiction solennelle. Puis, la foule s’écoule lentement, emportant de cette touchante cérémonie, une profonde et impérissable impression.
N° 27 Décembre 1893
Chronique du mois
En attendant, il ne faudrait pas croire que nous restons tout-à-fait inactifs. C’est le temps des plantations d’arbres et d’arbustes. Et certes, ce n’est pas une petite affaire que de pourvoir, sur ce point, à l’ornementation d’une surface nue de cinq à six hectares. Il faut planter, planter beaucoup; mais, il faut planter aussi avec intelligence et goût. Et, pour cela il faut certaines connaissances spéciales, qui ne sont pas le fait du premier venu.
Vous qui avez lu la vie de notre Bienheureux Père, vous souvient-il comment, lorsqu’il avait besoin d’un aide pour quelqu’une de ses Œuvres, la Providence lui mettait pour ainsi dire, sous la main, le sujet convenable ? Sur le point de commencer ses courses apostoliques, il sent le besoin d’un compagnon de voyage. Il voit un jeune homme à genoux, dans une église de Poitiers, il lui dit comme autrefois le Maître à ceux qu’il avait choisis: Suivez-moi. Et le Frère Mathurin, admirablement doué pour son emploi, le suit, en effet, dans toutes ses missions, chantant les Cantiques, et faisant le catéchisme aux petits enfants.
Il vient de dédier à Notre-Dame de la Sagesse, dans son ermitage de St-Lazare, un oratoire restauré. Il lui faut quelqu’un pour le garder et l’entretenir : C’est vous, dit-il à une vertueuse fille, qui se trou-rait dans l’auditoire, c’est vous qui serez la gardienne de Notre-Dame de la Sagesse. Et Guillemette Rousel, qui n’avait jamais songé à pareil emploi, accomplit pieusement la tâche qui lui avait été confiée, pendant vingt-sept ans, jusqu’à la fin de sa vie.
A certains faits, nous serions tentés de croire que grâce sans doute à l’intercession du Bienheureux, la Providence continue d’agir de même, pour la continuation de son Œuvre du Calvaire.
Il y a quelques mois, un ancien élève d’une ferme-école chrétienne, où l’on s’occupait très particulièrement d’horticulture, vient frapper à la porte de notre maison du Calvaire. Après avoir rempli les fonctions de maître-jardinier, dans plusieurs maisons importantes et en dernier lieu dans une maison religieuse du Midi, il avait senti le besoin et le désir de revenir en Bretagne, d’où il était parti.
Ayant entendu parler des travaux du Calvaire, il venait simplement offrir ses bras et sa bonne volonté au B. de Montfort. Il ne demandait pour tout salaire, qu’une cellule où il pût se retirer et prier, après avoir bien travaillé. Sa proposition acceptée, l’installation ne se fit pas attendre. Et dès le lendemain, il était à l’œuvre.
Les plates-bandes et les massifs du Jardin de Gethsémani sont régularisés et profondément fouillés. La grande sécheresse avait fait de grands ravages dans nos plantations. Les sujets desséchés sont remplacés par des sujets nouveaux. Puis, voilà toute une réserve de jeunes plants soigneusement piqués, pour les besoins de l’avenir. Nos grandes allées étaient simplement marquées par deux rangées d’arbres à haute tige ; maintenant des arbres et arbustes verts en complètent la décoration. La Voie douloureuse attendait, elle aussi, ses deux rangées d’arbres. Ils viennent d’être plantés, avec toute la régularité et le soin désirables. Et ce n’est qu’un début, mais qui nous fait espérer pour le printemps prochain, un changement d’aspect tout à l’avantage de notre pèlerinage. Nous craignons bien que l’humble tertiaire de Saint-François, qui est en cause dans ces lignes, ne soit un peu fâché, en les lisant. Mais ce qui le consolerait, croyons-nous, c’est si ces mêmes lignes donnaient à quelques personnes la bonne pensée de lui procurer certains plants qu’il convoite, et qu’il lui est plus difficile de se procurer. Ce sont précisément ceux qui donneraient surtout la couleur locale à son Jardin de Gethsémani ; quelques plants du cèdre, voire même quelques palmiers…
Qu’il serait heureux aussi d’avoir en quantité suffisante des rosiers de Bengale pour en border la Voie douloureuse!
Pour lui permettre d’accomplir ce qui est déjà fait, des mains généreuses se sont ouvertes ou plutôt réouvertes. Et c’est bien le moins que de nouveau aussi, nous en exprimions ici notre reconnaissance.
†
Tandis qu’ont lieu ces embellissements extérieurs, des mains pieuses ne se lassent pas de travailler à orner, dans la chapelle, l’autel de notre Bienheureux.
C’est ainsi qu’il y a peu de jours encore, on mettait sous nos yeux, un beau tour d’autel, brodé au crochet, d’un goût exquis, d’un travail achevé. Que d’heures il a fallu donner, pour mener à bonne fin un ouvrage si délicat. Et ce qui rend le sacrifice de ces heures plus méritoire, c’est que la jeune orpheline auteur de ce travail, les a prises sur ses récréations si peu nombreuses. Elle fait partie de l’Ouvroir de la Petite Providence, rue du Lycée, à Nantes. Nous avons une raison particulière d’indiquer ainsi d’une manière bien précise, cette excellente maison. Dans un de nos derniers numéros, nous avons parlé d’un dessus d’autel également offert par une orpheline de la même maison, et dont le travail méritait les mêmes éloges que nous donnons aujourd’hui au travail de sa compagne. Mais nous avons, par erreur, mis le nom d’un autre Ouvroir pour celui de la Petite Providence. Cette erreur nous tenons à la réparer. Ce sont bien deux enfants de la Petite Providence qui ont voulu ainsi offrir à l’autel du Bienheureux une parure complète.
Lui ne s’y sera pas trompé, et nous sommes sûrs qu’il n’a point manqué d’abaisser tout particulièrement ses regards bienveillants sur une maison, dont le nom seul lui plaisait tant, puisqu’il ne voulait pas autrefois habiter d’autre maison que la Maison de la Providence. Partout, dans ses missions, la maison où il descendait, du moment qu’il y avait mis le pied, s’appelait la maison de la Providence.
N° 28 Janvier 1893
Travaux et embellissements à la Voie douloureuse.
Disons tout d’abord que malgré toute la bonne volonté et l’ardeur dépensées dans notre dernière campagne de travaux pour la Voie douloureuse, ces travaux furent trop précipités pour arriver à un achèvement complet. Ce qu’il fallait surtout obtenir alors, c’est que la Voie apparût bien marquée sur la lande du moins dans le parcours destiné à recevoir les statues dont l’inauguration et la bénédiction devaient avoir lieu le 24 juin. Ce but fut atteint, et la grande et belle cérémonie eut lieu.
Mais, de l’avis de tous, il restait beaucoup à faire pour donner à cette Voie l’aspect qu’elle doit avoir, dans l’ensemble du pèlerinage dont elle est comme le centre.
Sur un assez long espace, du côté qui aboutit à la route, elle n’était qu’ébauchée. Sur le reste du parcours, les pierres qui en font le revêtement avaient été jetées un peu pêle-mêle. Celles en particulier formant arête de chaque côté n’étaient ni alignées, ni consolidées. Au-dessous le talus en terre était très irrégulier et sans consistance.
Nous parlions dans notre dernier numéro, de plantations et en particulier de deux rangées d’arbres qui bordent non pas la Voie douloureuse elle-même, mais les deux allées parallèles qui l’encadrent dans toute sa longueur. Cette plantation très soignée faisait ressortir encore davantage les défectuosités de la Voie principale.
Mais, au sujet de cette plantation même, qu’il nous soit permis d’ouvrir une parenthèse. Les arbres choisis pour faire cette bordure sont des plants d’acacia. L’acacia a un feuillage touffu et des fleurs odorantes. Parmi les plants, les uns sont à fleurs blanches, les autres à fleurs roses et sont entremêlés. Toutefois ce ne sont ni ses fleurs, ni son feuillage qui ont déterminé le choix.
L’acacia est aussi l’arbre aux dures épines. Il en est, en particulier, une variété, dont on peut voir quelques spécimens dans nos parcs et squares, et que l’on dit très commune en Judée, dont les épines sont extrêmement longues et acérées. D’après une tradition respectable, c’est cet arbre qui aurait fourni aux soldats romains les épines cruelles dont ils entrelacèrent la couronne de joncs marins qu’ils placèrent sur la tête de Notre-Seigneur au Prétoire. Et cette couronne le divin Sauveur la porta tout le long de la Voie douloureuse jusqu’au Calvaire.
Une fois, sur cette pente du symbolisme, la pensée vint de donner à la Voie douloureuse elle-même une bordure de rosiers à fleurs rouges. Le rosier aussi a ses épines. Et plusieurs saints Docteurs ont vu dans la rose rouge qui est regardée comme le symbole de l’amour, surtout le symbole de la Passion, qui est en effet l’amour porté à ses dernières limites.
S. Bernard, en particulier, dans un de ses beaux sermons sur la Passion, développe avec amour cette pensée, seulement bon nombre de ses expressions nous semblent intraduisibles en notre langue :
« Voyez, dit-il, en parlant de Notre-Seigneur, regardez ses mains l’une après l’autre, n’y voyez-vous pas deux roses du rouge le plus vif? Regardez ses pieds, ne sont-ils pas fleuris de la même manière. Regardez l’ouverture de son côté, n’y voyez-vous pas la rose la plus belle, bien que d’un rouge un peu plus pâle, à cause de ce mélange mystérieux de sang et d’eau qui sortit de son cœur, d’après le témoignage de l’Evangéliste S. Jean. »
Quelqu’un se souvient peut-être qu’il y a un mois, nous exprimions, ici, au nom de notre bon Frère-tertiaire horticulteur le désir d’avoir un nombre suffisant de plants de rosiers de Bengale rouges. On peut dire que ce désir a été prévenu. Dans les jours mêmes, nous recevions d’Orléans un colis assez volumineux. Ce colis contenait mille très beaux plants de rosiers tels qu’ils étaient désirés. L’envoi était fait au nom du R. P. Rivalland, Supérieur de la Résidence des Pères de la Compagnie de Marie, dans ladite ville. Qu’il reçoive ici l’expression de notre bien vive reconnaissance!
Il n’y avait plus qu’à se mettre à l’œuvre. Il fallait pour cela un certain nombre de travailleurs volontaires. Et, il a suffi pour les avoir de faire appel à nos amis des villages les plus rapprochés du Calvaire.
Le premier jour, mardi 5 décembre, ce sont les villages de Quémené, de la Brionnière, du Rot, de la Mondrais, de l’Hôtel-Guérif, tous de la paroisse de Crossac, qui nous envoient une vaillante troupe.
Le surlendemain jeudi 7 décembre, quatre autres villages de la même paroisse de Crossac nous envoient un groupe de travailleurs à peu près égal in nombre au premier. Ce sont les villages de Coismeux, de Quinta, de Bosla et de Lornais.
La semaine suivante, trois paroisses différentes sont représentées, le même jour vendredi 15décembre, chacune par un de leurs villages. La paroisse de St-Guillaume par le village des Métairies, celle de Ste-Reine par le village de Travers, et enfin Crossac par le village de la Cossonnais.
Le samedi, 16 Décembre, deux villages de la paroisse de St-Guillaume, le Buisson-Rond et Calla mettent la dernière main aux travaux projetés, pour ce moment, du moins.
Or, voici maintenant le résultat de ces quatre journées, en y comprenant, il est vrai, le travail continu de notre bon frère Cyprien, (c’est le nom de notre tertiaire horticulteur dont il a été déjà fait mention):
La voie douloureuse a été complètement achevée et a reçu son revêtement de pierres jusqu’à la route. Dans toute la longueur du parcours, chaque pierre formant arête des deux côtés de la voie a été mise en ligne et consolidée. Puis, au ras de terre, a été établie une seconde rangée de pierres à demi enfoncées dans le sol. Enfin, entre ces deux lignes a été rapportée une quantité de terre arable formant un talus en pente douce, large de cinquante à soixante centimètres. C’est sur ce talus qu’a été faite, avec, tout le soin possible la plantation des mille rosiers de Bengale.
Que l’hiver veuille bien continuer de nous ménager ses rigueurs, et dès le printemps prochain, nos pèlerins verront s’épanouir les roses et notre lande s’étonner de porter une pareille floraison !
Tous aussi verront mieux encore qu’auparavant, combien il est désirable que promptement, notre Voie douloureuse qui doit être si monumentale achève de se peupler et de s’animer, en complétant les groupes déjà commencés, et en y ajoutant ceux qui manquent encore totalement. Nous avons confiance que plusieurs prendront à cœur de nous aider à faire de ce désir une réalité.
†
A l’occasion des travaux et embellissements dont nous venons de parler, nous sommes invités à rappeler un avis qui a été donné plus d’une fois, ici, de vive voix, mais qui n’est pas parvenu, sans doute, aux oreilles de tous ceux qui visitent le Calvaire : C’est que sous aucun prétexte les pèlerins ne peuvent se permettre de monter, ni de marcher sur la chaussée de la Voie douloureuse proprement dite.
Il est évident, à première vue, que cette chaussé n’a pas été faite pour qu’on y puisse marcher. Les pierres qui la recouvrent sont très irrégulières et mal jointes. Le moins qui puisse être dit, c’est que vouloir y marcher, c’est s’exposer à de légers accidents. Les deux voies parallèles semées de gazon sont assez larges pour la circulation des pèlerins. Il n’y a pas de raison de s’approcher plus près pour mieux voir. Et si, en particulier, le pèlerin partant du Prétoire suit la voie qui est à gauche, il est au vrai point de vue pour bien voir les statues qui toutes sont légèrement tournées et inclinées de ce côté.
On ne saurait non plus invoquer je ne sais quels motifs de piété. Dernièrement encore, j’aperçus moi-même un groupe de pèlerines déjà bien engagées sur la voie et qui paraissaient, malgré les difficultés, bien décidées à la parcourir toute entière, contrairement au présent avis. Je me contentais tout d’abord de faire observer combien il était, plus simple et plus facile de marcher à côté sur la pelouse : « Ah! mais, mon Père, me fût-il répondu tout d’une voix, c’est pour gagner des mérites. » Je ne pouvais, sans doute, qu’être édifié de la réponse. Mais je dus cependant faire remarquer qu’il y avait mérite aussi à ne pas contrevenir à un règlement établi pour de sérieux motifs, et que dans le cas présent, le mérite de l’obéissance me semblait plus sûr que les autres. Nous ne doutons pas que ce ne soit aussi l’avis de nos lecteurs. La défense sera respectée de tous. C’est une mesure de bon ordre sans laquelle nous ne pourrions en particulier, ni entretenir, ni conserver la bordure de rosiers qui vient d’être plantée avec tant de précautions et de soins.
N° 29 Février 1894
Un autel à la Sainte Famille dans la chapelle du Pèlerinage
Nous célébrons, aujourd’hui, en union avec toute l’Eglise, pour la première fois, la Fête de la Sainte-Famille, dans notre Chapelle du Pèlerinage.
…Léon XIII, en instituant cette fête de la Sainte-famille, a voulu, qu’au moins une fois chaque année, tous les chrétiens fussent invités à contempler, pendant quelques instants, le ravissant spectacle qu’offrait autrefois l’humble maison de Nazareth. Spectacle alors inconnu des hommes, mais que les Anges contemplaient avec admiration du haut du Ciel, et qui nous a été révélé depuis.
Léon XIII a exprimé, de plus, le désir de voir dans chaque famille chrétienne, dans chaque communauté religieuse, une image, une représentation de la Sainte-Famille.
Ce désir, il l’a exprimé, dans une circonstance solennelle, d’une manière très particulière aux Enfants du B. Montfort, les engageant à user de tous les moyens en leur pouvoir, pour répandre et promouvoir la dévotion à la Sainte-Famille.
Aussi, est-ce un bonheur pour nous de pouvoir annoncer qu’il va nous être donné d’entrer très spécialement dans les vues du grand Pontife, par l’érection prochaine d’un autel à la Sainte-Famille, dans notre Chapelle du Pèlerinage.
Nous le devrons au vénérable vieillard, qui a déjà doté cette même chapelle de l’autel du Bienheureux, et dont le pinceau toujours jeune a retracé les deux scènes si gracieuses de l’Apparition de Marie à son Serviteur, sous les vieux chênes de la forêt, et de Montfort haranguant ses pieux travailleurs au pied de la colline du Calvaire.
Déjà le pieux artiste a repris ses pinceaux, et mis la main à l’œuvre.
Ses grandes lignes sont arrêtées, nous ne les connaissons pas. Mais, nous croyons pouvoir, cependant, dire sans indiscrétion que la principale pensée qui le guide dans cette Œuvre est de prêcher, à sa manière, la sanctification du travail par l’exemple de la Sainte-Famille.
Puisse le séjour qu’il va faire en Touraine lui donner de nouvelles forces et les meilleures inspirations sur ce beau sujet !
Ce sont bien en effet des familles de travailleurs, d’ouvriers qui viendront prier devant cet autel. Travailleurs du sol, ouvriers de l’usine, ouvriers des grands Chantiers de la Loire, ce sont eux qui forment toujours la grande majorité dans nos pèlerinages. Et nous l’avons fait remarquer plusieurs fois, c’est en famille qu’ils viennent au Calvaire, père, mère, enfants.
Nous les verrons, après s’être agenouillés quelques instants, comme ils ont coutume de le faire devant l’Autel du Bienheureux, s’avancer de quelques pas pour s’agenouiller aussi devant l’Autel de la Sainte-Famille. Et la leçon parlante qui sera sous leurs yeux sera comprise de tous, même des jeunes enfants.
La pose de cet autel servira, nous l’espérons, de prélude à la construction et à l’inauguration de la Maison même de la Sainte-Famille, telle qu’on la voyait autrefois à Nazareth, et qui, nos lecteurs le savent, a sa place marquée dans notre pèlerinage. Ce sera aussi un encouragement de plus pour ceux qui seront invités à venir prendre part aux travaux de notre Nazareth, ou plutôt du Nazareth de Montfort.
N° 30 Mars 1894
Notre Maison de Nazareth
C’est à la piété, à la générosité d’une honorable famille chrétienne de notre voisinage, que nous devrons d’avoir, ici, bientôt, une image, une représentation exacte de la Maison de Nazareth, ou Santa-Casa.
Tout est préparé à l’avance pour cela. Les plans qui seront suivis pour la construction de la sainte Maison ont été dressés à Lorette même, par un homme de l’art, et avec une exactitude scrupuleuse jusque dans les moindres détails. Nous sommes donc assurés d’avoir une reproduction fidèle quant à la forme de l’édicule et à ses diverses dimensions.
Quant aux matériaux mêmes, on sait que les murs de la Sainte Maison sont construits en petits moellons d’une pierre crayeuse, à teinte rougeâtre, dont on se sert encore aujourd’hui pour bâtir à Nazareth. Précisément, la Providence a placé non loin de nous certaines carrières dont la pierre est à peu près de la même teinte, et qui peut être facilement taillée, de manière à imiter assez bien les moellons de Nazareth, dont nous venons de parler.
Ce travail de préparation est déjà assez avancé; et aujourd’hui même, dimanche 18 février, un appel a été fait à tous nos bons cultivateurs des environs, pour vendredi prochain. Nous sommes assurés qu’ils se trouveront nombreux, à l’heure dite et au lieu fixé, en Sainte-Anne de Campbon, avec leurs attelages, pour transporter de la carrière au Calvaire chacun leur part des matériaux qui serviront à la construction de la Sainte Maison.
Cette construction n’est, elle-même, qu’une partie du travail projeté. Il faudra des terrassements pour figurer la petite colline à laquelle était adossée la Sainte Maison, colline dans le flanc de laquelle se trouvait creusée une grotte qui complétait l’habitation de la Sainte Famille. C’est dire assez que nous aurons plus d’une fois, cette année encore, à faire appel à nos travailleurs volontaires.
Pendant ce temps, la main d’un artiste préparera le groupe de l’Annonciation, ou de la visite de l’Archange Gabriel à Marie pour lui annoncer qu’elle va devenir la Mère de Dieu.
Nous avons la confiance que cette simple annonce intéressera les lecteurs de l’Ami de la Croix, à la continuation de notre Œuvre du Calvaire, qui est aussi la leur. Mais, nous nous proposons de revenir avec eux sur la merveilleuse histoire de la Santa-Casa : Merveilles qui s’y sont passées et dont elle a été témoin, merveilles accomplies par Dieu pour la préserver de toutes les profanations, de toutes les dévastations, et pour la conserver à son Eglise, merveilles de grâces de toute sorte, qui ne cessent d’y être répandues, surtout depuis qu’y afflue la foule des pèlerins ; faveurs précieuses accordées par les Souverains Pontifes à la visite de ce lieu béni et privilégié entre tous, et auxquelles nous espérons bien, par l’affiliation, avoir part un jour.
Léon XIII, glorieusement régnant, vient d’y ajouter encore, en accordant, par Lettres apostoliques, un Jubilé, pour le six-centième anniversaire de la Translation miraculeuse de la Sainte Maison, à Lorette. En recommandant la Dévotion à Notre-Dame de Lorette, il rappelle la Dévotion à la Sainte Famille, qui lui est si intimement liée, et qu’il a tant à cœur.
Nous ne donnons aujourd’hui que de simples indications, sur ces divers points. Contentons-nous de rappeler ce qui, sur ce sujet, doit intéresser plus particulièrement les dévots fidèles du Bienheureux Montfort, et leur donner l’assurance que, du haut du Ciel, il sourit à la nouvelle entreprise, et ne manquera pas d’y mettre lui-même la main.
Tous savent sa dévotion très spéciale pour le premier mystère du saint Rosaire, l’Incarnation du Verbe éternel de Dieu, dans le sein de Marie, qui, d’après ses propres paroles, est le Mystère de Jésus-Christ le plus caché, le plus élevé, le moins connu, et un abrégé de tous les autres mystères renfermant la volonté et la grâce de tous.
C’est le 25 mars, jour de l’Annonciation de la Sainte Vierge, qu’il désigne comme fête spéciale à ceux qui veulent entrer dans la Dévotion du Saint Esclavage de Jésus en Marie.
Nous avons rappelé déjà son pèlerinage à Notre-Dame-de-Lorette. Il trouva là tant d’attraits et de délices, qu’il y séjourna près de quinze jours, malgré son désir d’arriver promptement à Rome. C’est après l’avoir vu célébrer la sainte Messe à l’autel de Notre-Dame, avec une ferveur angélique, qu’un pieux habitant de la petite ville l’invita à loger chez lui, et à y prendre ses repas.
C’était sur la fin de mars, et il est probable que le grand dévot de Jésus et de Marie a célébré le Mystère de l’Incarnation le 25, dans la demeure même où il s’était opéré dix-sept siècles auparavant, à pareil jour.
Dans le nouvel ouvrage qui vient de paraître sur Notre-Dame-de-Lorette, à l’occasion du sixième centenaire de la Translation, l’auteur a un chapitre, l’un des plus intéressants du livre, intitulé : Témoignages des Saints et des Bienheureux.
Il n’a point oublié Montfort, et il rapporte même de lui certaines paroles que nous ne trouvons chez aucun de ses historiens, mais qui, peut-être, ont pu être conservées par la tradition, à Lorette même.
Nous citons textuellement le commencement de ce chapitre :
« La Mère du pur amour a rempli sa demeure de l’odeur du baume le plus précieux ; et de même que les vases retiennent l’odeur des parfums qu’ils ont contenus, ainsi est imprégnée des parfums célestes cette Maison qui a contenu la source de tout ce qui est suave au Ciel et sur la terre.
» La présence de Jésus, Marie et Joseph se fait toujours sentir dans la chère Demeure : Il semble, comme le disait le Bienheureux Grignon de Montfort, qu’on les voit, et qu’on les entend converser ensemble ; la Lumière du monde paraît toujours illuminer la chambre, et le sourire de Marie, la réjouir. »
Ce qui, du moins, ne peut faire doute, c’est que, là, il fut comblé des grâces les plus précieuses, et y goûta les consolations les plus douces.
Qu’il nous aide donc à construire notre nouveau Nazareth, et qu’il nous obtienne d’y avoir part, au moins dans une certaine mesure, à ces grâces et à ces consolations !
Journées de travail volontaire
Les travaux les plus importants et de nature à être plus remarqués, sans doute, qui vont avoir lieu pour la construction de notre Nazareth, ne doivent pas nous faire oublier des travaux plus modestes accomplis avec une bonne volonté digne de tous les éloges.
Sur une aussi vaste étendue de terrain que l’est l’enceinte du pèlerinage, on remarque et l’on remarquera probablement longtemps encore, des points où le travail est resté inachevé et qui laissent beaucoup à désirer pour la beauté, et la régularité de l’ensemble. C’est, ici, le nivellement d’une allée très défectueuse et qui demanderait à être corrigé; là, des amoncellements de pierres qui devraient être transportées ailleurs; là encore, une provision de bonne terre végétale, inutile à la place qu’elle occupe et qui serait d’un grand profit au pied de nos jeunes plantations, etc.
C’est pour des travaux de ce genre que les bons habitants du village de Cusia (paroisse de Ste-Reine) nous ont donné leur première journée de Carême, le Mercredi des Cendres. C’était vraiment une journée de pénitence, mais qui a été bravement acceptée. La pluie fine et presque continue qui tombait n’est point parvenue à ralentir leur ardeur au travail.
Les villages de la Gaine et de la Giraudais, do la paroisse de Crossac, convoqués pour le jeudi de la semaine suivante ont été, au contraire, favorisés par un très beau temps ; et leur journée a été fructueuse.
Aujourd’hui même, se sont des travailleurs volontaires de Drefféac, qui déblaient avec ardeur le terrain où doit s’élever notre Nazareth. De temps en temps, se fait entendre le chant : Ave Maria. C’est bien de circonstance, au milieu du travail qui a pour but l’édification de la maison même de l’Ave Maria.
C’est après-demain vendredi, que tous les chariots des environs se rendront à la carrière pour le transport des pierres qui formeront les murs de la Sainte Maison. On ne parle de rien moins que d’une cinquantaine d’attelages. Nous y reviendrons.
2 Avril fête du Lundi de la Quasimodo
C’est à ce jour qu’est renvoyée, cette année, la célébration de la Fête de l’Annonciation de la Sainte Vierge. C’est aussi à ce jour qu’est fixée la bénédiction de la première pierre de notre Maison de Nazareth. Cette fête sera présidée, et la bénédiction sera faite par M. le Curé-Doyen de Savenay, chanoine honoraire.
Dans la matinée, grand’messe à 9 heures. La bénédiction de la première pierre aura lieu, dans l’après-midi, vers deux heures.
Elle sera précédée d’une allocution par un prêtre membre de l’honorable famille qui fait, si généreusement les frais de la construction du pieux monument.
N° 31 Avril 1894
Travaux volontaires pour la construction de la Maison de Nazareth
La journée du vendredi, 23 février, a tenu ce qu’elle promettait. C’était, ainsi que nous le disions, dans la Chronique de notre dernier numéro, le jour fixé, pour amener de la carrière à pied-d ‘œuvre les pierres destinées à la construction de notre Maison de Nazareth.
C’est bien une cinquantaine de chariots attelés, qui se trouvèrent au rendez-vous, dès le matin. Etaient représentées les paroisses de Pontchâteau, de Sainte-Reine, de Crossac, de S.-Guillaume, et de Sainte-Anne-de-Campbon.
La distance du Calvaire est d’environ huit kilomètres. Ce qui rendait l’opération plus difficile, plus pénible, et par conséquent plus méritoire, c’est que la carrière est située à une certaine distance de la grande route. Et, précisément, ce jour-là, les terres avaient été détrempées par un dégel très prononcé.
Tout s’est néanmoins passé dans un ordre parfait et sans le plus léger accident.
Nous n’étions pas au départ de la carrière, mais nous avons assisté, ici, à l’arrivée et au déchargement. Conducteurs et chevaux sont un peu fatigués, sans doute, mais l’entrain et la bonne humeur ne font pas défaut. Un mot recueilli au passage peint les sentiments de ces braves gens si dévoués à l’Œuvre du Calvaire. Comme au départ, et pour les mêmes raisons, il y avait à l’arrivée, un passage difficile. Il fallait quitter la grande route, pour aller décharger dans le champ, à l’endroit où sont creusés, en ce moment, les fondations de la Maison de Nazareth. Il y avait un chemin tracé, il est vrai, mais tout-à-fait rudimentaire. Les pierres qu’on y avait jetées n’étaient pas solides sous les pieds des chevaux.
C’est le tour d’un bon vieux qu’à la couleur de ses vêtements et à sa coiffure spéciale, il est facile de reconnaître pour le propriétaire d’un des nombreux moulins à vent que l’on voit du Calvaire. Au passage difficile, le cheval hésite un moment. Or, voici de quelles paroles est accompagné un léger coup de fouet : « Allons, mon vieux… N’aie pas peur… Tu ne peux pas te faire de mal !… C’est pour le bon Père Montfort ! »
Telle est la confiance de nos bons villageois en la protection du Bienheureux. Et c’est toujours à sa voix qu’ils répondent, en venant au Calvaire. C’est pour lui qu’ils travaillent. C’est à lui qu’ils ne savent rien refuser.
Dans la circonstance présente, ils savent bien, sans doute, qu’il s’agit de la construction de la Maison de Nazareth, de la maison de la Sainte Vierge. Mais dans leur pensée, c’est encore au Père de Montfort que cette maison sera donnée, pour que lui-même en fasse hommage à la Reine du Ciel.
†
Le mercredi de la semaine suivante, 28 février, a été, ici, une belle journée de printemps, et aussi une belle journée de travail volontaire.
Il fallait bien une avenue, pour aborder à notre Maison de Nazareth ; et, même pour qu’elle fût plantée cette année, le temps pressait. Tous se rappelaient qu’il y a quatre ans, au début des travaux, était échu à nos plus proches et excellents voisins de Saint-Guillaume, l’honneur de mettre les premiers la main à l’œuvre, en traçant et en aplanissant la première allée qui conduit au monument du Prétoire.
Cette allée est déjà bien belle aujourd’hui avec ses rangées de tilleuls qui ont prospéré et grandi, et dont les bourgeons vont bientôt s’ouvrir, avec sa haie d’aubépine et ses fusains qui lui font une décoration de verdure même en hiver.
C’est encore aux bons paroissiens de Saint-Guillaume, que l’appel avait été adressé pour l’avenue de Nazareth.
Elle est parallèle à l’allée dont nous venons de parler, mais n’a que la moitié de sa longueur. Aussi, nos soixante braves n’ont-ils pas eu de peine à remplir leur tâche. Un détachement, même, a trouvé le temps de défoncer un vaste carré de terre en face du prétoire, dont le gazon avait besoin d’être renouvelé.
L’avenue de Nazareth est maintenant encadrée de deux rangs de pommiers, en attendant d’autres plants, qui, de chaque côté de la Sainte Maison, formeront ce qui s’appellera désormais le Verger de la Sainte Vierge, le Verger de Marie.
Les habitants de Saint-Guillaume, nous a-t-on dit, tiennent à la réputation de bons chanteurs. Aussi, plus d’une fois, dans cette belle journée, nous entendions du côté de Nazareth, des voix vibrantes redisant avec ensemble le Refrain du Bienheureux :
Par l’Ave Maria
Le Péché su détruira.
Par l’Ave Maria
Toute grâce nous viendra.
M. le Curé qui avait bien voulu accompagner, ici, les siens, donna, avant le départ la Bénédiction du Très Saint-Sacrement.
†
Nous ne devons pas oublier de mentionner ici, d’autres travaux volontaires moins remarqués, parce qu’ils se font isolément au jour le jour, mais qui ne sont pas moins méritoires.
Nous voulons parler du charroi des moellons ordinaires, qui entrent en quantité considérable dans les fondations et dans l’intérieur des murs de la sainte Maison, et surtout dans la construction de la grotte.
Jusqu’à présent, ce sont les bons cultivateurs des villages de la Cossonnais, de Coimeux, de Quinta, de la Bassinais, de La Noë, de Travers, de la Tanière, de Saint-Cado, de la Buronnerie, tous des paroisses de Crossac et de Sainte-Reine, qui ont rempli cette tâche. D’autres, après eux, nous en avons la confiance, la continueront avec le môme dévouement.
†
Un dernier mot: Nous devions certainement nous attendre à des réclamations, même vives, si dans les travaux et la construction de la Maison de Nazareth, une part n’avait été réservée aux travailleuses volontaires.
Un commencement de satisfaction va leur être donné. Dès la semaine de Pâques, on compte sur un certain nombre d’entr’elles pour aplanir les alentours de la sainte Maison, en faciliter l’abord, dégager le terrain qui sera plus tard le verger de la Sainte Vierge.
En un mot, elles auront à tout disposer, à tout mettre en ordre pour la fête de la Bénédiction de la première pierre, fixée ainsi que nous l’avons dit, au Lundi de Quasimodo.
La voie douloureuse
La construction de Nazareth, et la Représentation du premier mystère du Saint Rosaire, ne peut pas et ne doit pas nous faire oublier notre grande entreprise de la voie douloureuse.
Voici précisément venir le grand anniversaire de ces scènes sanglantes et divinement touchantes qui commencent à la grotte de Gethsémani, pour se terminer au sommet du Calvaire. N’est-ce pas le moment opportun, d’intéresser de nouveau nos lecteurs, à cette œuvre, qui dans la pensée de notre Bienheureux devait servir à la glorification de la Passion et de la Croix de son divin Maître, et aussi au salut de bien des âmes qui trouveraient là leur conversion ou leur affermissement dans le bien ?
Nous l’avons déjà dit à nos lecteurs, en leur témoignant notre reconnaissance; c’est grâce à la générosité avec laquelle ils ont répondu à notre appel, de toutes parts, l’an dernier, en prenant quelques billets de loterie que nous avons eu notre belle fête du 24 juin, marquée par la bénédiction des huit grandes statues en fonte, qui ont commencé d’orner et d’animer notre Via Crucis. C’est encore le produit de cette humble loterie auquel sont venus se joindre les dons de quelques personnes généreuses, qui a permis de faire la commande de sept autres statues composant la station complète de Jésus consolant les Filles d’Israël sur le chemin du Calvaire.
A en juger par les modèles photographiés que nous avons eus sous les yeux, ce groupe doit être du plus grand effet.
Mais, nos zélateurs et zélatrices ne veulent point s’en tenir là. Déjà plusieurs sont en campagne, ayant entre leurs mains la belle photogravure de la Vue générale du Pèlerinage, peinte par M. Gerbaud. Un exemplaire en est offert à toute personne qui veut bien se faire inscrire pour deux billets, (cinquante centimes). Ceux qui ne souscrivent que pour un seul billet (vingt-cinq centimes) reçoivent un chromo, portrait du Bienheureux, avec ses litanies. C’est un moyen de le faire prier et invoquer plus souvent et par un plus grand nombre.
Nous avions donné à penser que le Panorama du pèlerinage pourrait être adressé à chacun de nos abonnés, en même temps que l’Ami de la Croix. La grandeur du format ne le permet pas. Mais, nous croyons savoir que, sous peu de temps, il sera adressé par paquets, partout où nous avons un certain nombre de lecteurs. Nous avons la confiance que les personnes qui recevront cet envoi voudront bien en tirer parti, pour l’Œuvre du Bienheureux, comme les personnes dévouées dont nous venons de parler.
Nous avons déjà dit que la bénédiction de la Station de Jésus consolant les femmes de Jérusalem est fixée au Lundi de la Pentecôte. Le prochain numéro donnera le programme complet de cette fête. Mais, dès aujourd’hui nous pouvons annoncer que la cérémonie sera présidée par M. l’abbé Créton, curé de Saint-Nicolas, de Nantes, et que le sermon sera donné par M. l’abbé Camper, vicaire de la Roche-Bernard.
N° 32 Mai 1894
Travaux de Nazareth
Les travailleuses volontaires de la paroisse de Ste-Reine, annoncées pour la semaine de Pâques et qui devaient tout disposer autour des fondations de la Sainte Maison, se sont parfaitement acquittées de leur tâche, en y ajoutant même quelques travaux urgents sur la Voie douloureuse. Le travail était animé par le chant : Ave, Maria, qui, pendant la journée retentit bien des fois sur la lande.
†
C’est le mercredi, 11 avril, qu’a eu lieu le second convoi, pour amener des carrières de Sainte-Anne-de-Campbon les pierres spécialement employées pour la construction de la maison de Nazareth, Pontchâteau, Sainte-Reine et Missillac y prenaient part avec la même bonne volonté qu’à la première fois. Notons en passant ce petit fait : Les derniers chariots étaient un peu surchargés, et la montée est rude dans la Rue de la Gare de Pontchâteau. Plusieurs braves Pontchâtelains se sont empressés de, donner le coup de main, que les conducteurs sont obligés de réclamer quelquefois, mais dont ils sont toujours heureux de remercier, surtout quand il leur est offert aussi spontanément.
†
Aujourd’hui môme, jeudi 19 avril, une vaillante troupe de travailleuses venues de Saint-Malo-de-Guersac, commence les travaux de la petite colline à laquelle sera adossée la Maison de Nazareth.
N° 33 Juin 1894
Travaux à la Maison de Nazareth
Le compte-rendu de nos fêtes, ne nous laisse pas de place, cette fois, pour la continuation de l’Histoire de la Sainte Maison. Nous y reviendrons bientôt. Mais nous ne pouvons renvoyer à plus tard de féliciter ceux qui sont venus avec tant de bonne volonté prendre part aux travaux de notre Nazareth. Certes, ils en ont montré du courage et de la bonne volonté, ceux que nous avons à signaler les premiers, comme ouvrant cette nouvelle série.
Saint-André-des-Eaux est une paroisse peut-être ainsi nommée parce que d’un côté elle est à une assez petite distance de l’Océan, et que de l’autre elle se rapproche de la Grande-Brière qui n’est qu’un vaste lac pendant toute la saison d’hiver. Les habitants de Saint-André des-Eaux ont toujours été dévoués au Bienheureux Montfort. C’est une tradition certaine que leurs ancêtres furent des plus ardents à le seconder dans la construction de son Calvaire. Or, pendant qu’il était ici question d’entrer en pourparlers, afin de renouer cette tradition, voici que le R. P. Brény, très dévoué à l’Œuvre du Calvaire, vient y prendre quelques jours de repos.
Saint-André est presque son pays natal. Il y a là de nombreux membres de sa famille. C’est lui qui, du reste assuré du succès, se charge d’aller faire les premières propositions. L’appel adressé du haut de la chaire par le vénérable Curé est accueilli avec enthousiasme. Le jour fixé est le Vendredi, lendemain de l’Ascension. Le matin, cent cinquante hommes sont là présents pour le départ, armés de leurs instruments de travail. La route est longue de plus de sept lieues. Bien des chars-à-bancs ou carrioles ont été réquisitionnés, mais en nombre encore très insuffisant. Tous ceux qui n’ont pas de place prennent le chemin dit de la Grande-Brière. Ils espèrent bien trouver, et trouvent en réalité quelques bateaux pour les passages qu’il est impossible de franchir à pied. Et de fait, ils nous surprennent arrivant les premiers au Calvaire, formant un bataillon serré, et débouchant sur une voie par laquelle ils n’étaient point attendus. Tous sont bientôt réunis à la Chapelle, pour entendre la messe dite par M. le Vicaire de Saint-André. Ils y chantent avec un magnifique entrain les cantiques d’usage. Puis le travail commence. C’est merveille de voir certains talus de fossés disparaître, et les terres s’accumuler pour former la colline de Nazareth. Quelques bons fermiers des environs ont amené leurs chariots, qui sont remplis et déchargés en un clin-d ‘œil. De temps en temps, toutes ces voix d’hommes s’unissent pour jeter aux échos de la lande un pieux refrain. C’est vraiment une de ces Journées à la fin desquelles tous ceux qui y ont pris part se félicitent mutuellement. Quelqu’un nous cite le mot d’un de ces braves travailleurs, rendant bien la situation. « C’est nous qui sommes les vainqueurs !… Nous serons sur la feuille, le mois prochain ! » La feuille n’est autre que l’Ami de la Croix. Ils y sont autant que nous pouvons les y mettre tous les braves de Saint-André-des-Eaux, regrettant de ne pouvoir inscrire tous leurs noms.
Nous avons déjà dit que M. le Vicaire remplaçait le vénérable Curé. M. le Maire aussi était là, avec son adjoint, prenant part à tous les travaux et payant largement de leur personne.
Ce jour-là, ce sont nos bons amis de Bergon qui viennent nous prêter main-forte, avec leur bonne volonté ordinaire. Ils vont être dirigés par M. Gerbaud, qui nous arrive sans avoir pris le temps de se reposer du voyage qu’il vient de faire pour assister aux fêtes d’Orléans. Tandis qu’on lui amène de la crête de la lande, sur un traîneau ingénieusement construit, les blocs de pierre, il les dispose avec son goût ordinaire; et bientôt l’on voit se dessiner l’entrée de cette grotte qui faisait partie de l’habitation de la Sainte Famille à Nazareth. La colline en même temps s’élève, et c’est avec une agréable surprise que tous peuvent constater le soir, les progrès accomplis dans la journée. Honneur aux braves travailleurs de Bergon !
†
La journée du lendemain, 11 mai, n’est pas moins fructueuse. C’est toute la chrétienne paroisse de la Chapelle-des-Marais qui est aujourd’hui représentée. Et au nombre des travailleurs, il est permis de conjecturer que bien peu de familles n’ont pas là quelqu’un des leurs. Tous ne se regardent-ils pas comme solidaires dans la reconnaissance pour les bienfaits reçus ? Et n’est-ce pas une marque évidente de la protection spéciale du B. Montfort sur la paroisse que la guérison de cet enfant, racontée par nous dans notre dernier numéro? Quoi qu’il en soit, les travailleurs de la Chapelle-des-Marais ont montré, une fois de plus, leur zèle pour l’Œuvre du Calvaire, et ont fait grandement avancer les travaux.
Sans doute, il reste encore beaucoup à faire; mais déjà l’on peut entrevoir ce que sera notre Sainte Maison avec sa colline et sou verger fleuris, rappelant Nazareth (la ville, des Fleurs).
†
P.-S. — Il ne nous est pas permis d’oublier que pour la pose du groupe de Jésus consolant les Filles de Jérusalem, de nombreuses et dévouées travailleuses nous sont venues des villages de Quémené et de la Brionnière. Elles ont mis la dernière main à l’aplanissement et à l’appropriation de la voie douloureuse, et ont eu quelque temps à donner encore aux travaux déjà commencés de Nazareth
Fête du lundi de la Pentecôte, bénédiction de la VIIIe station de la voie douloureuse
Nous empruntons avec plaisir au Nouvelliste de l’Ouest le compte rendu de cette fête.
L. G.
C’était fête, le lundi de la Pentecôte, au Calvaire de la Madeleine, et c’était grande fête. On savait dans toute la contrée — car rien de ce qui touche le Bienheureux Père Montfort n’y est inconnu — qu’un prêtre éminent devait bénir une des stations du grand Chemin de la Croix, la VIIIe, et qu’un orateur à la voix connue et aimée devait prendre la parole en cette circonstance.
A 10 heures, la fête a commencé par le Saint Sacrifice de la Messe. Déjà la foule était nombreuse.
Après la consécration, tout d’une voix, elle a chanté le Credo. La messe dite, les visites particulières ont été faites aux différentes stations et particulièrement à la VIIIe (Jésus console les filles de Jérusalem) que chacun admire pour la première fois.
A 1 heure et demie, les pèlerins se réunissent auprès de la chapelle du Bienheureux et la procession se met en marche.
En tête, sont déployées les bannières de la paroisse de St-Joachim — paroisse la plus assidue, peut-être, et la plus dévouée aux travaux du Calvaire. — Devant le clergé, sur un trône monumental, orné de velours rouge et de broderies d’or, on a placé la statue de Jésus chargé de sa croix. Cinquante hommes portent le brancard. Ils sont pris dans toutes les paroisses et se relèvent tour à tour.
Le cortège s’avance majestueusement au chant des cantiques. Arrivé en face du Prétoire, il s’arrête. En ce moment la foule massée au pied du monument dépasse cinq mille personnes. Le clergé gravit le grand escalier et prend place sous les coupoles. En face de l’autel est assis M. le Curé de Saint-Nicolas de Nantes qui préside.
Après le sermon, la procession a suivi la Voie Douloureuse. M. le Curé de Saint Nicolas a béni le groupe de la VIIIe station, puis a donné la bénédiction du Saint-Sacrement, au retour, à la Scala Sancta.
Tous les assistants de cette belle fête sont retournés chez eux, le cœur plein du souvenir du P. de Montfort.
La Roche-Bernard, 15 mai.
N° 34 Juillet 1894
Les travaux de Nazareth
Ils sont pour ainsi dire terminés.
La Sainte Maison est couverte à la manière orientale. Son unique fenêtre a reçu son treillis. On pourrait même dire qu’elle est déjà meublée, puisqu’il ne doit y avoir d’autres meubles que les humbles placards qui ont été ménagés dans la muraille.
C’est ainsi que, pour nous servir d’une expression bien connue, la clef de la Maison pourrait dès aujourd’hui être remise aux mains de la céleste propriétaire. Mais ce n’est qu’un peu plus tard qu’elle doit venir s’y fixer.
Le jardin ou verger de la Sainte Vierge, tracé par M. Gerbaud et planté par notre bon F. Cyprien, commence déjà à fleurir. C’est la première lettre du nom de Marie, M, qui se montre de plus en plus lisible, à mesure que s’épanouissent les fleurs.
La petite colline à laquelle est adossée la Sainte Maison, va aussi se couvrir bientôt de verdure et de fleurs. On y fait en ce moment même les semis et plantations.
Tout cet ensemble nous promet véritablement une image de Nazareth, ville des fleurs.
Mais, pour en arriver là, bien des bras ont été mis en mouvement. Il a fallu donner bien des coups de pelle et de pioche. Bien des mains ont tiré la chaîne pour mettre en place les rochers qui émergent jusqu’au sommet du tertre.
Tous, travailleurs et travailleuses ont rivalisé de bonne volonté, d’entrain et de zèle pour accomplir la tâche qui leur était assignée. Tous mériteraient en particulier d’être mis à l’ordre du jour; mais tous comprendront aussi que, dans le cas présent, nous devons nous borner à une simple nomenclature des journées de travail, avec le nom des paroisses ou villages qui y ont pris part.
Le mardi 22 mai : travailleuses des villages de Mazin, de Lony et de Pandille, de la paroisse de Saint-Joachim.
Le mercredi 23 mai : les travailleuses sont venues, des villages de la Cossonais, de Coimeux, de Lornais, de Bosla, de la Haie, tous de la paroisse de Crossac.
Le jeudi 24 mai, c’est la Chapelle-des-Marais représentée toute entière par un grand nombre de travailleuses.
Le vendredi 25 mai, c’est un groupe de braves travailleurs que nous envoie la paroisse de Saint-Joachim.
Le mercredi 30 mai, les femmes de la Chapelle-des-Marais reviennent plus nombreuses encore que la semaine précédente.
Le mardi 5 juin, les travailleuses viennent de loin, de Guenrouët, et elles sont très nombreuses. M. l’abbé Avenard leur dit la messe, et leur donne le salut, avant le départ.
Le jeudi 7 juin, ce sont les hommes de Campbon, la paroisse des zouaves pontificaux, dont plusieurs ont heureux de renouveler connaissance avec M. Gerbaud. Le vénérable pasteur est là, encourageant les travaux. Il est accompagné d’un de ses vicaires.
Le vendredi 8 juin, la paroisse de Crossac est représentée toute entière par des travailleuses, en grand nombre.
Le mercredi 13 juin, les travailleuses do Saint-Guillaume déjà bien nombreuses voient se joindre à elles un groupe assez nombreux de Bergon, en Missillac.
Le vendredi 15 juin, c’est le grand village de Féderin, paroisse de Saint-Joachim, qui a dû si trouver à peu près désert, si nous en jugeons par le nombre des travailleuses.
Enfin le mardi 19 juin, groupe nombreux et ardent de Saint-Malo-de-Guersac.
Si, involontairement, nous avions fait quelque oubli, ceux ou celles qui en auraient été l’objet peuvent se consoler en pensant que du moins ni Marie pour qui était le travail, ni le Bienheureux Montfort ne peuvent les oublier.
N° 35 Août 1894
Notre Maison de Nazareth
Nous assistons avec plaisir aux derniers préparatifs qui se font à notre Nazareth, pour la réception de l’hôtesse céleste qui doit en prendre possession très prochainement désormais.
Le jardin fleurit de plus en plus et se garnit même de quelques légumes. La petite colline revêt peu à peu son manteau de verdure. A l’extérieur, les abords de l’humble maison sont débarrassés des restes de matériaux qui l’encombraient, aplanis, sablés. L’intérieur est blanc et propret, comme il devait l’être alors que Marie y entretenait elle-même l’ordre et la propreté, seul luxe qu’elle ne connût jamais. Le plafond est bleu d’azur comme à Lorette. L’autel, rappelant celui que l’apôtre saint Pierre consacra lui-même dans la maison de Marie, vient d’être placé. Le tombeau de cet autel n’a d’autre ornement que le chiffre de la Sainte Vierge, d’or sur fond d’azur, entouré d’un chapelet aux grains d’argent. Les places réservées pour la représentation du mystère de l’Annonciation, celle de l’archange Gabriel apparaissant du côté de l’Epitre, et celle de Marie assise au travail, du côté de l’Evangile, sont encore vides. Mais, nous attendons incessamment de Paris, l’annonce de l’envoi de ce beau groupe.
Tout étant ainsi prêt et assuré, au point de vue matériel, hâtons-nous de dire qu’il n’y a pas non plus à craindre de retard du côté des avantages spirituels.
Le Titre d’agrégation de notre maison de Nazareth à la sainte maison de Lorette vient d’arriver de Rome et a déjà été visé par l’Evêché de Nantes.
D’après ce titre, signé par Son Eminence le cardinal Rampolla, préfet de la Congrégation de Lorette, notre maison de Nazareth participe à tous les privilèges, à toutes les faveurs, accordés par les Souverains Pontifes avec tant d’abondance à la Santa casa elle-même. Nos pèlerins pourront gagner, ici, les mêmes indulgences que ceux qui font le pèlerinage de Lorette, en Italie.
Qu’il nous suffise pour aujourd’hui de dire, qu’outre de nombreuses indulgences partielles, des indulgences plénières sont fixées aux fêtes de la nativité de N. S., de l’Immaculée-Conception, de la Nativité, de l’Annonciation de la Sainte Vierge, de la Translation de la Sainte-Maison, à Lorette.
Ils pourront donner dans le prochain numéro la traduction du texte complet de ce Titre d’agrégation qui, du reste, sera sans doute affiché dans le nouveau sanctuaire.
La fête de l’inauguration et la bénédiction de notre maison de Nazareth est définitivement fixée au dimanche dans l’Octave de l’Assomption, 19 aout, jour auquel l’Eglise célèbre la mémoire de Saint Joachim, père de la Bienheureuse Vierge Marie. La maison de Nazareth était, selon la tradition la plus commune, la maison de saint Joachim et de sainte Anne, et Marie en devint propriétaire en recueillant l’héritage paternel.
La fête du 19 août sera présidée par le R. P. Guiot, de la Compagnie de Marie; et lui-même fera la bénédiction solennelle.
Nos lecteurs n’ont pas oublié que c’est son excellente famille, qui a fait généreusement les frais de construction du nouveau sanctuaire. Sans doute, on remarquera, ce jour-là une place vide… celle de la pieuse Mère de famille que le bon Dieu a voulu appeler à lui, et qui, nous assure-t-on, jusque dans ses derniers moments, tournait pensée vers la Maison de Nazareth. Mais, tous pourront se consoler en pensant que, du haut du Ciel elle n’est pas étrangère à la fête.
Pour donner à un plus grand nombre la facilité d’y prendre part, il y aura double cérémonie :
Dans la matinée, à 10 h., bénédiction de la Maison de Nazareth, suivie de la messe qui y sera célébrée.
Dans la soirée, vers 2 h., bénédiction solennelle du groupe de l’Annonciation précédée d’une procession.
C’est alors surtout, que tous pourront chanter à pleine voix :
O Maison bénie
Vrai trésor du Ciel
*****************
Ave, Ave, Ave Maria !
L’autel de la Sainte Famille
Il sera placé dans la Chapelle du Pèlerinage, pour la belle fête de l’Assomption de la Sainte Vierge.
Cet autel est un ex-voto qui a sa légende.
Il y a un an environ, la santé du vénérable châtelain, à qui nous devions déjà le bel autel de notre Bienheureux, inspirait à tout son entourage les plus vives inquiétudes. Au moment où il était dans le plus grand danger, quelqu’un qui l’approchait, lui rappelant ce qu’il avait déjà fait pour le Bienheureux Père de Montfort lui suggéra de promettre, s’il revenait à la santé, d’entreprendre un travail du même genre, pour un autel dédié à la Sainte famille, et qui avait sa place marquée, non loin du premier.
De fait, le pieux et vénérable artiste revenu bientôt à un état de santé parfaite, n’a pas tardé à tracer un plan et à reprendre le pinceau, pour accomplir sa promesse.
Il y a quelques jours, nous répondions à la gracieuse invitation qui nous était faite de voir le travail presque achevé.
L’autel, en vieux chêne, comme celui du Bienheureux ne se distingue que par la pureté et la sobriété des lignes. Quant au tableau, formant retable, deux textes de l’Ecriture Sainte qui lui servent d’encadrement en indiquent tout le sujet : Et erat subditus eis… Il leur était soumis — In laboribus à juventute meâ … J’ai été exercé au travail, dès ma jeunesse.
Nous sommes dans l’atelier de Joseph. Celui-ci vient de terminer, dans la pièce de bois qu’il travaille, la mortaise destinée à recevoir une autre pièce qui doit y être adaptée, et que, sur son ordre, Jésus est allé chercher et lui présente, Joseph s’est relevé, essuyant, sans doute la sueur de son front, et tandis qu’il décharge Jésus du fardeau qu’il porte, son regard qui exprime tout à la fois l’amour le plus tendre et je ne sais quel étonnement mêlé d’admiration s’arrête fixé sur le rayonnant visage de l’Enfant divin. De l’autre côté, Marie ! Le fuseau qu’elle tient dans sa main délicate a cessé de tourner un instant, et son regard se rencontre avec celui de Joseph, sur le même point et dans l’expression du même sentiment.
C’est une prédication sur l’obéissance et la sanctification du travail dans la famille chrétienne, qu’a voulu faire le pieux et vénérable artiste, ainsi qu’il nous l’a dit lui-même. Nous pouvons affirmer que son sermon sera très goûté et compris.
N° 36 Septembre 1894
Dernières préparatifs à Nazareth
Les lecteurs de l’Ami de la Croix connaissent déjà notre Nazareth, à l’extérieur du moins. Nous le leur avons décrit. Du reste, il n’a fait que s’embellir depuis un mois. La colline est plus verdoyante. Il y a plus de fleurs épanouies. Mais, alors l’intérieur était encore vide. Il n’en est plus de même aujourd’hui.
C’est vraiment une représentation bien vivante de cette entrevue solennelle du messager céleste avec l’humble Vierge de Nazareth, que nous avons sous les yeux, entrevue dans laquelle se débattait le salut du monde tout entier.
D’un côté l’archange apparaît, comme sur un nuage, à un mètre environ du sol. Son vêtement est riche, son port est noble et majestueux, comme il convient à l’ambassadeur du Roi des rois. Mais ses paupières modestement abaissées, son attitude toute entière marquent bien qu’il reconnaît dans l’humble Vierge son Auguste Souveraine. Une de ses mains porte un lis d’une blancheur immaculée, l’autre montre le Ciel d’où il vient.
De l’autre côté, Marie, dans le costume tout à la fois si modeste et si gracieux des filles d’Israël, est assise sur un simple escabeau. Sa main vient de déposer la quenouille qu’elle filait. Son regard limpide comme l’azur du Ciel et fixé sur l’apparition radieuse marque encore quelque étonnement ; mais il semble que ses lèvres si pures s’entrouvrent déjà, pour faire entendre la parole de salut qu’attendent le Ciel et la Terre : Ecce ancilla Domini Fiat : Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole.
Impossible, à cette vue de ne pas entrer doucement dans la méditation de ce premier et si doux mystère du saint Rosaire.
Tout est donc prêt pour la fête du dimanche, 19 août, et pour l’inauguration de notre Santa Casa.
N° 37 Octobre 1894
LE R. P. JEROME ancien Vicaire custodial de la Terre-Sainte au CALVAIRE
Le R. P. Jérôme, ancien Vicaire custodial de la Terre-Sainte, n’est pas un inconnu pour les lecteurs de l’Ami de la Croix. Ils se rappellent sans doute que le Calvaire avait déjà reçu sa visite il y a deux ans, à peine.
C’est par ses conseils appuyés sur sa parfaite connaissance de la topographie de Jérusalem, si longtemps habitée par lui, qu’ont été déterminés plusieurs points importants de notre pèlerinage, notamment la direction de la Voie douloureuse et l’emplacement des quatorze stations de cette même voie.
C’est à lui aussi que nous devons de posséder plusieurs souvenirs intéressants, reliques précieuses des divers sanctuaires de la Terre-Sainte, et en particulier les quatorze petites croix faites du bois des oliviers de Gethsémani, qui seront bénites et placées à chacune des stations de notre Chemin de Croix monumental, lorsqu’il sera, un jour, inauguré.
N° 39 Décembre 1894
Projets de travaux au Calvaire
De tous côtés, nous le savons, parmi les amis nombreux, qui s’intéressent à l’Œuvre du Calvaire, se posent, en ce moment, ces questions : Quels travaux vont être entrepris, cette année, sur la lande de la Madeleine? A quoi seront occupés les travailleurs volontaires ? Quelle tâche va leur être demandée ? Et parmi ceux qui parlent ainsi, il en est un grand nombre, en effet, qui songent à nous apporter le concours de leurs bras et de leur bonne volonté. Sans pouvoir, peut-être encore, donner une réponse précise et complète à ces questions il nous est permis cependant de satisfaire, au moins en partie, une très légitime curiosité.
Tous ceux qui ont visité dernièrement le pèlerinage et ceux mêmes qui en ont eu seulement sous les yeux le plan pris à vol d’oiseau savent que la Voie douloureuse en occupe le centre, partant du monument du Prétoire situé au bas de la lande et se dirigeant vers le Calvaire. Cette voie a ceci de très particulier qu’elle est une reproduction aussi exacte que possible de la Voie douloureuse de Jérusalem : d’abord pour la longueur totale du chemin, qui est, à peu de chose près, la même; puis par la distance respective des stations entre elles; et enfin par les détours qu’on y remarque et qui correspondent aux détours que doit faire à Jérusalem le pèlerin, en se rendant du Prétoire de Pilate au Golgotha. De plus, chaque station doit être formée par un groupe de stations posées sur la voie même et représentant d’une manière aussi saisissante que possible la marche vers le Calvaire. Présentement, cette voie s’arrête brusquement, un peu au-delà de l’emplacement du la huitième station : Jésus console les femmes de Jérusalem qui le suivent. Dans ce parcours même, c’est-à-dire de son point de départ à la limite que nous venons d’indiquer, elle est loin d’être achevée et complète. La huitième station seule dont nous venons de parler et qui a été inaugurée et bénite solennellement le Lundi de la Pentecôte, de cette année, peut donner une idée de ce que sera un jour notre Chemin de Croix monumental. Les autres stations ne sont encore marquées que par une ou deux statues, les principales il est vrai, mais sans le cortège qui doit les accompagner. Ce cortège leur sera donné, à mesure seulement que des ressources seront fournies à l’Œuvre pas les âmes pieuses et charitables.
Pour le moment, on songe à continuer la voie jusqu’au sommet du Calvaire. Hâtons-nous de dire que grâce à un arrangement conclu à la satisfaction de tous, entre la Fabrique de Pontchâteau et la Compagnie de Marie chargée de desservir le pèlerinage, rien ne s’opposera plus à l’exécution de ce projet.
Mais, c’est un travail considérable et qui demandait à être étudié sérieusement pour arriver à un plan réunissant toutes les conditions désirables.
En effet, il faut tout d’abord ménager au flanc de la colline une pente assez douce pour qu’on puisse y monter processionnellement, sans enlever à cette colline l’aspect abrupt que donne au Golgotha, la Tradition. De plus, il faut également ménager sur le sommet, ou presque sur le sommet un emplacement convenable pour la représentation des grandes scènes qui s’y sont passées; c’est-à-dire, outre la Mort de Jésus en Croix, celles qui sont désignées dans le Via Crucis, sous ces différents titres : Jésus est dépouillé de ses vêtements, Jésus est attaché à la Croix par les bourreaux, Jésus est descendu de la Croix et remis entre les bras de sa sainte Mère. Enfin, il faut prévoir l’emplacement du Saint-Sépulcre, de manière à ce que l’abord en soit rendu facile en descendant du Calvaire.
C’est en tenant compte de toutes ces conditions et des difficultés qu’elles présentent, qu’après une étude sérieuse a déjà été esquissé un plan que nous avons eu sous les yeux, et qui nous semble, sauf quelques légères modifications, devoir être généralement approuvé. En nommer l’auteur sera déjà une recommandation pour nos lecteurs qui n’ont pas oublié M. A. Gerbaud, l’excellent Directeur de nos travaux antérieurs, et en particulier le créateur do notre Jardin des Oliviers et de la Grotte de Gethsémani.
Il y a quelques jours, causant ensemble, il nous parlait de la nuit passée par lui sur le Calvaire, dans l’Eglise du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dans des termes qui nous donnaient à penser que dès lors il était comme appelé au rôle si important qu’il a bien voulu accepter avec tant de dévouement et de générosité, dans l’exécution des projets de Notre Bienheureux Père de Montfort.
Personne n’ignore que l’aspect du Calvaire de Jérusalem tel qu’on le voit aujourd’hui, est tout différent de ce qu’il était au grand jour de la mort du Fils de Dieu. II n’en saurait être autrement après les transformations ordonnées par un empereur païen pour faire oublier par la profanation la plus odieuse ce lieu saint entre tous; après les fouilles faites par sainte Hélène et les appropriations jugées nécessaires pour la construction de sa basilique monumentale ; après surtout les incendies et les dévastations qui dans l’enceinte de cette même Eglise ont accumulé ruines sur ruines. Mais, il n’est personne aussi qui ne comprenne, que sur les lieux mêmes, en tenant compte des profondeurs, des distances et aussi de l’aspect d’autres collines des environs de Jérusalem qui n’ont pas subi les mêmes transformations, une reproduction assez exacte devient possible.
Quoi qu’il en soit, ce plan doit être présenté très prochainement à l’approbation d’une commission qui, elle aussi, nous croyons pouvoir nous permettre de le dire, offre toutes les garanties désirables.
Elle doit être présidée par un délégué de Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes, et se compose en outre de trois représentants de la Fabrique de Pontchâteau et de trois représentants de la Compagnie de Marie chargée de desservir le pèlerinage du Calvaire.
Le délégué de Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes est M. l’abbé Allaire, vicaire-général. Les trois représentants de la Fabrique de Pontchâteau sont : M. l’abbé Richard, curé-doyen; M. Cousin, président de la Fabrique et M. de Marcé, conseiller.
Les représentants de la Compagnie de Marie sont : le R. P. Le Bagousse, secrétaire du Supérieur général de la Compagnie de Marie et des Filles de la Sagesse; le R. P. Barré, directeur du pèlerinage, et le Père Directeur de la Revue de l’Ami de la Croix.
Nous avons pensé que nos lecteurs, tous amis et bienfaiteurs du Calvaire avaient quelque droit à connaître ces détails. Nous espérons bien qu’ils auront pour résultat d’encourager encore leur zèle à nous seconder, surtout en propageant de plus en plus la connaissance de l’Œuvre autour d’eux, dans les différents milieux qu’ils habitent.
Que pourrions-nous ajouter encore? Voici que les grands travaux de l’automne touchent à leur fin. Les semailles sont terminées. Déjà même les blés sortis de terre verdissent les sillons. Le moment est venu de faire appel aux travailleurs volontaires. Cet appel, ils l’entendront très prochainement. Dans quel ordre et sous quelle forme leur sera-t-il adressé ; nous ne pouvons rien préciser encore. Il faut pour cela une entente préalable avec les excellents et vénérés Pasteurs des paroisses qui nous entourent et que nous savons tous disposés à nous prêter leur précieux concours. C’est là pour nous, est-il besoin de le dire, un gage assuré de succès, et ce qui nous permet de tout entreprendre avec la plus grande confiance.
Il en est qui peuvent désirer que des jours différents soient assignés à diverses sections de leur paroisse. Il en est qui aimeront mieux que l’appel soit adressé à la paroisse entière pour plusieurs jours, laissant à chacun la liberté de choisir son temps et son heure. Il va sans dire qu’on sera toujours heureux de se ranger à leur avis.
Nous ne nous dissimulons point qu’il s’agit de travaux plus considérables que ceux qui ont été exécutés, les années précédentes, avec tant de facilité et un entrain si admirable. Il faudra plus d’efforts, plus de bras. Mais ces efforts seront faits, et nous l’espérons bien, les bras ne nous manqueront pas.
Il s’agit cette fois de travailler au Calvaire même. Ce sont des travaux tout à fait semblables à ceux entrepris et si admirablement dirigés jadis par le saint Missionnaire, apôtre et protecteur de cette contrée. C’est à cette même place, c’est ce même sol que nous allons fouiller, cette même terre arrosée de ses sueurs et des sueurs de ses vaillants travailleurs, arrosée plus tard de leurs larmes lorsque vinrent les jours mauvais, et qu’ils virent renverser et détruire sous leurs yeux ce qu’ils avaient édifié avec tant de courage et d’ardeur, et avec une constance telle que les travaux se poursuivirent pendant quinze mois sans être interrompus. Si nous rappelons ces grands et pieux souvenirs, ce n’est certes pas dans la pensée qu’ils peuvent être oubliés autour de nous. Oh non ! nous savons bien au contraire que ces souvenirs sont ici vivants, très vivants dans toutes les mémoires, qu’on les redit souvent au foyer de chaque famille, et qu’on y tient avec raison comme à un titre d’honneur.
Ici les fils n’ont pas dégénéré de leurs pères. Ce que les pères ont fait, les fils animés de la même foi, sont prêts à le faire avec la même bonne volonté, le même courage, le même désintéressement, la même ardeur.
Tous entendront l’appel qui leur sera fait, comme précédemment, au nom de celui qu’ils vénèrent et invoquent comme leur Protecteur et leur Père. Cet appel, en effet, s’adressera à tous. Les travaux projetés, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, ne différeront guère de ceux exécutés autrefois sous les ordres du Père de Montfort lui-même. Tous pourront y prendre part. Il faudra surtout remuer, transporter, monter beaucoup, beaucoup de terre.
Si la brouette est plus expéditive, la hotte et les paniers d’autrefois ne sont pas à dédaigner. Nous les verrions avec plaisir reparaître. Du moins, désirons-nous que tous puissent mettre la main à l’Œuvre et que ce soit véritablement l’Œuvre de tous, comme au temps du Bienheureux Père.
Encore quelques jours, et les échos de la lande de la Madeleine rediront à l’envi ce vieux refrain des premiers et vaillants travailleurs de Montfort :
Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous.
Grands et petits, de tout sexe et tout âge,
Faisons un Calvaire à Dieu,
Faisons un Calvaire.
Et du haut du Ciel, comme encouragement, il nous semblera entendre la voix du Bienheureux lui-même nous répondant par ce couplet prophétique :
Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Que de conversion,
De guérisons, de grâces sans pareilles ;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire !
N° 40 Janvier 1895
Réunion de la Commission pour les travaux du Calvaire
C’est le mercredi, 12 décembre, que s’est réunie ici, la Commission de surveillance des travaux du Calvaire, sous la présidence de M. l’abbé Allaire, vicaire-général de Mgr l’Evêque de Nantes.
Tous les membres de cette Commission, dont les noms sont déjà connus de nos lecteurs, étaient présents.
M. A. Gerbaud est invité à présenter le plan dont nous avons dit quelques mots dans notre dernier numéro. Pour en mieux juger la Commission se transporte sur le terrain, où les travaux doivent être exécutés. Là, d’après les explications données, avec une clarté parfaite, par notre excellent Directeur des travaux, il est permis à chacun de se faire une idée nette de l’aspect que présentera le monument du Calvaire, après la restauration projetée. Les points indiqués pour l’emplacement des diverses scènes qui seront représentées, permettent à chacun de constater que les groupes de statues se détacheront distincts, sans se confondre. Tous peuvent s’assurer aussi que les pentes et les détours de la voie sont ménagés de manière à faciliter le déploiement des processions, aux jours de nos plus grandes solennités. Quant aux moyens d’exécution, bien qu’il s’agisse de remblais très considérables, l’avis des Commissaires est, que les terrains environnants en peuvent fournir les éléments nécessaires.
Après cet examen attentif la Commission adopte, à l’unanimité des voix, le plan présenté par M. Gerbaud, et vote à l’avance les encouragements les plus chaleureux à tous ceux qui prêteront leur concours à son exécution. Dès le lendemain, ainsi qu’on va le voir, elle aurait eu déjà à voter des félicitations.
Commencement des travaux du calvaire
A peine la Commission s’était-elle séparée, et nos honorables hôtes avaient-ils quitté le Calvaire, que le R. P. Barré, directeur du Pèlerinage, parcourait déjà quelques-uns des villages voisin. Dans cette saison, les jours sont courts, la nuit vient vite, et, à la campagne surtout, l’on rentre de bonne heure, à la maison. Bien des portes sont déjà fermées. Mais sa voix est entendue, la porte s’entrebâille, quelqu’un paraît sur le seuil. Un mot suffit : — « C’est demain que commencent les travaux du Calvaire, et c’est vous qui êtes invités les premiers. » — « Comptez sur nous, à demain !» — « Oui, à demain tous les hommes de Guémené, de Calla, de la Brionnière, du Buissonrond, et dans huit jours, vos femmes et vos filles, » – Oui, oui, répondent de l’intérieur d’autres voix !
Et le lendemain, ils étaient là, tous les hommes des villages que nous venons de nommer, au nombre de cinquante environ. Et après le chant de quelques couplets, les pioches et les bêches creusaient, à l’envi, le sol; et les pelles chargeaient la terre; et les brouettes roulaient pour la transporter à l’endroit marqué, où les douves doivent être comblées pour donner entrée au Calvaire. A la fin de la journée, tous ces braves travailleurs se réunissent à la chapelle pour recevoir la bénédiction du Très Saint Sacrement, et en sortaient pour retourner heureux et contents dans leur demeure. Nul doute qu’à la veillée, l’on ne parle surtout du beau plan du Calvaire, tel qu’il sera après les travaux qu’ils viennent de commencer, et qu’ils ont vu de leurs yeux.
A la même heure, l’infatigable Directeur du Pèlerinage, parcourt d’autres villages qui le lendemain répondront avec la même fidélité, avec le même ensemble à l’appel qui leur est fait.
Ce lendemain même, nous nous absentions, pour une semaine, du Calvaire. A notre retour, presqu’à la veille des fêtes de Noël, nous pouvons constater tout d’abord que les travaux ont avancé considérablement. La voie est ouverte et praticable, dans toute la largeur de la douve, et déjà les terres s’amoncellent dans la première enceinte de la colline. Un résultat semblable, au bout de huit jours seulement suffirait à rassurer les timides, s’il s’en était trouvé autour de nous.
Mais, ce n’est pas assez de cette brève mention pour témoigner notre reconnaissance à nos travailleurs de la première heure, ou plutôt de la première semaine. Heureusement, nous avons sous les yeux un document précieux, qui nous permet, bien qu’ayant été absent, de rendre justice à chacun.
†
Çà été assurément une excellente idée, d’ouvrir ici, un Registre, qui porte déjà le nom de Livre d’or des travailleurs du Calvaire, et sur lequel chacun d’eux est invité à signer, à la fin de sa journée. Si nous avions un document de ce genre datant des jours de Montfort, combien nos braves d’aujourd’hui seraient heureux d’y retrouver le nom de leurs aïeux ! Cette joie pourra être ménagée, un jour, à leurs petits-fils, et arrière-neveux.
La première page de ce Registre est remplie par une copie du procès-verbal de la séance tenue par la Commission des travaux du Calvaire le Mercredi 12 Décembre 1894.
A la seconde page, se lisent les noms de tous ceux, qui sont accourus, au premier appel, des divers villages que nous avons nommés plus haut, et qui ont eu l’honneur de commencer la campagne, le Jeudi 13 Décembre.
†
Convoqués le soir de ce même jour les habitants île villages de Coimeux, de la Bassinais, de Cunta, de Lornais et de Bosselas, venaient le lendemain 14 décembre avec le même élan, le même entrain que ceux qui les avaient précédés la veille. Ils travaillaient avec le même courage, la même ardeur. Leurs noms remplissent la troisième page de notre registre.
Un incident est à signaler dans cette seconde journée de travail. Ce même jour, un groupe nombreux de bonnes paroissiennes de Saint-Joachim étaient venues en pèlerinage au Calvaire, conduites par un motif de piété très touchant dont nous aurons à dire ailleurs un petit mot. Elles avaient accompli dans la matinée, très dévotement les exercices du Pèlerinage, fait le Chemin de croix, récité le Rosaire. L’heure de midi était venue, l’heure du frugal repas des travailleurs, qu’ils viennent prendre d’ordinaire dans les salles du parloir, ou sous l’abri qui est en face. Sans doute, les pieuses pèlerines guettaient ce moment; car, à peine le chantier est-il vide qu’on les voit s’emparer des divers instruments laissés épars çà et là, pelles, pioches et brouettes, puis bientôt les manœuvrer avec une ardeur incroyable. Elles semblent persuadées, non sans raison probablement, que la grâce qu’elles sont venues demander au bon Père de Montfort, leur sera d’autant plus sûrement accordée qu’elles auront mêlé plus de sueurs à la terre de son Calvaire. Elles ne mettent bas les armes qu’au moment où elles voient s’avancer le groupe des travailleurs qui viennent reprendre leur journée.
†
Le Samedi, 15 Décembre, troisième journée, les travailleurs présents ont eu pour nous venir, à parcourir une plus longue route que les précédents. Mais, ce n’est pas une distance de huit ou dix kilomètres à franchir, qui peut arrêter les braves habitants de Bergon, quand il s’agit de travailler au Calvaire du P. de Montfort. Il va sans dire qu’une fois au travail, il n’y paraît rien. La quatrième page du Registre ne suffit pas à contenir leurs noms, et ils empiètent notablement sur la cinquième.
†
Le village d’Aignac, en Saint Joachim, est au moins aussi éloigné du Calvaire que Bergon, mail du haut de la chaire le vénéré Pasteur a fait appel à cette fraction de sa grande paroisse, pour qu’elle donne au Calvaire la journée du lundi 17 décembre. En faisant cet appel, il n’ignorait pas que la partie la plus robuste des hommes de ce quartier est toute entière occupée dans les chantiers de la Marine, mais il savait aussi qu’il restait sur place une bonne réserve pleine de courage et d’énergie sur laquelle on pouvait compter. L’événement a bien montré qu’il ne se trompait point. La page du registre qui porte les noms des travailleurs de ce jour offre ceci de particulier, qu’un bon nombre ont tenu à inscrire leur âge à la suite de leur signature. Or, nous relevons les chiffres de 68, de 70, de 71 deux fois, de 75, de 77 deux fois, de 78. Le dévouement de ces courageux vieillards partis de leur demeure à 6 heures du matin pour n’y rentrer qu’à huit heures du soir, faisant dix kilomètres le matin, dix kilomètres le soir, et travaillant toute la journée comme des jeunes, n’est-il pas au-dessus de tout éloge?
†
Le mardi 18 décembre, ce sont les villages de la Guène, de la Giraudais et du Souchet, qui ont envoyé au Calvaire un groupe de vaillants. Pour la première fois, la pluie vient contrarier grandement l’ardeur de tous. C’est une épreuve que tous aussi supportent sans se plaindre, et assurément une occasion de mérite de plus.
†
Le mercredi 19 décembre s’ouvre une série de trois journées de travail accompli uniquement par de courageuses femmes chrétiennes qui tiennent singulièrement à ne pas rester en arrière de leurs aïeules du temps de Montfort. Ce sont des paroissiennes de Missillac, du village de Bergon qui viennent les premières et qui déploient pendant toute cette journée une activité merveilleuse. Aussi le remblai avance-t-il à vue d’œil. Le soir la douve est entièrement comblée, et chacune des travailleuses tient à conduire au-delà sa brouettée déterre dans la première enceinte du Calvaire.
†
Les femmes de Quémené, de la Brionnière, du Buisson rond attendaient sans doute avec quelque impatience l’octave du jour où leurs maris et leurs frères étaient venus inaugurer cette campagne de travaux. Cette date, si l’on s’en souvient, leur avait été fixée. Nulle parmi elles ne l’avait oubliée. Rivalisant d’ardeur pendant toute la journée, elles ne consentent à cesser le travail qu’à cinq heures du soir, heure déjà tardive pour la saison.
†
Le vendredi 21 décembre est aussi le jour octave pour les femmes de Coimeux, de Bosselas, de la Cossonnais et des autres villages dont les noms figurent à la date du vendredi de la semaine précédente. Elles en font mémoire de la même manière que leurs compagnes de la veille, en travaillant et priant avec la même foi, la même ardeur.
†
A partir de ce jour les travaux sont suspendus jusqu’à la fête de Noël. Mais, dès pour le lendemain, 26 décembre, M. le Curé de Saint-Joachim a jugé opportun de faire appel aux braves ouvriers du village de Fédrin, ou plutôt de l’îlot de Fédrin, comme on dit dans la Grande-Brière. Il savait qu’un grand nombre d’entr’eux embauchés dans les chantiers de la Loire pourrait plus facilement disposer de cille journée. Aussi formaient-ils un bataillon compact en arrivant au Calvaire. En ouvriers entendus, ils ont fait dans cette journée, avec une régularité parfaite une besogne prodigieuse. Nous les avons admirés non-seulement au travail, mais aussi à la Chapelle, lorsqu’ils chantaient avec ensemble et tant de cœur les prières liturgiques pour le Salut du Très Saint-Sacrement qui a été donné par M, l’abbé Pabois, l’un de leurs vicaires.
†
Aujourd’hui jeudi 28 décembre, ce sont les femmes des villages de la Guène, de la Giraudais, de, Rault, de la Ricordais, qui sont venues, huit jours aussi après leurs maris et leurs frères, continuer les travaux. La pluie qui tombait assez drue ce matin ne les a point arrêtées. Et, de fait, dans le reste de la journée, le temps est on ne peut plus favorable. Elles poussent le remblai jusque dans la seconde enceinte du Calvaire.
Il y a quinze jours, peut-être eût-on pu rencontrer, ici, quelques timides se disant tout bas que le plan arrêté, très beau sans doute, pourrait bien dépasser ce qu’il était possible de réaliser. Mais, aujourd’hui pour ceux-là mêmes, nous croyons que la preuve est faite. L’élan est donné, et il ne fera que s’accentuer dans l’année 1895. Les bonnes volontés s’offrent de toutes parts.
Nous tiendrons nos lecteurs, au courant de tout. Ils voudront bien, de leur côté, nous continuer, chacun à leur manière, leur précieux concours.
N° 41 Février 1895
Continuation des travaux du Calvaire
Ces travaux, à peine interrompus, pendant quelques jours, au déclin de l’année qui vient de finir, ont repris avec plus d’ardeur et d’entrain encore, dès le lendemain du premier jour de l’an 1895. Ce n’est pas en vain que l’infatigable Père Directeur du Pèlerinage est allé prêcher la croisade dans les paroisses du voisinage. Sa voix s’est fait entendre successivement à St-Joachim, à Missillac, à Besné, à Saint-Roch, à Saint-Dolay (Morbihan), à Drefféac. Et, partout, elle a trouvé de l’écho. Telle paroisse s’est engagée à fournir une journée de travail par semaine, pendant quatre semaines consécutives. Telle autre a pris le même engagement pour cinq semaines, telle autre pour six. Et tous, sans y manquer, font honneur à leur parole. Chose extraordinaire, malgré les variations de la température, dans la saison où nous sommes, il n’y a pas eu un seul jour où les travaux aient été empêchés. Nous n’avons pas échappé complètement au verglas, et il y a eu dans le mois quelques jours où la pluie rendait le travail tout-à-fait impossible. Mais, il est arrivé providentiellement que ces jours étaient les jours marqués pour le repos, c’est-à-dire le Dimanche… ou le samedi, qui d’un commun accord avec les Pasteurs des paroisses, a été excepté des jours où l’on viendrait travailler au Calvaire. Nous avons vu ainsi, après deux jours d’un temps détestable, le lever un beau soleil, le lundi matin. Depuis le commencement du mois, ce sont donc régulièrement cinq jours par semaine, pendant lesquels les pioches n’ont pas cessé de creuser la terre, les pelles de la charger, et les vagonnets de rouler, pour la transporter au flanc de la colline.
De la fenêtre de notre chambre, à deux cents mètres au plus, nous avons ce spectacle sous les yeux. Il ne manque certes pas d’animation et de pittoresque. Surtout il est édifiant quand on sait de quels sentiments sont animés travailleurs et travailleuses.
Dans les conditions que nous venons de dire, la somme de travail déjà fournie est considérable, et étonne même les visiteurs. M. Gerbaud, qui n’avait pu nous venir plus tôt, mais qui est, ici, en ce moment, s’en montre lui-même très satisfait. Sous sa direction, le plan nouveau du Calvaire va commencer à se dessiner avec plus de netteté.
Tout fait prévoir d’ailleurs que l’entrain et l’ardeur dont nous sommes témoins, bien loin de se ralentir, ne peuvent qu’aller croissant, grâce au zèle du Père Directeur du Pèlerinage, secondé par son jeune aide-de-camp, le R. P. Sarré. Ici, se présente à nous, une véritable difficulté. Nous serions heureux d’adresser un mot de remerciement, et d’éloge si bien mérité, à chacun des groupes de travailleurs et de travailleuses qui se, sont succédés, ici pendant ce mois. Mais, visiblement l’espace nous manque. Et puis, nous serions obligés de nous répéter à chaque ligne, puisqu’aussi bien, tous, travailleurs et travailleuses ont montré la même bonne volonté, rivalisé d’ardeur pour le travail, et grandement édifié ceux qui les ont vus à l’œuvre.
Voici ce qui seul nous semble pratique : Ouvrant le Registre du Livre d’or des travailleurs, sur lequel ils aiment à inscrire leurs noms, comme clients du Père de Montfort, nous nous contenterons d’indiquer à la date de chaque jour de travail, le nom de la paroisse ou des villages qui ont fourni le groupe des travailleurs de cette journée :
†
Le Mercredi, 2 janvier, c’est un groupe d’hommes de la paroisse, de Saint-Joachim qui ouvre la série des travaux de 1895. Leur excellent curé, M. l’abbé Gaillard, a tenu à les accompagner et à les encourager de sa présence.
†
Le Jeudi, 3 janvier, les travailleurs présents sont tous des villages de la paroisse de Pontchâteau les plus rapprochés du Calvaire. Ils ont à leur tête M. Félix Dubois, conseiller d’arrondissement et adjoint au maire de Pontchâteau, notre très bon voisin. Pendant toute la journée, il paie largement de sa personne. Dans la soirée, M. le Curé vient visiter et féliciter ses bons paroissiens.
†
Le Vendredi, 4 janvier, c’est la paroisse de Sainte-Reine qui fournit le contingent des travailleurs. Elle est largement représentée par les hommes des villages de Travers, des Noës, de l’Organais, de Monmara, de la Bironnerie, etc., etc.
Presque, chacun de ces villages si dévoués au culte du B. Montfort, garde un souvenir particulier de son passage. Au village des Noës, on montre la maison où il a séjourné plus d’une fois, pendant la construction du Calvaire ; à l’Organais, un petit coffre qui lui a servi de siège.
†
Le Lundi, 7 janvier, la paroisse de Crossac, qui n’est pas à sa première journée de travail, envoie un nouveau groupe d’hommes, les uns du bourg même de Crossac, les autres des villages de la Ricordais, de la Haye, de la Peltraie, de la Cossonnais, des Eaux, etc.
†
Le Mardi, 8 janvier, est la première journée donnée par la paroisse de Besné, qui doit revenir chaque mardi, pendant quatre semaines consécutives. Malgré la résolution prise en commençant ce compte-rendu, il nous est impossible de ne pas signaler l’ardeur et l’entrain des travailleurs de cette journée, sous la vigoureuse impulsion de M. l’abbé Niel, leur Curé. MM. les Vicaires de Besné et de Trans le secondaient du reste très bien. Nous pourrions donner le chiffre exact des brouettées de terre, conduites dans cette journée, au pied de la colline, par M. le Curé seul. Tout en étant exact, c’est fabuleux!
†
Le Mercredi 9 Janvier : Travailleuses de Saint-Joachim, nombreuses bien qu’elles ne soient qu’une des six sections de cette grande paroisse qui doivent venir successivement, pendant six semaines, chaque mercredi. La section d’aujourd’hui est celle même du bourg de Saint-Joachim.
†
Jeudi 10 Janvier : Paroissiens de Saint-Guillaume. Ils ont répondu si nombreux à l’appel qui leur a été fait, qu’on est obligé de dire qu’il eut été mieux de former deux sections. M. le Curé était présent ainsi que son vicaire. Le salut du soir est donné par M. le Curé.
†
Vendredi 11 Janvier : Frairie de Saint-Dié, de la paroisse de Missillac. C’est une des quatre ou cinq sections de cette excellente paroisse qui doivent venir successivement donner leur journée de travail au Calvaire. Tous ces bons travailleurs sont heureux de voir au milieu d’eux leur excellent Pasteur, M. l’abbé Gaudin, qui est venu pour les encourager et les féliciter.
†
Lundi 14 Janvier : Vaillante petite escouade du village de Burin, en Saint-Dolay (Morbihan). Elle eut été bien plus nombreuse sans des circonstances tout-à-fait indépendantes de la volonté de tous. Nous savons, du reste, que les braves paroissiens de Saint-Dolay, ne nous ont pas dit leur dernier mot.
†
Mardi 15 Janvier : Seconde journée de la paroisse de Besné, qui rappelle en tout la première par l’entrain et l’ardeur au travail. La pluie qui tombait le matin n’a retenu personne.
†
Mercredi 16 Janvier : Ce sont les deux villages de Manzin et de Pandille, formant l’une des six sections de la grande paroisse de Saint-Joachim qui nous ont envoyé cette troupe de vaillantes clin’ tiennes si intrépides au travail.
†
Jeudi 17 Janvier : Ce jour-là, tous les hommes des villages qui entourent Casso, maison d’habitation de M. du Favouëdic, conseiller général de Pontchâteau, ont à leur tête M. de Marcé son gendre, qui prend part à tous leurs travaux. Nous parlons plus loin de cette journée marquée par la visite de Nosseigneurs les Evêques de Vannes et de La Rochelle.
†
Vendredi 18 Janvier : Nouvelle section de la paroisse de Missillac. Ce sont les habitants du bourg même, et des villages les plus rapprochés de l’église. M. l’abbé Landau, vicaire, bien connu déjà pour la part qu’il a prise aux travaux du Calvaire, est présent.
†
Lundi 21 Janvier : Grande foire à Pontchâteau. Presque tous nos bons villageois y ont des affaires. Et c’est un va-et-vient continuel sur notre route. Malgré cela, un groupe d’excellents paroissiens de Sainte-Reine, et en particulier du village de Cusia nous a donné une bonne journée de travail.
†
Mardi 22 Janvier : Nous revoyons pour la troisième fois, M. le Curé de Besné et son vicaire, toujours infatigables, à la tête de leurs infatigables travailleurs.
†
Mercredi 23 Janvier : Quatrième journée donnée par la paroisse de Saint-Joachim. Ce sont les Femmes de l’îlot de Fédrin. Elles ont le nombre, mais aussi le courage et l’ardeur au travail.
†
Jeudi 24 Janvier : Saint-Roch, petite mais bien bonne paroisse représentée toute entière et largement dans cette journée. Infatigables, les travailleurs sont parvenus à pousser les vagonnets presque jusqu’au sommet de la colline actuelle. M. l’abbé Yviquel, leur curé, heureux au milieu d’eux, n’a pas quitté le chantier, et a donné, le soir, le salut du Très-Saint Sacrement.
†
Vendredi 25 Janvier : La Frairie de Sainte Luce, en Missillac, clôture aujourd’hui brillamment la série des travaux dont il nous est permis de rendre compte, dans le présent numéro.
Précieux encouragements aux travailleurs du Calvaire.
Dans la journée du jeudi 17 janvier, les travailleurs du Calvaire recevaient des encouragements, bien précieux et tout-à-fait inattendus. C’étaient, ce jour-là, les habitants des villages de la paroisse de Pontchâteau, qui entourent Casso, maison de campagne de M. du Favouëdic, conseiller général. M. de Marcé, son gendre était à leur tête. Dans l’après-midi alors que tous avaient pris leur frugale réfection, et se trouvaient à leur poste de travail, on voit s’arrêter au sommet de la côte, un attelage. Monseigneur l’Evêque de Vannes et Monseigneur l’Evêque de la Rochelle en descendent, à deux pas des travailleurs occupés à charger les wagonnets. Le R. P. Directeur du Pèlerinage, M. le Curé de Pontchâteau qui venait d’arriver pour féliciter ses bons paroissiens, et M. de Marcé s’avancent aussitôt pour aller à la rencontre de Leurs Grandeurs. Après avoir prié un instant au pied du Calvaire Nosseigneurs da Vannes et de La Rochelle visitent tout le chantier, témoignant partout leur satisfaction, ayant partout une bonne parole pour les travailleurs, les félicitant, les bénissant.
Pendant les courts instants qu’ils pouvaient nous donner, ils ont eu le temps encore de descendre la Voie douloureuse, jusqu’au monument du Prétoire, de visiter notre Maison de Nazareth, de s’agenouiller devant l’autel du Bienheureux dans la Chapelle du Pèlerinage. Monseigneur de Vannes a demandé qu’on y allumât une lampe à son intention, pendant un mois.
Leurs Grandeurs quittaient ensuite le Calvaire, laissant à nous tous, à nos chers travailleurs volontaires un souvenir de leur passage, qui n’est pas près d’être oublié. Ajoutons que Monseigneur de Vannes et Monsieur de La Rochelle ont très gracieusement à l’avance fait valoir leurs droits a être invités pour la grande fête qui couronnera les travaux actuels de restauration du Calvaire.
Pour Monseigneur de Vannes, ses diocésains aujourd’hui, comme au temps de Montfort, ont une large part dans tous les travaux qui se font, ici. Il suffît de nommer les paroisses de Saint-Dolay, de Nivillac, de Marsan, de Férel, etc.
Quant à Monseigneur de La Rochelle, il tient à grand honneur de rappeler que ce fut l’un de ses prédécesseurs de sainte mémoire, Mgr de Champflour, qui accueillit à bras ouverts le saint missionnaire obligé de quitter le diocèse de Nantes ; que, dans le diocèse de La Rochelle, il accomplit es grands et derniers travaux, et enfin rendit le dernier soupir. Assurément, ceci non plus ne sera point oublié.
N° 42 Mars 1895
Continuation des travaux du Calvaire
N’est-ce point une distraction? Ne serait-ce pas plutôt : Interruption des travaux du Calvaire, qu’il eut fallu écrire. Par les temps si rigoureux que nous venons de traverser et dont nous ne voyons pas encore la fin, est-ce qu’il n’y a pas eu forcément chômage partout? Avec la couche de neige couvrant la terre, et le verglas jetant par-dessus son miroir poli de glace, avec ce vent du Nord soufflant toujours impitoyablement, est-ce qu’il y avait autre chose à faire, à la campagne surtout, que de se renfermer de son mieux dans sa demeure, est-ce que tous les travaux en plein air, tous les travaux des champs n’étaient pas nécessairement et partout suspendus ? Oui, ils l’étaient partout autour de nous, excepté cependant au Calvaire.
Il faut bien le dire, nos braves ouvriers volontaires eux-mêmes en étaient stupéfaits. Lorsque, le soir, par un temps affreux, une voix se faisant entendre dans le village, disait : « C’est sur vous mes amis, que l’on compte pour travailler demain au Calvaire. » Les portes s’entr’ouvraient, quelqu’un apparaissait sur le seuil. Et à l’invitation répété l’on répondait : « Le temps n’a pas l’air de changer. Il fera demain comme aujourd’hui. » — «Mais aujourd’hui, reprenait la voix, on a travaillé au Calvaire, ce sont vos amis de tel et tel village que nous ont donné aujourd’hui même une excellent journée de travail. » — « Hé bien ! nous irons ! » Et le lendemain matin, ils étaient là. Au commencement, il fallait se servir de la barre de fer pour faire se détacher la croûte de terre si profondément glacée. Puis les pics et les pioches ouvraient la tranchée et bientôt les vagonnets commençaient rouler pour ne plus s’arrêter. Tous semblaient oublier le froid et la bise qui cependant continuait toujours de souffler. A midi, tous, chantant un refrain de cantique descendaient du Calvaire, pour prendre leur légère réfection, et la soirée se passait avec la même ardeur au travail que la matinée. Ils ne partaient qu’après avoir reçu à la Chapelle la bénédiction du Très Saint-Sacrement qu’ils avaient si bien mérité.
Voilà ce que nous avons vu de nos yeux dans ce terrible mois de février. Nous l’écrivons simplement comme nous l’avons vu, mais non sans éprouver intérieurement un profond sentiment d’admiration pour la foi et le dévouement de ces braves villageois, montrant une fois de plus qu’ils ne savent vraiment rien refuser de ce qui leur est demandé au nom de leur protecteur et Père, le Bienheureux Montfort.
Il n’est pas douteux que, du haut du Ciel, il n’ait accueilli d’un œil favorable cette nouvelle marque de leur attachement et de leur fidélité. Un jour ou l’autre, il ne manquera pas de le leur rendre, en obtenant pour eux et leurs familles quelque grâce spéciale. Leurs noms sont tous inscrits sur le Livre d’or des travailleurs, et lui surtout n’en oublie aucun.
Pour nous, nous devons nous borner, ainsi qu’il a été convenu, à indiquer à la date de chaque journée de travail, aussi brièvement que possible, le nom de la paroisse ou des villages qui l’ont donnée au Calvaire.
Chacun parcourant cette liste pourra constater par lui-même combien il reste peu de jours sans travail, en dehors du Samedi, qui avec le Dimanche ainsi que nous l’avons dit, était réservé d’avance au repos.
†
Le Lundi 28 Janvier. La neige n’empêche point un groupe de braves de Drefféac, de venir nous donner une excellente journée de travail. C’est l’avant-garde de cette excellente paroisse que nous verrons reparaître au Calvaire.
†
Le Mardi 29 Janvier. M. le Curé de Besné apparaît pour la quatrième fois, à la tête de ses vaillants paroissiens, et nous fait espérer que ce ne sera pas la dernière. Dans l’après-midi, c’est à peine si une bourrasque de neige très violente interrompt les travaux, un instant.
†
Le Jeudi 31 Janvier. La paroisse de Pontchâteau qui a été déjà représentée deux fois par les hommes de divers villages, l’est encore aujourd’hui très bien par ceux de la Joubraie, de la Houssaye, de la Jatte, de l’Epinaie, de Saint-Michel, etc.
†
Le Vendredi 1er Février. C’est la troisième journée donnée par la paroisse de Sainte-Reine. Les braves d’aujourd’hui sont quelques-uns du bourg de Sainte-Reine, mais en plus grand nombre du village bien connu de Cuziac.
†
Le Mardi 4 Février. Nous avons parlé d’une avant-garde envoyée la semaine dernière par la paroisse de Drefféac. Aujourd’hui, une escouade du bourg même et de la vallée de Drefféac, bien que la température soit excessivement froide, continue bravement les travaux.
†
Le Mardi 5 Février. La température n’a point changé ; mais le courage et l’ardeur sont aussi les mêmes de la part des bons villageois de Quémessé de la Mondraie et de la Brionnière en Crossac. C’est la troisième journée de travail que ces excellents villages donnent aux travaux du Calvaire. Ils ont secondés aujourd’hui par un certain nombre de travailleurs de Drefféac, qui n’ayant pu se joindre la veille à leurs compatriotes, nous arrivent sans être attendus.
†
Le Mercredi 6 Février. Pour la troisième fois, en bien peu de temps, honneur à la paroisse de Drefféac! Ce sont les courageux chrétiens des villages de Branducas et de Catiho, qui n’ont pas voulu rester en arrière du Bourg et de la Vallée, et que n’ont pu retenir ni le verglas, ni le vent glacial du Nord.
†
Le Jeudi 7 Février. Ciel ! que le froid se fait sentir même sous un abri assez confortable ! Et je regarde par l’étroit espace de la vitre que la glace n’a pas rendu tout-à-fait opaque. Je les vois, ils sont là ! Les vagonnets vont et viennent ; et, à la même date, je lis à la marge du Livre d’or des travailleurs : Neuvième journée de travail donnée par la paroisse de Crossac, et qui est spécialement la troisième pour les villages des Bosselas, de la Haie, de Cunta. — Quel éloge ajouter à celle simple indication ?
Quelques travailleurs des villages de Travers et de la Poterie en Sainte-Reine étaient présents ce même jour.
†
Le Mercredi 13 Février. La Chapelle-des-Marais donne brillamment sa première journée. Ces braves gens n’avaient été convoqués que la veille au soir.
Un vieillard de 76 ans, qui marche difficilement est parti de chez lui, dès trois heures du matin, pour arriver en même temps que les autres travailleurs.
†
Le Jeudi 14 Février. C’est la sixième journée de travail donnée par la paroisse de Missillac. Ce sont les habitants de Bergon bien connus pour leur dévouement, qui paraissent pour la seconde fois.
†
Le Vendredi 15 Février. Septième journée de la paroisse de Missillac donnée par la seconde moitié de la Prairie de Sainte-Luce. Le Ciel ne peut que bénir la pieuse émulation qui semble exister entre les diverses paroisses.
†
Le Lundi 18 Février. La Chapelle-Launay, distante de quatre lieues est représentée par soixante robustes travailleurs. M. le Curé passe la journée entière au chantier, au milieu de ses chers paroissiens.
†
Le Mercredi 20 Février. Les travailleurs modèles de cette journée représentent pour la troisième fois les excellents villages de la Guêne, de la Giraudas, du Souchet, de Rault, de l’Hôtel-Guérif, tous de la paroisse de Crossac. C’est la dixième journée de travail qui est due à celle excellente paroisse.
†
Le Jeudi 21 Février. C’est la dernière journée qui puisse figurer dans ce compte-rendu. Par extraordinaire, il arrive aujourd’hui que deux groupes, l’un de travailleurs, l’autre de travailleuses se présentent presque en même temps. L’explication la Voici : le temps étant encore très rude, on regardait comme non avenue une invitation qui avait été adressée, il y a quelque temps déjà, pour ce jour, aux femmes du village de Fédrun, en St-Joachirn; et c’est pour cela qu’on s’était adressé depuis au grand village de Béraud, de la paroisse de Pont-Château. De vaillantes chrétiennes sont venues de Fédrun, et d’excellents travailleurs de Béraud. Chaque groupe a son rôle assigné pour le travail, et s’en acquitte avec la même bonne volonté, la môme ardeur.
II. — Pieuse générosité
Si le dévouement et la foi de ceux qui viennent travailler au Calvaire, surtout dans ces jours, est au-dessus de tout éloge, n’y a-t-il pas lieu de louer aussi la pieuse générosité de ceux ou celles qui ne pouvant absolument venir, retenus par la maladie ou les infirmités confient à ceux qui partent, la modeste offrande qu’ils regardent comme équivalente au salaire de la journée qu’ils auraient pu donner.
On nous cite un de ces bons chrétiens qui devait rendre son dernier soupir la veille même du jour où sa paroisse devait venir travailler, et qui présentant une petite pièce à son excellent Curé, deux jours auparavant, lui disait : Voilà ma journée du Calvaire !
Ces modestes offrandes contribuent à couvrir les frais de l’outillage nécessaire pour des travaux aussi considérables.
N° 43 Avril 1895
Continuation des travaux du Calvaire
Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes a daigné adresser dernièrement au P. Directeur du Pèlerinage, la lettre suivante :
« Nantes, le 12 mars 1895.
» M. R. P. Tout ce que vous me dites de l’ardeur, de la générosité des travailleurs du Calvaire me remplit de consolation. Je suis fier et heureux d’être l’Evêque d’aussi vaillants chrétiens. Dieu le récompensera un jour; mais dites-leur-qu’en son nom je les bénis, eux, leurs familles, et vous leur infatigable chef. »
Cette lettre nous dispense évidemment, pour aujourd’hui, de tout éloge à l’adresse de nos travailleurs volontaires et de ceux qui les dirigent. Nous craindrions d’affaiblir par nos paroles un témoignage aussi éclatant, aussi précieux.
Nous nous bornerons donc à nommer les paroisses, frairies, ou villages qui, dans le cours de ce mois, en venant travailler au Calvaire, ont mérité de recevoir cet éloge de leur Premier Pasteur.
†
Le Vendredi 22 Février : C’est la onzième journée que la paroisse de Crossac donne au Calvaire. Parmi les travailleurs, il en est du bourg, des villages de Coimeux, de la Cossonnais, de Bellebat, de l’Ile-Olivais, du Bran, de la Ricordais, de La Noë, du Blanchet.
†
Le Lundi 25 Février : Seconde journée de travail de la paroisse de la Chapelle-Launay. M. le Curé est présent et encourage les travailleurs.
†
Le Mardi 26 Février : C’est pour la seconde fois que nous vient la paroisse de la Chapelle-des-Marais. Les volontaires d’aujourd’hui sont des villages de Camers, de Camérin et de Québrite.
Détail à noter : Bon nombre de ces braves chrétiens sont des ouvriers des Chantiers de la Loire. La Compagnie donne le congé du mardi-gras. Ils en ont profité pour venir offrir leur journée au bon P. de Montfort.
†
Le Mercredi 27 Février : La Frairie du bourg d’Herbignac sanctifie, ici, par le travail cette première journée du Carême. Les autres frairies de cette grande paroisse doivent venir successivement. M. l’abbé Paquelet, vicaire, passe la journée au milieu des travailleurs, et donne le salut du soir.
†
Le Jeudi 28 Février : M. le Curé-doyen de Saint-Gildas-des-Bois préside la première journée donnée par ses paroissiens aux travaux du Calvaire, et donne le salut de la fin du jour. Nous aurons le plaisir de le revoir, à la tête d’autres sections de sa paroisse.
†
Le Vendredi 1er Mars : L’excellente paroisse de Sévérac bien que distante du Calvaire au moins de quatre lieues, a fourni aujourd’hui une nombreuse équipe d’ardents travailleurs ; et ce ne serai pas la dernière.
†
Le Lundi 4 Mars : Troisième journée de la Chapelle-des-Marais. Ce sont les bons habitants des villages de Mazun, de Lartot et du Frelon, toujours très dévoués au culte du B. Montfort.
†
Le Mardi 5 Mars: Seconde journée de la paroisse de Sévérac. Malgré la distance et la neige tombée le matin, cette seconde section de travailleurs est plus nombreuse encore que la première.
†
Le Mercredi 6 Mars : C’est aussi la seconde journée de la paroisse d’Herbignac. Monsieur le Curé-doyen préside les travaux et donne le salut du soir.
†
Le Jeudi 7 Mars : Ce jour a vraiment rappelé les plus beaux, les plus mouvementés entre ceux dont font mention les historiens du B. Montfort lors de la construction de son Calvaire. C’est le chiffre de cinq cents qu’ils donnent alors pour le nombre des personnes qui prenaient part aux travaux. Elles étaient aussi environ cinq cents le 7 mars, les travailleuses venues de S.-Roch et de S.-Joachim. Les moyens employés étaient les mêmes qu’autrefois. Huit chaînes étaient formées du pied de la colline au sommet. Cinq de ces chaînes montaient les paniers remplis de terre et les trois autres redescendaient les paniers vides. Le reste des travailleuses avait à pourvoir au chargement des paniers. Spectacle aussi curieux qu’édifiant!
†
Le Vendredi 8 Mars : Troisième journée de la paroisse de Sévérac. M. le Curé, et son vicaire M. l’abbé Hieffac, sont venus encourager de leur présence leurs excellents paroissiens.
†
Le Lundi 11 Mars : Ce sont des Morbihannais, représentant la bonne paroisse de Férel. M. l’abbé Guyot qui a dit le matin, en arrivant, la sainte messe à l’autel du Bienheureux, donne le salut à la fin de la journée.
†
Le Mardi 12 Mars: Seconde journée donnée par la paroisse de S.-Gildas-des-Bois. Parmi les travailleurs, on voit M. l’abbé Bretesché vicaire de la paroisse, et M. l’abbé Manon, vicaire du Landreau, né à S.-Gildas, et qui passait, en ce moment, quelques jours dans sa famille. Le salut est donné par M. l’abbé Bretesché.
†
Le Mercredi 13 Mars : M. l’abbé Paquelet, vicaire d’Herbignac, reparaît avec une troisième escouade de travailleurs de cette paroisse. Parmi eux se trouvent très opportunément un certain nombre de maçons et d’ouvriers de S.-Nazaire qui aident à poser les fondations de la grotte d’Adam, dont nous parlons plus loin.
†
Le Jeudi 14 Mars : Troisième journée de la paroisse de S.-Gildas-des-Bois, sous la direction de M. l’abbé Bretesché.
†
Le Vendredi 15 Mars : Première journée des Campbonnais. C’est la Frairie de S.-Martin de Campbon. M. l’abbé Appert donne l’exemple au milieu des travailleurs et les bénit le soir au salut du Très Saint-Sacrement.
†
Le Lundi 18 Mars : Seconde journée des Campbonnais. C’est la Frairie de S.-Victor. Cette excellente frairie eût été représentée par un bien plus grand nombre de travailleurs, si plusieurs n’étaient retenus par leurs affaires, à la foire de Pontchâteau, qui a lieu aujourd’hui même.
†
Le Mercredi 20 Mars : -Monsieur le Curé-doyen d’Herbignac à bien voulu venir présider cette quatrième journée donnée par ses paroissiens aux travaux du Calvaire. Il était accompagné d’un de ses vicaires, M. l’abbé Ménard qui ne s’est pas ménagé au chantier.
†
Le Jeudi 21 Mars : Première journée de la paroisse de Fégréac. Fégréac est à une distance de cinq lieues du Calvaire. M. le Doyen pouvait être fier du bataillon de travailleurs qui l’avait suivi, l’un des plus nombreux que nous ayons vu da moins dans cette campagne. Et nous savons que Fégréac ne nous a pas dit son dernier mot.
Le Vendredi 22 Mars : Première journée de la paroisse de Sainte-Anne de Campbon, et la dernière que nous pouvons mentionner, ici. Le nouveau Pasteur avait tenu à accompagner ses paroissiens qui paraissaient très heureux de le voir au milieu d’eux. Il a donné le salut à la fin de la journée.
W. l’abbé Serrandour, vicaire, tenait l’orgue.
Coup d’œil sur l’état actuel des travaux du Calvaire
Nous croyons que c’est répondre à la légitime Curiosité de nos lecteurs de dire quelques mots à ce sujet. En parlant du plan adopté, nous avons essayé de faire comprendre que le Calvaire devait perdre sa forme actuelle, qui est celle d’un cône tronqué, et présenter l’aspect d’une colline naturelle se prêtant mieux au développement des différentes scènes qui doivent y être représentées! Cette transformation s’opère, mais lentement ; et à l’heure présente, il faut le dire, bien qu’on ait fait des remblais considérables, elle n’apparaît bien distincte ni à la base ni au sommet.
On s’occupe, en ce moment, d’un travail spécial sur l’ancienne plate-forme. Ceux qui ont vu le monument qui s’y trouve, peuvent se rappeler que le vaste piédestal en fonte qui supporte les croix est orné d’un bas-relief en deux panneaux, représentant la chute d’Adam et d’Eve et leur expulsion du Paradis terrestre. Le B. Montfort lui-même avait cette idée, de rapprocher le souvenir de la chute de celui de la Rédemption. Au pied de son Calvaire, un petit espace de terrain représentait le Paradis terrestre, le Jardin de délices, et avait pour pendant le jardin de Gethsémani ou de l’Agonie de Notre-Seigneur.
De plus, tous connaissent l’antique tradition qui veut que le premier homme soit venu dormir son dernier sommeil sur le Golgotha et qu’il ait été enseveli au lieu même où devait être plantée la Croix du divin Sauveur, où devait couler le sang de la Rédemption. Cette tradition est consacrée à Jérusalem, dans l’église du Saint-Sépulcre par l’existence d’une petite chapelle souterraine, au-dessous du Calvaire, et qui porte le nom de Chapelle d’Adam. Pour ces motifs, et pour d’autres encore, il fallait conserver le bas-relief dont nous venons de parler, et le moyen tout indiqué était de l’encadrer dans une espèce de grotte ou chapelle dont la position au-dessous de la Croix du Calvaire correspond assez bien à celle qu’occupe dans l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, la chapelle d’Adam.
Ce travail qui absorbe, pour le moment, presque tous les efforts des travailleurs, à cause de la difficulté du transport des matériaux à cette hauteur, sera bientôt terminé.
III. Coup d’œil en avant.
Un peu par devoir professionnel, le Rédacteur de L’Ami de la Croix aime à recueillir les réflexions, les appréciations des allants et venants, des pèlerins et des travailleurs. C’est ainsi qu’il lui a été facile de constater que, presque à l’unanimité, tous ceux qui étaient mis en présence du plan projeté pour le Calvaire et dont une ébauche est exposée dans notre parloir, semblaient dire qu’il fallait quelque chose de plus. On avait beau leur dire que la colline serait plus élevée, monterait jusqu’au pied des croix, il fallait s’attendre à cette réponse ou à quelque parole équivalente : « Mais la croix, elle, ne sera pas plus élevée, nous ne pourrons donc pas la saluer de plus loin. »
En y réfléchissant, celui qui écrit ces lignes est arrivé à se dire que tous ces braves gens avaient au sujet de leur Calvaire l’idée qu’en avait lui-même le P. de Montfort, et son idée toute entière. Il est certain, en effet, que le saint missionnaire avait, ici, un double but: Faire méditer la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, mais aussi glorifier la Croix. C’est ce qui apparaît notamment dans les cantiques composés par lui dans la circonstance même.
La grotte de Gethsémani, le Prétoire, la Voix douloureuse répondent parfaitement à la première pensée ; mais la seconde est-elle irréalisable e même temps? En cherchant bien, il nous a semblé que non.
Sans doute le Crucifiement, qui est la douzième station du Chemin de la Croix, doit occuper, en avant, le sommet de la colline. Mais, rien ne s’oppose, sur le même sommet, un peu en arrière, à l’érection d’une Croix, aux proportions grandioses, qui serait la Croix triomphante, ornée si l’on veut de rayons dorés, ou de ce que l’on appelle une gloire, dominant tout le reste, et pouvant être vue de très longues distances. Il faut que l’idée soit bonne ; car à peine l’avons-nous confiée discrètement à l’oreille, qu’elle a été bientôt connue d’un grand nombre, et, si nous ne nous trompons, goûtée et approuvée de tous.
N° 44 Mai 1895
Continuation des Travaux
Notre dernier compte-rendu, à ce sujet, s’arrêtait au 22 mars. Depuis ce temps, certes, le travail n’a pas chômé. Il semble même que nos braves ouvriers volontaires tenaient à montrer encore plus de bonne volonté et d’ardeur dans ces dernières semaines du Carême, consacrées plus particulièrement à honorer la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Quant à l’état des travaux, nous disions, il y a un mois, qu’on s’occupait surtout alors de la construction de la Grotte d’Adam, dont nous avons essayé de donner une idée à nos lecteurs. Cette construction nous semblait alors déjà bien avancée et devoir se terminer bientôt. Elle n’est cependant pas encore achevée. Il reste une partie de la voûte à faire.
Cette grotte est établie à la hauteur de la plateforme de l’ancien Calvaire. Il faut du travail et du temps pour monter là les blocs de pierre dont elle est formée. Peut-être aussi la construction a-t-elle pris des proportions sur lesquelles on ne comptait pas tout d’abord. Quoi qu’il en soit, le travail touche à sa fin ; et dès maintenant, il n’est pas douteux que dans l’ensemble de la restauration du Calvaire, cette grotte ne produise un très bel effet.
Mais, hâtons-nous de signaler, comme nous en avons pris l’engagement, les paroisses et villages qui, avec tant de dévouement, ont pris part à ces travaux pendant la période de temps qui vient de s’écouler.
†
Le Mardi 26 mars. C’est la troisième journée fournie par la paroisse de Campbon. Les travailleurs d’aujourd’hui sont les habitants des deux Frairies de Sainte-Barbe et de Bessac. Ils ont à leur tête M. l’abbé Waran, vicaire, dont l’ardeur au travail sert de modèle à tous. Il donne au départ le Salut du Très Saint-Sacrement.
†
Le Jeudi 28 mars a été l’une de ces journées pendant lesquelles la colline du Calvaire apparaît littéralement couverte, de la base au sommet, de travailleuses qui se font passer, de main en main, les paniers chargés de terre. Aujourd’hui, elles sont toutes venues de Pontchâteau, de Sainte-Reine et de Saint-Guillaume. Monsieur le Curé de Pontchâteau a paru, dans la soirée, pour les encourager de sa présence. Monsieur l’abbé Marchant a donné le Salut. Monsieur le Curé de Saint-Guillaume a fait ensuite vénérer les reliques du Bienheureux.
†
Le Vendredi 29 Mars, est la quatrième journée de travail que nous donne la paroisse de Drefféac. Nous aimons à voir en tête de la liste des travailleurs qui ont signé ce jour-là sur notre registre : Comte de Baudinière, maire de Drefféac, Vaillant, adjoint, Cléro, conseiller municipal.
†
Le Lundi 1er Avril. Nous voyons pour la seconde fois les bons habitants de Férel (Morbihan). Bien que fort éloignés, ils arrivent de bonne heure au Calvaire et ne nous quittent qu’à la chute du jour. Ils avaient à leur tête leur excellent Recteur, M. Gergaud.
†
Le Mardi 2 Avril. Quatrième groupe de travailleurs de la paroisse de Campbon, composé des hommes de la Frairie de la Foi. Nous empruntons au Livre d’or des travailleurs cette réflexion : « La Prairie de la Foi est bien nommée. Ce sont des hommes de foi, à qui Dieu a donné, en même temps, la force et le courage. Ils l’ont montré aujourd’hui. » M. l’abbé Apert, vicaire de Campbon, était au milieu des travailleurs.
†
Le Mercredi 3 Avril : Grande journée pour les vaillantes chrétiennes des paroisses d’Herbignac et de la Chapelle-des-Marais. Emulation d’ardeur et de bonne volonté entre les représentantes do ces deux excellentes paroisses.
†
Le Jeudi 4 Avril : C’est un second groupe de vaillants travailleurs de la paroisse de Fégréac. Ils ont à leur tête M. l’abbé Daviaud, vicaire, et M. H. de Barmon qui est déjà pour nous une ancienne connaissance.
†
Le Vendredi 5 Avril : Sainte-Anne de Campbon est largement représentée ce jour-là par les hommes des Frairies du Champblanc, de Saint-Lomer et de Coterets. M. le Curé et son vicaire sont présents. Nous remarquons aussi sur le Registre, en tête de la liste des travailleurs, le nom de M. le Maire de Sainte-Anne de Campbon.
†
le Lundi 8 Avril : A cette date, une note du Livre d’or des travailleurs fait connaître qu’ayant appris tardivement que les travailleurs d’Herbignac sur lesquels on comptait pour ce jour-là ne pouvaient venir, on a dû faire appel à nos plus proches voisins. D’un côté, M. du Bois, conseiller d’arrondissement, autour de Bodio; de l’autre, M. H. de Gouttepagnon, autour de la Chasselandière qu’il habite en ce moment, ont bien vile fait de réunir chacun leur groupe de braves volontaires, et viennent à leur tête nous donner une excellente journée de travail.
†
Le Mardi 9 Avril : Les Campbonnais pour la cinquième fois ! tous venant aujourd’hui de la Frairie du Mont. Le vénérable Pasteur de cette grande et belle paroisse qui, les autres jours, s’était fait représenter par l’un de ses vicaires, a bien voulu venir lui-même présider cette journée. Il l’a passée toute entière, au milieu de ses chers travailleurs, et a donné le salut, au moment du départ.
†
Le Mercredi 10 avril: Il était fait une fois de plus appel aux bons habitants de Sainte-Reine, qui une fois de plus répondaient à cet appel avec leur bonne volonté ordinaire. Ils venaient les uns du bourg même de Sainte-Reine, les autres des villages de Travers, de la Buronnerie, de l’Organais, de Montmara et de la Varonnière.
†
Le Vendredi-Saint, 12 Avril: Au sortir de la cérémonie si touchante de ce jour, à laquelle toutes s’étaient fait un devoir d’assister à leur Eglise paroissiale, les pieuses chrétiennes de Crossac, munies de leurs instruments de travail, venaient, en continuant de prier, au Calvaire. Elles étaient au nombre d’environ quatre cents, travaillant avec ardeur, tout en conservant un recueillement qui ne laissait pas que d’être édifiant pour ceux qui en étaient témoins.
Vers trois heures, M. le Curé de Pontchâteau, suivi d’un bon nombre de personnes de sa paroisse, arrivait au Calvaire pour y présider, selon un usage traditionnel, le Chemin de la Croix. A ce moment, les vaillantes chrétiennes de Crossac, suspendent leur travail pour s’unir aux fidèles de Pontchâteau et prendre part au même pieux exercice. Mais elles le reprennent bientôt, avec une nouvelle ardeur, pour le continuer jusqu’à la fin du jour.
Plusieurs prêtres des environs, présents au Calvaire dans cette soirée, et témoins du spectacle dont nous venons de parler, en semblaient très touchés.
Nous donnons plus loin un souvenir tout spécial de cette journée au Calvaire, qu’a bien voulu nous adresser l’un de ces témoins.
†
Le Mardi 16 avril: Dès ce surlendemain de la grande fête de Pâques, un groupe de la paroisse de Missillac, inscrite sur notre registre, pour la huitième fois, vient continuer les travaux. On voit aussi un certain nombre de bons fermiers de la paroisse de Crossac qui ont amené leurs charrettes pour transporter des pierres destinées à la voute de la Grotte d’Adam.
†
Le Mercredi 17 avril: C’est la Frairie de Kérobert qui fait les frais de cette journée. MM. René et Ferdinand Corbun de Kérobert sont à la tête de cette petite troupe d’élite et s’en montrent dignes par leur entrain et leur ardeur au travail.
†
Le Jeudi 18 avril: Nous n’avions pas encore vu les riverains de la Loire. Voici Donges aujourd’hui, avec ses excellents travailleurs, Donges qui connut longtemps la barque du P. de Montfort, sur laquelle il n’y avait à craindre ni naufrage, ni accident. M. l’abbé Dautais, vicaire, M. l’abbé Meignen, de Donges, où il prend en ce moment ses vacances de professeur, prennent part aux travaux de la journée.
†
Le Vendredi 19 avril : Ce n’est plus des bords de la Loire, mais des bords de l’Océan plus éloignés encore que nous viennent les travailleurs de cette journée. Assérac qui garde toujours pieusement le souvenir du B. Montfort ne pouvait manquer de répondre à l’appel qui lui était fait pour la restauration de son Calvaire. Ses travailleurs, sous la conduite de M. l’abbé Paré, vicaire, nous ont donné une excellente journée.
†
Le Samedi 20 avril : Par extraordinaire, aujourd’hui samedi, habituellement jour de repos, on a recours, pour un travail pressé à nos bons voisins du village de Quémené en Crossac. A l’heure dite, ils sont tous là présents, et la tâche que le P. Directeur du Pèlerinage voulait voir terminée, avant de faire une courte absence, l’est, en effet, à la fin de cette journée.
†
Nous ne pouvons terminer ce compte-rendu sans signaler certains concours bien précieux pour l’Œuvre et aussi quelques faits particuliers.
†
Sur le chantier même, les bras suffisaient pour monter au sommet de la colline les matériaux d la grotte, mais pour aller chercher, plus ou moins loin, dans la campagne, les blocs de pierre, il fallait bien des charrettes et des attelages. Nous ne saurions, à ce sujet, assez louer le dévouement de tous les fermiers du voisinage : car, c’est à eux naturellement qu’on s’est adressé. Nous voudrions pouvoir faire parvenir un mot de reconnaissance à chacun d’eux, au nom de tous ceux qui s’intéressent à l’Œuvre du Calvaire; mais il nous faudrait donner tous les noms des villages qui nous entourent, tant de la paroisse de Pontchâteau que de celles de Crossac, de Saint-Guillaume et de Sainte-Reine.
†
Tous se rappellent avoir lu dans la vie du Bienheureux, qu’on venait de très grandes distances travailler à son Calvaire. Il y a quelques jours, un excellent ouvrier des environs d’Amiens, apprend à Rennes où il était venu voir sa fille, religieuse, les travaux qui se font, en ce moment, au Calvaire. Il n’hésite pas et vient de Rennes, ici, pour y prendre part. Eh certes, les heures qu’il a passées au milieu le nous, n’ont pas été inactives. C’est un de ces vaillants, comme il s’en trouve encore heureusement partout, sur le sol de notre France, plein des souvenirs du grand pèlerinage des ouvriers à Rome, dont il faisait partie et parlant avec enthousiasme de la réception que leur fit Léon XIII.
Quelques jours après, un chef d’équipe au chemin de fer, domicilié à La Membrolles (Maine-et-Loire), profitait du court congé que lui accordait la Compagnie, pour venir aussi donner sa journée au P. de Montfort, pour qui, lui et sa famille ont toujours eu un culte spécial.
On lit aussi dans les relations du temps que parmi les travailleurs du Calvaire, tous les rangs étaient confondus, qu’on y voyait des ecclésiastiques, des messieurs et des dames de qualité, il nous a été donné de constater que, pour le temps présent, ces paroles, à la lettre, sont également vraies.
N° 45 Juin 1895
Travaux du Calvaire
Hâtons-nous de dire tout d’abord que la grotte d’Adam est ouverte et complètement achevée, sauf peut-être quelques ornements qui seront ajoutés au-dessus de la façade. L’aspect général semble à tous très satisfaisant. En arrivant par la route de Pontchâteau, le regard est frappé par la vue de ces trois baies de grandeur et de forme inégales qui en forment l’entrée. On les dirait vraiment creusée dans le roc, tant les blocs de pierre qui les encadrent ont été artistement ajustés, par l’habile architecte.
L’intérieur un peu sombre sans doute, est également bien réussi, quant à la voûte surtout. Rien n’y manquera quand la polychromie aura donné la vie à l’ancien bas-relief que tous les visiteurs du Calvaire connaissent et qui représente la chute d’Adam et d’Eve, et leur expulsion du paradis terrestre.
Quant au reste des travaux, grâce à la bonne volonté et à la constance de nos travailleurs volontaires, ils avancent toujours quoique lentement. Espérons qu’ils ne seront pas interrompus jusqu’à ce que la voie principale qui donne accès au sommet du Calvaire soit mise en état, au moins jusqu’à la hauteur de l’ancienne plate-forme. Il faut qu’elle soit rendue praticable aux nombreux pèlerins qui voudront, pendant cet été, faire l’ascension de la colline.
Du reste, le zèle et l’ardeur de tous sont loin de se ralentir. Nos lecteurs vont pouvoir en juger pal la simple énumération suivante :
†
Le Samedi27 Avril: A cette date, je constate au registre des travailleurs qu’il s’agissait d’un travail spécial et urgent: Amener à pied d’œuvre, d’une assez grande distance, les pierres choisies pour faire la voûte de la grotte en construction. A ce sujet, le Père Directeur du Pèlerinage a écrit sur le Registre ces lignes : « Ce n’est pas en vain que j’ai fait appel, le soir du 26, aux braves cultivateurs des Métairies, de la Viotterie, de la Plaie, de la Pintaie, du Buisson rond, en Saint-Guillaume. Le lendemain matin, 27, onze charrettes attelées étaient à notre disposition. »
†
Le Lundi 20 Avril : M. le Recteur de Marzan nous vient d’au-delà de la Vilaine à la tête d’une petite escouade de très bons travailleurs.
†
Le Mardi 30 Avril: Aujourd’hui, deux paroisses sont, en même temps, largement représentées, Prinquiau et Quilly. Il va sans dire, que, de part et de l’autre, on rivalise d’ardeur et d’entrain, et que les blocs de pierre les plus lourds montent en peu de temps jusqu’au sommet. Quilly fort éloignée du Calvaire ne pouvait venir à pied. Aussi à l’arrivée, comme au départ, l’on eut pu voir un fort beau défilé de trente-trois voitures que remplissaient les travailleurs.
A la fin de la journée le salut est donné par le vénérable curé de Prinquiau. M. le Vicaire de Quilly fait ensuite vénérer à tous les reliques du Bienheureux.
†
Le Mercredi 1er Mai : A cette date, on peut lire sur le registre des travailleurs ces lignes : « Ce sont nos braves amis de S.-Joachim, qui reviennent continuer les travaux. Nous les connaissons. La journée ne peut manquer d’être excellente.» Elle l’a été, en effet.
†
Le Jeudi 2 mai : Le vénérable Curé de Sain André-des-Eaux a bien voulu venir, de si loin, à la tête de ses courageux paroissiens. Les uns ont passé la Grande-Brière en bateau. Les autres sont venus par la route de Guérande, en voiture. Ton» ont travaillé avec une ardeur incroyable.
†
Le Vendredis 3 mai : Aujourd’hui, c’est Pontchâteau ville et campagne qui prend part aux travaux du Calvaire. Ce sont, par conséquent, les descendants de ceux à qui le Bienheureux Montfort, il y a près de deux cents ans, à la fin de sa grand mission, communiqua tout d’abord le projet qu’il méditait depuis longtemps, et que tous accueillirent avec tant d’enthousiasme. Aujourd’hui, l’enthousiasme aussi ne manque pas. On peut dire que le plus grand nombre des familles de la ville en particulier sont représentées.
Signalons la présence de M. le Curé, de M. Paillé, maire, de ses adjoints, MM. Sarzeau et du Bois, et M. de Marcé, de M. de Gouttepagnon, etc.
†
Mardi 7 et Mercredi 8 mai : Travail spécial qui consiste à fournir de matériaux à l’ouvrier qui construit la grotte et qu’accomplissent activement les bons habitants des villages de la Giraudais, de la Maison-Neuve et du Rault. Ces villages sont de Crossac; et une note fait connaître que ce sont les quatorzième et quinzième journées de travail donnés au Calvaire par cette excellente paroisse.
†
Le Jeudi 9 mai : Seconde journée de la paroisse de Saint-André-des-Eaux, aussi brillante que la première. « Comment ces braves gens venant de si loin, ont-ils pu arriver de si bonne heure au Calvaire ? » « En partant de là-bas, à deux heures du matin, » répond simplement M. le Vicaire de Saint-André qui préside aujourd’hui la caravane. M. le Maire est aussi présent. Détail à noter: M. le Vicaire d’Escoublac, paroisse qui se trouve, par rapport à nous, encore au-delà de Saint-André, avait voulu accompagner son confrère, ce jour-là, en peu, nous est-il permis de penser, pour étudier le terrain. Il s’engage à nous revenir bientôt, avec une troupe de travailleurs.
†
Le Jeudi 9 mai : Nous avons signalé plus haut, les travailleurs de Prinquiau. Les femmes ne pouvaient rester en arrière. Elles arrivent, elles aussi, de bon matin, malgré la distance, et bien qu’un grand nombre aient dû faire la route à pied. Il est facile de constater qu’elles puisent leur ardeur dans leur foi et leur piété.
†
Le Vendredi 10 mai : C’est ce jour où chacun des travailleurs ont eu le bonheur de recevoir la bénédiction solennelle donnée par Monseigneur l’Evêque de Nantes, du haut du Calvaire. Nous avons dit qu’elles étaient environ deux cents. Ajoutons que la paroisse de Saint-Joachim avait bien quelque droit à cette faveur. C’était la dixième journée donnait par cette excellente paroisse aux travaux du Calvaire.
†
Le Lundi 13 mai : M. le Recteur de Nivillac est venu à la tête d’une bonne escouade de travailleurs. Toutefois, il eut été suivi d’un bien plus grand nombre, sans une circonstance spéciale. Presque toute la jeunesse valide doit se présenter aujourd’hui au conseil de révision, à la Roche-Bernard. La chaleur excessive n’empêche pas l’ardeur au travail. L’excellent Recteur donne le salut, à la fin de la journée.
†
Le Mardi 14 mai : Ce jour-là, on voit les courageuses chrétiennes des bords de la Vilaine et des rives de la Loire fraterniser ensemble au Calvaire. Elles rivalisent de zèle et d’ardeur pour la restauration de ce monument qu’élevèrent autrefois leurs aïeules, à la voix de Montfort. Ce sont les paroissiennes de St-Dolay (Morbihan) et de Donges (Loire-Inférieure). Le salut est donné par M. le Curé de Donges. M. Le Garnec, vicaire de St-Dolay, était présent.
†
Le Mercredi 15 mai : M. l’abbé Avenard, dont nous connaissons, de longue date, le zèle pour les travaux du Calvaire, doit être fier à bon droit de nous avoir amené de Guenrouët un groupe si nombreux d’excellents travailleurs. M. le Curé lui-même est venu dans la journée les encourager de sa présence.
†
Le Jeudi 16 mai : Très-nombreuse réunion de travailleuses, les unes de la paroisse de Drefféac, les autres de la paroisse de Ste-Anne de Campbon. Il va sans dire que tout en chantant de nombreux refrains, les unes et les autres rivalisaient d’ardeur au travail. Leurs noms remplissent sur le registre six grandes pages in-folio.
†
Le Vendredi 17 mai : A cette date reparaît pour la septième fois, sur le Livre d’or des travailleurs, le nom de l’excellente paroisse de la Chapelle des Marais. J’y trouve aussi exprimé le regret de ce qu’un bon nombre de ces braves gens, après nous avoir donné une si bonne journée, aient négligé, par oubli, sans doute, d’y inscrire leurs noms. Du moins le Bienheureux Père les connaît.
†
Le Mardi 21 mai : Troisième journée de la paroisse de St-Roch. Peu nombreux sans doute, mais plein de bonne volonté et d’ardeur, ce petit groupe a contribué très utilement au travail important fait ce jour-là au-dessus de la voûte de la grotte, pour la rendre imperméable.
†
Le Vendredi 24 mai : C’est la dernière journée inscrite, pour le moment, sur le registre. Elle aussi prend de nombreuses pages pour les signatures. Ce sont les femmes de la grande et belle paroisse de Missillac. Tandis que les vagonnets déchargent la terre apportée, on la charge dans des paniers qui passent de main en main jusqu’au-dessus de la Grotte d’Adam. De temps en temps, les conversations s’arrêtent en même temps, et l’on entend retentir dans les airs un pieux refrain.
M. l’abbé Gaudin, curé de Missillac, n’a pu non donner, ce jour-là, que quelques instants bien courts.
Fête du 24 JUIN 1895 – Inauguration et bénédiction de la septième station de la Voie douloureuse
Jusqu’à présent, sur le parcours de la Voie douloureuse qui monte du Prétoire au Calvaire, la septième station (seconde chute de Notre-Seigneur, sous le poids de sa croix) n’était marquée que par une simple croix de bois. C’était un vide à remplir, et il va l’être bientôt, non pas complètement, il est vrai. Les Pèlerins du Calvaire savent que la huitième station (Jésus console les Filles de Jérusalem) peut seule être regardée comme complète, et que les autres ne sont indiquées que par une ou deux statues, attendant le groupe qui doit les accompagner. La septième station va être représentée par trois statues seulement, en attendant les autres qui doivent compléter le groupe.
Ce sont ces trois statues dont nous annonçons l’inauguration et la bénédiction pour le 24 juin [prochain, fête de saint Jean-Baptiste. Cette fête sera présidée par M. l’abbé Pellerin, curé-doyen d’Herbignac. Tout le canton d’Herbignac, qui se compose des paroisses d’Herbignac, d’Assérac, de la Chapelle-des-Marais, de Pompas et de Saint-Lyphard est spécialement invité. Nous ne doutons pas que chacune des paroisses que nous venons de nommer, ne soit largement représentée.
Quant à l’ordre des cérémonies de la journée : Dans la matinée la messe sera dite, vers dix heures, à la Scala Sancta.
Dans l’après-midi, réunion à la Scala Sancta pour entendre l’allocution qui sera prononcée. Puis, procession pour se rendre à la septième station, où aura lieu la bénédiction des statues. A cette procession, sera portée, sur son grand et riche brancard, la statue de Jésus chargé de sa Croix.
Nous comptons bien que chacune des paroisses susnommées fournira son groupe de quarante hommes au moins, pour procurer ce triomphe Notre-Seigneur.
Tous les porteurs recevront la décoration du Pèlerinage, qui est la croix de Jérusalem sur fond rouge.
Retour à la Scala Sancta, pour le Salut solennel du Très Saint Sacrement.
N° 46 Juillet 1895
Fête du 24 juin 1895 : Inauguration et bénédiction de la VIIe Station
Notre Voie douloureuse vient de s’enrichir d’un nouveau groupe, qui comble heureusement une lacune que tous les pèlerins pouvaient remarquer jusqu’à cette heure. La huitième station : Jésus console les Filles de Jérusalem, était inaugurée et bénite l’an dernier, et la septième, la précédente, n’était indiquée jusqu’à présent, que par une simple croix de bois.
Désormais, nul ne passera là, sans s’y arrêter un instant, pour recueillir quelque bonne pensée, pour y faire une courte prière.
Le groupe qu’on y voit aujourd’hui, est encore incomplet, comme tous ceux qui le précèdent sur la Voie douloureuse. Trois statues seulement sont à leur place, sur six ou sept qui doivent former la station de : Jésus tombe pour la seconde fois. Mais, la scène est déjà bien touchante et frappante de vérité.
Comme il convenait, tout y est disposé de manière à ce que les regards soient attirés tout d’abord et se fixent sur la divine Victime.
A la première chute, un seul genou a fléchi, le bras gauche s’est tendu, et la main touchant au pavé a empêché que la chute ne fût plus profonde, tandis que le bras droit retient encore la Croix sur l’épaule déjà meurtrie. Mais, ici, l’affaissement est bien plus grand. Les deux genoux et les deux mains portent à terre. La tête seule n’y a pas touché et se redresse avec effort, laissant voir, sur le visage, l’empreinte de la plus profonde douleur. Le regard surtout impressionne. Les yeux semblent fixer un objet lointain, sans doute le sommet du Golgotha, qui apparaît de là, à une assez grande distance encore. Mais, ce regard divin ne porte-t-il pas plus loin, voyant dans la suite des âges la multitude de ceux qui après avoir été réconciliés, pardonnes, retombent dans le péché, et dont il a voulu expier ainsi, les rechutes innombrables?
L’affaissement de la divine Victime a été tel, que la Croix eut dû être renversée totalement. Quelqu’un s’est trouvé là pour la retenir en équilibre, jusqu’à ce qu’elle puisse être replacée sur l’épaule ensanglantée de l’Homme des douleurs. Si cette figure de Juif qui fait contraste avec celle du Divin Maître, n’exprime pas de compassion, on n’y lit pas non plus de haine. Ce n’est pas un nouveau Cyrénéen qui aidera Jésus à porter sa croix, mais nous ne croyons pas qu’on le retrouve parmi ses insulteurs et les blasphémateurs de la dernière heure. C’est un de ces passants qui se trouvent toujours dans la rue, lorsqu’arrive un accident quelconque, pour donner ce que l’on appelle un coup de main.
Quant au soldat romain, placé un peu en arrière, sa figure est impassible, et, il semble que c’est plutôt par un mouvement machinal, que par un mouvement de colère que, de l’extrémité du bâton de sa lance il touche le divin supplicié gisant à terre, comme pour l’exciter à se relever.
C’est ainsi que rien-là ne vient distraire l’attention de l’objet principal, et qu’elle se concentre toute entière sur Celui qui succombe sous le poids des péchés du monde, dont il s’est chargé, bien plus encore que sous le poids de sa Croix.
Tel est le groupe artistique, qui va être inauguré, en quelques instants, et recevoir la bénédiction de l’Eglise.
Ajoutons que sur la Voie douloureuse de Jérusalem, l’emplacement de la septième station se trouve à l’endroit où l’on voit encore quelques restes de l’ancienne Porte judiciaire, par laquelle les condamnés devaient passer, pour se rendre au lieu du supplice, en dehors des murs de la Ville. C’est ainsi que les derniers pas de Jésus sur le sol de l’ingrate Jérusalem furent marqués par cette chute si douloureuse.
Sur le même emplacement, dans une petite maison qui est la propriété des Pères Franciscains, se voit une colonne dite Colonne de la Sentence. C’est, sur cette colonne, que, d’après la tradition, fut affiché l’arrêt de mort de Notre Seigneur Jésus Christ.
†
Mais voici que déjà l’heure est venue de se diriger vers la Scala Sancta, où doit commencer la fête. Avec la VIIe Station qui doit être bénite, c’est le seul point entouré d’oriflammes. Les paroisses d’Herbignac, d’Assérac et de Pompas ont répondu à l’appel spécial fait au canton d’Herbignac. Leurs Pasteurs sont là. Les représentants de chacune des trois paroisses marchent à la suite de leurs croix.
Bientôt M. le Curé-doyen d’Herbignac monte à l’autel. A l’Evangile, M. l’abbé Guyot, vicaire de Férel, prend la parole, et a bientôt fait de captiver tout son auditoire….
Après ce discours, le saint sacrifice de la Messe s’achève. La divine Hostie est saluée par le beau cantique de Montfort : O l’auguste Sacrement!…
Les pèlerins se dispersent un moment en attendant la cérémonie de l’après-midi.
La réunion se fait de nouveau à la Scala Sancta, au chant des cantiques en l’honneur de Montfort.
Quand tous sont rassemblés autour du pieux monument, M. l’abbé Paré, vicaire d’Assérac leur adresse une seconde allocution…
A ces conseils, à cette invitation, pendant que la procession s’organise, tous les voix répondent par ce refrain :
Dieu le veut ! et Montfort est l’écho de sa voix,
Dieu le veut ! soyons tous les amis du la Croix !
En tête du défilé, nous remarquons un groupe de jeunes filles à qui a été confiée la bannière du Bienheureux et qui forment un chœur bien nourri. C’est le pieux ouvroir de la Petite-Providence de Nantes.
Puis viennent les croix des trois paroisses représentées.
Honneur aux vaillants d’Herbignac, d’Assérac et de Pompas qui courbent, en ce moment, leurs épaules pour porter non seulement la Croix, mais Jésus chargé de sa Croix, sur son glorieux pavois. Leur mérite est d’autant plus grand que leur nombre est plus restreint et que la chaleur est plus accablante. Celui qui n’oublie rien leur tiendra compte un jour, des sueurs abondantes qu’ils ont répandues dans le long parcours.
Mais les rangs de la procession s’arrêtent, puis se replient de manière à envelopper la septième station. M. le Curé doyen d’Herbignac, officiant, entouré des autres membres du clergé prononce alors la formule liturgique de la bénédiction, et asperge le nouveau groupe.
Puis, on chante encore Vive Jésus ! Vive sa Croix ! en redescendant à la Scala Sancta, où se termine la fête, par la bénédiction solennelle du Très Saint-Sacrement.
Les travaux du Calvaire
La campagne des travaux commencée, le 13 décembre, touche évidemment à sa fin. Il a toujours été convenu qu’il y aurait interruption à la saison dans laquelle nous sommes déjà entrés, alors que tous les bras suffisent à peine aux grands travaux des champs. Il ne pourra y avoir désormais que de rares exceptions pour certains groupes des populations environnantes qui se trouvent dans des conditions particulières.
Nous pouvons dire aujourd’hui que la bonne volonté, l’ardeur et l’entrain se sont maintenus jusqu’à la fin. On se souvient qu’à certains jours, nous ne pouvions assez admirer le courage qui faisait braver le verglas et la neige, le froid le plus intense; mais, il n’en faut peut-être pas moins pour soutenir, ainsi que nous l’avons pu voir, récemment, la fatigue d’une longue journée de travail, avec une chaleur accablante, sous un soleil de feu.
Ainsi la foi, la reconnaissance, le zèle savent triompher du froid et de la chaleur.
†
Le Lundi 27 Mai : Nous voyons pour la seconde fois les vaillants hommes d’Escoublac, qui ont une si longue route à parcourir pour venir, des bords de la mer, jusqu’à nous. Néanmoins, ils sont arrivés pour commencer la journée de bonne heure. Le nom de M. Durand, maire d’Escoublac, est en tête de la liste, avec celui de M. J. Blois, vicaire, que nous connaissons pour l’avoir déjà vu à l’œuvre.
†
Le Mardi 28 Mai : D’après le registre, c’est la centième journée de travail, depuis la campagne commencée, au milieu de décembre ; et c’est M. l’abbé Niel, curé de Besné, suivi de ses paroissiennes, si dévouées, qui nous la donne. Inutile d’ajouter qu’elle a été bien remplie. Il n’y a pas lieu de s’étonner, qu’entraîné par l’exemple, tout le pèlerinage de St-Jacques ait voulu prendre part aux travaux. On dit bien que plus d’une main emportait des marques qu’y avaient laissées des instruments qu’on n’était point habitué à manier. Mais, personne ne paraissait trop s’en inquiéter.
†
Le Mercredi 29 Mai : Très belle réunion d’hommes, tous de la paroisse de Nivillac. Pendant cette chaude et si active journée, M. l’abbé Le Large et M. l’abbé Guégan, vicaires, n’ont pas cessé de payer de leur personne au milieu des travailleurs.
†
Le Jeudi 30 Mai : Les noms des travailleuses de cette journée remplissent 10 pages du registre in-folio. Il faut dire que deux paroisses étaient réunies, celle de Guenrouët et celle de Quilly. C’est aussi, ce jour-là, que les pensionnaires de la Sagesse de Rennes prirent part aux travaux, après les exercices de leur pèlerinage.
Signalons deux bonnes anciennes de Quilly, l’une de 78, l’autre de 79 ans, arrivées des premières, le matin, après avoir fait quatre lieues à pied.
M. l’abbé Avenard, vicaire de Guenrouët, a donné le salut. Son collègue, M. l’abbé Lemerle a fait vénérer les reliques. M. le vicaire de Quilly était aussi présent.
†
Le Mardi 4 Juin. C’est la sixième journée de travail donnée par la grande et belle paroisse de Campbon. M. l’abbé Appert déploie son activité ordinaire; et, dans leur ardeur à fournir leur tâche, les travailleuses ne semblent pas tenir compte de la grande chaleur.
†
Le Jeudi 6 Juin : Pontchâteau, St-Guillaume et St-Roch, ces trois noms sont répétés plus d’une fois en marge de la longue liste des travailleuses de ce jour. C’est dire que ces trois paroisses qui n’en formaient qu’une du temps de Montfort avaient bien voulu s’unir, de nouveau, pour lui offrir cette journée de travail, édifiante entre toutes.
C’est ce jour-là aussi que le petit pèlerinage de Loudéac était présent et prit part aux travaux.
†
Le Vendredi 7 juin : Encore deux paroisses réunies aujourd’hui et rivalisant d’ardeur et de zèle au travail, La Chapelle-du-Marais et Ste-Reine, toutes deux si attachées au culte du Bienheureux.
Parmi les travailleuses de cette journée, une vénérable octogénaire qui se rappelle avoir déjà remué quelques pelletées de terre, à la restauration du Calvaire, par M. Gouray, en 1821. Cette fois, elle laisse son instrument de travail en ex-voto, pour une guérison obtenue, par l’intercession du Bienheureux.
†
Le Lundi 10 Juin : Dixième journée de la paroisse de Missillac. Si les travailleurs et travailleuses de cette excellente paroisse qui nous sont venus dès la première heure étaient dignes d’éloges, celles d’aujourd’hui ne le sont pas moins. Quelques personnes de Quimperlé, en pèlerinage au Calvaire, ont aussi pris part aux travaux.
†
Le Mardi 11 Juin : Après cette journée de fatigue, l’excellent Recteur de Nivillac a dû certainement éprouver quelque joie, en bénissant le soir cette réunion de femmes courageuses venues de si loin, pour accomplir un acte de foi, et de reconnaissance envers le Bienheureux Montfort.
†
Le Jeudi 13 Juin : Elles sont nombreuses, échelonnées sur les flancs de la colline du Calvaire, celles qui prennent part aux travaux de cette journée. Il est vrai que là sont représentées, et bien représentées, deux paroisses bien chrétiennes, Crossac et St-Malo de Guersac. Monsieur le Curé de St-Malo était présent, ainsi que son vicaire.
†
Vendredi 21 Juin: Fête du Sacré-Cœur. Les pieuses chrétiennes de Saint-Gildas-des-Bois lui ont fait ce jour-là, par leur travail, une offrande qui n’a pu manquer de lui être agréable. M. le Curé-doyen a donné le salut.
N° 47 Août 1895
Derniers travaux au Calvaire
Il y a un mois, nous annoncions qu’on allait mettre la dernière main aux travaux de notre Grotte d’Adam, afin qu’elle fût complètement achevée et ornementée avant la fête du 8 septembre, jour auquel est fixée son inauguration solennelle.
La façade ou entrée demandait un couronnement, de manière que les trois baies qu’on y voit et qui éclairent la Grotte, parussent véritablement et comme naturellement creusées dans le rocher, au flanc de la colline. C’est fait, grâce aux bons fermiers qui ont bien voulu, malgré leurs occupations multiples, aller avec leurs attelages, à une assez longue distance, chercher les blocs de pierre nécessaires pour ce travail, grâce aussi aux courageuses chrétiennes qui ont ensuite, avec des efforts vraiment incroyables, monté ces mêmes blocs de pierre, jusqu’au sommet de la colline où ils devaient être placés.
La pose est très bien réussie, et beaucoup de visiteurs, en examinant attentivement l’ensemble, s’étonnent qu’on ait pu faire, dans ce que l’on appelle le genre rocaille, un travail si achevé sans avoir eu recours aux hommes du métier.
Aussi nous semble-t-il juste de nommer, ici, le simple ouvrier maçon, père de neuf enfants, qui seul a posé et ajusté tous les blocs de pierre de la Grotte d’Adam, après avoir accompli le même travail pour la Grotte de Gethsémani. Il se nomme Vaillant, et porte bien son nom.
Ajoutons qu’en rendant témoignage à l’habileté de ce brave ouvrier, nous accédons au désir de notre excellent Directeur des travaux, M. A. Gerbaud, qui, comme tous les nobles cœurs, aiment à faire une large part dans les éloges que méritent leurs œuvres, à leurs plus humbles collaborateurs.
†
Pendant que s’achevait la grotte à l’extérieur, M. Gerbaud que nous venons de nommer mettait la main au pinceau, et s’appliquait à l’intérieur, à donner la vie à l’ancien bas-relief, dont nous avons parlé, et qui représente, en deux panneaux, la chute d’Adam et d’Eve, et leur expulsion du Paradis terrestre. Nous croyons avoir dit déjà que le bas-relief est loin d’être un chef-d’œuvre. Mais il fallait le conserver comme souvenir. Et ceux qui le connaissaient à l’avance, en le voyant rajeuni par la polychromie, pourront constater une heureuse différence.
†
Il nous reste encore à signaler les journées dei braves volontaires qui nous ont apporté leur concours, dans ces dernières semaines, concours d’autant plus méritoire que les chaleurs étaient plus intenses, et que les grands travaux de la campagne étaient partout commencés.
†
Le jeudi 27 Juin : Grande et belle journée de travail, donnée par la paroisse de Saint-Malo de Guersac. M. le Curé est là, prenant part aux travaux et encourageant ses paroissiens. La chaleur est très grande, mais n’empêche pas l’entrain. Ni les mains ne se lassent de travailler, ni les voix de chanter de pieux et joyeux refrains.
†
Le vendredi 28 Juin : Un groupe seulement de vaillantes travailleuses de Saint-Joachim. C’est, du reste, la onzième journée inscrite au Livre d’or, pour le compte de cette excellente paroisse.
†
Le lundi, 8 Juillet : C’est le jour où plusieurs fermiers de Sainte-Reine et en particulier du village de Cusia, ainsi que de la Petite-Madeleine, en Pontchâteau, parlaient avec leurs attelages, dès trois heures du matin, pour charger les blocs de pierre qui devaient servir au couronnement de la Crotte d’Adam.
†
Le mardi 9 Juillet : Les courageuses femmes de la Chapelle-des-Marais montent jusqu’au sommet de la colline les blocs de pierre amenés, la veille, par les charrettes au pied du Calvaire. C’est une somme de travail vraiment étonnante, ainsi qu’en témoigne le Livre d’or à la date précitée.
†
Le mercredi 10 Juillet : Ce sont les femmes d’Herbignac qui continuent les travaux. Si, pour différentes causes, elles n’ont pu venir en grand nombre, elles sont, du moins, pleines de bonne volonté et de courage et travaillent avec beaucoup d’ardeur.
†
Le jeudi 11 Juillet : Nous ne croyons pas qu’il soit fait d’appel nouveau, avant l’automne prochain. C’est donc la dernière journée de cette campagne de travaux, commencée le 14 décembre dernier. On peut dire en toute vérité, que cette fin de campagne a été brillante, et dignement clôturée par cette journée du jeudi 11 juillet.
Nous le devons à la paroisse de Saint-Lyphard connue depuis longtemps pour sa dévotion au Bienheureux Père de Montfort, et pour son attachement au Calvaire.
En travaillant avec tant d’ardeur à ce Calvaire, en chantant avec tant de cœur, pendant tout le jour, les louanges du Bienheureux, les pieuses et vaillantes travailleuses de Saint-Lyphard ont bien montré que les sentiments de cette chrétienne paroisse étaient toujours les mêmes et que l’on pouvait toujours compter sur elle.
Fête du 8 Septembre : Inauguration de la Grotte ou Chapelle d’Adam
Nous avons déjà annoncé cette fête comme devant être la fête de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses volontaires de cette année au Calvaire. On peut évaluer leur nombre à dix ou douze mille au moins; et ce doit être à peu près le nombre des signatures apposées sur notre registre ou Livre d’or. Beaucoup, sinon tous répondront à l’appel qui leur est fait. Ceci nous promet déjà une grande et brillante fête.
Nous savons aussi dès maintenant, que plusieurs de Messieurs les Curés des paroisses voisines du Calvaire ont promis de venir, ce jour-là, paroissialement, c’est-à-dire avec leurs croix et bannières.
Quant aux heures des différentes cérémonies, rien n’est changé à ce qui a été d’usage, dans nos précédentes fêtes.
Dans la matinée, à 10 heures, à l’arrivée des différentes paroisses, dès qu’elles se seront groupées autour de la Scala Scinda, commencera la messe.
Cette messe sera dite par M. le Curé-doyen de! Pontchâteau.
Une allocution sera prononcée par le R. P. Renaud, des Missionnaires de L’Immaculée-Conception de Nantes.
Dans l’après-midi, vers 2 heures, réunion autour de la Scala Sancta, où l’on entendra une seconde allocution du R. P. Renaud, puis départ de la grande procession suivant les détours de la Voie douloureuse jusqu’au Calvaire, où aura lieu la bénédiction de la Grotte ou Chapelle d’Adam.
Retour de la procession à la Scala Sancta pour la bénédiction solennelle du Très Saint-Sacrement.
Les chants de la journée sont ceux contenus dans le petit Guide ou Manuel du Pèlerin au Calvaire de Pontchâteau.
N° 48 Septembre 1895
Légende de la Grotte d’Adam
Bon nombre des lecteurs de L’Ami de la Croix se proposent, sans doute, de prendre part à la fête du 8 septembre, et d’assister à l’inauguration et bénédiction de notre Grotte d’Adam.
Tous savent que cette grotte ou chapelle n’est, qu’une reproduction, représentation de la Grotte ou Chapelle du même nom, qui se trouve dans l’Eglise même du Saint-Sépulcre, à Jérusalem, au-dessous du vrai Calvaire. Nous avons pensé qu’il serait intéressant pour eux, d’avoir à l’avance, sous les yeux, ce qui peut se lire, au sujet de cette Grotte, dans les Guides du Pèlerin en Terre-Sainte, les plus autorisés.
Les détails qui suivent sont empruntés particulièrement à l’ouvrage du Fr. Liévin, franciscain, qui réside depuis si longtemps au Couvent de Saint-Sauveur, à Jérusalem. Cet excellent religieux, connu des pèlerins du monde entier pour son affabilité et son dévouement, a étudié à fond, mieux que personne, tout ce qui concerne l’histoire, les traditions, la topographie des divers sanctuaires de Terre-Sainte.
La Basilique du Saint-Sépulcre construite par Ste Hélène, plusieurs fois brûlée et ruinée, relevée pour la dernière fois en 1808 renferme dans son enceinte, non seulement le Tombeau de Notre-Seigneur, mais la colline toute entière du Golgotha.
C’est après être monté à la partie supérieure du Calvaire, pour s’y prosterner à l’endroit même où fut dressée la Croix du Sauveur, que le pèlerin, descendant un escalier de dix-huit marches, se trouve en face de la Grotte ou Chapelle d’Adam.
C’est une voûte étroite et sombre qui s’étend sous le Calvaire même. L’origine de cette grotte est inconnue. Son nom lui vient de ce que, d’après la tradition orientale que nous rappellerons plus loin, elle a renfermé le chef du premier homme. Ou ignore si elle avait déjà été transformée en chapelle avant le temps des Croisades. Mais, ce qui est certain, c’est qu’à cette époque, elle devint un oratoire funèbre dans lequel les Croisés placèrent eux-mêmes un autel où l’on célébra la Sainte Messe, pour les défunts, tout le temps que, la Grotte appartint aux Catholiques.
La première chose que le pèlerin voit en y entrant est l’emplacement des Tombeaux des deux premiers Rois Latins de Jérusalem, Godefroid, mort eu 1100, et Baudoin Ier, mort en 1118. Nous avons dit l’emplacement, car les mausolées en marbre blanc qui recouvraient leurs restes, ont disparu en 1808. Il en a été de même des tombeaux des autres rois de Jérusalem qui faisaient suite aux deux premiers en dehors de la Grotte. Les Grecs non-unis, disciples de Photius, profitant de la permission qu’ils avaient obtenue, à prix d’argent, de Constantinople, à l’effet de réparer les dégâts causés par l’incendie du 12 octobre 1808, les démolirent, voulant se débarrasser, autant que possible, de tout ce qui pouvait rappeler les Latins.
Deux bancs en pierre du pays, placés par les démolisseurs, de chaque côté de l’entrée de la Grotte font assez connaître la place qu’occupaient les tombeaux des deux premiers rois. Celui de Godefroid était à droite en entrant, et celui de Beaudoin, à gauche.
En avançant un peu dans l’intérieur de la Grotte, on fait remarquer l’emplacement d’un autre tombeau bien plus ancien et qui ne serait autre que le tombeau de Melchisédech, roi de Salem.
Or, d’après la tradition hébraïque, Melchisédech est le même personnage que Sem, fils premier né de Noé. Il vint, après la sortie de l’arche, à l’âge de 211 ans, fonder Salem qui devint plus tard Jérusalem. Il mourut à l’âge de 600 ans, et il aurait été enseveli en cet endroit là-même.
Enfin, au fond de la Chapelle, au milieu du mur ou plutôt de la paroi orientale, on remarque une excavation qui est le lieu où fut déposé le crâne d’Adam. Elle est aujourd’hui fermée par une porte en cuivre doré, ornée des armes de la Russie ; mais une ouverture pratiquée au centre de cette porte et couverte d’une petite grille en fil de laiton permet de plonger les regards à l’intérieur.
Voici maintenant, d’après le Fr. Liévin, le résumé de la tradition au sujet de la présence du crâne d’Adam, dans cette excavation, au moment de la mort de Notre-Seigneur :
Noé, avant d’entrer dans l’arche prit avec lui les restes mortels du premier homme et les garda religieusement pendant toute la durée du Déluge.
A la sortie de l’arche, il les partagea entre ses fils, comme le plus précieux héritage qu’il pût leur laisser.
Sem, ou Melchisédech, à qui le chef du père du genre humain fut dévolu, l’apporta avec lui quand il vint fonder la ville de Salem et la déposa dans cette excavation. Jusqu’à quelle époque y demeura-t-il ? On l’ignore ; mais, il n’en avait pas encore été retiré au moment de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ. A l’heure où le divin Sauveur rendit le dernier soupir, il se fit un tel tremblement de terre, d’après le témoignage de Pline lui-même, que de mémoire d’homme, rien ne s’était vu de semblable. Le choc fui si violent que les plus énormes rochers se fendirent. Le rocher du Calvaire, lui aussi, se déchira comme un morceau d’étoffe.
La fente se fit de haut en bas, dans la direction de l’Est à l’Ouest, ainsi qu’on peut le voir encore aujourd’hui, et traversa presque perpendiculairement l’angle Nord-Est de l’excavation où était le crâne d’Adam.
C’est par cette fente que le sang du divin Sauveur, d’après une tradition très ancienne, coula sur la première tête coupable.
Ce sentiment, qui semble extraordinaire, mais qui n’est pas inadmissible, a pour lui de très graves autorités, telles qu’Origène, Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Basile, Saint Epiphane etc. Il explique aussi la coutume de placer ordinairement un crâne au-dessous de l’image de Notre-Seigneur en croix.
Cette tradition se trouve surtout confirmée par l’existence au-dessous du Calvaire d’un sanctuaire nommé Chapelle d’Adam.
Ce qu’on remarque aujourd’hui surtout dans l’excavation dont nous venons de parler, c’est la fente du rocher qui se fit à la mort de Notre-Seigneur, et qu’on voit très distinctement à travers la grille.
†
Déjà, nous avons rappelé ailleurs les divers motifs qui nous ont fait penser qu’il convenait d’avoir aussi une Grotte d’Adam, au-dessous de notre Calvaire, comme à Jérusalem.
Tout d’abord, l’idée qu’avait eue le Bienheureux Père de Montfort lui-même, de rattacher le souvenir de la chute d’Adam, à celui de la Rédemption, en mettant, au pied de son Calvaire, sous les yeux des pèlerins, une image du Paradis Terrestre.
Puis, le désir de conserver le bas-relief que les pèlerins du Calvaire étaient habitués à voir et qui leur rappelait la même pensée.
En y ajoutant les souvenirs traditionnels que nous venons de transcrire pour nos lecteurs, nous ne doutons pas que désormais les pèlerins du Calvaire, s’arrêtant quelques instants dans le nouveau sanctuaire, qui va être bénit le 8 Septembre, n’y trouvent le sujet d’utiles réflexions, suivies d’une pieuse et fervente prière.
N° 1 Octobre 1895
Inauguration et Bénédiction de la Grotte d’Adam
La fête du 8 Septembre a donné ce qu’elle promettait.
Etaient représentées avec croix et bannières, conduites par leur clergé, les paroisses de Pont-Château, de Missillac, de Saint-Joachim, de Crossac et de Besné. La liste serait longue des autres paroisses qui étaient représentées seulement par un groupe de pèlerins plus ou moins nombreux.
Il faudrait nommer toutes celles qui sont inscrites sur le Livre d’or des travailleurs. Nous avions dit que ce devait être plus spécialement la fête des travailleurs volontaires. Aussi, avaient-ils répondu en grand nombre à cette invitation. On évaluait au moins à six mille personnes, la foule pieuse qui, le matin, entourait la Scala Sancta pour entendre la messe célébrée par M. le Curé-doyen de Pont-Château, et qui le soir environnait le Calvaire, au moment de la bénédiction de la Grotte d’Adam.
Rien ne manquait à l’éclat de la fête et de la procession en particulier. Les clairons de Missillac marchaient en tête, et vers le milieu, la musique instrumentale de Crossac soutenait très heureusement le chant des cantiques, dont les refrains étaient redits avec enthousiasme.
Il fallait là une parole capable de faire vibrer les sentiments qui étaient déjà, sans doute, dans tous les cœurs, et de les y graver plus profondément et d’une manière durable. Et, cette voix n’a point manqué.
Déjà, le matin, à l’Evangile de la messe, le Révérend Père Renaud, avait célébré les joies, les gloires, l’immense bienfait pour nous de la Nativité de la Très sainte Vierge. Il nous semblait entendre un écho de la voix du grand serviteur et panégyriste de Marie, Montfort lui-même, dont l’orateur rappelle ensuite les glorieux travaux, les bienfaits sans nombre répandus par lui dans les contrées qu’il a évangélisées, et tout particulièrement en ces lieux. Il ne nous l’eut pas dit, nous eussions deviné, en l’entendant, que le Révérend Père est de ceux qui dès leurs premières années, sur les genoux d’une mère vendéenne, ont appris à honorer, à aimer, à invoquer le bon Père de Montfort.
Dans l’après-midi, avant le départ de la grande procession qui devait précéder la bénédiction de la Grotte d’Adam, le Révérend Père Renaud prenait de nouveau la parole. Les yeux fixés sur le Calvaire, il retraça en traits rapides la grande scène qui s’est passée sur le Golgotha de Jérusalem, il y a plus de dix-huit cents ans. Puis il répond à ces trois questions qu’il s’est posées à lui-même: Pourquoi cette grotte d’Adam, sous le Calvaire ? Quel est son enseignement ? Que demande-t-elle ?
C’est avec une vive attention que l’auditoire entend l’exposé de l’antique tradition qui place la sépulture du premier homme, au lieu même où devait couler le sang du nouvel Adam.
Il est profondément ému des enseignements qui découlent du rapprochement de l’immense bienfait de la Rédemption et de la profondeur de la chute. Mais, ce dont nous ne saurions donner une idée c’est la chaleur communicative avec laquelle l’orateur développe la réponse à sa troisième question : « Ce qui est demandé, ici, de nous tous, c’est l’achèvement, le couronnement de cette grande œuvre conçue par Montfort, en l’honneur de Jésus crucifié, Dieu le veut ! Debout les Amis de la Croix ! » s’écria-t-il, et rien n’est oublié des souvenirs glorieux du passé et des éloges mérités dans le présent, pour allumer le feu sacré dans les âmes et les exciter au dévouement, à la générosité.
Que dirions-nous de plus ? Le zélé missionnaire doit être content. Sa parole a été entendue et comprise. Les habitants de Pontchâteau, en particulier, et d’autres encore y ont déjà répondu par de généreuses offrandes, et nous sommes assurés que les dévouements auxquels il a fait un appel si chaleureux, ne nous manqueront pas.
Vraiment belle, cette journée du huit Septembre, pleine de promesses et d’encouragements, pour ceux qui s’intéressent et se dévouent, à cette œuvre si chère au cœur du Bienheureux Montfort !
N° 2 Novembre 1895
Reprise des travaux du Calvaire
Nous ne comptions pas, il faut l’avouer, avoir à transcrire ce titre sur ce numéro de l’Ami de la Croix. Tous savent que pendant ce mois d’octobre, et parfois même dans les jours qui suivent la Toussaint, tous les bras sont occupés, à la campagne, pour confier à la terre la précieuse semence, qui, après avoir germé lentement dans les sillons, montera, après l’hiver, en épis et deviendra la moisson dorée.
Mais il est, dans nos environs, certaines paroisses qui n’ont pas, ou très peu du moins, cette préoccupation des semailles, et qui ont bien voulu devancer l’époque qui semblait naturellement fixée pour la reprise des travaux du Calvaire.
+
C’est la paroisse de Saint-Malo-de-Guersac, qui a eu l’honneur d’inaugurer cette nouvelle campagne, dès le mercredi 16 octobre. Il va sans dire que cette première journée a été pleine d’entrain, en dépit de quelques ondées qui n’ont fait qu’interrompre, pour quelques instants, le travail repris ensuite avec encore plus d’ardeur.
M. le Curé et son vicaire étaient présents.
+
La semaine suivante, les femmes de Saint-Joachim ont donné trois journées consécutives aux mêmes travaux.
Le mardi, celles du bourg, de Pandille et de Mazin.
Le mercredi, celles de la frairie de Fédrun.
Le jeudi, celles de la frairie d’Aignac.
Toutes ont donné une nouvelle preuve de leur dévouement bien connu pour l’Œuvre du bon Père de Montfort.
+
Aujourd’hui, mardi 29 octobre, ce sont les hommes de la même paroisse, du moins ceux qui ne sont pas occupés dans les chantiers. Tous excellents ouvriers, manœuvrant à merveille. Il suffit de jeter, ce soir, un regard du côté du Calvaire, pour constater que la tâche accomplie, dans cette journée, est considérable.
Signalons, dans la même journée, la visite très édifiante d’un certain nombre de jeunes conscrits, sortant de la retraite qui vient de leur être donnée au Prieuré de Pontchâteau. Le Bienheureux Montfort qui a aimé tout particulièrement les soldats pendant sa vie, les aidera certainement a gardé les bonnes résolutions qu’ils y ont prises.
N° 3 Décembre 1895
Travaux du Calvaire
… Mais si le mouvement des pèlerins qui viennent seulement pour la prière se ralentit, un autre mouvement, celui des pèlerins travailleurs, s’accentue et se dessine tous les jours, déplus en plus.
Il est un point que nous sommes heureux de faire ressortir tout d’abord. Ainsi que nous en émettions le vœu, eu annonçant les grands projets de l’année présente, le cercle des paroisses prenant part officiellement à nos travaux s’est agrandi. Et nous avons, dès aujourd’hui, à notre grande satisfaction, à inscrire plusieurs noms nouveaux. Ce n’est pas en vain que la voix du R. P. Directeur du pèlerinage s’est fait entendre à plusieurs populations qui ne connaissaient pas assez l’Œuvre du B. Montfort, le but poursuivi et les efforts faits en ce moment pour donner à cette œuvre son complet épanouissement. Dès qu’elles ont su et bien compris qu’il s’agissait de reprendre, de compléter et d’achever une œuvre à laquelle leurs pères avaient autrefois travaillé sous la conduite du grand missionnaire de la contrée, ces excellentes populations n’ont pas hésité à venir y prendre part, malgré la distance, malgré les obstacles.
De ce nombre, est la première paroisse inscrite sur le Livre d’or des travailleurs, parmi celles que nous avons à mentionner aujourd’hui.
+
Le Mercredi 13 novembre. — L’Immaculée-Conception de Saint-Nazaire, paroisse de création récente, érigée deux ans seulement après la proclamation du dogme auquel elle emprunte son beau nom. Certes, là, en particulier, les obstacles, les difficultés ne manquaient pas. La distance du Calvaire est de sept lieues. Il fallait trouver nécessairement des véhicules pour transporter les travailleurs, et journellement, charrettes et chars-à-bancs sont employés à conduire diverses denrées à la ville voisine. Le zèle du bon Curé, la bonne volonté de ses paroissiens ont trouvé moyen d’aplanir tous ces obstacles. Et c’était vraiment une belle escouade de travailleurs que nous avions ici ce jour-là. Leur ardeur pendant toute la journée faisait plaisir avoir. Et, le soir, la fatigue ne leur avait rien ôté de leur gaieté. Tous, en partant, semblaient dire au Calvaire un joyeux au revoir !
+
Le jeudi 14 novembre. Paroisse de Drefféac. — Nous avons dit plus haut, que les bons habitants de Drefféac, en accomplissant leur pèlerinage annuel au Calvaire, avaient pris la résolution de venir bientôt mettre la main aux travaux déjà repris. Ce sont les femmes qui ont tenu parole, les premières. Elles sont présentes, au moins, une centaine. Pendant la nuit, la pluie a grandement détrempé le sol. Elles n’en accomplissent qu’avec plus de courage, et plus de mérite aussi, une tâche considérable.
+
Le vendredi 15 novembre. Paroisse de Besné. — M. l’abbé Babin, vicaire, vient, dès le matin, avec un certain nombre d’hommes et de jeunes gens du bourg. Ils ont à lutter contre la même difficulté que la veille : un terrain détrempé par la pluie. M. le Curé qui avait été retenu par des malades, apparaît au milieu du jour ; et sa présence ne contribue pas peu à réchauffer tous les courages. La soirée est employée surtout à hisser un bloc de pierre qui trouve sa place dans l’énorme contrefort que l’on construit en ce moment, au chevet de l’ancienne chapelle du Calvaire.
+
Le lundi 18 novembre. Paroisse de Savenay. — L’ancienne cité de Savenay, bien que découronnée de son titre de sous-préfecture, n’en est pas moins toujours regardée, comme la petite capitale de la Contrée. Il convenait bien qu’elle fût représentée à nos travaux du Calvaire. Et, de fait, Savenay a répondu admirablement au premier appel qui lui a été adressé. Vraiment, les deux Messieurs Vicaires, représentant M. le Doyen, avaient le droit d’être fiers, à la tête de ces cent vingt hommes, tous de bonne volonté et excellents travailleurs. Nous avons remarqué aussi leur chant plein de vie et d’ensemble au salut du Très Saint-Sacrement, donné par M. Laur, premier vicaire.
N’oublions pas de mentionner un bon missionnaire, curé à la Guadeloupe, en congé temporaire à Savenay, et qui a pris une part active au travail de cette journée.
Un groupe de l’orphelinat agricole de La Moëre, en Savenay, mérite aussi d’être mentionné très honorablement.
+
Le mardi 19 novembre. Paroisse de Lavau. — Encore un nom nouveau à inscrire sur le Livre d’or des travailleurs. Lavau est une petite paroisse, située sur les bords de la Loire. Le bon Curé, très dévoué au culte du Bienheureux Montfort, attendait qu’une voix vint rappeler à ses paroissiens qu’eux aussi étaient de ceux dont les ancêtres avaient connu le grand missionnaire et travaillé avec lui à son Calvaire. A peine cette voix s’est-elle fait entendre dans l’église de Lavau, que la résolution de répondre à son appel a été prise aussitôt. Ce n’était pas sans doute, une troupe très nombreuse, qui suivait son pasteur, le 19 novembre au Calvaire, la paroisse est petite, nous l’avons dit, et la distance est grande. Mais c’était une troupe d’élite, une avant-garde de vaillants, que d’autres voudront suivre bientôt.
+
Le mercredi 20 novembre. Paroisse de Crossac. — Nous voyons reparaître aujourd’hui nos amis et voisins, toujours dévoués des villages de Quémené, de la Brionnière et de la Pelletraie. Ce sont les villages de la paroisse de Crossac, les plus rapprochés du Calvaire. Les autres, également dévoués, viendront à leur tour ajouter au chiffre déjà considérable des bonnes et laborieuses journées fournies par cette excellente paroisse aux travaux du Calvaire.
+
Le jeudi 21 novembre. Paroisse de Montoir. — Voilà bien de vrais travailleurs volontaires, qui s’invitent eux-mêmes, s’organisent eux-mêmes, et le contentent de faire savoir : Nous nous rendrons tel jour. Ils semblent toutefois reconnaître un chef, très digne, du reste, d’être à leur tête.
On nous assure qu’à la fin de la journée si bien employée du 21 novembre, ils ont fixé le jour où ils pensent revenir plus nombreux encore.
+
Le vendredi 22 novembre. Paroisse de Drefféac. — C’est la dernière journée que nous avons à enregistrer pour cette fois. On devine que ce sont les hommes de Drefféac qui ont tenu à ne pas retarder, eux aussi, la promesse faite à l’occasion de leur pèlerinage du mois dernier. Ils ont travaillé avec la bonne volonté et le courage ordinaires.
Mais il convient de mentionner, dans cette journée, la présence de cinq charrettes attelées fournies par les fermiers des Métairies et de la Viotterie, tout voisins du Calvaire. Tandis que les uns allaient à une certaine distance charger les pierres sur ces charrettes, qui les amenaient au pied de la colline, les autres les hissaient jusqu’au sommet, OÙ elles étaient immédiatement mises en place. La journée a donc été très profitable pour l’avancement des travaux.
Nous ne sommes qu’au début ; mais la bonne volonté et le courage sont tels, qu’ils ne peuvent manquer de venir à bout de tout.
Pour les Statues du Calvaire et de la Voie douloureuse
Nos lecteurs viennent de voir avec quelle ardeur est commencée et se poursuit notre nouvelle campagne de travaux pour le Calvaire. Bien que la tâche qu’on s’est imposée pour cette année soit immense, tout fait espérer qu’elle sera remplie au moment voulu. La sainte colline exhaussée encore, et élargie à son sommet, sera prête à recevoir son magnifique couronnement de statues représentant les quatre grandes scènes qui se sont passées sur le Golgotha de Jérusalem : Jésus dépouillé de ses vêtements, Jésus attaché à la Croix, Jésus mourant sur la Croix, le corps de Jésus descendu de la Croix et remis entre les bras de sa Sainte Mère.
En ce moment, des artistes étudient avec tout le soin possible, ces différents groupes ; et nous avons tout lieu de penser que rien ne sera négligé pour répondre à l’attente de tous ceux qui s’intéressent à une Œuvre si grande et si belle.
Nous n’avons pas besoin de redire ici que les frais aussi seront considérables, et que pour les couvrir, nous comptons sur la générosité de tous. Tous le savent et nous avons l’assurance qu’ils ne le mettent pas en oubli.
Nous sommes heureux d’avoir, dès aujourd’hui, à témoigner notre reconnaissance à ceux qui les premiers ont bien voulu s’inscrire comme bienfaiteurs de l’Œuvre. Certes, ils sont déjà nombreux !
Au premier appel, de généreux donateurs se sont inscrits pour l’offrande d’une des statues du Calvaire ou de notre Voie douloureuse. En même temps s’ouvrait dans plusieurs paroisses une souscription, ayant le même but d’offrir une statue au Calvaire. D’autres paroisses se préparent à imiter leur exemple.
Nous n’avons pas besoin de dire que les listes de souscription sont ouvertes aux plus humbles offrandes, qui souvent peuvent être les plus méritoires devant Dieu.
Nous donnons, aujourd’hui, les premiers et très encourageants résultats d’un élan de générosité qui nous permet d’espérer, dans un bref délai, l’achèvement complet de notre Voie douloureuse.
+
Mentionnons, tout d’abord, les dons suivants :
+
1° M. Jean Desbois et Mlle Reine Desbois, de la Haute-Haie, en Crossac, ont fait don d’une des statues de la VII° station, en leur nom et au nom de leurs frère et sœur défunts Julien Desbois cl Marie Desbois, tertiaire de Saint-François.
+
2° M. le comte A. de la Villeboisnet, au château du Deffais, a souscrit pour une statue du Calvaire.
+
3° Anonyme : Une somme de mille francs pour, les statues du Calvaire.
+
N° 4 Janvier 1896
Travaux du Calvaire
Malgré les intempéries de la saison, des pluies fréquentes, ces travaux poussés avec une ardeur au-dessus de tout éloge, ont fait de notables progrès dans ce mois de décembre. On a construit du côté est, un énorme, contrefort en blocs de rochers pour garantir contre tout éboulement l’ancienne chapelle et aussi pour soutenir la voie que suivent en quelques circonstances les processions.
Et puis, nous avons eu, au moins pendant quelques jours, la présence de M. Gerbaud, et l’on en a profité pour marquer définitivement les limites de la plate-forme du Calvaire, l’emplacement des croix, etc., d’après le plan tracé par lui et approuvé de tous. Tous les efforts vont se tourner maintenant de ce côté, et malgré la grandeur de la tâche, tout fait espérer son achèvement complet, eu temps voulu.
Nous avons à signaler aujourd’hui des dévouements admirables de la part de travailleurs que nous ne connaissions pas encore, venus pour la première fois au Calvaire. Les autres voudront bien nous permettre d’enregistrer seulement leur présence, au jour marqué :
+
Le lundi 25 novembre : Ce sont les hommes de Sainte-Beine qui reprennent les travaux. Et c’est déjà la septième journée que cette paroisse donne au Calvaire.
+
Le mardi 26 novembre : Les vaillants de Besné sous la conduite de leur vaillant chef.
+
Le mercredi 27 novembre : Les femmes de la Chapelle-des-Marais. Plusieurs partaient dès cinq heures du matin, pour donner une journée plus complète.
+
Le jeudi 28 novembre : Un petit groupe d’hommes de Prinquiau, pleins d’ardeur et de bonne volonté, ayant à leur tête M. J.-M. Roussel.
+
Le vendredi 29 novembre : C’est la huitième journée que donne au Calvaire l’excellente paroisse de Drefféac. Le travail était d’autant plus méritoire ce jour-là, que le terrain était fort détrempé par la pluie.
+
Le lundi 2 décembre. — Monsieur le Curé de la Chapelle-Launay a le droit d’être fier de la belle compagnie de travailleurs, au milieu de laquelle il est resté toute cette journée.
+
Le mardi 3 décembre. — Les hommes de Saint-Roch ont donné, ce jour-là, une nouvelle preuve de leur dévouement traditionnel au bon Père de Montfort.
+
Le mercredi 4 décembre. — Nous saluons avec bonheur les braves travailleurs de Saint-Lyphard. Nous n’avons pas oublié que dès le début de nos travaux, ils ont été des ouvriers de la première heure. Leur adresse à extraire et à manier la pierre est connue. Ils l’ont bien montré ce jour-là.
+
Le jeudi 5 décembre. — Aujourd’hui, on peut vraiment dire que tout Crossac est là, tant sont nombreux les travailleurs. Aussi quel bloc énorme de pierre traîné par tous ces bras vigoureux, nous voyons monter jusqu’au sommet du Calvaire !
+
Le vendredi 6 décembre. — Les hommes de la Chapelle-des-Marais, peut-être un peu moins nombreux que ceux de la veille, ont d’après le Livre d’or, accompli ce jour-là, un travail prodigieux.
+
Le lundi 9 décembre. — Malville, nom nouveau. C’est une avant-garde d’élite venue sous la conduite du Pasteur et de son vicaire, qui, eux-mêmes, ont pris part aux travaux de la journée. Tous, en partant très joyeux, nous donnent l’assurance qu’ils reviendront nombreux, bien plus nombreux.
+
Le mardi 10 décembre. — Les ferventes chrétiennes de Saint-Joachim avaient hâte de témoigner au bon Père de Montfort leur reconnaissance, pour les grâces de la Mission, en prenant pour lui la pioche et la pelle à la main. Elles montrent dans Cette journée leur foi, leur dévouement, leur ardeur ordinaires.
+
Le mercredi 11 décembre. — Nous n’avons qu’à répéter la note précédente. Ce sont encore les femmes de la paroisse de Saint-Joachim, mais plus nombreuses encore que la veille, et animées des mêmes sentiments.
+
Le jeudi 12 décembre. — Les Campbonnais se montrent, une fois de plus, dignes de leur réputation. Leur vénérable Pasteur, M. l’abbé Halgan, chanoine honoraire, passe la journée entière au milieu de ses travailleurs.
+
Le vendredi 13 décembre. — Une circonstance spéciale n’a pas permis aux bons habitants de Saint-Dolay de venir aussi nombreux qu’ils l’avaient pensé. Mais, ce n’est que partie remise. Et ceux qui étaient présents ont suppléé au nombre par leur activité et leur courage.
+
Le lundi 16 décembre. — Ce sont les hommes du village de Bergon, que nous avons déjà vus plus d’une fois à l’œuvre, et qui nous reviennent toujours avec la même bonne volonté, le même dévouement.
+
Le mardi 17 décembre. — Vay ! Le clocher de Vay est à dix lieues du Calvaire, et le matin, la pluie menace. Les routes sont tellement mauvaises qu’il ne paraît pas possible d’aller en chars-à-bancs. Il y a le chemin de fer. La compagnie de l’Ouest n’est pas généreuse pour accorder des remises. Ces braves gens paient leur billet d’aller et retour, quatre francs, pour venir donner leur journée de travail, au Calvaire. N’est-ce pas admirable de générosité et de dévouement ? Puis, quelle ardeur à la besogne, pendant toute la journée ! Ajoutons ce que les travailleurs disaient eux-mêmes tout haut, le soir, que nul n’avait mieux payé de sa personne que leur excellent vicaire. Nous reverrons les bons paroissiens de Vay.
+
Le jeudi 19 décembre. — C’est une seconde section de la paroisse de Campbon, qui vient à huit jours de distance, conduite par M. l’abbé Warron, vicaire. Les travailleurs d’aujourd’hui sont dignes de leurs devanciers.
+
Le vendredi 20 décembre. — Nos voisins de Saint-Guillaume ! Leur dévouement est toujours le même. M. le Curé et M. l’abbé Marchand prennent part aux travaux.
+
Il y a temps d’arrêt, pendant toute la semaine de Noël ; mais les convocations sont déjà faites pour le lundi 31 décembre, et pour les jours suivants.
Pour les Statues
du Calvaire et de la Voie douloureuse.
Une maison généreuse, qui désire garder l’anonyme, a souscrit pour le paiement d’une statue.
+
N°5 Février 1896
Travaux du Calvaire
Le mois de janvier dont on avait voulu faire, il y a cent ans, le mois de Nivôse, ne nous a pas donné de neige, cette année, du moins sur notre lande de la Madeleine. Aussi, les travaux ont-ils marché sans interruption. Il a été fait beaucoup de besogne, mais, de l’avis de tous, il reste encore beaucoup plus à faire. Après la quantité énorme de pierres et de terre, montée à force de bras, pour former le chevet du Calvaire, on est bien loin d’atteindre la hauteur fixée pour la plate-forme, sur laquelle seront disposées les différentes scènes.
En voyant les efforts faits aujourd’hui, pour la transformation de notre colline, on comprend mieux ce qu’il a dû en coûter jadis à notre Père de Montfort, pour la créer de toute pièce.
Heureusement que rien n’est capable d’ébranler ou même d’affaiblir le courage de ceux qui travaillent à cette œuvre. La bonne volonté et le dévouement des travailleurs volontaires, qui nous viennent continuellement de toutes les paroisses plus ou moins rapprochées, et dont le cercle, ainsi que nous l’avons déjà dit, va toujours s’élargissant, cette bonne volonté, ce dévouement sont admirables et au-dessus de tout éloge. Mais que dire du courage et de la constance de ceux qui, tous les jours, sont en avant sur la brèche ? On nous permettra bien, en passant, cette allusion discrète à la dépense de forces et de dévouement que font, chaque jour, le R. P. Directeur du pèlerinage, et son jeune lieutenant le P. Sarré.
Il faut bien le dire aussi, les encouragements viennent de partout et quelquefois de haut. C’est ainsi qu’on pouvait voir, il y a quelques jours, M. le général du Guiny, qui commandait encore, il y a deux ans à peine, le 3e Corps de l’armée française à Rouen, prendre bravement la tête de file, et tirer à la chaîne, pour monter au sommet un énorme bloc de pierre. Non moins fier, et il en avait bien le droit, ce nous semble, que quand il avait sous ses ordres trente mille hommes. Nous entendons encore l’accent joyeux avec lequel, dans un moment de repos, après le frugal déjeuner, il nous disait, en nous la montrant de la main : « C’est celle-là, mon Père, cette grosse pierre plus notre que les autres, que nous avons monté ce matin. » Aujourd’hui, maire de Prinquiau, il avait tenu à venir avec le vénérable Pasteur de la paroisse à la tête de ses administrés.
Faut-il rappeler que la piété a toujours sa bonne part dans ces laborieuses journées. Le chant des cantiques prélude toujours au travail, et en marque aussi la suspension. C’est toujours aussi avec élan, que vers le milieu du jour, retentissent au loin, du haut du Calvaire, les acclamations à Jésus, à la Croix, au B. Père de Montfort. Puis, avant le départ, la bénédiction du Très Saint-Sacrement, et la vénération des reliques du Bienheureux.
Avec cela enfin, toujours beaucoup d’entrain et de franche gaîté, malgré la fatigue, malgré la longueur de la route. On l’abrège en chantant un air de marche : et il se trouve toujours quelque improvisateur, qui, sans trop souci de la rime, sait y adapter des paroles de circonstance. C’est ainsi que la semaine dernière, les braves travailleurs de Sévérac, annonçaient à l’avance, leur arrivée ici, par ce refrain :
Allons, amis, marchons bon train,
Car le Calvaire est encore loin.
Au départ le refrain était un peu différent.
Allons, amis, marchons bon train,
Car le Calvaire n’est pas loin
Cinq grandes lieues à faire à pied, et le retour, le soir, après une journée de fatigue !
Mais, il nous faut, maintenant, selon l’usage, donner une courte mention, à chacune des paroisses, qui ont pris part aux travaux, depuis la clôture de notre dernière chronique :
+
Le lundi 30 décembre, c’est la troisième frairie de Campbon, sous la conduite de M. l’abbé Appert, vicaire. C’est sur le territoire de celte frairie, que se trouve le florissant orphelinat agricole de la Ducheraie. M. l’abbé Fonteneau, directeur de cet établissement, avait amené ses plus grands jeunes gens. Quels bons travailleurs, dès maintenant ; et quels bons agriculteurs ils seront plus tard, après avoir été à si bonne école ! L’excellent Directeur, comme toujours, sans doute, ne se contentait pas de commander, mais payait largement de sa personne. Quant aux Campbonnais, leur éloge n’est plus à faire. Ils étaient nombreux, et cette journée compte certainement parmi les meilleures de cette campagne.
+
Le mardi 31 décembre : A nos plus proches voisins, les bons habitants de Saint-Guillaume, était réservé l’honneur de clôturer l’année 1895. Ils eussent été plus nombreux sans le mauvais temps.
+
Le jeudi et le vendredi 2 et 3 janvier : A la paroisse de Pontchâteau de marcher en avant, au commencement de cette année 1896 : Elle l’a fait vaillamment en nous donnant ces deux excellentes journées. Nous relevons parmi les signatures des travailleurs celle d’un bon vieillard de 80 ans, sabotier à Pontchâteau, qui, bien jeune alors, avait déjà mis la main aux travaux de restauration du Calvaire, exécutés par M. Gouray en 1821.
M. le Curé de Pontchâteau est venu encourager les travailleurs. Il était accompagné de M. l’abbé Massé, vicaire, de M. l’abbé Béziers, professeur à Saint-Stanislas de Nantes. Le second jour, c’est M. l’abbé Vaillant, aumônier du château de Casso, qui a donné le salut.
+
Le lundi 6 janvier : Un groupe de ces braves ouvriers de Saint-Joachim, qui nous ont tant édifiés, à la clôture de leur mission, lorsqu’au nombre de douze cents, ils acclamaient le Christ sur notre lande. Ils sont moins nombreux aujourd’hui, mais tous remplis d’ardeur et de courage.
+
Le mardi et le jeudi 7 et 9 janvier : Ces deux journées étaient réservées à la paroisse de Sainte-Anne de Campbon. La première a été excellente, les travailleurs étaient en nombre et pleins d’entrain. La seconde n’a fourni qu’un groupe peu nombreux. Il faut ajouter que ce jour-là, le froid était, ici, très intense.
+
Le mercredi et le vendredi 8 et 10 janvier. —Nous pouvons répéter, en l’appliquant à Missillac, la même note que nous venons de donner à Sainte-Anne de Campbon. Première journée excellente. La seconde, travailleurs peu nombreux, pour le même motif, sans doute.
+
Le lundi 13 janvier. — Il était décidé, en principe, que les femmes ne devaient prendre que plus tard dans la saison, part à des travaux plus faciles que ceux exécutés, on ce moment. Aussi n’est-ce qu’en cédant à leurs instances réitérées, que le Père Directeur du Pèlerinage avait fixé cette journée aux femmes de la Chapelle-des-Marais. Toutefois, un groupe d’hommes de Crossac avait été convoqué, en même temps. Pendant que ceux-ci extrayaient les blocs de pierre de la carrière, les vaillantes chrétiennes de la Chapelle-des-Marais, les montaient au sommet de la colline; et à la fin de la journée, se trouvait accomplie une tâche très considérable.
+
Les mardi, mercredi et vendredi 14, 15 et 11 janvier. — Trois journées dans la même semaine données par la si chrétienne paroisse de Sévérac. Ce sont ces braves dont nous parlons plus haut et qui, ayant cinq et même six lieues à faire à pied, pour venir ici, chantaient si bien :
Allons, marchons bon train,
Car le Calvaire n’est pas loin.
Les trois journées ont été assurément fort bien remplies ; mais le bon Curé de Sévérac ayant appris qu’un jour, en particulier, plusieurs avaient été retenus par une foire qui avait lieu dans le voisinage, a décidé qu’une journée supplémentaire serait fixée pour tous ceux qui auraient été empêchés pour une raison ou pour une autre.
+
Le jeudi 16 janvier. — C’est la paroisse de Saint-Gildas qui tient à garder ses traditions de fidélité et de dévouement au Calvaire. Si nous n’avons pas le plaisir de recevoir aujourd’hui M. le doyen, ni son vicaire, les bons Frères de la Doctrine chrétienne sont là, donnant comme à l’ordinaire l’exemple du travail, à tous.
+
Le mardi et le vendredi 21 et 24 janvier. — Deux journées données au Calvaire par la paroisse d’Herbignac. Le premier jour, travailleurs très actifs, mais peu nombreux. L’un d’eux en exprime son regret, sur notre Livre d’or. Mais quelle belle revanche savent prendre les paroissiens d’Herbignac le vendredi 24. Ce jour-là, ils forment un beau bataillon ayant à leur tête, MM. de la Monneraye, C. de la Chevasnerie, F. et R. de Kérobert.
+
Le mercredi 22 janvier. — Paroisse d’Assérac, qui a pour limite une longue côte de l’Océan. Le bon Curé avait tenu à accompagner ses paroissiens. Il connaît de longue date leur bon esprit et leur générosité, mais il paraissait heureux de voir qu’ils avaient si bien répondu à l’appel qui leur avait été fait.
+
Le jeudi 23 janvier. — Paroisse de Prinquiau. Nous avons déjà fait mention de cette journée en signalant la présence de M. le général du Guiny. Inutile d’ajouter que c’a été une de nos belles journées et des mieux remplies.
+
Le lundi 27 janvier. — Paroisse de Crossac. Que dire des bons habitants de Crossac qui sont venus aujourd’hui, pour la vingtième fois prêter le concours de leurs bras aux travaux du Calvaire. C’est toujours la même bonne volonté, le même esprit de foi, le même désir de conserver les faveurs et la protection du Bienheureux Montfort. M. le Curé qui ne manque aucune occasion de montrer l’intérêt qu’il porte à l’Œuvre du Calvaire était présent, et a donné, le soir, le salut du Très Saint Sacrement.
Jérusalem en Bretagne
M. le baron Gaëtan de Wismes, le sympathique bibliothécaire de la Société d’Archéologie, vient de mettre sa plume d’érudit et de littérateur au service du Calvaire de Pontchâteau.
Sous le titre de Jérusalem en Bretagne, il a fait paraître un intéressant opuscule que l’on vend au profit de l’Œuvre du B. Père de Montfort.
Après avoir salué la Croix, dans un préambule plein de foi, comme l’ornement de tous nos sites bretons, l’auteur si goûté des articles intitulés : Nos fêtes chrétiennes, peint à grands traits tous les travaux du vaillant apôtre de la Croix et du Rosaire pour construire le gigantesque Calvaire de Pontchâteau, le zèle infatigable de ces foules accourues à sa voix pour travailler sous ses ordres à la gloire du Divin Rédempteur, et enfin, hélas ! le douloureux dénouement de ce drame émouvant !
Mais l’heure du triomphe prédite par le saint missionnaire a sonné dans la dernière moitié de notre siècle. Un de ses fils les plus dévoués, le R. Père Barré, docile aux inspirations du Ciel, est parvenu à donner à l’idée de son B. Père une magnifique réalisation. M. de Wismes nous raconte un pèlerinage qu’il a fait au Calvaire de Pontchâteau, il se croit à Jérusalem. Avec lui nous visitons la chapelle de N.-D. de Pitié, due à la munificence d’un de nos évêques les plus populaires et les plus regrettés, Mgr Fournier ; la Grotte de Gethsémani, pour la construction de laquelle se sont accomplis des prodiges d’habileté et de dévouement ; le torrent du Cédron, si pittoresque avec ses rochers sauvages ; la Scala Sancta, où le talent de M. Vallet a rendu si vivante la scène de la Flagellation. Suivons la Voie douloureuse et arrivons au Calvaire, d’où la vue s’étend sur 32 clochers.
Puisse l’œuvre du B. de Montfort rayonner au loin ; et avec elle l’amour de N.-S.J.-C. qu’elle prêche si éloquemment.
Telles sont, en résumé, les pages pleines d’intérêt pour l’esprit, d’édification pour le cœur. Tous voudront les lire et envoyer au R. P. Barré l’offrande qu’il demande pour l’achèvement de son Calvaire.
H. Pincé, chanoine.
N° 6 Mars 1896
Travaux du Calvaire
Travaillons tous à ce divin ouvrage
Dieu nous bénira tous
Grands et petits, de tout sexe et tout âge.
Montfort peut voir, du haut du ciel, comment cette invitation qu’il faisait entendre, il y a deux cents ans, sur notre lande, y est encore accueillie. C’est avec le même empressement que tous, grands et petits, y répondent.
Aujourd’hui samedi, jour de chômage habituellement, nous voyons, de notre fenêtre, qu’il y a du mouvement du côté du Calvaire, beaucoup de mouvement même.
Ce sont des petits plutôt que des grands. Mais, qu’ils paraissent intrépides à la besogne ! Ce sont, à n’en plus douter, les enfants de l’Ecole apostolique. Nous les savions occupés, pendant toute cette semaine, par de longues séances d’examen, ce qui ne laisse pas d’être pour tous, maîtres et élèves, l’occasion d’une tension pénible. Evidemment, il s’agit de se détendre un peu les nerfs ; les examens sont finis. Et sans en être informé, nous pourrions affirmer que ces examens ont été satisfaisants. Car la faveur accordée aujourd’hui, nous le savons, est prisée, estimée plus que n’importe quelle promenade, n’importe quel congé. Aussi, s’en donnent-ils à cœur-joie, les braves enfants !
Les wagonnets se chargent, se déchargent, montent, descendent avec une rapidité, et, il faut le dire aussi, avec une régularité peu communes. On s’anime, on s’interpelle joyeusement. Il paraît bien que les plus jeunes ne veulent le céder en rien à leurs aînés. Du reste, chacun est au poste qui lui a été assigné, conducteur de train, chef d’équipe, aiguilleur, chargeur. Aussi le remblai auquel on travaille, avance-t-il, à vue d’œil, sur le flanc de la colline.
A voir la bonne volonté et l’ardeur de ces jeunes enfants, on sent bien qu’ils entendent la voix du Père : Travaillons tous à ce divin ouvrage, et qu’ils veulent être tous du nombre de ceux dont il disait : Dieu nous bénira tous ; et qu’ils ont même l’ambition d’être des privilégiés parmi ces bénis.
Ils le seront, nous en avons bien la confiance : Bénis, dans leurs travaux de fin d’année, bénis dans tout le cours de leurs études, bénis quand ils auront le bonheur de faire définitivement partie de la famille de Montfort, bénis surtout, quand ils seront devenus apôtres, allant, comme leur Père, prêcher partout la Croix et le Rosaire, Jésus crucifié et Marie, sa divine mère.
+
Et, maintenant, essayons de rendre hommage à ceux qui, de l’extérieur, ne cessent pas de venir au Calvaire prêter le concours de leurs bras.
Au cours de ce mois, une nouvelle paroisse est encore entrée dans le mouvement. Elle mérite à tous égards, d’être particulièrement signalée.
Qui ne connaît, au moins de nom, la grande forêt du Gâvre, célèbre par les exploits cynégétiques qui s’y accomplissent chaque année, et à laquelle se rattache plus d’un souvenir historique. A l’entrée de la forêt, près de l’emplacement de l’ancien château féodal, autrefois propriété des ducs de Bretagne, et qu’habita quelque temps la B. Françoise d’Amboise, apparaît aujourd’hui une coquette petite ville qui porte aussi le nom du Gâvre. La population presque toute entière est composée d’ouvriers. Malgré la distance qui est d’au moins dix lieues, le R. P. Directeur du Pèlerinage qui savait que le nom du Père de Montfort est connu, invoqué parmi eux, ne craignit point d’aller leur faire entendre son appel. Ils y ont répondu d’une manière admirable. Il n’y avait qu’un moyen : prendre le chemin de fer. Ces bons ouvriers, au nombre de près d’une centaine, n’ont pas hésité à sacrifier, en même temps, deux journées, puisqu’en venant en donner une au Calvaire, ils devaient verser le prix d’une autre, pour avoir leur place au chemin de fer.
Ici, rien ne saurait exprimer leur bonne volonté, leur activité, ainsi que leur contentement et leur joie. Eux seuls exprimaient bien ces sentiments, lorsqu’à la fin de la tournée, en descendant du Calvaire, ils chantaient tous ensemble le cantique : Bénissons à jamais…
Leur digne pasteur avait tenu sa place au chantier, pendant tout le jour, donnant l’exemple à tous. De plus, malgré des instances réitérées, il ne voulut prendre son repas, qu’au milieu de ses chers ouvriers, et un repas en tout aussi frugal que le leur.
Ajoutons que M. le Maire du Gâvre n’ayant pu venir lui-même, avait envoyé quelqu’un pour le représenter.
+
Il nous reste à mentionner à leur jour, les autres paroisses, dont le dévouement, l’activité sont déjà connus, et qui ne se lassent pas d’en donner de nouvelles preuves.
+
Le mercredi 29 janvier : Journée supplémentaire pour les hommes de Sévérac qui n’avaient pu venir la semaine précédente. Ils sont renforcés par les bons habitants du village de Cusia en Sainte Reine.
+
Le jeudi 30 janvier : Ce sont les femmes de Besné, toujours aussi matinales et aussi actives. M. le Curé et M. le vicaire sont là.
+
Le vendredi 31 janvier : Paroisse de Nivillac. Beau groupe d’hommes sous la conduite de M. le Recteur.
Le mardi 4 février : Les généreuses femmes de Crossac. C’est si nous ne nous trompons la vingt et unième journée donnée au Calvaire par la même paroisse.
+
Le mercredi 5 février : Ce sont les hommes de Sainte-Reine. Cette paroisse en est à sa huitième journée.
+
Le jeudi 6 février : Journée vraiment remarquable donnée par les paroissiens de Bouvron qui sont nombreux et si bien dirigés, disons mieux, entraînés par l’exemple de leurs deux infatigables vicaires, M. l’abbé Lucas et M. l’abbé Jambu.
+
Le vendredi 7 février : Les hommes de Saint-Guillaume, venus déjà si souvent et toujours aussi dévoués.
+
Le lundi 10 février : Nous avons déjà rendu compte de cette belle journée. C’est la journée du Gâvre.
+
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 11, 12, 13 et 14 février : Ces quatre journées sont données successivement par les femmes de Drefféac, de Bergon en Missillac, de Saint-Roch et de Sainte-Reine. C’est toujours le même esprit de foi, la même activité, le même dévouement.
+
Le lundi 17 février : M. le Curé de La Chapelle-Launay, retenu à son grand regret a confié ses travailleurs à son bon vicaire. Plusieurs de ces braves gens ont dû faire le sacrifice de quelque intérêt, en manquant la grande foire de Pontchâteau. Et ils traversaient la ville pour venir ici ! La générosité ne fait pas défaut à La Chapelle-Launay.
+
Le mardi 18 février : Impossible de ne pas faire ressortir le mérite tout particulier des travailleurs de cette journée. C’est le mardi-gras, ne l’oubliez pas. Et voilà des hommes auxquels, hélas ! n’est pas toujours accordé le repos du dimanche, parce qu’ils travaillent dans les chantiers de Saint-Nazaire. Aujourd’hui, le chômage est forcé puisque les ateliers sont fermés. Quel esprit de foi ne faut-il pas leur supposer, pour qu’ils viennent, ici, donner cette journée à Dieu, au bon Père de Montfort ! Et, c’est ce qu’ont fait un bon nombre de ces braves de La Chapelle des Marais. Et ils l’ont fait généreusement, joyeusement, gaiement. Car la joie et la gaîté ne manquaient pas ici. Un bon ancien me faisait cette remarque, en entendant chanter les jeunes : « Il y a de la joie et de la gaîté, ici, mon Père, mais quelle différence avec ce qui se passe ailleurs ! »
+
Le mercredi des Cendres, 19 février : Après la pieuse et grave cérémonie du matin, les femmes de la ville et de la campagne de Pontchâteau, ont commencé le travail allègrement, courageusement et l’ont continué de même jusqu’au soir. Acclamations enthousiastes, du sommet du Calvaire à Jésus-Christ, à la Croix, au Père de Montfort. Dans l’après-midi, M. le Curé de Pontchâteau, et plusieurs autres ecclésiastiques, notamment le B. P. Marchal, un des chapelains de la Basilique de Jeanne d’Arc à Domrémy, ont visité le chantier et encouragé les travailleuses.
+
Le jeudi 20 février : Journée pluvieuse. Les bons habitants de Drefféac n’en ont que plus de mérite d’être venus, bien que le temps fût menaçant, dès le matin. A la moindre éclaircie, ils se mettent à l’ouvrage, et travaillent même sous la pluie.
+
Le vendredi 21 février : Belle journée, le soleil a reparu. Les bons habitants de Bergon toujours si actifs en profitent admirablement.
N° 7 Avril 1896
Les travaux du Calvaire
Dans ce mois, nous avons à enregistrer bien des noms nouveaux, des paroisses qui nous sont venues, pour la première fois, la plupart de très loin, et dont le dévouement ne saurait être assez loué.
Première Semaine de Carême.
Le mardi, 25 février. — Voici les braves bretons d’au-delà de la Vilaine qui s’ébranlent. D’autres les suivront bientôt. Jusqu’à présent les jours étaient trop courts, pour venir de si loin. Aujourd’hui, ils viennent de Péaule et de Marzan. Chacune des paroisses avait son jour différent assigné ; mais par un malentendu qu’on ne peut regretter, elles se trouvent réunies et fraternisent admirablement. Les travailleurs sont au nombre de deux cents environ. Avec une telle force, que ne ferait-on pas?
Depuis assez longtemps un bloc de pierre énorme gisait en bas, au milieu de la carrière. Plusieurs se demandaient s’il ne resterait pas là, et si jamais il pourrait être utilisé, dans son volume entier. Les moyens de locomotion employés d’ordinaire étaient trop insuffisants. Le traîneau le plus fort eût été écrasé sous le poids. On pouvait au moins essayer de le traîner à la chaîne à l’aide de bras nombreux et vigoureux. C’est ce qui fut fait. L’opération fut longue et dura la soirée entière. Mais quels joyeux hurrahs, chaque fois que le monolithe faisait un pas en avant, et surtout quand on le vit à la place assignée, à mi-côte environ de la colline, où il ne peut manquer d’être remarqué par les visiteurs.
Les travailleurs de Péaule et de Marzan méritent aussi d’être félicités pour le chant des cantiques et du salut. Evidemment le chant religieux est en honneur dans ces deux paroisses. Il faut dire aussi que tout était bien dirigé par M. l’abbé Jollivet, vicaire de Péaule, et par M. l’abbé ***, vicaire de Marzan.
+
Les mercredi et jeudi, 26 et 27 février. —Ces deux journées ont été données : la première par les femmes de Prinquiau, que la longueur de la route à faire à pied n’a point effrayées, et qui, une fois venues, se sont mises à l’œuvre avec une grande activité ; la seconde, par les femmes de Missillac, qui se sont montrées, comme à l’ordinaire, courageuses et pleines de bonne volonté, et en plus excellentes chanteuses, surtout au salut du Très Saint-Sacrement.
Seconde Semaine de Carême.
Le lundi, 2 mars. — Paroisse de Fay : Il semble que les paroisses à qui l’on n’a fait appel qu’en dernier lieu, à cause de leur éloignement, tiennent à bien montrer que leur dévouement ne le cède en rien au dévouement des premières appelées. Tous, ici, disent bien haut que nous n’avons pas eu de plus belle journée de travail que celle-ci, dans tout le cours de cette année. Deux cents hommes au moins, tous pleins d’activité, d’entrain ! A leur tête, les deux Messieurs Vicaires de Fay, heureux et fiers d’avoir été si bien suivis, heureux aussi du contentement qui en reviendra à leur vénérable Curé. On ne saurait dire la somme de travail fournie dans cette journée. Les plus énormes pierres ont été hissées non seulement à mi-côte, mais jusqu’au sommet. A un moment donné la photographie, dont on dit, en ces jours, tant de merveilles, a dû prendre le groupe si vivant, si animé des travailleurs. Elle n’a pu reproduire, évidemment, que des visages bien ouverts et bien joyeux. Au milieu de tout cela, la foi et la piété ont eu leur compte. Dans le peu de temps de repos qui a suivi la réfection, les travailleurs ont parcouru, en vrais pèlerins, les diverses stations, chantant des cantiques, faisant l’ascension de la Scala Sancta, etc. Et bien que la route fut longue, et que l’heure était avancée, tous ont assisté au salut du Très Saint-Sacrement, et pris part à la vénération des reliques.
+
Le mardi, 3 mars. Paroisse de Saint-Gildas-des-Bois. — Bien courageuses, les femmes de Saint-Gildas, qui malgré la tempête qui souffle sont venues si nombreuses et de si bon matin. Si la bourrasque les oblige à suspendre le travail ; elles ne perdent pas courage et le reprennent dès que le soleil reparaît dans la soirée. Un semblable dévouement ne peut manquer d’avoir sa récompense.
+
Le mercredi, 4 mars. Travailleurs nantais. — Nous l’espérions bien, Nantes ne pouvait rester en dehors du mouvement. Nantes est trop redevable au Bienheureux Montfort. Son culte est en honneur dans plusieurs de ses églises. Et dès le début de la campagne de travaux qui se poursuit, Mgr Le Coq, ne disait-il pas que le Calvaire du B. Montfort, était une des gloires du diocèse de Nantes ? Un jour ou l’autre, la ville épiscopale devait ici apporter son concours. C’est le jeudi 4 mars, que nous arrive ce premier groupe de travailleurs volontaires nantais. C’est à l’excellent comité de La Croix, présidé par M. de Monti de Rezé qu’est due cette heureuse initiative. A côté du nom que nous venons de citer, qu’il nous soit permis de placer le nom de M. J. Lévêque, qui s’est dépensé avec tant de zèle pour tout organiser.
Rien d’édifiant comme ces pèlerins-travailleurs, débarquant par le premier train à Pontchâteau, faisant la route du Calvaire à pied en égrenant leur Rosaire. En arrivant ils entendent une messe à laquelle, plusieurs communient. Puis, les voilà à la besogne. Malgré le terrain glissant, dans la matinée du moins, jamais il ne fut mis plus d’ardeur à tirer à la chaîne, à monter les wagons, et cette ardeur ne fera que croître jusqu’au départ. Sans doute, il y a là une jeunesse vigoureuse, mais il en est de plus âgés qui ne s’épargnent pas.
A la fin du repas qui réunit tous les travailleurs dans la salle des Pèlerinages, M. de Monti se lève et comme s’il était l’obligé, il remercie le R. P. Directeur du Pèlerinage de l’accueil fait à la petite troupe venue de Nantes. Puis, il revendique hautement pour tous ceux qui sont présents, le beau titre d’Amis de la Croix si cher à Montfort. Il exprime en termes chaleureux les sympathies de tous, pour l’Œuvre du Calvaire, et fait espérer pour bientôt, venant de la même ville de Nantes, un nouveau pèlerinage de travail plus nombreux.
En quelques mots partant du cœur, le R. P. Directeur du Pèlerinage remercie M. de Monti et les travailleurs volontaires. Puis, il donne lecture d’une lettre reçue, le matin même de M. Th. Viard, à qui son état de santé n’a pas permis, à son grand regret de prendre part à l’expédition d’aujourd’hui. Ce sont des pages débordantes de l’enthousiasme d’un zélateur ardent des grands pèlerinages de Terre-Sainte, et qui salue, avec bonheur, la Jérusalem bretonne ou plutôt française, qui s’élève ici, et pour laquelle il entrevoit les destinées les plus glorieuses. Il émet, en particulier le vœu que bientôt la Bretagne et la Vendée se trouvent là réunies pour porter en triomphe et planter une des croix des pèlerins de Terre-Sainte, qui nulle part ne peut avoir mieux sa place qu’en ce lieu choisi par Montfort, le grand Apôtre de la Croix, dans nos contrées.
La lettre est accompagnée d’un sonnet :
Jérusalem française ! O divin sanctuaire
De l’Arbre du salut, exalté par Montfort!
Tu nous Vois réunis au pied de ton Calvaire,
Bretons et Vendéens, race au cœur toujours fort.
Héritiers de la foi du saint Missionnaire,
Nous venons t’acclamer, ô Croix, avec transport,
Debout, à tes côtés, la tête haute et fière,
Nous jurons de lutter pour loi, jusqu’à !a mort.
Sois béni, Pontchâteau, lieu dont la Providence
A daigné faire choix au sein de notre France,
Pour y glorifier le signe Rédempteur !
Le Christ triomphera, sur Ion immense plaine,
Et tes nobles enfants, maintenant à la peine,
Bientôt avec leur Dieu, se verront à l’honneur.
Cette lecture est accueillie par de nombreux applaudissements. Mais, ces applaudissements redoublent, quand M. de Monti, revenant sur la pensée d’un nouveau et prochain pèlerinage de travail, et engageant chacun des amis de la Croix présents, à faire des recrues, fixe le chiffre à atteindre : « Ce n’est qu’un zéro, dit-il, qu’il faut ajouter au chiffre d’aujourd’hui. » Or, ce nombre est de 40, exactement.
Au sortir de la salle des pèlerinages, visite à Nazareth, au Prétoire, à Gethsémani, le tout avec chants bien nourris et prières ferventes à chacune des stations. Puis reprise du travail ; avec non moins d’ardeur, mais plus de facilité que dans la matinée. Mais les heures passent vite. Les travailleurs se réunissent à la chapelle pour recevoir la bénédiction du Très Saint-Sacrement. Et, voici le moment du départ venu, qui met sur toutes les lèvres ce mot : Au revoir !
Nous ne pouvons oublier que ce même jour un certain nombre d’hommes très dévoués de Saint-Lyphard ont rendu d’éminents services, en extrayant de la carrière les pierres que les Nantais montaient ensuite au sommet de la colline.
+
Le jeudi, 5 mars. — Les femmes d’Assérac, venues de si loin, jusque des bords de la mer, ont montré dans cette journée, beaucoup de courage et d’activité, une grande joie manifestée surtout par le chant de nombreux couplets, tout en continuant leur travail.
+
Le vendredi, 6 mars. —Il a été question, ici, plusieurs fois des Campbonnais, et assurément toujours avec éloges. Il paraît bien que les Campbonnaises ont à cœur de n’en mériter pas moins. Et d’abord, c’est certainement la réunion la plus nombreuse que nous ayons vue dans le cours de cette année, trois cents environ. Leurs longues files enveloppent tout le Calvaire, lorsqu’elles se font passer de main en main les matériaux jusqu’au sommet. Et en même temps des groupes de trente, quarante, ne cessent de charger et de monter les wagonnets. Après le repas, la visite aux stations rappelle par le nombre des personnes qui y prennent part, et par les chants, les belles processions des pèlerins du dimanche, en été.
Au salut donné par M. l’abbé Appert, une voix souple, bien exercée a fait entendre de bien belles strophes, en l’honneur de la divine Eucharistie.
+
Troisième semaine de Carême.
Le lundi, 9 mars. — Cette semaine débute admirablement par l’arrivée matinale des hommes de Blain. En vrais pèlerins-travailleurs, ils s’annoncent en chantant un des cantiques à la Croix du B. Montfort. Et, ils se mettent sans tarder à la besogne. C’était plaisir de voir arriver tout à l’heure Cette belle compagnie de cent hommes. C’est plaisir surtout de les voir maintenant travailler avec tant d’ardeur. Au milieu d’eux, les deux Messieurs Vicaires de Blain, prêchent de parole et d’exemple surtout. Ils ne quittent pas un instant leurs chers travailleurs, dont ils veulent même partager le repas frugal, au milieu du jour. Dans la soirée, des efforts inouïs sont faits pour monter jusqu’au sommet du Calvaire le bloc de pierre le plus énorme qui ait encore atteint cette hauteur.
Tous ces braves gens ont sacrifié, non seulement leur journée, mais aussi le prix de leur place au chemin de fer. Nous avons appris depuis, que le contentement de tous était tel, qu’en rentrant à Blain, spontanément ils ont entonné le cantique Bénissons à jamais, et en ont poursuivi le chant en parcourant les rues de la petite cité.
+
Le mardi, 10 mars. —Il semble qu’aujourd’hui, des deux bords opposés de l’embouchure de la Vilaine, on s’est jeté le défi d’arriver les premiers au Calvaire. C’est Ambon, bien que le plus éloigné, qu’a devancé Pénestin et Camoël. L’heure est si matinale et la distance telle (8 et 10 lieues) que tous sont partis longtemps avant le jour.
Les Ambonnais, à leur arrivée, entendent la messe dite par M. le Recteur à la chapelle du Pèlerinage Puis voici Pénestin et Camoël. Quand tous sont réunis, ces trois cents braves Bretons forment vraiment un bataillon superbe. On peut deviner quelle somme de travail a été fournie par un si grand nombre de bras ; que de terre et de pierres n’en ont été remuées. Nous avons remarqué, après le repas, l’empressement des pieux travailleurs à faire l’ascension de la Scala Sancta, et aussi l’élan avec lequel étaient redits les refrains des cantiques.
Etaient présents MM. les Recteurs d’Ambon et de Camoël, MM. les Vicaires d’Ambon et de Pénestin, M. Geffriau, maire de Pénestin, M. de la Roche et son fils.
+
Le Mercredi, 11 mars. – Le vénérable pasteur de Saint-André-des-Eaux, pour accompagner ses chers paroissiens au Calvaire, n’a pas reculé devant un voyage bien fatigant pour lui. Parti à jeun, de grand matin, il dit en arrivant la sainte messe Qu’entendent tous les travailleurs. Il demeure sur le chantier, tout le jour. Quant aux bons habitants de Saint-André-des-Eaux, ils se montrent tels que nous les connaissions déjà, pleins de dévouement, pleins d’ardeur.
Ce sont eux, disons-le à leur louange, qui les premiers nous sont venus de si loin, et qui ont donné l’exemple à tant d’autres paroisses qui viennent maintenant de huit et dix lieues prendre part à nos travaux.
+
Le Jeudi, 12 mars. — Les volontaires de Montoir. Ici, ce mot de volontaires a une signification spéciale. Il n’y a eu pour eux aucune convocation Officielle. Eux-mêmes ont choisi leur jour. Et vous ne devineriez pas pourquoi le jour préféré est celui de la Mi-carême. C’est que les zélés promoteurs du mouvement ont pensé qu’ils pourraient enrôler quelques-uns des ouvriers des fameuses usines de Trignac, qui chôment aujourd’hui. Leur attente n’a pas été trompée. Trignac a fourni son contingent de jeunes ouvriers un peu étonnés peut-être eux-mêmes de se voir travaillant, ici, à un Calvaire, si loin de leurs hauts-fourneaux, qu’on aperçoit fumants encore, à l’horizon.
On a remarqué, dans toute la journée, une grande explosion de gaîté et de joie, joie et gaîté assurément du meilleur aloi.
+
Le Vendredi, 13 mars. — L’activité, la joie ne font pas non plus défaut aujourd’hui, sur la colline. Ce sont les excellentes chrétiennes d’Herbignac, au nombre de cent cinquante au moins, qui ont tenu à montrer une fois de plus leur attachement au culte du Bienheureux Père de Montfort, qui évangélisa jadis leur paroisse, dans le temps même où l’on travaillait, ici, à son Calvaire.
+
Quatrième semaine de Carême.
Le Lundi, 16 mars. — Un groupe de Campbonnais répondant à une invitation trop tardive, s’est montré digne en tout de la réputation si bien méritée dont jouit leur excellente paroisse.
+
Le Mardi, 17 Mars. Noyal-Muzillac. — Cette paroisse avait eu, ici, l’été dernier, un très beau et très édifiant pèlerinage. Mais elle a voulu faire plus. Elle a voulu avoir aussi son pèlerinage de travail. Les voici, arrivés dès sept heures, malgré la distance, pour assister à la messe dite par M. le Recteur, à la chapelle du pèlerinage. Leur nombre dépasse la centaine. Bientôt, ils ont la main à l’œuvre, et la tâche remplie, dans cette journée est considérable. Noyal aura aussi, comme plusieurs autres paroisses sa pierre mémorable montée avec grands efforts, jusqu’au sommet.
Notons, en passant, l’ensemble parfait avec lequel sont chantés les cantiques, à la visite des stations du pèlerinage.
M. le Recteur et l’un de ses vicaires ont passé tout le jour au milieu des travailleurs.
+
Le mercredi, 18 mars. Paroisse de Crossac. — C’est nommer la paroisse bien décidée à ne se laisser dépasser pas aucune autre, en dévouement et en générosité, pour l’œuvre du Bienheureux Montfort. C’est encore une excellente journée qu’elle donne au Calvaire.
+
Le jeudi, 19 mars. Fête de Saint Joseph. —Deux paroisses ont choisi ce jour pour le donner aux travaux du Calvaire : Saint-André-des-Eaux dont nous avons vu déjà l’avant-garde, la semaine dernière, et qui nous envoie aujourd’hui tout un bataillon de braves ; l’autre est Saint-Malo de Guersac, qui avait hâte de donner une nouvelle preuve de son attachement à l’Œuvre du Calvaire. Les deux groupes accomplissent, chacun de leur côté, avec une grande activité la tâche qui leur est assignée. Saint Joseph n’a pas été oublié. Tous les travailleurs ont assisté à la sainte messe dite le matin, à leur arrivée, et au salut solennel, donné le soir, avant le départ.
+
Le samedi, 21 mars. — Limmerzel ! Encore un nom nouveau à inscrire sur le Livre d’or des travailleurs du Calvaire. Et comment louer le dévouement de ces braves bretons, partis dès deux heures du matin, et par un temps douteux, pour franchir les neuf lieues qui les séparent du Calvaire. Quelques-uns même, partis à pied, touchaient presque le but du voyage quand ils sont recueillis par une voiture moins chargée. La foi de tous est récompensée. Les nuages se dissipent, et la journée est très belle. Les travailleurs de Limmerzel débutent par un coup d’éclat. Une énorme pierre était restée à mi-côte, de l’avant-veille, chargée sur le traîneau. En très peu de temps, elle est hissée jusqu’au sommet à la place qui lui était marquée. Le reste du temps est employé surtout à fournir de matériaux les ouvriers qui construisent en ce moment les bases des croix. On peut en conclure que l’immense travail de surelèvement du Calvaire touche à sa fin. L’excellent Recteur de Limmerzel, sans compter avec la fatigue, a payé de sa personne pendant toute cette journée, de manière à étonner même ceux qui sont habitués à se dépenser, ici, le plus largement. Il a donné, avant le départ, le salut du Très Saint Sacrement.
Une fête à l’Ecole Apostolique
Le jour même de la fête de Saint Joseph, qu’elle honore comme son protecteur spécial, l’Ecole Apostolique du Calvaire célébrait son vingtième anniversaire, et donnait à cette occasion une petite séance littéraire. Que n’étaient-ils là, ceux des lecteurs de l’Ami de la Croix qui, en si grand nombre, portent à cette œuvre un si vif intérêt. Chants, récits, compositions poétiques leur auraient mieux fait connaître encore cette pépinière d’Apôtres qui leur est chère. De tout cela, nous ne pouvons, malgré notre bonne volonté, que leur envoyer un bien faible écho, en indiquant quelques titres du programme.
Un jeune narrateur redit les circonstances providentielles qui amenèrent la fondation de l’Ecole du Calvaire. Un autre trace à grands traits l’histoire des vingt années, appuyant toutefois sur les temps héroïques, alors qu’une seule pièce tenait lieu, tout à la fois de salle d’étude, de réfectoire et de dortoir. Un troisième a donné pour titre à son récit : Nos grands jours et retrace les émotions de certaines journées mémorables entre toutes, dans la vie de l’école. Un jeune poète suppose que dans une vision sur la lande de la Madeleine, Montfort voit, dans un avenir plus éloigné, il est vrai, que pour les Filles de la Sagesse, une pépinière de missionnaires de la Compagnie de Marie. Un nouveau récit nous montre déjà dispersé sur différentes plages, les missionnaires sortis de l’Ecole. Et sous l’image d’une vigne, un nouveau poète nous la fait voir étendant de plus en plus ses rameaux de tous côtés.
Entre temps, se déroulent les divers actes d’un petit drame où s’allie agréablement le plaisant au sérieux, et tout d’actualité, puisqu’il s’agit d’une vocation d’apôtre entravée de diverses manières el qui finalement triomphe de tous les obstacles.
En somme, charmante fête que Saint Joseph semblait présider avec une satisfaction marquée, du haut du trône fleuri, que des mains habiles et pieuses lui avaient élevé, dans la salle des Fêtes.
Souscriptions pour les Statues du Calvaire
1° Une pieuse et généreuse dame de la Vendée fait don au Calvaire du Bienheureux Montfort de la station principale, la douzième : Jésus meurt sur la Croix.
+
2° Mlle Bretault-Billou, de Saint-Lyphard, donne une des statues représentant Notre-Seigneur.
+
3° La famille Moyon-Curet, de Saint-Malo-de-Guersac donne deux cents francs, pour la dernière station.
N° 8 Mai 1896
Travaux du Calvaire
Tous les étrangers qui passent au Calvaire ne manquent pas d’exprimer leur admiration pour le courage et le dévouement de nos travailleurs et travailleuses volontaires. Ce courage, ce dévouement, en effet, bien loin de s’affaiblir va toujours croissant, à mesure que la campagne se prolonge. Nos lecteurs savent déjà que le cercle des paroisses désireuses de prendre part à l’Œuvre du B. Montfort s’est considérablement élargi ; et nous avons à en signaler aujourd’hui encore plusieurs venant pour la première fois, et avec un élan vraiment extraordinaire, malgré la longue distance du Calvaire.
Ce que l’on constate aussi avec plaisir, c’est que ceux qui n’ont pu, pour une raison ou pour une autre, faire partie d’une première expédition, voyant ceux qui sont allés les premiers revenir si contents, si joyeux, demandent avec instance qu’on assigne à leur paroisse une nouvelle journée. Là, où les hommes invités ont déjà répondu à l’appel, les femmes tiennent à ne pas rester en arrière. C’est ainsi, nous assure-t-on, que deux paroisses éloignées qui nous ont envoyé de nombreux travailleurs volontaires, s’entendent, en ce moment, pour avoir un train spécial de travailleuses, ce qui suppose au moins cinq cents personnes désireuses de montrer ainsi leur foi, et en même temps leur dévotion envers le Bienheureux Montfort, Mais, n’anticipons pas, nous avons assez à faire présentement de signaler les actes de foi et de dévouement dont il nous a été donné d’être témoins jusqu’à ce jour.
Notre dernière chronique donnait le compte-rendu des travaux des quatre premières semaines de Carême, et s’arrêtait au dimanche de la Passion.
La semaine même de la Passion nous a donné trois belles journées dont le souvenir qui s’éloigne déjà, il est vrai, n’est pas près d’être effacé ici.
Le lundi 28 Mars : Le Guerno ne compte pas parmi les grandes et populeuses paroisses morbihannaises, mais assurément parmi les meilleures, celles qui conservent toutes les bonnes et anciennes traditions. Nous l’avons bien vu ce jour-là. C’est vraiment une troupe d’élite qui a tenu à suivre si loin son excellent Recteur, pour accomplir, ici, un acte de foi et de dévouement. Travaillant avec entrain tout le jour, ils prient et chantent de même. Voilà bien ceux dont la voix aime à redire le refrain si connu : Catholique et Breton toujours !
+
Le mardi 24 mars : Caden est une grande et importante paroisse de la même région que Le Guerno, et animée du même esprit. Naturellement, les travailleurs étaient plus nombreux. Ils dépassaient la centaine. Toutes les voitures de l’endroit avaient sans doute été mobilisées pour la circonstance. L’un des travailleurs après avoir signé sur le Livre d’or, a mis en marge ces simples mots : Les chrétiens de Caden sont venus au Calvaire de Pontchâteau pour travailler, et ils ont fait de leur mieux. » C’est assurément bien modeste, et nous devons ajouter qu’en faisant de leur mieux, ils ont fait admirablement bien. La même note nous apprend que ce jour-là, le lever à Caden était fixé à trois heures du matin.
Si le vénéré Recteur de Caden n’a pu être témoin de cette belle journée, le compte-rendu qu’a dû lui faire son excellent vicaire, n’a pu manquer de réjouir son cœur de prêtre, de pasteur.
+
Le jeudi 26 mars : Paroisse de Saint-Victor. Ici, nous rentrons dans le diocèse de Nantes. Peu de jours après la date que nous venons d’indiquer, le journal La Croix donnait dans son supplément, à l’article de Croisade en France, la note qui suit :
COMITÉ DE SAINT-VICTOR (Loire-Inférieure.)
Jeudi 26, la messe mensuelle du sous-comité de Saint-Victor a été célébrée au Calvaire pour les lecteurs de La Croix et de la Vie des Saints, et leurs parents défunts.
Que ce lieu convient bien pour cette messe ! Nous étions là 125 hommes de notre petite paroisse. Pour y venir, il nous a fallu faire plus de 50 kilomètres, dont 40 en chemin de fer.
Le reste de la journée, nous avons travaillé ferme à l’œuvre du R. P. de Montfort qui voulait transformer cette lande bretonne en une petite Terre-Sainte. Son intention, en effet, était d’y représenter tous les mystères du Rosaire.
Les Jansénistes l’ont empêché d’achever son œuvre, ils ont même plus d’une fois ruiné les travaux commencés ; mais, par le zèle du R. P. Barré, cette œuvre a été reprise plus grandiose et plus belle. Nos paroisses bretonnes, à plus de quinze lieues à la ronde donnent à tour de rôle des travailleurs de bonne volonté. On roule des pierres énormes, on transporte des terres, on élève le Golgotha artificiel en chantant :
« Chers amis, tressaillons d’allégresse,
Nous avons le Calvaire chez nous… »
Il convient d’ajouter à cette note, que l’organisation de cette belle journée, assurément l’une des meilleures que nous ayons vues, est due au zèle de M. l’abbé Thomas, qui en fondant, à Saint-Victor, un Comité de La Croix, une caisse rurale dont ce même comité a la direction, a fait des cultivateurs et des ouvriers de cette paroisse déjà bonne, de vrais amis de la Croix, comme ils l’ont bien montré dans cette journée du 26 mars.
+
A partir de ce jour, les travaux sont interrompus jusqu’au lendemain des fêtes de Pâques,
+
Le Mercredi 8 avril : Les ferventes chrétiennes de Crossac répondaient au nouvel appel qui leur était fait, avec leur dévouement ordinaire. Ce mot dit tout. Mais, généreuse au travail, la paroisse de Crossac s’est montrée généreuse aussi entre toutes dans sa souscription pour les statues du Calvaire. Ce jour-là, il fut fait aux travailleuses une communication qui ne pouvait manquer de les toucher. On venait de recevoir, ici, un premier envoi de statues, celles composant la onzième station: Jésus est attaché à la Croix ; et déjà, on les avait disposées de manière à donner une idée de ce que serait le groupe placé sur le Calvaire. Naturellement, après la réfection, les travailleuses formèrent cercle autour de ces statues. Elles se montraient surtout celle qui représente Notre-Seigneur étendu sur la Croix, la main droite déjà clouée par le bourreau, quand le R. P. Directeur du Pèlerinage, comme s’il eût deviné la pensée de plusieurs, leur dit : « Hé bien! cette statue, c’est la vôtre ; vous pourrez dire à tous, et en particulier à vos enfants, que c’est vous qui en avez fait don au Calvaire du bon Père de Montfort. »
+
Le Jeudi 9 avril : Les hommes de Pontchâteau, bien qu’en nombre assez restreint, et presque tous de la campagne, ont donné au Calvaire une bonne journée de travail.
+
Le vendredi 10 avril : Les femmes de la Chapelle-des-Marais. Chaque fois qu’elles sont venues au Calvaire, elles se sont fait remarquer par leur courage et leur ardeur. Mais, il semble que ce jour-là, elles aient voulu, au témoignage de ceux qui dirigent les travaux, se surpasser elles-mêmes. Bien que le travail devienne de plus en plus pénible, à mesure que s’élève le sommet au haut duquel il faut transporter terre et pierres, aucun obstacle ne les arrête : « N’est-ce pas pour le bon Dieu et le bon Père de Montfort ! »
+
Le Lundi 13 avril : Déjà au commencement du Carême, la grande paroisse de Péaule (Morbihan) nous avait envoyé un bataillon de cent cinquante travailleurs volontaires. Mais tous n’avaient pas pu prendre part à cette première expédition. Aujourd’hui, c’est le bataillon de réserve qui donne. Moins nombreux, il est vrai, que le premier, il l’égale en courage et en bonne volonté. C’est M. l’abbé Naël, vicaire, qui dirige les chants et les divers mouvements.
+
Le mardi 14 avril : Paroisse de Muzillac : On a certainement remarqué l’élan admirable de ces paroisses d’au-delà de la Vilaine, qui ont à franchir une distance de neuf et dix lieues, pour venir jusqu’à nous. Mais, il semble que Muzillac a tenu à surpasser encore les paroisses qui l’entourent. Quelle file interminable de voitures ! Nous n’exagérons pas en fixant à deux cent cinquante le nombre des travailleurs de cette journée. Nous n’aurions pas su à l’avance que Muzillac est un sol fécond en vocations ecclésiastiques et religieuses, nous l’aurions pu deviner aujourd’hui. Il ne nous souvient pas d’avoir vu au flanc de la colline où montent et descendent les wagonnets, autant de soutanes mêlées aux habits laïques. Ce sont les deux Messieurs Vicaires de Muzillac, dont l’un ancien pèlerin de Terre-Sainte, deux professeurs du Petit-Séminaire de Sainte-Anne en vacances, puis des élèves du Grand-Séminaire de Vannes, également en vacances. Les bons Frères de l’Instruction chrétienne de Ploërmel, sont aussi là à la tête d’une petite escouade de leurs écoliers qui manœuvre admirablement bien.
M. le Maire de Muzillac était présent ainsi que M. le comte d’Andigné et plusieurs autres notables de la petite cité, que nous regrettons de ne pouvoir nommer.
Nous savons que le vénéré Recteur accompagnait la pieuse expédition de tous ses vœux.
En somme grand et beau pèlerinage de travail, marquant parmi les plus nombreux et les plus édifiants.
+
Le mercredi, 15 avril : Les femmes de la paroisse de Pontchâteau et de Saint-Guillaume donnent ensemble cette journée de travail au Calvaire.
+
Le jeudi 16 avril : Quilly nous vient aujourd’hui, avec drapeaux, étendards déployés. Le premier de ces étendards est une reproduction de celui-là même qu’arborait Jeanne d’Arc sur le champ de bataille. Le second est orné des armes qui furent concédées à Jeanne, et à sa famille, après le sacre de Reims. C’est qu’à Quilly, on est vraiment chrétien et patriote, et l’on ne craint pas de s’affirmer, surtout depuis que la lecture du journal La Croix et de la Vie des Saints a remplacé dans toutes les familles, d’autres lectures plus ou moins malsaines. On aime toutes les grandes et saintes choses que prêche et défend La Croix. Aussi celui dont le zèle a suscité tout ce beau mouvement, M. l’abbé Philippe, n’a pas eu de peine à réunir ce beau bataillon de cent cinquante travailleurs volontaires, qui nous arrivent si vaillants, et dont l’ardeur se soutient pendant toute celle chaude journée. Honneur à eux !
+
Le vendredi 17 avril : Le dévouement des pieuses chrétiennes de Sainte-Reine, leur attachement au culte du B. Montfort, qui visita autrefois chacun de leurs villages, sont bien connus. Elles ont montré aujourd’hui, comme dans maintes autres circonstances, que, chez elles ces sentiments ne faiblissent point.
+
Le lundi 20 avril : Le mouvement ne manque pas d’ordinaire dans la gare de Savenay, mais, ce matin, c’est vraiment une animation extraordinaire, qu’on y remarque. C’est le pèlerinage de travail des femmes de Savenay, au Calvaire de Pontchâteau. Elles sont là deux cent cinquante, tant de la ville que de la campagne, et il a fallu ajouter au train de Bretagne un certain nombre de wagons supplémentaires. Débarquant ensemble à la gare de Pontchâteau, elles arrivent en groupe au Calvaire, formant une longue et belle procession, chantant déjà les cantiques en l’honneur de la Croix et du B. Montfort. Cette procession, nous la verrons se reformer au milieu du jour pour visiter pieusement les diverses stations du pèlerinage. Mais auparavant, il faut bien accomplir sa tâche. Bientôt toutes s’y emploient avec la meilleure volonté du monde. Celles qui ne manient pas le pic ou la pelle se font passer de main en main les paniers chargés de sable, ou les pierres de moyenne grosseur qui servent à construire, en ce moment, les bases des croix du Calvaire. Bref, belle journée remplie par un travail méritoire, et une fervente piété ! Aussi le vénérable doyen de Savenay qui la clôturait en donnant le salut du Très Saint-Sacrement, et qui n’avait pas quitté un instant le théâtre des travaux, exprimait-il hautement sa satisfaction, pour tout ce dont il avait été témoin. Par une attention pleine de délicatesse il a voulu que chacune des travailleuses emportât un souvenir de son laborieux pèlerinage. Toutes au départ, reçurent de sa main une gravure représentant le Bienheureux, et au verso, ses litanies que plusieurs aimeront à réciter de temps en temps.
Le mercredi 22 avril : L’Immaculée-Conception de Saint-Nazaire. Qu’on aime à voir reparaître ces chrétiennes paroisses qui ont laissé, ici, une première fois, de si bons souvenirs. Là, ainsi que dans plusieurs autres endroits, tous ceux qui en avaient le désir n’avaient pu faire partie de ce groupe de travailleurs vaillants qu’amenait, ici, il y a quelque temps, l’excellent curé de l’Immaculée. Ceux-là viennent aujourd’hui, conduits par son digne vicaire. Nous ne pouvons rien dire de mieux de cette journée, sinon qu’elle nous rappelle en tout la première dont nous venons de faire mention.
+
Le jeudi 23 avril : Bien que la convocation ne soit pas parvenue, nous assure-t-on, dans toutes les parties de la paroisse, très étendue, il est vrai, les travailleuses de Missillac sont aujourd’hui nombreuses, et montrent leur bonne volonté ordinaire.
+
Le vendredi 24 avril.- Nous citions, il y a un mois la paroisse de Campbon, comme ayant fourni la réunion la plus nombreuse de travailleuses que nous avions vu dans le cours de cette année. Elles étaient au moins trois cents. Et voici, qu’à un nouvel appel, elles atteignent presque le même chiffre. Quant à la physionomie de la journée, elle est la même que celle du 6 mars. C’est à M. l’abbé Warron, qu’a été confiée, cette fois, par le vénéré Pasteur, la direction de ce beau pèlerinage de travail.
+
Le lundi 27 avril, veille de la fête du B. Montfort, les pieuses chrétiennes de la Chapelle-Launay viennent lui souhaiter bonne fête, à leur manière, en offrant leurs bras aux travaux du Calvaire. Elles sont au nombre d’environ cent cinquante, et c’est vraiment un chiffre étonnant pour la Chapelle-Launay. Plus d’une fois déjà les hommes de cette excellente paroisse s’étaient distingués, ici, par leur ardeur au travail et leur dévouement; on voit bien que les femmes ne veulent pas rester en arrière. M. le Curé, présent toute la journée, est visiblement satisfait. Dévot comme il l’est au B. Montfort, il ne peut douter que le travail qui a été fait aujourd’hui en son honneur, travail interrompu seulement par les chants et les prières qui lui étaient adressés, n’assure aux âmes qui lui sont confiées la continuation de sa protection spéciale, et les bénédictions du ciel.
Les Statues du Calvaire
Tous ceux qui s’intéressent à notre Œuvre apprendront avec plaisir, que déjà nous avons reçu deux des groupes de statues qui doivent couronner le Calvaire monumental qui se dresse, ici, en ce moment. Ces deux groupes représentent les deux scènes si touchantes du Dépouillement et du Crucifiement de Notre-Seigneur. L’artiste nous semble avoir traité sérieusement et heureusement ce double sujet. Toutefois, il nous semble que pour en donner une appréciation plus sûre, il vaut mieux attendre qu’ils aient été mis en place.
N° 9 Juin 1896
Les travaux du Calvaire
Jusqu’à ces derniers jours, l’encombrement des matériaux, la disposition ancienne des trois croix qui ne cadrait plus avec l’orientation nouvelle de la colline, ne permettait que très difficilement de se rendre compte de ce que sera notre futur Calvaire.
Il n’en est plus ainsi depuis que les trois croix ont été mises à leur place définitive, et que les échafaudages élevés pour leur déplacement ont disparu. Cette disposition nouvelle des croix, qui présente un coup d’œil bien différent de l’ancien, sera, croyons-nous, généralement approuvée.
Il ne reste plus guère qu’à niveler l’emplacement des groupes qui doivent les entourer. Avec l’ardeur qu’on y met, et dont nos lecteurs vont pouvoir une fois de plus, juger eux-mêmes, ce n’est plus désormais que l’affaire de quelques semaines.
+
Le mercredi, 29 avril. — Au lendemain même de la fête du Bienheureux, M. l’abbé Avenard, dont le zèle pour l’Œuvre du Calvaire est bien connu, paraît de bon matin à la chapelle du pèlerinage. Il attend les braves de Guenrouët, auxquels il a donné rendez-vous pour 7 h. et 1/2, et qui doivent entendre la messe, avant de commencer le travail. Mais, viendront-ils ? Il est certain qu’hier de nombreux pèlerins, en adressant leurs vœux au Bienheureux, lui ont confié leur désir de voir arroser leurs prairies et même les sillons de leurs champs, qui, trop tôt, commencent à jaunir. Et voici que, cette nuit même, la pluie a commencé de tomber. On se demande si à Guenrouët, au moment de partir, les nuages n’ont pas paru trop menaçants pour se mettre en route. L’incertitude n’est pas longue. A l’heure fixée, les premières voitures apparaissent bien remplies, d’autres les suivent et voilà déjà une escouade de travailleurs, suffisante pour accomplir dans la journée une tâche considérable. Cette tâche, ils l’ont remplie généreusement, malgré les difficultés qu’y ajoutait un sol détrempé par plusieurs averses. Et, tous partaient le soir, le cœur content.
+
Le jeudi, 30 avril. — Le temps est à peu près le même qu’hier, et la journée s’annonce de même. Et ce sont des femmes qui sont convoquées. Mais on connaît le courage des braves chrétiennes de Saint-Roch. Elles sont, ici, de bonne heure et se mettent promptement à la besogne. Un peu plus tard apparaît un autre groupe. Ce sont les femmes de Lavau. Qu’on juge de leur dévouement : Au départ, deux lieues à faire, pour prendre le chemin de fer à Savenay ; et en descendant de wagon, à Pontchâteau, encore une lieue à faire pour parvenir jusqu’ici ; et il faudra recommencer le soir.
Les deux groupes rivalisent d’ardeur au travail, qui n’est interrompu qu’une ou deux fois par la pluie trop abondante. Pour compenser, les femmes de Saint-Roch donnent encore une heure de travail après le salut du Très Saint-Sacrement, qui avait été fixé d’après l’heure du train que devaient prendre les travailleuses de Lavau.
+
Le vendredi, 1er mai. — Les femmes de Bouvron, seraient venues aujourd’hui bien plus nombreuses, sans diverses circonstances qui n’étaient pas prévues, lorsqu’à été faite la convocation. Mais, celles qui sont venues suppléent au nombre par leur activité, de telle sorte que celui qui dirige les travaux n’hésite pas à ranger cette-première journée du mois de Marie, parmi les meilleures.
Elles ne sont pas pressées de quitter le travail, bien qu’elles aient une longue route à faire. Il suffît, disent-elles, qu’elles soient arrivées pour le Mois de Marie qui se fait dans chaque village à neuf heures. A ce sujet, il échappe à l’une d’elles qui s’est fait remarquer par son entrain au travail pendant toute la journée, de dire que pourtant, elle n’a pas pris de repos la nuit dernière. El la raison est celle-ci donnée le plus simplement du monde : C’est que le Mois de Marie pour son village se fait dans sa maison, et que voulant donner cette journée au Calvaire, il fallait bien passer la nuit précédente à orner l’autel de la Madone, pour que tout fut prêt, ce soir, à l’heure de la réunion.
+
Le lundi, 4 mai. — Les femmes de la Chapelle-des-Marais montrent le même esprit de foi, déploient le même courage, la même ardeur au travail que nous avons eu à louer maintes fois.
+
Le mardi, 5 mai. — Lors de son beau pèlerinage de prière, à la fête du 25 mars, Donges avait promis son pèlerinage de travail. Les braves et nombreux travailleurs présents aujourd’hui au Calvaire accomplissent généreusement ce qui était promis. Les deux Messieurs vicaires de Donges ont leur part, dans cette laborieuse journée.
+
Le Mercredi, 6 mai — Il y a huit jours, c’étaient les hommes de Guenrouët qui nous donnaient une excellente journée. Aujourd’hui, les femmes chrétiennes de la même paroisse en font brillamment l’octave. Elles sont au moins cent cinquante, toutes animées de la même piété, et de la même ardeur au travail. C’est bien surtout dans ces jours qu’ici la prière s’unit au travail, et que le travail lui-même est offert comme une prière, pour obtenir du Ciel la pluie qui se fait attendre depuis si longtemps. C’est à l’activité et au zèle bien connus de M. l’abbé Avenard qu’est encore due l’organisation de ce beau pèlerinage de travail.
+
Le Jeudi, 7 mai. — M. l’abbé Philippe, vicaire de Quilly, est aussi un zélé du Calvaire de Montfort. Plusieurs fois déjà, il a paru ici, à la tête des braves travailleurs de cette excellente paroisse. Aujourd’hui, ce sont les travailleuses. Elles auraient été plus nombreuses, si certains obstacles ne s’étaient présentés, au jour fixé ; mais, il eût été impossible de déployer plus d’activité et de dévouement.
+
Le vendredi, 8 mai. — Deux groupes de travailleuses arrivent, presque en même temps, de deux points opposés. L’un vient de Saint-Gildas-des-Bois, l’autre de Malville. Ces deux groupes ont bien vite fait connaissance, et unissent, avec la meilleure volonté du monde, leurs efforts pour accomplir la tâche qui leur a été assignée. M. le doyen de Saint-Gildas, qui n’avait pu venir, dès le matin, n’a pas manqué de paraître, au milieu du jour, pour encourager les travailleuses.
+
Il était décidé, à l’avance que, pour les trois jours des Rogations, pendant lesquels, il est si désirable que les populations assistent aux processions qui se font dans les paroisses, les travaux seraient suspendus au Calvaire. Quelques ouvriers spéciaux seuls devaient tout préparer, pendant ce temps, pour la translation des trois croix à la place qu’elles doivent définitivement occuper dans le plan du nouveau Calvaire. C’est donc seulement :
+
Le vendredi, 13 mai, que reprennent les travaux de terrassement ordinaires. Nous avons ce jour-là, les fidèles amis que le Calvaire compte toujours, et en grand nombre, à Montoir. Les travailleuses de cette journée ont bien montré leur courage, ayant à lutter contre ce vent continu du Nord-Est qui ne cesse de soulever autour d’elles des tourbillons de poussière. Elles n’en chantent pas moins de tout leur cœur, en se faisant passer de main en main les pierres et les paniers remplis de terre.
+
Le samedi, 14 mai. — Avec quel élan, la paroisse de Billiers (Morbihan) répond aujourd’hui à l’invitation qui lui a été faite. Billiers est loin d’ici, sur les bords de l’Océan, de l’autre côté de la Vilaine. Mais, qu’importe la distance ? Ils sont là de bonne heure, marins et cultivateurs, tous animés de la même ardeur. Nous sommes heureux de saluer, en même temps, la double autorité religieuse et civile, M. l’abbé Blain, recteur de la paroisse, et M. Le Masne, maire de la commune.
On sait l’habileté des marins lorsqu’il s’agit de manœuvrer les câbles d’un palan pour soulever les plus lourds fardeaux. Avec quel ensemble surtout, ils obéissent au commandement donné. Nous comptions sur les marins de Billiers pour l’opération difficile au jugement, de tous, du déplacement des croix du Calvaire. La facilité avec laquelle s’effectue, sous nos yeux, le transfert de la croix du bon larron, montre bien que s’il n’eut dépendu que d’eux, l’opération eût été complètement achevée, à la fin de la journée. Mais les ouvriers mécaniciens ne sont pas parvenus à détacher la croix principale, et puis l’outillage fait défaut. Il faut y renoncer au grand regret de tous. Mais la journée n’en a pas moins été cependant bonne et- fructueuse.
+
Le lundi, 18 mai. — Un groupe très méritant de travailleuses de la paroisse de Bouvron, dont nous connaissions déjà la fidélité et le dévouement à l’Œuvre du Calvaire.
+
Le mardi, 10 mai. — Avec l’intention très spéciale d’obtenir du ciel, par l’intercession du B. Montfort la fin de la sécheresse, une centaine d’hommes de la paroisse de Saint-Dolay accomplissent aujourd’hui, ici, leur pèlerinage de travail. Tous, à leur arrivée, assistent dévotement à la messe dite par M. le Recteur. On prie encore à la visite des stations, au salut, ce qui n’empêche pas de travailler ferme tout le reste du jour.
+
Le mercredi, 20 mai. —Grande journée de travail, et par le nombre de bras mis en mouvement, et par le résultat accompli. Deux paroisses sont fortuitement réunies et largement représentées : La Roche-Bernard, cent hommes ; Pénestin, près de deux cents femmes.
Aux hommes de la Roche-Bernard, est réservé l’honneur de mettre en place la croix principale. Nous avons dit que le jour où nous avions, ici, les marins de Billiers, l’outillage était insuffisant. Il s’est trouvé quelqu’un pour le compléter. M. Boterf, maire de la Roche-Bernard, nous arrive, non seulement muni de poulies plus fortes, mais avec tout un personnel habitué à manœuvrer avec ensemble, en semblable occurrence, au commandement de sa voix, dans la grande usine qu’il dirige. Aussi les derniers préparatifs achevés, les dernières précautions prises, dans un temps relativement court, on voit la lourde masse de fonte, comme obéissant â la voix qui dirige le mouvement, s’ébranler d’abord, puis se soulever, et se poser enfin, sans secousse, à la place qui lui était préparée. On entend alors une longue acclamation à la Croix.
Cependant les travailleuses de Pénestin, avec une activité au-dessus de tout éloge, accumulaient au sommet de la colline, les matériaux, pierres, terre et sable, qui doivent servir à l’achèvement de la crête rocailleuse sur laquelle reposent les trois croix.
Au milieu du jour, la visite des statues avec accompagnement de cantiques, donne le spectacle d’une belle procession.
M. le Curé-doyen de La Roche, qui assiste à cette journée, la clôture, en donnant le salut du Très Saint-Sacrement.
+
Le jeudi 21 mai. —C’est au zèle d’une généreuse bienfaitrice du Calvaire, que nous devons aujourd’hui ce beau pèlerinage des travailleuses, de la paroisse Saint-Lyphard, qui atteint la centaine.
Elle seule les a convoquées, elle seule a tout organisé pour le voyage. Et il faudrait la voir, eu ce moment, au flanc de la colline, animant tout le monde par la parole et surtout par l’exemple. Rarement aussi, le travail s’est fait avec autant d’ordre et d’activité, en même temps. Ajoutons encore, qu’à la messe, le matin, au salut, le soir, à la visite des stations, dans le milieu du jour on a prié pieusement et admirablement chanté.
+
Le vendredi, 22 mai. —Paroisse de la Madeleine de Guérande. C’est la dernière journée inscrite, pour le moment, sur notre Livre d’or. La paroisse de la Madeleine dont le clocher est à près de cinq kilomètres de la ville n’a pas cessé pourtant de faire partie de la commune de Guérande. Nous saluons aujourd’hui dans ces braves travailleurs de la Madeleine, amenés au Calvaire par leur excellent Pasteur, comme une avant-garde d’élite de la grande paroisse de Guérande, qui a aussi un jour fixé, pour son pèlerinage de travail.
N° 10 Juillet 1896
État présent des travaux du Calvaire
Comme on le pense bien, à cette heure, où les travaux des champs autour de nous réclament impérieusement tous les bras, il y a interruption, suspension presque totale des travaux du Calvaire. Toutefois, nous avons encore à enregistrer, pour ce mois-ci, des dévouements d’autant plus méritoires qu’ils supposent un plus grand sacrifice. Avant de satisfaire à ce devoir, nous voudrions mettre, autant que possible, sous les yeux de nos lecteurs, l’aspect, l’état présent de notre sainte colline. Ils pourraient ainsi juger des résultats obtenus dans la campagne de travaux qui vient de finir, et ceux d’entr’eux qui viendront nous visiter, pendant cet été, ne seront pas étonnés de trouver un monument encore inachevé. L’objectif était d’aménager le sommet de manière à recevoir les quatre grandes scènes du Via crucis, qui s’y sont accomplies, savoir : le Dépouillement de Notre-Seigneur, la Crucifixion, la Mort sur la Croix, et enfin la Descente de Croix. Disons, tout de suite, qu’on s’est aperçu de bonne heure que cette dernière scène ne trouverait sa place qu’après l’élargissement projeté du côté sud de la colline et qui rentre dans le plan du Saint-Sépulcre renvoyé à la prochaine année.
Présentement, le pèlerin après avoir gravi le sentier qui conduit au sommet du Calvaire voit, en y arrivant, un peu sur sa gauche, la scène du Dépouillement, qui se compose seulement de trois statues : celle de Notre-Seigneur et celles des deux bourreaux qui lui arrachent sa tunique. Pour produire tout son effet, ce groupe devra changer un peu de disposition et être renvoyé un peu plus sur la gauche, après l’élargissement projeté de ce côté. A droite, sur un plan sensiblement plus élevé, et immédiatement au-dessus de la grotte d’Adam, se voit la Crucifixion. Cette scène se compose de quatre statues : celle de Notre-Seigneur étendu sur la Croix, et dont une main est déjà à moitié clouée ; deux bourreaux, dont l’un enfonce le clou de la main droite, tandis que l’autre retient les pieds de la Divine Victime; enfin un soldat, la lance au poing, témoin impassible de la sanglante exécution. La place de cette station est définitive, elle ne laisse rien à désirer, comme disposition, comme effet.
Au milieu, sur le point le plus élevé du sommet du Calvaire, se dressent les trois croix, à une distance convenable les unes des autres ; celle du bon larron légèrement tournée du côté de la Croix de Notre-Seigneur, celle du mauvais larron sensiblement tournée dans le sens contraire.
La Mater dolorosa et Saint-Jean sont déjà à leur place, l’une à droite, l’autre à gauche, un peu en avant de la Croix principale. Mais, c’est seulement à la fin de Juillet que notre douzième station sera complète. Nous attendons pour ce moment le nouveau Christ, qui doit remplacer l’ancien, les statues du bon et du mauvais larron, de Marie-Madeleine, de Marie de Cléophas, suivante de la Sainte Vierge, du soldat Longin, des deux juifs, personnifiant les pharisiens et le peuple insulteurs du Divin crucifié.
Dès maintenant, tel qu’il est, l’aspect du Calvaire est vraiment imposant, non seulement vu de près, mais aussi à distance.
Il serait difficile de donner une idée de ce qu’il en a coûté de travail et d’efforts pour en arriver là. Les visiteurs eux-mêmes ne peuvent s’en rendre compte en partie, qu’en faisant le tour de l’enceinte, et en voyant la base de rochers qu’il a fallu donner à ce sommet dont la hauteur est de vingt mètres au-dessus des douves anciennes.
II. — Dernières journées consacrées aux travaux du Calvaire.
Il nous reste maintenant à mentionner brièvement les dernières journées, consacrées si généreusement à cette grande œuvre, dont l’achèvement ne peut désormais se faire longtemps attendre.
+
Le Mercredi 27 mai : Huit jours après que les hommes de Saint-Dolay, sous la conduite de leur excellent Recteur, ont donné au Calvaire une journée si bien remplie, ce sont les pieuses chrétiennes de la même paroisse que nous voyons, en ce moment, à l’œuvre. Plus nombreuses que n’étaient les hommes, elles sont animées du même courage, de la même ardeur. La piété a eu son compte, le matin, à la sainte messe, à l’exercice pieux du milieu du jour, au salut du soir.
+
Le Vendredi 29 mai : Réunion très chantante, très joyeuse, et en même temps très active. Ce sont les travailleuses de Saint-Malo-de-Guersac que nous avons vues plus d’une fois déjà, sur la colline. M. le Curé et son vicaire sont présents.
+
Le Lundi 1er juin : Ce n’est qu’un groupe de travailleuses de la grande paroisse de Saint-Joachim, Mais elles se montrent dévouées et courageuses, comme elles l’ont toujours été pour les travaux du Calvaire.
+
Le Mardi 2 juin : Beau et nombreux pèlerinage des travailleuses de la paroisse de Donges. M. le Curé que nous avons le bonheur de revoir, à cette occasion, ne se contente pas de présider les travaux, il y met bravement la main. Impossible aussi de ne pas remarquer dans ces longues files qui montent les wagonnets, en chantant, les robes grises de Sœurs de la Sagesse. Elles paraissent bien décidées à ne pas céder leur rang, dans ce milieu si plein d’activité et de courage.
+
Ici, une note du Livre d’or mentionne la générosité avec laquelle M. du Bois de Bodio, et plusieurs fermiers, de la Petite-Madeleine, des Cottrets, de la Berneraie, ont mis leurs attelages à la disposition du R. P. Directeur du Pèlerinage pour amener, de loin, les pierres qui servent aujourd’hui de base aux croix du Calvaire.
+
Le Lundi 8 juin : Nos lecteurs n’ont peut-être pas oublié la bonne et fructueuse journée des marins et cultivateurs de Billiers (Morbihan), à l’embouchure de la Vilaine. Aujourd’hui, ce sont les femmes de cette généreuse paroisse, qui fout preuve d’une activité et d’une ardeur incroyables. Tous sont étonnés de la quantité de matériaux montés, en si peu de temps, au sommet de la colline. Nous devons, ici encore, signaler les bonnes Sœurs de la Sagesse à la tête de leur ouvroir de Sainte-Anne de Billiers. Pendant celle journée de travail incessant, les chants en l’honneur de la Croix et du Bienheureux Montfort ne cessent pas, non plus, de se faire entendre. M. le Recteur de Billiers, qui a signé, ancien pèlerin de Jérusalem, présidait, visiblement heureux du spectacle qu’il avait sous les yeux.
+
Le Mardi 9 Juin : Un appel fait seulement à quelques villages de la paroisse de Crossac réunit un groupe de vaillants travailleurs. Le fait saillant de cette journée est l’ascension de la première des statues en fonte qui doivent couronner le sommet du Calvaire, celle de Notre-Seigneur cloué par les bourreaux à la Croix. Nous avons dit déjà quelle est offerte à l’œuvre par les généreux habitants de Crossac.
+
Le Mercredi 10 Juin : Nous avions parlé d’un train spécial qui devait nous amener au Calvaire cinq cents travailleuses. Par suite de difficultés faites par la Compagnie de l’Ouest, les trois paroisses qui avaient conçu le projet ont dû y renoncer. Mais, elles n’en fourniront pas moins, à quelques jours de distance, le contingent annoncé. Aujourd’hui, c’est la paroisse de Vay qui commence. Saint-Victor et le Gâvre suivront bientôt. Ce n’est pas en vain que M. le Curé de Vay, a mis par-dessus la soutane le sarreau de travail. Il donne l’exemple ; et l’activité la plus grande règne pendant toute la journée, sur le chantier ; ce qui n’empêche pas les chants pieux et joyeux, et les prières ferventes, à la chapelle et aux diverses stations du pèlerinage.
+
Le Jeudi 11 Juin : La paroisse de Saint-Victor, voisine de celle de Vay, la suit de près. Les travailleurs de Saint-Victor, au lieu d’aller jusqu’à Pontchâteau, sont descendus à la gare de Besné. Et, après avoir passé le Brivet en bateau, elles arrivent par les chemins de traverse au Calvaire, priant et chantant.
La journée, pour l’activité au travail, ressemble à celle d’hier. M. le vicaire de Saint-Victor et M. le vicaire de Besné, qui est un enfant de Saint-Victor, s’entendent si bien tous les deux, pour souffler l’ardeur et l’entrain ! Vers la fin de la journée, on monte jusqu’au sommet une seconde statue du groupe de la Crucifixion. Ce sera un souvenir de ce beau pèlerinage de travail.
Le Vendredi 12 Juin : Ce devait être une journée de complet repos ; mais, le matin, un groupe de jeunes filles de Saint-Joachim vient assister à une messe dite pour l’une de leurs compagnes malade. Elles ne sont pas nombreuses, mais bien décidées à faire quelque chose pour assurer le succès de leur pèlerinage. Quelques personnes de l’entourage se joignent bientôt à elles, et nous distinguons même dans le nombre quelques-unes des Sœurs de la Sagesse du Calvaire. Par elles, les deux statues qui doivent compléter la onzième station sont montées et mises en place.
+
Le Lundi 15 Juin : Paroisse d’Arzal (Morbihan). C’est, croyons-nous, le dernier grand pèlerinage de travailleurs, pour cette campagne. Rien n’y manque, du reste, pour qu’il ne soit pas oublié de sitôt. La caravane se compose de vingt-deux voitures portant de cent vingt à cent trente hommes. M. le Recteur et M. le Maire d’Arzal sont présents. Nommons encore M. le comte de Saisy de Kérempuis, M. Révérend, ancien courtier maritime, M. l’abbé Boudard, vicaire. La journée est pour la piété et le travail tel qu’on devait l’attendre d’une pareille réunion de vrais Bretons, tous hommes de cœur et de foi. Ce sont les travailleurs d’Arzal qui ont, ce jour-là, monté et mis en place les trois statues du groupe du Dépouillement de Notre-Seigneur, dixième station de notre Chemin de Croix monumental.
+
Le Mardi 16 Juin : A peine la Roche-Bernard nous avait donné cette belle journée de travailleurs qui vit le transfert de notre Croix principale, que les ferventes chrétiennes de la même ville avaient décidé de venir aussi travailler à leur tour. Certes, elles y mettent, en ce moment, une ardeur digne de tout éloge. On cause et on chante sans doute ; mais l’on travaille ferme, aussi. Les travailleuses de la Roche-Bernard n’oublieront pas que ce sont elles qui ont monté au pied de la Croix de Notre-Seigneur, la statue de la Sainte Vierge, la Mater dolorosa. M. le vicaire de la Roche-Bernard était présent, non seulement encourageant le travail, mais y prenant une large part.
+
Le mercredi 17 juin : Paroisse de Blain. — M. le Curé-doyen de Blain, nous le savions, avait été très satisfait de l’excellente journée de travail, que nous avaient donné ses paroissiens, au mois de mars. Aussi a-t-il voulu présider, lui-même, à notre grande satisfaction à nous, le beau pèlerinage de travailleuses qui nous arrive aujourd’hui. Toutes sont remplies d’ardeur et de dévouement. Si quelques averses viennent interrompre momentanément le travail, c’est un peu plus de temps donné à la chapelle, aux exercices pieux, à certains souvenirs qui nous restent, ici, du B. Montfort. La journée n’en est pas moins bonne et fructueuse. Dans la soirée, les travailleuses de Blain ont monté et mis en place la statue de l’Apôtre S. Jean, qui fait face à la Mater dolorosa, au pied de la Croix.
+
Le jeudi 18 juin : Le Gâvre est la troisième paroisse qui devait se joindre, la semaine dernière, à celles de Vay et de Saint-Victor. Elle forme aujourd’hui à elle seule un nombreux pèlerinage de travail, présidé et dirigé très activement par M. l’abbé Aoustin, vicaire du Gâvre et par M. l’abbé Lecoq, vicaire de Montrelais, qui prend, en moment, quelques jours de vacances, dans sa famille, au Gâvre. C’est assurément une bonne et excellente journée pour les pèlerines travailleuses et pour nous tous
+
A partir de ce moment, il y a suspension des travaux. Toutefois, un travail spécial semble encore nécessaire pour la pose des statues attendues, fin juillet. Un appel discret est fait au village si dévoué de Bergon en Missillac, et le mardi 23 juin, les travailleuses sont en nombre pour faire le travail demandé, malgré la chaleur torride de la journée. Ajoutons, pour terminer, que c’est la huitième journée que ce même village de Bergon, donne, cette année, aux travaux du Calvaire.
N° 11 Août 1896
Un autel à sainte Anne dans la Chapelle du Pèlerinage
Notre chapelle du Pèlerinage, où l’on prie si bien, comptait déjà six autels. Cependant il lui en manquait un. Est-ce que la bonne Mère sainte Anne ne devait pas avoir son image et son autel dans ce sanctuaire, où le plus grand nombre de ceux qui viennent s’agenouiller sont tout particulièrement ses clients ! Et notre Bienheureux, Breton lui-même, ne semblait-il pas le réclamer? Tout semble aussi fait pour le satisfaire, au mieux. L’autel de la bonne Mère sainte Anne est placé vis-à-vis du sien ; sa statue fait le pendant de la sienne.
Nous devons ce nouvel autel, comme du reste, presque tous les autres qui enrichissent notre chapelle, à la munificence généreuse et au talent artistique bien connu de M. le marquis de Montaigu.
On vient de le mettre en place, quelques jours seulement avant la fête de sainte Anne. C’est vraiment un petit chef-d’œuvre de bon goût.
Le tombeau de l’autel, en vieux chêne, est divisé en trois panneaux. Dans le panneau du milieu, une croix d’or se détache sur un fond bleu de ciel. A droite et à gauche, sur les deux autres, d’un côté, une branche de lis, symbole de la pureté parfaite, et de l’autre, une branche d’olivier, symbole de la paix.
N’est-ce pas ce que sainte Anne a donné au monde, en lui donnant Marie?
Mais, les regards se sentent attirés vers le retable qui surmonte l’autel, dans son bel encadrement de chêne.
La statue de la sainte, nous devrions dire plutôt, le groupe de sainte Anne et de sa fille immaculée, Marie, polychrome avec un soin tout particulier, ressort admirablement sur un paysage tout à la fois sévère et gracieux. Sainte Anne debout, tient dans ses mains l’une de ces bandelettes sur lesquelles sont tracés les textes sacrés des divines Ecritures. Et Marie encore enfant, debout aussi près d’elle, y semble lire prédit à l’avance le secret de sa destinée à nulle autre pareille.
Le paysage dont nous avons parlé, n’est autre que le paysage même de Sainte-Anne d’Auray. Le monument qu’on y voit est l’antique et miraculeuse chapelle qui a fait place aujourd’hui à la splendide basilique, que l’on sait.
Sainte Anne placée en avant semble dire : « Moi aussi, j’ai mon sanctuaire privilégié, où vous venez, où vous viendrez un jour ou l’autre me visiter, et d’où ceux qui m’invoquent ne s’en retournent jamais sans être comblés de faveurs et de grâces, mais, en attendant, vous pouvez, ici même, m’adresser votre prière, et votre prière sera entendue. » Et sur les lèvres viennent se placer ces invocations qu’on lit en lettres d’or, de chaque côté du paysage: Sainte Anne, mère de Marie, priez pour nous ! Sainte Aune, patronne des bretons, priez pour nous !
Pèlerinage des Travailleurs nantais à Pontchâteau
Le 14 juillet 1896, plus de cent pèlerins nantais prenaient le train de 6 heures pour accomplir le second voyage de notre pieuse cité à la lande bénie de la Madeleine.
Arrivés à Pontchâteau à 8 heures, nous nous organisons rapidement et sous la conduite du si dévoué M. Claude de Monti nous traversons la petite ville en récitant le chapelet. Puis ce sont les cantiques populaires du Bienheureux Père de Montfort qui réveillent les échos de la campagne. Vers le milieu du trajet arrive vers nous, le sourire aux lèvres et la main tendue, le P. Sarré qui ne nous quittera que le soir.
A 8 h. 3/4 nous débouchons sur la lande et pour ceux d’entre nous qui n’ont pas encore eu le bonheur de faire ce pèlerinage, c’est un spectacle enchanteur : à droite, la montagne du Calvaire couronnée par les trois croix et dorée par le soleil ; à gauche, la blanche théorie des groupes du chemin de la croix avec, au second plan, l’austère monument du prétoire et à l’horizon les clochers de nombreuses paroisses.
Après quelques instants de repos, on se rend à la chapelle où le R. P. Grolleau célèbre la sainte Messe à la place du R. P. Barré, le Directeur aimé de l’œuvre du Calvaire, obligé à son très vif regret d’assister à une réunion à Saint-Laurent-sur-Sèvre et dont l’absence est pour nous tous un profond chagrin.
A peine l’office terminé, nous nous rendons au pied du Calvaire et le pieux labeur commence. Les femmes, avec cette activité qui anima jadis les Bretonnes filant la rançon de du Guesclin, remplissent de grosses pierres de petits wagonnets. Aussitôt, les hommes s’attellent avec entrain et, les uns tirant, les autres poussant, font gravir aux petits chariots le chemin extrêmement raide de la sainte montagne.
Le zélé M. Gerbaud nous dirige avec sa vieille expérience et le P. Sarré nous aide de la voix, du geste et ne quitte la pioche que pour s’atteler à la chaîne. Une partie des femmes montent des paniers de terre.
Il fait chaud sans doute en cette splendide matinée de juillet, mais la chaleur de nos cœurs nous fait oublier celle du soleil et la vieille gaieté française ne cesse d’animer les ouvriers volontaires qui travaillent pour le Christ.
A 11 h. 1/4, repos. Puis, à 11 h. 1/2, déjeuner. Une vingtaine d’hommes ont la grande joie de prendre leur repas ensemble dans le réfectoire de la communauté. Le R. P. Grolleau préside, ayant à sa droite M. Gerbaud et à sa gauche le baron Gaétan de Wismes. En face de lui est assis M. de Monti de Rezé.
Signalons encore parmi les convives le respectable abbé Tual, ancien curé de Ruffigné, M. Bourgeois, l’habile imprimeur de la Semaine religieuse et de L’Ami de la Croix, M. Lévêque, M. Garnica de la Gruz, etc.
Est-il besoin de dire que la plus franche cordialité ne cesse de régner parmi nous. Mais l’heure des toasts est arrivée. M. de Monti se lève et assure le R. P. Grolleau de la vive gratitude de tous pour son accueil affable et son hospitalité bien bretonne ; il salue de loin le R. P. Barré que nous eussions été si heureux de voir. Le R. P. Grolleau félicite les travailleurs nantais et dit qu’il sera toujours enchanté de les recevoir. Enfin le baron Gaétan de Wismes remercie ses chers compatriotes d’avoir répondu nombreux à l’appel, s’excuse d’avoir choisi une journée si chaude, mais ajoute que si l’on a plus de peine, on en sera plus récompensé ; il souhaite qu’au printemps prochain, notre ville envoie plusieurs centaines de travailleurs.
Après une demi-heure de repos et de conversations amicales, tous les pèlerins, hommes et femmes, sont convoqués dans la salle du réfectoire pour assister à une petite fête de famille. S. S. Léon XIII vient d’accorder à M. Albert Gerbaud la croix de chevalier de Saint-Grégoire le Grand. Le R. P. Grolleau donne lecture des pièces officielles et rappelle les titres magnifiques de notre compatriote. C’est le zouave pontifical recevant dans ses bras son capitaine frappé à mort sur le champ de bataille de Mentana, c’est le voyageur intrépide aidant de tout son pouvoir les Missionnaires de la Chine, c’est enfin l’homme zélé qui depuis tant d’années dirige avec un dévouement sans bornes et une habileté remarquable les difficiles travaux de la lande de la Madeleine. Alors M. de Monti, chevalier de Saint-Grégoire le Grand, attache la croix si bien gagnée sur la poitrine de son nouveau confrère et lui donne l’accolade L’assistance debout éclate en bravos frénétiques et après les quelques mots de remerciements de M. Gerbaud beaucoup de pèlerins vont lui donner l’accolade.
Il est environ deux heures. On se forme en procession et l’on suit toutes les voies de la nouvelle Jérusalem, sous la direction du P. Sarré qui, à chaque station, nous rappelle en termes éloquents, les grandes scènes de la vie de Jésus-Christ et nous engage à en tirer de fortes résolutions pour l’avenir. Entre les stations se font entendre les cantiques du Bienheureux les mieux appropriés au mystère. Cette émouvante et salutaire cérémonie se termine au sommet du Golgotha où retentissent des acclamations vibrantes d’enthousiasme en l’honneur de Jésus et de sa Croix.
On se réunit de nouveau à la chapelle et cette inoubliable journée se termine par le salut du Très Saint-Sacrement et le baisement des reliques du Bienheureux.
Hélas! l’heure de la séparation a sonné. Ce n’est pas sans une peine véritable que nous quittons cette terre miraculeuse arrosée de tant de sueurs et que nous prenons congé des PP. Grolleau et Sarré qui depuis le matin nous ont traités avec la plus tendre affection. Nous reprenons la route de Pontchâteau en chantant une dernière fois les cantiques de Montfort et quand la vapeur nous emporte nos cœurs se sentent déchirés par une douleur dont la vraie consolation est la réconfortante perspective d’un nouveau pèlerinage à la lande de la Madeleine.
Un pèlerin nantais.
N° 12 Septembre 1896
Les nouvelles Statues du Calvaire
Un mois d’absence seulement, un mois sans voir notre cher Calvaire, et c’est assez pour le trouver, au retour, enrichi, embelli, plus près de son achèvement complet. A cette heure tardive de la journée, il n’y a plus, d’ordinaire, de visiteurs sur la sainte colline. Ce sont donc de nouveaux personnages que nous y apercevons de loin.
Notre vue ne nous a point trompé. Ce n’est pas encore toute la grande scène de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur la Croix, telle qu’on la verra bientôt : mais cinq statues nouvelles viennent d’être mises en place. L’on ne peut, en ce moment, que juger de l’effet général, qui est très satisfaisant. Pas de confusion, chaque personnage se détache bien sur le fond déjà un peu obscur du ciel. Demain, nous pourrons juger l’attitude et les traits.
Félicitons, en attendant les hommes de la ville de Pontchâteau, qui, à l’appel du Révérend Père Directeur du Pèlerinage, sont immédiatement venus, leur clergé en tête, M. le Curé et ses deux Vicaires.
Aussi, est-ce en très peu de temps que les cinq statues ont été montées au sommet de la colline, fixées à leur place, y compris les deux larrons sur leurs croix.
Ce sont ces deux personnages qui, par leur position, lorsqu’on est encore assez loin du groupe, attirent, en ce moment, tout d’abord, les regards. Le contraste entre les deux est frappant de vérité. Tout dans l’attitude et les traits du crucifié de droite qui semble vouloir s’élancer de sa croix vers Celui qu’il reconnaît pour le Fils de Dieu exprime la foi, la confiance et déjà l’amour. Le crucifié de gauche se détournant au contraire, comme pour fuir la lumière, se tord dans les convulsions du plus affreux désespoir.
En approchant du sommet, on se trouve en face d’un personnage qui s’apprête à en descendre. Le bras est tendu vers le Christ, la tôle rejetée en arrière. Et de ses lèvres qu’entr’ouve un sourire sarcastique semble s’échapper le blasphématoire défi: « Si tu es le Christ, fils de Dieu, descend maintenant de ta croix » C’est bien le Pharisien orgueilleux et incrédule, poursuivant jusqu’à la fin, de sa haine aveugle, la divine Victime.
Passons… Mais qu’elle apparaît touchante Marie-Madeleine au pied de la Croix que d’un bras elle tient enlacée. Ses larmes se mêlent au sang du bien-aimé. Elles ne tariront plus désormais. Oh! c’est bien celle dont Jésus lui-même a dit : il lui a été beaucoup pardonné parce qu’elle a beaucoup aimé.
Depuis ce jour, cet amour a grandi. Il grandit, en ce moment même, au milieu de son immense douleur, et il ne cessera point de grandir encore jusqu’à ce qu’il ait sa consommation parfaite au Ciel.
Enfin, nos regards se portent vers la suivante de la Sainte Vierge, Marie de Cléophas qui a voulu l’accompagner jusqu’au sommet du Golgotha. L’une des mains appuyant son front, cache une partie du visage, mais n’empêche pas d’y lire une douleur profonde, qu’atteste encore l’autre main tendue et légèrement crispée. Cette douleur plus humaine, moins contenue, fait ressortir davantage le calme surhumain de la Mère des douleurs au milieu do son incomparable martyre.
Il manque encore du côté où se trouve l’apôtre saint Jean, le soldat Longin tenant la lance qui ouvrit le côté du divin Sauveur et dont la pointe atteignit ce Cœur divin qui venait de cesser, pour quelque temps seulement, de palpiter d’amour pour nous.
Il y a aussi une place encore vide pour l’homme du peuple, qui doit, lui aussi, jeter à la divine Victime une insulte plus grossière peut-être, mais moins coupable que celle du pharisien qui l’a trompé.
Nous attendons surtout le Christ mourant, celui-là même, dont la résignation toute divine, dans la scène de la Crucifixion qui est là tout près, a déjà touché bien des cœurs. Combien de pèlerins s’agenouillent pour baiser cette main transpercée par l’énorme clou. On nous assure avoir vu des enfants, qui après avoir accompli cet acte pieux, ne pouvaient se défendre en se relevant, de donner un soufflet au bourreau qui lève son marteau pour frapper un nouveau coup. Le fait n’est pas à imiter, mais il témoigne assurément d’un bon et louable sentiment.
Plus la grande Œuvre se développe, fait de progrès, plus il est permis de prévoir avec certitude quels en seront les heureux résultats pour le bien des âmes.
Oui, il y a une éloquence singulièrement persuasive, dans cette représentation des mystères de la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et, en particulier, de sa Passion, éloquence à laquelle bien peu d’âmes restent insensibles.
Ce que nous voyons dès aujourd’hui, est déjà une récompense et une consolation pour ceux qui se dévouent à cette Œuvre avec tant de zèle. C’est aussi une récompense pour tous ceux qui ont apporté si généreusement leur concours à cette même Œuvre, et un encouragement pour tous ceux qui, dans un avenir prochain, seront appelés à y prendre part.
C’est enfin, tout particulièrement, un encouragement pour l’Ami de la Croix, qui va, le mois prochain, entrer dans sa sixième année. Il continuera, lui aussi, avec plus de confiance que jamais, d’apporter son humble concours à la grande Œuvre, en s’efforçant de la faire de plus en plus connaître et
N° 3 Décembre 1896
Reprise des travaux
C’est le mardi, 10 novembre, au lendemain de l’Octave de la Toussaint, que les travaux du Calvaire ont été repris avec une bonne volonté, une confiance, une ardeur plus grande que jamais.
On ne pouvait songer à commencer plus tôt. Cette année, les pluies surabondantes du mois d’octobre, ont rendu les semailles particulièrement difficiles. Elles n’étaient pas encore terminées à la Toussaint. Du reste, il y avait une autre raison majeure qui en eût empêché.
Suivant l’exemple de leur Bienheureux Père, qui tout en surveillant les travaux de son Calvaire, évangélisait les populations d’alentour, le R. P. Directeur du Pèlerinage et son aide si actif, le R. P. Sarré, donnaient une grande mission, dans une paroisse voisine, à Saint-Dolay, du diocèse de Vannes. Cette mission ne se terminait qu’au 2 novembre. Il leur fallait bien quelques jours de répit, pour organiser la nouvelle campagne de travaux.
Il n’entre pas dans notre dessein, de donner un compte-rendu de cette mission. Mais, nous pouvons bien dire qu’elle a été féconde en fruits de salut pour les âmes. Elle a été pour les bons habitants de Saint-Dolay, dont les ancêtres connurent autrefois le Bienheureux Montfort, une occasion de ranimer encore leur confiance en sa protection, et leur attachement à son Calvaire.
Faut-il dire ici un mot d’un incident qui remonte à la veille même de la fête de la Toussaint?
Un léger éboulement s’est produit du côté sud-ouest du Calvaire. Mais le fait, amplifié comme il arrive toujours, en passant de bouche en bouche, a pu faire croire, au loin, à quelques personnes, qu’il s’agissait d’un véritable désastre. Heureusement, il n’en est rien. La vérité, la voici : Au moment où se terminait la précédente campagne de travaux, c’est-à-dire au mois de juin dernier, on s’aperçut que la plate-forme du Calvaire n’avait pas la largeur suffisante pour y placer convenablement, même d’une manière provisoire, la station du dépouillement de Notre-Seigneur. L’élargissement jugé nécessaire demanda une journée de travail. Mais c’était un travail provisoire. On n’ignorait pas que le vieux mur qui servait d’appui n’était pas suffisamment solide. Et il était bien convenu que, dès la reprise des travaux, on donnerait à ce côté du Calvaire des bases plus sérieuses. C’est précisément le travail qui se fait en ce moment. Et ce travail, il l’eut fallu faire, quand même l’éboulement en question n’aurait pas eu lieu. Tout se borne donc à un simple émoi. Mais, que nos amis se rassurent. Rien de ce qui a été fait au Calvaire pour rester à demeure, n’est ébranlé.
Aussi est-ce avec une confiance entière et une ardeur toute nouvelle que les travaux ont repris et se continuent depuis déjà trois semaines.
Tandis que le Livre d’or des travailleurs du Calvaire continue de recevoir les noms de chacun d’eux, nous regardons comme un devoir de continuer aussi à signaler au moins le nom des paroisses qui ne se lassent pas de montrer leur zèle pour l’achèvement de l’Œuvre du Bienheureux Montfort.
Jusqu’ici cette excellente paroisse s’est distinguée entre toutes les autres par son dévouement et sa générosité, elle méritait l’honneur d’être appelée la première à cette reprise des travaux. Et voici comment elle a répondu à cet appel. Des quatorze journées de travail inscrites du 10 au 27 novembre, au moment où nous écrivons ces lignes, elle en a donné six à elle seule. Les hommes, partagés en cinq sections, d’après la topographie de la paroisse, sont venus les 10, 11, 12, 13 et 16 novembre. Les femmes, en grand nombre, ont donné la journée du 24 novembre.
M. le Curé et M. le Vicaire sont venus, à différents jours, encourager travailleurs et travailleuses, et ont donné le salut du Très-Saint Sacrement.
Si la paroisse de Saint-Guillaume, voisine de nous comme celle de Crossac, n’a qu’une journée de travail inscrite à son actif, pendant ces trois semaines, celle du 14 novembre, elle n’en mérite pas moins d’être signalée pour son dévouement, dans cette même période de temps. C’est elle qui a fourni le plus grand nombre d’attelages nécessaires pour amener d’une assez longue distance les pierres que la carrière ouverte près du Calvaire ne donne plus. Nous regrettons de ne pouvoir citer, ici, les noms. Il nous faudrait nommer presque tous les villages de l’excellente paroisse de Saint-Guillaume.
La paroisse de Drefféac, divisée en deux sections, celle du bourg, et celle de la campagne, a donné les deux journées du 18 et du 20 novembre. Nous nous rappelons que l’un de ces jours, le temps était pluvieux dans la matinée; mais les braves travailleurs de Drefféac ne se sont pas découragés pour cela; et ils ont eu une belle soirée.
Paroisse de Montoir
Voici une paroisse déjà bien éloignée du Calvaire (quatre lieues). Mais, les bons habitants de Montoir si dévoués à l’Œuvre du Bienheureux Montfort, ont voulu dès maintenant, en donner une nouvelle preuve. Ils sont venus nombreux le 19 novembre, et ils ont montré dans cette journée leur ardeur ordinaire.
Ils promettent de revenir plus nombreux encore lorsque les jours seront plus longs et plus beaux.
Paroisse de la Chapelle-des-Marais
Ce n’est évidemment qu’une avant-garde de la Chapelle-des-Marais que nous avons vue le 23 novembre. Mais cette avant-garde n’a pas manqué de suppléer au nombre par l’ardeur au travail. La journée, nous a-t-on dit, a été des meilleures.
M. l’abbé Laur, ancien vicaire de Savenay, avait déjà donné des preuves de sa sympathie pour l’Œuvre du Calvaire. C’est à lui qu’est échue la succession du regretté M. Niel, à la cure de Besné. Nous sommes heureux de le saluer aujourd’hui, 25 novembre, à la tête de ses paroissiens, toujours animés du même entrain. M. l’abbé Babin, vicaire, qui ne manque pas l’occasion de nous donner un bon coup de main, est aussi présent.
Paroisse de Saint-Malo de Guersac
Le froid déjà piquant n’a point empêché travailleurs et travailleuses, de Saint-Malo de Guersac de venir nous donner cette bonne journée du jeudi 26 novembre. L’activité, le mouvement sont tels qu’on s’aperçoit à peine que le vent du Nord ne cesse pas de souffler.
Village de Bergon en Missillac
Ce sont les habitants de ce grand village, toujours si pleins de bonne volonté, qui clôturent aujourd’hui 27, ces travaux du mois de novembre. Ils le font dignement par une journée de travail bien remplie, très fructueuse.
†
Les travaux exécutés dans ce court espace de temps, ont déjà un résultat très appréciable. On voit que le côté sud-ouest du Calvaire, où viendra s’adosser le Saint-Sépulcre, présentera un coup d’œil très satisfaisant.
N° 4 Janvier 1897
Continuation des travaux
Ni la pluie, ni la neige, ni les autres intempéries de la saison n’ont pu les interrompre : et ils vont continuer avec le même entrain, la même ardeur.
Nous allons voir nous revenir les paroisses qui, déjà, y ont pris part, et dès aujourd’hui, nous avons à en inscrire de nouvelles:
Paroisse de la Chapelle-Launay.
30 novembre. — Nous ne saurions mieux débuter dans l’Avent. C’était hier la clôture du Jubilé national à la Chapelle-Launay. Il y avait communion générale. Heureuse paroisse, dont le Pasteur qui connait bien son troupeau peut dire en pareille circonstance : « Je ne sache pas qu’il y ait eu d’abstentions. » Ajouter à toutes les bonnes œuvres accomplies pendant le temps du Jubilé l’offrande d’une journée de travail au Calvaire du bon Père Montfort, pour obtenir la grâce de la persévérance, la pensée était excellente. Elle ne pouvait manquer d’être accueillie avec enthousiasme. C’est au nombre de cent, chiffre considérable relativement à la population, que les hommes de la Chapelle-Launay ont suivi, aujourd’hui, leur Pasteur au Calvaire. Toutes les familles sont, sans doute, représentées. C’est une journée grandement profitable, pour l’avancement des travaux. Et, qu’elle se termine bien par le salut du Très Saint-Sacrement ! On ne peut entendre sans émotion toutes ces voix d’hommes n’en formant qu’une seule pour chanter les louanges du Dieu de l’Eucharistie.
1er décembre. — C’est un nom nouveau à inscrire sur la liste déjà longue des paroisses qui ont bien voulu jusqu’à ce jour apporter leur concours à nos travaux. Et c’est vraiment une petite troupe d’élite qui nous est venue, aujourd’hui, sous la conduite de M. le Curé de Boué. En voyant ces hommes si bien disposés, si ardents au travail, si désireux, dans les courts instants de repos qui leur ont été donnés, de connaître les diverses stations du pèlerinage, il n’est pas téméraire de penser que, s’il était besoin, à un nouvel appel, nous viendraient de ce côté, de nouveaux et plus nombreux renforts.
2 décembre. — Il semble que nos proches voisins de Sainte-Reine eussent dû apparaître plus tôt. Ce n’est pas la bonne volonté qui leur manquait ; mais, ils avaient, pendant ces dernières semaines, une grande mission. Il convenait que rien ne vint les distraire de ces pieux exercices. Le Ciel leur a ménagé une journée bien méritoire. La pluie du matin a détrempé le sol, et le travail est bien plus difficile. Ils ne se découragent pas pour cela, et ils travaillent vigoureusement jusqu’à la tombée de la nuit.
Braves travailleurs de Sévérac! Par un temps incertain, ils sont partis, ce matin, à pied, le plus grand nombre du moins, pour faire une route de cinq à six lieues. Et les voilà qui travaillent presque sans relâche, toute la journée, plus belle qu’on ne pouvait l’espérer. Et ils ne paraissent pas préoccupés du long trajet qui leur reste à faire, avant de prendre leur repos.
Encore une de ces paroisses où tous les hommes prennent part aux chants liturgiques. Très beau salut du Saint-Sacrement avant le départ.
7 décembre. — Les habitants de Donges répondent aujourd’hui à l’appel qu’est allé leur Taire le B. P. Directeur du pèlerinage lui-même.
Si le temps avait été plus sûr, ce matin, les travailleurs seraient venus, sans doute, en plus grand nombre ; mais ceux qui sont présents déploient une telle ardeur, un tel courage, que la somme de travail accompli à la fin de la journée n’en est pas moins considérable,
M. le Curé, présent au chantier, pendant tout le jour, donne, le soir, le salut du Très Saint-Sacrement.
9 décembre. — Ce n’était, la semaine dernière, que la première section de cette excellente paroisse. La seconde arrive aujourd’hui, en chantant un refrain que nous avons eu déjà occasion de citer :
Allons bon train !
Car le Calvaire est loin.
Et après une route si longue, monter pendant des heures les wagons chargés jusqu’au sommet de la colline! Vraiment un tel dévouement doit être admiré et ne peut rester sans récompense.
10 décembre. — Il y a huit jours, c’étaient les hommes, aujourd’hui, ce sont les femmes. Leurs noms couvrent trois pages du Livre d’or. C’est assez dire leur grand nombre. Mais, non moins remarquable est leur activité au travail. Il semble même qu’elles tiennent à le prolonger; et le jour a déjà bien baissé, quand elles se réunissent à la chapelle, pour chanter toutes ensemble les louanges du Dieu de l’Eucharistie, et recevoir sa bénédiction.
Paroisse de Missillac, village de Bergon
11 décembre. — Déjà nous avons fait ressortir le dévouement de Bergon pour le Calvaire, lorsque les hommes sont venus, le mois dernier. Aujourd’hui les femmes continuent la tradition et font preuve d’une grande énergie, en continuant un travail qui devient de plus en plus pénible et difficile, à mesure que l’on approche du sommet de la colline. Aucune lâche ne les effraie, aucun bloc de pierre ne les arrête.
15 décembre. — On avait oublié que, ce jour-là, tous les bras à Saint-Joachim sont occupés au transport de la motte, que l’on ne peut tarder plus longtemps à sortir de la Grande-Brière dont les eaux montent toujours. Aussi, les travailleurs qui ont pu venir sont-ils relativement peu nombreux. Ils n’en ont pas moins fait preuve d’une grande bonne volonté. Et ils ont demandé, eux-mêmes, qu’un nouveau jour leur soit assigné dans le courant du mois de janvier.
Paroisse de Pontchâteau. – Prairie de Casso
16 décembre. — L’excellente Frairie de Casso, malgré divers obstacles, nous envoie aujourd’hui un groupe assez nombreux pour fournir une bien bonne journée de travail au Calvaire. Ceux qui ont été retenus pourront se dédommager prochainement, quand la paroisse de Pontchâteau sera convoquée toute entière.
Paroisse de Saint-Gildas-des-Bois
17 décembre. — C’est une des belles et nombreuses réunions d’hommes. Et partout le travail s’accomplit dans un ordre parfait. Aussi, les résultats constatés, le soir, sont-ils excellents. Nous ne pouvons-nous empêcher de signaler parmi tous ces intrépides travailleurs les bons Frères de la Doctrine chrétienne. C’est leur jour de congé qu’ils emploient ainsi, eux dont les autres jours sont remplis par les travaux si fatigants et si pénibles de la classe.
18 décembre. — Honneur aux braves qui sont venus, ce jour-là, et qui sont repartis bien décidés, malgré les fatigues de la journée et de la route, à tenir la promesse qu’ils avaient faite d’assister à l’exercice du Jubilé qui devait avoir lieu, le soir même. Cette circonstance était ignorée lors de la convocation.
21 décembre. — Ce n’est qu’une section de cette grande paroisse, sous la conduite de M. l’abbé Warron, vicaire. Evidemment, les braves Campbonnais qui ont une réputation à soutenir ne nous disent pas aujourd’hui leur dernier mot. Nous les reverrons bientôt à l’œuvre; et même si nous ne nous trompons pas, avant la fin de cette année 96.
Ce matin, un léger manteau de neige couvre la terre. Le travail sera-t-il possible au Calvaire? Telle est la question qui se pose en ce moment, sous bien des toits en Saint-Roch et en Saint-Guillaume ; car les femmes de ces deux paroisses, ont rendez-vous pour aujourd’hui. Encore si le ciel gris s’éclaircissait un peu ! En réalité, cette éclaircie a lieu, mais seulement vers dix heures. Pour celles qui ont une ou deux lieues à faire, il est trop tard pour se mettre en chemin. Cependant, par divers sentiers, on voit arriver, par groupes de deux ou trois, les plus voisines. Elles sont bientôt assez nombreuses pour qu’on puisse organiser le travail ; et la tâche accomplie à la fin de la journée n’est pas à dédaigner.
Les autres sont appelées à se dédommager bientôt.
23 décembre. — C’est la dernière journée de cette série de l’Avent que nous ayons à inscrire. Les habitants de Pontchâteau, et, il faut le dire, tout particulièrement nos plus proches voisins, la clôturent dignement.
Mentionnons parmi ces braves travailleurs M. du Bois, conseiller d’arrondissement.
Impossible de ne pas signaler aussi ce groupe de jeunes garçons, qui, pendant que les autres sont occupés au chargement et au déchargement, ne cessent de monter les wagons, avec une activité incroyable et dans un ordre parfait.
†
Nous voudrions pouvoir dire en terminant que les travaux d’élargissement du Calvaire du côté Ouest sont achevés. C’est l’affaire de quelques jours encore, avant de mettre la main à la voie qui conduira au Saint-Sépulcre.
N° 5 Février 1897
Travaux du Calvaire
Interrompus seulement par les fêtes de Noël, ils n’ont pas attendu le nouvel an pour être repris. Et, bien que la température ait été des plus variables, avec ses tempêtes de vent, de neige et de pluie, c’est à peine si, deux ou trois fois, nos travailleurs volontaires n’ont pas paru au jour marqué, arrêtés qu’ils étaient par l’impossibilité absolue de se mettre en chemin. Nous ne pouvons guère faire autre chose, ici, que d’inscrire les noms des différentes paroisses qui ont ainsi montré un courage, un dévouement au-dessus de tout éloge.
28 décembre. — Plus nombreux que la semaine précédente les Campbonnais, sous la conduite de M. l’abbé Warron, vicaire, se montrent en tout dignes de la réputation qui leur est si légitimement acquise.
29 décembre. — La semaine dernière, c’étaient les hommes; aujourd’hui, ce sont les femmes de la ville et de la campagne, nombreuses et, comme toujours, pleines d’ardeur au travail.
30 décembre. — Le temps est très mauvais, mais n’a pu cependant arrêter un groupe de travailleuses intrépides, qui suppléent au nombre par leur activité infatigable.
Paroisses de Saint-Guillaume et de Saint-Roch
31 décembre. — Ce sont les femmes de ces doux excellentes paroisses, qui, nous n’avons pas besoin de le dire, rivalisent de zèle et d’ardeur, dans cette dernière journée de l’année 1896.
Un incident est à noter dans la soirée. Il arrive de temps en temps que de jeunes mariés, suivis de leurs invités, viennent, le jour même de leurs noces, ou le lendemain, faire un pèlerinage au Calvaire. C’était le cas. La compagnie était assez nombreuse et de la paroisse de Montoir. Tous témoignèrent le désir de prendre part au travail et de monter quelques wagonnées de terre ou de pierres au sommet de la colline. Ce qui leur fut, sans peine, accordé.
5 janvier. — Nous sommes heureux de revoir l’excellent Curé, M. le chanoine Maucler, à la tête de ses paroissiens. Ils sont nombreux et pleins d’ardeur comme ils l’étaient l’année dernière. M. l’abbé Mainguy, vicaire, prend part à tous les travaux de la journée.
7 janvier. — Comme elles sont nombreuses aujourd’hui, et désireuses d’accomplir une large lâche, les vaillantes chrétiennes de Saint-Joachim ! Pourquoi faut-il que, vers le milieu du jour, le soleil se cache, les nuages s’amoncellent et versent des torrents de pluie qui rendent tout travail impossible! Celui pour qui elles sont venues ne leur tiendra pas moins compte de leur grande bonne volonté.
Paroisse de la Chapelle-des-Marais
8 janvier. — Un petit groupe seulement d’excellentes travailleuses a bravé la pluie qui tombait encore drue, ce matin. Elles méritent bien d’en être félicitées.
11 janvier. — Sans être très nombreux, les hommes de Sainte-Reine donnent aujourd’hui une excellente journée de travail au Calvaire.
12 janvier. — Nous revoyons aujourd’hui les braves travailleuses de Besné. Elles n’ont pas oublié leur joyeux chant de marche au Calvaire du bon Père Montfort. L’élan qu’elles mettent à le redire est le même qu’elles déploient ensuite au travail. M. le Curé a été empêché. M. l’abbé Babin est là, aussi actif qu’à l’ordinaire.
13 et 19 janvier. — Le 13, c’était déjà une belle réunion de travailleurs, composée d’une partie seulement de la campagne. Mais le 19, nous relevons, sur le Livre d’or, cette note : « Journée exceptionnellement bonne. » II y avait le nombre, (la centaine environ), et aussi la qualité. Nous ne pouvons oublier de remercier M. de la Monneraye, qui, dans ces deux journées, a non seulement encouragé les travailleurs de sa présence, mais a largement payé de sa personne. M. l’abbé Lecerf, vicaire, a montré son dévouement dans la journée du 13. M. le Curé a exprimé son regret de n’avoir pu, comme il l’espérait, venir le 17.
14 janvier. — Les travailleurs de Saint-Joachim devaient être soumis à la même épreuve que les travailleuses de la même paroisse, il y a huit jours à peine. La pluie ne cesse pas. Néanmoins, dix-huit de ces braves veulent que leur voyage n’ait pas été inutile, et, dans l’impossibilité où l’on est de monter au Calvaire, vont à quelque distance extraire des blocs de pierre qui seront amenés plus tard et mis en place.
20 janvier. — C’est au nombre de plus de cent que les hommes de Férel ont suivi au Calvaire l’excellent Recteur qui leur est si dévoué. Arrivés de bien bonne heure, malgré la longue distance, ils ont entendu la messe dite par lui, dans la Chapelle du Pèlerinage. Quelques-uns, n’ayant pu trouver place dans les voitures, nombreuses cependant, étaient partis dès deux heures du matin, pour n’être pas eu retard. Après une bonne journée de travail, M. le Recteur a donné le Salut du Très Saint-Sacrement.
21 janvier. — Honneur au petit groupe d’excellents travailleurs qui a suivi aujourd’hui M. le Curé de Lavau au Calvaire, et qui a fait de si bonne besogne pendant toute la journée !
Village de Bergon, en Missillac
22 janvier. — Peut-on se lasser de louer le courage et le dévouement au Calvaire des bon Bergonniers, lorsqu’ils ne se lassent pas d’en donner de nouvelles preuves ? Il n’y a qu’à les voir encore aujourd’hui à l’œuvre.
25 janvier. — Le vénérable Curé d’Assérac peut être fier de cette belle compagnie de travailleurs qui l’accompagne, ici, aujourd’hui, et qui manœuvrent avec tant d’activité et d’ordre, en même temps. Ce jour-là, M. Gerbaud, qu’un deuil de famille vieil de rappeler à Nantes, était heureux de revoir un compagnon de collège et d’armes aux zouaves pontificaux, M. Berthelot de la Glétais, présider du Conseil de Fabrique d’Assérac, et qui avait bien voulu venir prendre part aux travaux du Calvaire
†
Nous terminons cette série par deux noms nouveaux :
26 janvier. — Saint-Omer est bien loin, mais dès qu’on lui a fait appel, il a su y répondre. Car on a du cœur dans cette bonne petite paroisse. Et puis tant de souvenirs rattachent le nouveau Pasteur au Calvaire ! Aussi voyez cette longue file de voitures qui débouchent au sommet de la côte. C’est près d’une centaine de travailleurs qui en descendent, tous pleins de bonne volonté et d’ardeur. Aussi, que de terre et de pierres remuées dans cette journée ! M. le Curé et son vicaire donnent l’exemple. A noter aussi l’attitude religieuse de ces bons habitants de Saint-Omer, lorsqu’au milieu du jour ils parcourent les diverses stations du pèlerinage, que la plupart ne connaissaient pas. Cette bonne journée se termine par le salut du T. S.-Sacrement.
Paroisse de Saint-Etienne-de-Montluc
28 janvier. — C’est vraiment une belle démonstration de sa foi et de son esprit chrétien que donne ici aujourd’hui cette grande et belle paroisse de Saint-Etienne-de-Montluc. Ils sont cent quarante hommes. A leur tête, M. le Curé-doyen, M. Dubois de la Patelière, maire, M. de la Biliais, M. le comte de Chevigné, M. l’abbé Renaud, vicaire. Ceux dont je viens de dire « à leur tête » seront pendant toute la journée mêlés aux rangs des travailleurs. Deux chantiers fonctionnent en même temps et admirablement bien. Non seulement la plate-forme du Calvaire est achevée, mais la voie qui conduit au Saint-Sépulcre est ouverte. Au milieu du jour, visite pieuse aux sanctuaires du pèlerinage. Le soir, salut du T. S.-Sacrement. Puis au départ, expression très marquée de la satisfaction générale, qui se traduit par les mots bien des fois répétés : Au revoir! A bientôt!
N° 6 Mars 1897
Première visite de Monseigneur l’Evêque de Nantes au Calvaire
Le dimanche, 7 février, Monseigneur, après avoir présidé l’office du matin dans l’église de Pontchâteau, arrivait au Calvaire dans l’après-midi, vers trois heures, et descendait à l’entrée de la Chapelle du Pèlerinage. Il y était attendu par la Communauté tout entière, et un certain nombre de fidèles des villages voisins.
Dès que Sa Grandeur a pris place au trône qui lui a été préparé, le R. P. Supérieur prend la parole, pour lui souhaiter la bienvenue, et solliciter une bénédiction spéciale pour chacune des Œuvres que dirige, ici, la Compagnie de Marie. « Et d’abord, l’Œuvre du pèlerinage, l’Œuvre du Calvaire, dont la fondation remonte au Bienheureux Montfort lui-même, qui choisit la lande de la Madeleine, pour en faire un centre de dévotion à la Croix et au saint Rosaire, œuvre plus vivante que jamais, surtout depuis le jour où le saint missionnaire a été placé sur les autels. Puis, l’Ecole apostolique, née au pied du Calvaire, il y a vingt ans, et d’où sont sortis déjà plus de soixante prêtres, pour la plupart apôtres-missionnaires. Enfin, le noviciat de la Compagnie de Marie qui est venu, depuis deux ans, prendre ici la place du Grand-Séminaire d’Haïti, par lequel sont passés, pendant vingt-cinq ans, presque tous les prêtres des vastes diocèses de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Les Sœurs de la Sagesse, les Frères coadjuteurs de la Compagnie de Marie, chargés des soins du matériel dans la maison, ne sont pas oubliés. »
Dans sa réponse si pleine de paternelle bonté Monseigneur n’oublie non plus personne. Il a des encouragements pour tous. Il fait pour tous les vœux les meilleurs ; et ses bénédictions s’étendent à tous les membres de la famille du Bienheureux Montfort. Il se dit heureux lui-même, de fouler en ce moment, ce sol béni, sur lequel un saint, l’apôtre de la Bretagne et de la Vendée, a laissé des traces si profondes.
Immédiatement, les vêpres sont chantées, Sa Grandeur au trône, assistée par le R. P. Supérieur et par M. le Curé-doyen de Pontchâteau.
Les vêpres terminées, c’est le moment où dix jeunes apostoliques doivent recevoir le sacrement de Confirmation. Avant de le leur donner, le représentant de Jésus-Christ, le successeur des Apôtres leur rappelle les effets merveilleux de ce Sacrement, quels dons précieux apporte à une âme cette venue de l’Esprit-Saint, quels grands devoirs en découlent, de quels sentiments ils doivent être animés en ce moment, eux surtout qui se destinent à être un jour des apôtres.
De cette allocution substantielle et touchante, il n’est du reste, personne dans l’auditoire qui n’ait à tirer profit, quelque conclusion pratique pour lui-même.
C’est le vénérable marquis de Montaigu qui a bien voulu servir de parrain à chacun des confirmants.
Tout l’office s’achève par la bénédiction solennelle du Très Saint-Sacrement.
Le jour a déjà baissé ; mais comme il reste encore quelque temps avant le repas du soir, Monseigneur monte jusqu’au Calvaire, d’où le regard embrasse un si vaste horizon, et d’où il peut jeter un coup d’œil d’ensemble sur le pèlerinage. La visite aux diverses stations est renvoyée à demain, dans la matinée.
Vers la fin du dîner, un jeune novice, qui se proclame, lui-même, bien novice en poésie, lit quelques strophes inspirées par le cœur, qui sont applaudies par l’assistance et qui lui valent de la part de Sa Grandeur un gracieux merci.
Avant de prendre du repos, Monseigneur veut bien encore honorer de sa présence la petite séance qu’ont préparée de leur mieux, les enfants de l’école apostolique.
Le lendemain matin, la Communauté tout entière est réunie pour assister pieusement à la messe dite par Sa Grandeur dans la Chapelle du Pèlerinage. Et voici qu’assez peu de temps après la sortie de la chapelle, on entend à quelque distance et se rapprochant un chœur de voix bien nourri, accompagné de quelques instruments.
Ce sont les travailleurs de Crossac qui montent en colonne, quatre de front, l’allée des tilleuls, et forment bientôt un vaste demi-cercle dans la cour d’honneur. Tous ont le pic ou la pelle levée sur l’épaule.
Lorsque Monseigneur apparaît, un immense Vivat s’échappe de toutes les poitrines.
On peut se demander si jamais général venant passer la revue d’un bataillon d’élite fut accueilli avec une fierté aussi joyeuse. Car, ils sont fiers les travailleurs de Crossac, de l’honneur bien mérité du reste, qui leur a été fait, en les invitant à venir, ce jour-là, au Calvaire. Monseigneur ne peut adresser, pour le moment, que quelques bonnes paroles à ceux qui l’approchent de plus près, mais il promet à tous de les revoir tout à l’heure au chantier même.
Le R. P. Barré, directeur du pèlerinage, laisse à d’autres pour le moment, le soin d’organiser le travail. Du reste, telle est l’ardeur et la bonne volonté de tous, que cette organisation n’aura rien que de très facile. Il accompagne Sa Grandeur dans sa visite aux diverses stations, sur la lande de la Madeleine, à Nazareth, à Gethsémani, au Prétoire, d’où l’on remonte au Calvaire, en suivant la Voie douloureuse.
Dans ce trajet qui dure environ une heure, il lui est donné non seulement de montrer les travaux déjà accomplis, mais aussi de donner une idée de ce qui reste à faire pour l’exécution complète du plan projeté.
Nous pouvons dire que, chemin faisant, Monseigneur a témoigné plus d’une fois sa satisfaction. Et ce qui n’est pas moins une marque précieuse d’intérêt, il a bien voulu donner sur divers points, notamment sur la disposition des groupes de la Voie douloureuse, des conseils dont on ne peut manquer de tenir compte en temps voulu.
Cependant, grande est l’activité sur tout le chantier, et Monseigneur, en y arrivant, peut constater par lui-même que les instruments de travail ne chôment pas. Mais, il convient qu’il y ait suspension d’armes quand il monte au Calvaire. Aussi, sans qu’il soit besoin de donner un signal, il se voit bientôt au sommet de la colline, au pied même des croix, entouré de très près par nos deux cent cinquante travailleurs.
Soudain, une voix entonne le refrain bien connu:
Dieu le veut ! et Montfort est l’écho de sa voix,
Dieu le veut! Soyons tous les amis de la Croix.
Et ce refrain, et le chant tout entier, qui respire une foi si vive, est redit par toutes les voix, avec un entrain admirable.
Monseigneur, visiblement ému, sans doute parce qu’il sent battre autour de lui des cœurs de chrétiens vraiment animés des sentiments qu’expriment leurs voix, laisse à son tour échapper de son cœur des paroles, que n’oublieront pas ceux qui les ont entendues.
Avec quel accent il conjure ceux qui l’entourent de s’attacher de plus en plus à leurs champs, à leurs chaumières, et surtout d’y garder toujours ce trésor de la foi, plus précieux que toutes les richesses. Non, ce n’est pas l’abondance des richesses dont on abuse trop souvent qui fait le bonheur. Son souvenir se reporte en ce moment vers d’autres contrées, où naguère encore régnait l’abondance, la richesse, mais où, malheureusement, Dieu, l’auteur de tous les biens, était de plus en plus oublié. Le châtiment est venu, le phylloxéra a ravagé ces contrées, ruiné ceux qui vivaient dans l’abondance, hélas ! et sans les ramener à Dieu. Qu’ils sont donc à plaindre ceux qui n’ont pas les consolations de la foi, et qui ne tournent pas leurs regards vers le Ciel ! Ah ! il n’en est pas ainsi, qu’il n’en soit jamais ainsi dans cette contrée bénie, évangélisée autrefois par le Bienheureux Montfort !
Deux cent cinquante voix répondent par cet autre refrain :
O Montfort, ô Bienheureux Père,
Nous saurons conserver la foi des anciens jours,
Dignes de nos aïeux qui suivaient ta bannière,
Nous jurons d’être à Dieu toujours.
et le chant tout entier qui se continue ainsi :
Nous le jurons, ô sainte Eglise,
Nous serons toujours vos enfants.
Pleins d’amour, d’une foi soumise,
Nous suivrons vos enseignements !
De tels moments passent vite, et l’heure est déjà venue où Sa Grandeur doit quitter le Calvaire, mais pour y revenir… bientôt nous l’espérons. Travailleurs, novices, enfants de l’Ecole apostolique, sont réunis pour recevoir sa bénédiction, et l’acclament tous ensemble une dernière fois.
Aux lecteurs de l’Ami de la Croix qui portent tant d’intérêt à l’Œuvre du Calvaire, nous nous reprocherions de ne pas faire connaître ces paroles de Monseigneur s’adressant, avant son départ, aux Pères de la Communauté : « Pour votre grande et belle œuvre, que je connais maintenant, vous pouvez compter sur moi, je suis avec vous. »
Travaux du Calvaire
Le beau temps est revenu et les jours vont en croissant. Aussi, les travaux avancent-ils très rapidement. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que la voie qui descend du sommet du Calvaire au Saint-Sépulcre étant bientôt terminée, on va pouvoir, dans quelques jours travailler au Saint-Sépulcre même.
L’élan est toujours le même ou plutôt va toujours grandissant. Le R. P. Directeur du Pèlerinage qui va, chaque dimanche, prêcher la Croisade, dans quelque paroisse, trouve partout le même accueil. Bon nombre de paroisses nouvelles sont déjà inscrites et vont nous venir. On parle même, en ce moment, d’un train spécial de Bretagne qui doit nous amener, bientôt, cinq cents travailleurs.
En attendant, honneur à ceux qui dans ce mois de février ont montré tant de dévouement et accompli une si belle lâche.
29 Janvier. Dire que cette dernière journée du mois de Janvier était réservée aux travailleuses de Crossac, c’est dire que rien n’y a fait défaut, ni le courage, ni le nombre. C’est aujourd’hui qu’on met, en quelque sorte la dernière main à la plate-forme du Calvaire. Le groupe du Dépouillement apparaît à sa place définitive, faisant le pendant de la Crucifixion, et ne se confond plus avec la douzième station.
4 Février. Dans les premiers jours de février, le temps a été tel que les travaux ont été interrompus forcément. Mais, ils sont repris aujourd’hui vigoureusement par un groupe d’environ soixante-dix hommes de la paroisse de Prinquiau. Décidément, la voie qui descend du sommet du Calvaire au Saint-Sépulcre est ouverte ; et tout fait prévoir qu’il suffira d’un assez petit nombre de journées comme celle-ci pour la mener à bonne fin.
Paroisse de Saint-Dolay (Diocèse de Vannes)
5 Février. Aussi nombreux au moins qu’étaient hier les travailleurs de Prinquiau, ceux de Saint-Dolay, sous la conduite de Monsieur l’abbé Burbau, vicaire, font preuve aujourd’hui d’une bonne volonté, d’un courage dignes de tout éloge. Ils montrent aussi qu’ils ont bon souvenir. Il est édifiant de les entendre psalmodier en chantant une dizaine du Rosaire, comme ils ont appris à le faire, dans cette belle mission qui leur fut donnée par ceux-là mêmes qui en ce moment, dirigent et partagent leurs travaux.
8 Février. C’est la grande et belle journée, dans laquelle les travailleurs de Crossac ont eu le bonheur et l’honneur de voir au milieu d’eux Monseigneur l’Evêque de Nantes. Il a bien voulu planter de sa main, à mi-côte de la colline trois yuccas, en l’honneur de la Très-Sainte-Trinité, a-t-il dit. Il a daigné aussi inscrire son nom sur le Livre d’or des travailleurs
Etaient présents, ce jour-là, M. le Curé de Crossac, M. le Maire, M. l’abbé Poisson, vicaire, qui, tout en dirigeant le chant des cantiques, a pris au travail une part très active.
Paroisse de la Chapelle-des-Marais
2 Février. — Toujours infatigables, les travailleuses de la Chapelle-des-Marais font avancer aujourd’hui considérablement la voie qui conduit au Saint-Sépulcre. C’est, si nous ne nous trompons pas, la troisième journée qu’elles donnent au Calvaire, depuis la reprise des travaux cette année.
11 février. — Les travailleuses de Sainte-Reine montrent aujourd’hui le même zèle et la même ardeur. Nombreuses et vaillantes, tout va admirablement bien.
15 février. — La distance est longue ; et cependant, malgré le temps incertain, une bonne petite troupe d’excellents travailleurs nous arrive de Camoël, d’assez bonne heure, et fait de très bonne besogne, pendant toute la journée. Encore une de ces paroisses, où l’autorité civile et religieuse sont bien d’accord. Nous en avons pour garant les signatures de M. le Recteur et de M. le Maire, apposées l’une à côté de l’autre sur notre Livre d’or.
17 février. — Quand il s’agit de Saint-Joachim, ce n’est plus sur une centaine de travailleuses qu’il faut compter. Elles sont bien aujourd’hui trois cents. Aussi, tout a été prévu en conséquence, de manière à ce que toutes soient occupées ou au chargement, ou aux wagons, ou à la chaîne par laquelle passent de main en main les pierres de moyenne grosseur. Chacune garde son rang, et l’ordre est parfait. M. le Curé est présent. M. l’abbé Blois, vicaire, qui a une réputation de travailleur à soutenir, ne quitte pas le chantier. Signalons aussi la présence des bonnes petites Sœurs garde-malades de la paroisse, pour qui cette journée semble être un agréable délassement de leurs occupations ordinaires parfois si pénibles et qui demandent tant de dévouement.
18 février. — Drefféac bien moins peuplé nous envoie aujourd’hui sa centaine de bonnes travailleuses. Il en est de bien jeunes, jeunes comme des écolières. C’est jeudi le jour du congé. Mais elles ne sont pas venues au Calvaire pour rester inactives. Et si elles veulent compter, ce soir, le nombre de fois qu’elles ont gravi la colline, avec leur panier à la main, l’addition pourra être assez longue.
19 février. — M. l’abbé Serrandour, vicaire, est venu aujourd’hui avec quelques bons jeunes gens de cette paroisse qui ont bien employé leur journée. Il nous fait espérer, dans un avenir prochain, un groupe de travailleurs plus nombreux.
22 février. — C’est la première paroisse qui nous vient, cette année, d’au-delà de la Vilaine. Du reste, Marzan tient fort bien, de ce côté, la tête de ligne, avec ses soixante-dix braves travailleurs. Monsieur l’abbé Martin, nouveau recteur, leur a dit la messe à la Chapelle du Pèlerinage, en arrivant, et donné le Salut du Très Saint-Sacrement, avant le départ.
L’un de Messieurs les vicaires est aussi présent.
Paroisses de Saint-Joachim et d’Herbignac
23 février. — Les hommes de Saint-Joachim qui arrivent sous la conduite de M. l’abbé Blois se trouvent renforcés par une section d’Herbignac, qui n’avait pas reçu de convocation, en même temps que le reste de cette grande paroisse. C’est la section qui avoisine le château de Kérobert. Aussi les jeunes Corbun de Kérobert sont-ils à la tête de cette escouade de travailleurs. On peut deviner quelle somme de travail est accomplie par ces deux troupes réunies, animées de la même ardeur, et fraternisant très bien ensemble.
Paroisses de Saint-Joseph-du-Dresny et de la Chevallerais
24 février. — Aujourd’hui encore deux paroisses, et deux paroisses nouvelles, se trouvent réunies fortuitement. La plus éloignée arrive la première, par le chemin de fer, il est vrai.
Elle s’annonce de loin, sur la route de Pontchâteau, par des sonneries de clairon que l’on entend dès avant huit heures.
Entre les sonneries de clairon, ce sont les voix qui redisent sur un air de marche très entraînant, des couplets improvisés :
Guidés par notre bon Pasteur,
Nous allons tous avec bonheur,
Voir le nouveau Calvaire
Qu’on dit si beau (bis)
Voir le nouveau Calvaire,
Qu’on fait à Pontchâteau.
Enfants de la Chevallerais,
Nous n’avons pas eu peur du frais,
Pour voir le Calvaire…
Ces braves et leur vaillant vicaire sont déjà au travail quand arrive Saint-Joseph-du-Dresny. C’est beau une file de trente voitures suivant celle du Pasteur qui tient la tête. Pontchâteau a pu voir que son ancien vicaire, M. l’abbé Macé, n’a pas tardé à conquérir les sympathies de la paroisse où il vient d’être nommé curé. Nous en avons eu plus d’une preuve dans la journée.
Voilà donc près de deux cents hommes réunis, tous pleins d’ardeur au travail. Le chantier du Calvaire est trop étroit. Dans l’après-midi une escouade de cent hommes au moins va, sur la lande, charger sur un traîneau les énormes blocs de pierre qui formeront le rocher du Saint-Sépulcre.
Dans les passages difficiles, les clairons sonnent la charge et l’obstacle est toujours franchi.
Cette belle journée se termine par le salut solennel du Très Saint-Sacrement donné par M. le Curé de Saint-Joseph-du-Dresny. Les clairons sonnent une fois encore en l’honneur du Dieu de l’Eucharistie.
25 février. — La paroisse de Donges, toujours dévouée et généreuse pour le Calvaire, est représentée aujourd’hui par plus de cent travailleuses. Et quelles travailleuses! Actives, courageuses, infatigables, chantant à ravir, tout en faisant glisser les wagons sur la pente étroite. Le nouveau vicaire de Donges, qui n’a pas oublié que sa bonne mère l’amenait tout enfant en pèlerinage au Calvaire, remplaçait dans cette journée son excellent Curé.
25 février. — Les paroissiens de Missillac sont mis à contribution en ce moment pour l’achèvement de leur belle église. Cela n’empêche pas une centaine de bonnes travailleuses de cette paroisse de nous donner cette excellente journée, la dernière du mois de février.
N° 7 Mars 1897
Les travaux du Calvaire
Pendant ce mois de mars, malgré les tempêtes et les pluies de la première quinzaine surtout, les travaux du Calvaire ont fait un véritable progrès. La voie qui descend du sommet du Calvaire au Saint Sépulcre, avec son prolongement qui traverse les douves, est à peu près terminée. Le Saint-Sépulcre lui-même est construit, voûté, entouré d’un solide blocage. Il ne reste plus qu’à le compléter par la chambre de l’Ange, qui lui servait d’entrée, et à enfermer le tout dans un vaste rocher. C’est à quoi va s’occuper M. Gerbaud qui nous arrive aujourd’hui.
Nommons maintenant les paroisses généreuses qui ont pris part à ces travaux, pendant ce mois, et qui, après avoir été à la peine, ont si bien mérité d’être à l’honneur.
Paroisse de la Chapelle-Launay.
1er mars. — Excellent début ! Mais nous ne saurions parler de l’activité et du dévouement des travailleurs de la Chapelle-Launay et de leur excellent Pasteur, sans nous répéter. Ils approchent de la centaine. Ce sont eux qui montent sur le Calvaire les statues de la XIIIe station, nouvellement arrivées.
4 mars. — Malgré le temps plus qu’incertain, une escouade d’excellents travailleurs, sous la conduite de M. l’abbé Aoustin, est venue de si loin et ne s’épargne pas à la besogne.
5 mars. — M. l’abbé Mouilleron vicaire de Vay, qui était à la tête de ce beau pèlerinage de travail, a signé le soixante-sixième, mais, comme il arrive souvent, des noms doivent manquer. Les travailleurs de Vay, que nous avions déjà vus à l’œuvre, l’année dernière, ont fait preuve aujourd’hui du même dévouement.
Paroisse de St-Malo-de-Guersac.
8 mars. — La dernière qui a signé sur le Livre d’or, a fait suivre son nom de ces mots : Pas de beau temps ! Elles en auraient si bien profilé les travailleuses de St-Malo, toujours si alertes et si actives. Leur dévouement ne mérite pas moins d’être loué, et n’en aura pas été moins bien agréé par le bon P. de Montfort.
9 mars. — C’est un nom nouveau. Le cercle s’agrandit donc toujours. Et quel beau pèlerinage de travail ! Cent hommes environ ! M. le Curé et M. le Maire, en tête. Les bons frères de l’école sont aussi présents. Le temps est beau. On tire du fond des douves deux énormes pierres qui doivent servir au Saint-Sépulcre.
10mars. — Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. MM. les abbés Rucher et Terrien, vicaires, nous disent que le mauvais temps du matin a empêché plusieurs de se mettre en roule. Honneur du moins, à ceux qui sont venus !
12 mars. — C’est toujours un beau bataillon d’hommes qui nous vient quand cette grande paroisse s’ébranle. En tête de la liste nous voyons les noms des deux vicaires de la paroisse et des deux adjoints de la commune, représentant la double autorité. L’ordre et l’activité dans le travail ne laissent rien à désirer.
Paroisse de Blain.
15 mars. — Les travailleurs de Blain n’ont pas à se féliciter d’avoir eu du beau temps, comme l’an dernier. La pluie tombait abondamment le matin. Sans cela, ils seraient venus plus nombreux, nous dit M. l’abbé Bourdel, vicaire. Ceux qui sont présents s’acquittent admirablement de leur lâche.
16 mars. — La paroisse d’Escoublac, distante d’environ huit lieues, est invitée à venir aujourd’hui pour la première fois. La nuit et le matin encore, c’est une tempête affreuse. Et, cependant, bon nombre de braves sont partis, ayant à leur tête leur courageux vicaire. Au milieu du trajet, la Grande-Brière a envahi la route ; et sur un espace de plus de cent mètres, les chevaux ont de l’eau jusqu’au poitrail. Et, contre toute attente, on les voit arriver au Calvaire. Et, contre toute attente aussi, le temps s’éclaircit et leur permet d’offrir au P. de Montfort, qu’ils ont en grande vénération, une bonne journée de travail.
Le R. P. Directeur du Pèlerinage a noté lui-même, sur le Livre d’or, cette journée dans laquelle les travailleurs étaient au nombre d’environ deux cents : Arrivée dès 7 heures du malin, au chant de l’Ave Maria. Messe dite par M. le Recteur. Travail sous la pluie et dans la boue. Courage admirable !
18 mars. — Encore un jour (que ce soit le dernier !) où il a fallu braver la pluie pour se mettre en route, le matin. C’est ce qu’ont fait les généreux travailleurs de Montoir. Une fois venus, ils ont eu une belle journée dont ils ont usé parfaitement, comme à l’ordinaire.
22 mars. — C’est d’au-delà de la Vilaine que nous viennent ces excellents travailleurs conduits par leur vicaire. La distance est longue, mais la foi bretonne est si généreuse. Ils en donnent bien aujourd’hui la preuve.
23 mars. — Journée superbe, avec un soleil d’été, et présidée par le vénérable Curé-Chanoine, M. Halgan. Les travailleuses Campbonnaises n’en sont pas à leur coup d’essai. Mais il semble qu’elles aient voulu se surpasser elles-mêmes, ce jour-là. Elles étaient environ deux cents. M. l’abbé Warron était aussi présent.
24 mars. — Cette journée ressemble en tout à la précédente. M. le Curé-doyen d’Herbignac, qui est présent, se montre heureux et fier du nombre, de l’activité de ses paroissiennes.
26 mars. — Le temps continue d’être beau. Aussi les travaux avancent-ils à vue d’œil, surtout avec une aussi vaillante troupe de travailleurs que celle amenée aujourd’hui par M. le Curé de Fégréac. M. de Barmon, adjoint de la commune, prend aussi part à cette journée.
29 mars. — Nous avons à inscrire, en terminant, encore un nom nouveau. Arrivés de bonne heure, les travailleurs du Coudray entendent d’abord la messe dite par M. le Vicaire. M. Gerbaud arrive à temps pour commander la manœuvre. Et ils mettent en place, dès la matinée, une des énormes pierres qui formeront l’entrée de la Chambre de l’Ange. Dans l’après-midi, après avoir parcouru pieusement les stations du pèlerinage, ils se remettent au travail avec une nouvelle ardeur.
Le nouveau groupe du Calvaire
Il y a un mois, nous annoncions l’arrivée prochaine du groupe de statues formant la treizième station de notre Chemin de Croix monumental. C’est, en effet, dans les premiers jours de mars que et envoi a été reçu.
La treizième station du Via Crucis s’intitule d’ordinaire : La descente de Croix, ou Jésus remis entre les mains de sa sainte Mère. On comprendra sans peine que nous ne pouvions pas représenter sur notre Calvaire la Descente de Croix proprement dite. C’est donc la remise du corps inanimé de Jésus dans les bras de sa divine Mère qu’on a là sous les yeux.
A ce sujet, il y a dans le récit de l’Evangile un mot qui doit être remarqué. Il y est dit que Pilate ordonna que le corps du supplicié fût rendu. Et, à qui rendu, sinon à Marie? C’est bien elle qui avait ici tous les droits. C’est le moment où Joseph d’Arimathie et Nicodème remettent avec un souverain respect, entre ses mains, ce dépôt sacré. Pour compléter la scène, aux personnages que nous venons de nommer, il faut joindre Madeleine, toujours là et qui prosternée, en ce moment, arrose de ses larmes, en y collant ses lèvres, une des mains du divin Crucifié.
L’emplacement, choisi pour ce groupe si émouvant, est la petite plate-forme qui s’étend devant l’entrée de la grotte d’Adam. Il se présente ainsi en face de celui qui descend du sommet du Calvaire, et juste au détour de la voie qui mène au Saint-Sépulcre.
Pour la vue d’ensemble, le nouveau groupe ainsi placé donne au côté-est de notre Calvaire une certaine ampleur, un relief qui semblait lui manquer. De plus, cette disposition permet, à distance, d’embrasser d’un seul coup d’œil, bien que distinctes entre elles, les quatre scènes du Calvaire: Le Dépouillement, la Crucifixion, la Mort sur la Croix et la Remise du corps sacré entre les bras de Marie.
On se souvient que sous le titre de Témoins du Calvaire, nous avons écrit quelques pages sur chacun des saints personnages qui ont eu une part spéciale dans ces différentes scènes. Il en est un, faisant partie du groupe dont nous venons de parler, duquel nous n’avons rien dit encore, mais que nous n’avons pas oublié. C’est l’aide pieux d Joseph d’Arimathie, dans les derniers devoirs rendu au corps sacré du Divin Sauveur, Nicodème. Il reparaîtra, du reste, dans la scène du Saint-Sépulcre. L’espace nous manque aujourd’hui, mais prochainement nous dirons ce que nous savons, par l’Evangile et la Tradition, de celui dont le nom est inséparable des grandes et dernières scènes du Calvaire.
N° 8 Mai 1897
Continuation des Travaux
Dans ce mois d’Avril, si riche en nombreuses fêtes, il s’est trouvé encore un certain nombre de jours pour la continuation des travaux du Calvaire. Il faut bien que le Saint-Sépulcre s’achève, que la colline tout entière prenne sa forme définitive, et que les voies, les sentiers qui donnent accès jusqu’à son sommet soient aplanis, rendus praticables pour tous. Il faut enfin que tout soit prêt pour la grande fête déjà annoncée pour le mois de septembre, et que S. G. Monseigneur l’Evêque de Nantes voudra bien présider lui-même.
Certes, avant d’en arriver là, il reste beaucoup à faire. Mais comment ne pas compter sur une bonne volonté qui, depuis si longtemps déjà, ne s’est jamais démentie ! Il reste encore plusieurs semaines avant l’ouverture de ce que l’on appelle les grands travaux des champs, et nous sommes certains qu’elles vont être, ici, bien employées.
Voici, inscrites à leur jour, sur le Livre d’or des travailleurs du Calvaire, les diverses paroisses qui nous ont apporté leur concours, depuis le 29 mars, date à laquelle se terminait la dernière chronique de l’Ami de la Croix.
30 mars. — Diverses causes ont empêché les excellents travailleurs de Bouvron de venir aujourd’hui aussi nombreux que nous les avons vus autrefois. Et cependant, il se présente un travail qui demande une dépense de forces considérables. Il s’agit de retirer du fond des anciennes douves une énorme pierre presque carrée et qui semble taillée tout exprès pour faire à elle seule un des côtés de la chambre de l’Ange, qui sert de vestibule au Saint-Sépulcre. Par exception, on fait appel à toute la maison du Calvaire. Novices, frères, apostoliques, tous, avec les braves Bouvronnais, mettent la main à la longue chaîne. Après de multiples et longs efforts, le monolithe apparaît, enfin, sur les bords de la douve, et au milieu des hurrahs est traîné triomphalement jusqu’à la place qui lui était destinée.
31 mars. — Ce jour-là, un certain nombre de travailleuses dévouées, de la paroisse de Pontchâteau, continuent les travaux de terrassement aux abords du Saint-Sépulcre.
1er avril. — C’est avec la même bonne volonté, la même ardeur, que les hommes de Saint-Victor, qui ont laissé ici, l’an dernier, le souvenir d’une si belle journée de travail, répondent aujourd’hui à un nouvel appel. Ils ont également à leur tête leur généreux vicaire, M. l’abbé Thomas, qui sait si bien souffler partout l’action et l’entrain.
2 avril. — Elles sont là, près de deux cents, les vaillantes travailleuses de Férel. Le grand nombre a trouvé des voitures pour venir. Mais, il en est un certain nombre, aussi, qui n’ont pas hésité à faire à pied la longue route de plus de cinq lieues. Et elles ne sont pas là pour se reposer. II n’y a qu’à voir avec quelle activité les wagonnets sont chargés, traînés, déchargés. Sur les rangs des travailleuses, tranche le blanc costume des Sœurs du Saint-Esprit, qui tiennent l’école des filles de Férel, et qui, là, tiennent à ne pas se laisser dépasser par leurs anciennes élèves en générosité et en dévouement. L’excellent Recteur de Férel qui donne, le soir, le salut du Très Saint-Sacrement, se montre particulièrement satisfait du succès de cette belle journée donnée après plusieurs autres, par sa paroisse, au Calvaire du Bienheureux Montfort.
6 avril. — Nozay est bien loin du Calvaire. Toutefois, environ cinquante braves ont répondu à l’appel qu’est allé leur faire entendre le R. P. Directeur du Pèlerinage. Leur vénérable Pasteur, M. le chanoine Sévète, a voulu les accompagner, et a tenu à leur dire la messe dans la chapelle du Pèlerinage. M. l’abbé Dejoie, vicaire, est aussi présent.
Bien peu des travailleurs connaissaient le Calvaire. Aussi, est-ce avec beaucoup d’intérêt et de piété qu’ils ont fait, au milieu du jour, la visite des diverses stations du Pèlerinage. Le reste du temps a été employé au travail très activement et fructueusement.
Paroisse de Saint-André-des-Eaux
8 avril. — Nous connaissions déjà le dévouement de cette excellente paroisse au Calvaire de notre Bienheureux. Mais quelle belle et nouvelle preuve elle nous en donne aujourd’hui ! Ils sont, là, 115 hommes venus des bords de la mer, d’au-delà de la Grande-Brière que plusieurs ont traversée en bateau de grand matin. Les autres sont venus en vingt-quatre voitures formant un superbe défilé à l’arrivée et au retour.
Le vénérable Pasteur de Saint-André-des-Eaux, que nous avons eu le bonheur de recevoir en pareille circonstance, n’a pu s’absenter aujourd’hui. Il est remplacé par son nouveau vicaire, M. l’abbé Philippe, qui certes est loin d’être un inconnu pour le Calvaire, et qui, nous le voyons bien, n’a rien perdu, en changeant de poste, de son activité et de son zèle. M. le Maire, M. l’Adjoint de Saint-André-des-Eaux sont encore aujourd’hui à la tête de leurs administrés. Nous n’avons pas à dire comment, dans cette journée, les travaux du Saint-Sépulcre avancent à vue d’œil. La fatigue n’empêche pas l’enthousiasme au retour. Et nous savons que, sur le long trajet, au passage du long défilé de voitures, les bourgs de Sainte-Reine, de la Chapelle-des-Marais et de Saint-Lyphard, ont retenti du chant des cantiques en l’honneur du Père de Montfort.
9 avril. — Encore une caravane qui nous arrive des bords de la mer. Mais aujourd’hui ce sont des femmes. Et combien actives et dévouées ! accomplissant des travaux qui sembleraient vraiment au-dessus de leurs forces, avec une gaité de bon aloi, qui ne se dément pas de toute la journée. La liste des signatures est longue. Elle doit dépasser la centaine.
Paroisse de la Chapelle-Launay
12 avril. — Plus longue encore est la liste des travailleuses de La Chapelle-Launay. Elle doit atteindre le chiffre de cent cinquante. Le bon Curé, justement fier du bon renom de sa pieuse paroisse, ne se trompera pas en comptant cette journée parmi celles qui peuvent y ajouter encore. C’est le sentiment de ceux qui sont témoins de l’activité, du dévouement, de la piété de ses excellentes paroissiennes.
21 avril. — Nous connaissions déjà les bons paroissiens d’Ambon, bien qu’ils habitent loin de nous, au-delà de la Vilaine. Ils sont aujourd’hui, ici, accomplissant religieusement leur pèlerinage de travail au Calvaire du Bienheureux Montfort. Dans l’absence du Recteur, ils sont dirigés par les deux vicaires de la paroisse.
23 avril. — Les hommes étaient venus, et ils étaient retournés si enchantés de leur pieuse excursion ! Il fallait bien que les femmes aussi eussent leur jour. M. l’abbé Aoustin, le nouveau Curé, n’a eu qu’à le fixer. Et elles sont venues au nombre de cent quinze. Beaucoup ne connaissaient pas encore le Calvaire. Elles en ont visité avec d’autant plus d’intérêt toutes les pieuses curiosités. Ce qui ne les a pas empêchées de fournir un travail considérable et de faire d’excellente besogne. M. le vicaire était aussi présent.
29 avril. — Au lendemain même du grand pèlerinage des travailleurs bretons dont il est rendu compte ailleurs, Savenay nous donne encore une très belle journée. Les travailleuses, aussi nombreuses que l’an dernier, sont animées de la même bonne volonté, et se montrent aussi généreuses. Elles ne se plaignent pas de la chaleur, bien que le soleil soit brûlant. Le R. P. Directeur du Pèlerinage est admirablement secondé, au chantier, par M. l’abbé Mainguy, vicaire de Savenay. On craignait de ne pas voir, aujourd’hui, le vénérable curé-doyen. Mais il arrive au milieu de la journée et la fête est complète. Il donne le salut avant le départ.
†
Bien que notre lande manque encore de verdure et d’ombrage, les pèlerins qui la visitent, en ce moment, peuvent voir que l’on n’a pas négligé de faire, à la saison, des plantations assez nombreuses. C’est un devoir de reconnaissance dont nous nous acquittons peut-être un peu tardivement, mais avec grand plaisir, de dire ici que bon nombre de ces arbres verts, épicéas, pins sapins, etc., sont un don fait au Calvaire par M. Agasse, horticulteur à Saint-Gildas-des-Bois.
Grand pèlerinage de travail au lendemain de la fête du B. Montfort 29 avril
Dans cette campagne vraiment glorieuse des travaux de restauration du Calvaire, qui dure depuis bientôt trois ans, cette date restera désormais célèbre, sous le nom de Journée des mille.
Ils atteignent, en effet, ce chiffre, les braves Bretons des cantons de Questembert, de Rochefort-en-Terre, d’Elven et d’Allaire, qui nous arrivent, ce matin, le cœur plein d’enthousiasme, et leurs instruments de travail à la main. En somme, onze paroisses, ayant à leur tête leurs recteur ou vicaires, prennent part à cette belle démonstration de foi. Ce sont les paroisses de Questembert, de Larré, d Molac, de Pleucadeuc, de la Vraie-Croix, de Malansac, de Pluherlin, de Saint-Gravé, de Caden, de Rochefort-en-Terre et de Peillac.
Au moment de l’arrivée, un léger brouillard, qu’un soleil brillant va bientôt faire disparaître, empêche de voir au loin.
Mais, déjà les chants des pèlerins se font entendre sur la route de Pontchâteau. La bannière du Bienheureux les attend au sommet de la côte, et est remise aux mains des jeunes gens, qui marchent en avant de la première paroisse. Nous assistons alors à un beau et pittoresque défilé. Chaque paroisse forme un groupe bien marqué, avec son clergé en tête. Nous remarquons aussi plusieurs bons Frères de l’Instruction chrétienne et des Religieuses de différentes Congrégations. C’est jour de congé.
N’oublions pas quelques séminaristes, dont les vacances de Pâques ne sont pas encore terminées. On nous dit aussi que plusieurs communes sont représentées par leurs maires ou adjoints, sans que nous puissions le constater, parce que ces Messieurs ne portent aucun insigne et sont confondus dans cette foule de pieux travailleurs pèlerins.
Presque tous ont été débarqués par train spécial à la gare de Pontchâteau. Un certain nombre, cependant, malgré la distance, ont préféré venir de Questembert en voiture et sont arrivés à la même heure. Mais, ce qui est assurément moins commun, c’est le fait d’un groupe de dix personnes, parti à pied de Questembert et attendant, dans notre chapelle, dès six heures, ce matin, l’arrivée des autres pèlerins.
Pendant que chaque groupe va déposer les paniers de provision et les instruments de travail à l’endroit qui lui est désigné, plusieurs prêtres se préparent à dire la sainte messe aux différents autels de notre Chapelle. La messe du pèlerinage est dite à l’autel principal par M. le Recteur de Malansac.
Mentionnons, ici, un regret exprimé par plusieurs, c’est qu’on n’ait pas songé à préparer l’autel de la Scala Sancta, comme pour nos jours de grande fête. On a beau se presser, la chapelle du Pèlerinage est vraiment trop étroite. Et, comme ces mille voix (car tous chantent) s’unissant en un seul chœur, et redisant les mêmes couplets, se seraient mieux déployées là-bas, en plein air! L’attitude de tous pendant le saint Sacrifice n’en est pas moins édifiante et recueillie.
Peu de temps après la messe, tous les groupes s’étant reformés, et marchant au chant des cantiques, font une courte visite aux divers sanctuaires du pèlerinage : Nazareth, Gethsémani, le Prétoire. Cette rapide mais pieuse excursion se termine en montant la voie douloureuse jusqu’au sommet du Calvaire. Et c’est là que le R. P. Directeur du Pèlerinage assigne à chaque groupe, à mesure qu’il y arrive, le poste qu’il devra occuper au travail, pendant la journée.
Pour mettre en mouvement une telle quantité de bras, il a fallu tout prévoir, diviser le travail en plusieurs chantiers différents, assez distants les uns des autres pour qu’il n’y eut pas embarras et confusion. De plus, la Direction habituelle des travaux qui se compose, avec M. Gerbaud, des RR. PP. Barré et Sarré, avait dû s’adjoindre quelques aides pour la circonstance. Heureusement, elle n’a pas eu à chercher bien loin. C’est avec la meilleure grâce du monde que nos excellents et proches voisins, M. Félix du Bois, conseiller d’arrondissement pour le canton de Pontchâteau, et M. Arthur de la Villeboisnet fils, ont accepté l’emploi.
Mais, comment donner une idée du coup d’œil que présente alors ce millier de travailleurs volontaires tous pleins d’activité et d’ardeur? Il en est qui portent le chiffre à douze cents, parce qu’un certain nombre sont arrivés plus tard, en prenant le train ordinaire.
De la place où nous sommes apparaît, au premier plan, le groupe dirigé par M. Félix du Bois. Serait-ce parce qu’il a dû plaider plus d’une fois, chaudement, la cause des chemins vicinaux, devant le Conseil dont il fait partie, que ce lot lui est échu ? Toujours est-il qu’il est chargé de tracer et d’ouvrir une large voie de dix mètres, reliant le Saint-Sépulcre à la grande route de Guérande. Le travail consiste surtout à rejeter sur les côtés la terre végétale qui sera remplacée par le gravier plus solide. Pour cela on pioche ferme, tout en chantant à pleine voix. C’est avec grand plaisir surtout que nous écoutons un groupe de jeunes gens, redisant avec tant de cœur les couplets du beau chant de l’Ouvrier chrétien, qu’on ne se lasse pas d’entendre, du reste, dans toutes les réunions de Patronages et Cercles catholiques.
Au second plan, en avant du Calvaire, c’est M. Gerbaud et son équipe de braves travailleurs. Sa tâche est, ainsi qu’il l’exprime lui-même, de dégager le pied de la colline de manière à lui donner plus de jour, plus d’élancement. Là, un grand nombre ont aussi la pioche en main ; mais il en est plusieurs qui sont armés de la cognée du bûcheron. Et, de temps en temps, on entend gémir un malheureux pin. Puis, sous l’effort de bras vigoureux qui tirent sur un long câble, on le voit chanceler un instant et enfin s’affaisser lourdement sur le sol. Avouons que ce ne peut pas être sans un certain regret qu’on voit disparaître ces témoins discrets et silencieux de tant de bonnes prières et pieuses méditations ; car plusieurs avaient déjà atteint un âge respectable. Il est vrai qu’ils avaient eu le tort de naître et de grandir pêle-mêle, les uns sur les bords, les autres au fond même des anciennes douves. L’évasement ou l’élargissement en pente douce, de ces mêmes douves, tel est le travail qu’accomplit dans cette journée la seconde équipe, en même temps que le déboisement dont nous venons de parler. Dès le soir, bien que ce travail soit inachevé, il est permis de juger que le résultat en sera bon pour l’effet général.
A gauche, aux alentours du Saint-Sépulcre, du côté du Calvaire qui regarde la forêt de la Madeleine, c’est un nombreux bataillon de travailleurs et de travailleuses commandé par M. Arthur de la Villeboisnet. Il s’agit, là, de remblais pour créer une plate-forme assez large, à la hauteur de l’entrée du Saint-Sépulcre. Ce qui fait la difficulté de ce travail, c’est qu’il faut tirer des côtés et du fond même des douves les matériaux de remblai. Sur un espace assez restreint règne une activité incroyable. Les uns piochent la terre, les autres avec des pelles en remplissent les paniers. Les paniers chargés passent de main en main jusqu’à l’endroit voulu, ainsi des pierres suffisamment maniables. Les plus grosses sont roulées à force de bras. Et tout ce mouvement a lieu sans désordre, sans confusion. A la fin du jour, le jeune Directeur de travaux improvisé est enchanté de sa troupe. Il nous disait, le soir, combien certains traits charmants de naïveté, de générosité l’avaient heureusement impressionné ans cette journée.
Mais c’est au flanc de la colline et sur la voie qui conduit au sommet que manœuvre encore la plus nombreuse troupe sous les ordres du R. P. Directeur du Pèlerinage. Là les wagonnets vont et viennent. Il y a des chargeurs et des déchargeurs. Et comme la pente est trop rapide, il faut encore se servir de paniers pour monter plus haut la terre qui sert à élargir la voie. C’est à cela que tous les bras sont occupés. Sur ce même terrain, dans la soirée, a lieu l’ascension d’un énorme rocher qui restera, au flanc de la colline, comme souvenir de la Journée des mille.
Enfin, un peu plus loin, sur la Voie douloureuse elle-même, une dernière escouade de travailleurs et de travailleuses est très activement occupée sous la direction du R. P. Sarré. Notre voie douloureuse, telle qu’elle est provisoirement, consiste seulement dans une couche de terre de trente à quarante centimètres, recouverte d’une seconde couche de cailloux de moyenne grosseur, qui simulent un pavé très primitif. A la longue, ce pavé menaçait de disparaître sous les plantes parasites qui l’avaient envahi. Un nettoyage complet était nécessaire. Voici comment on procède à ce travail minutieux et partant bien méritoire. Un premier groupe enlève une à une les pierres et les rejette sur un des côtés de la voie. Un second groupe suit armé de pics et de pioches déracinant les plantes et les rejetant aussi hors de la voie. Un troisième groupe enfin remet en place les pierres qui forment pavé de nouveau. Tel est le travail très méritoire, qui s’accomplit joyeusement, dans cette journée, sinon sur tout le parcours, du moins sur une bonne partie de la Voie-douloureuse.
Nous sentons bien que les indications que nous venons de donner sont insuffisantes. Elles ne donnent pas l’idée du spectacle que nous avons eu aujourd’hui sous les yeux. Il faudrait dire l’entrain, la bonne humeur, la joie de tous, et surtout l’élan de foi de toute cette foule.
Ajoutons que ces Messieurs ecclésiastiques dont le zèle avait préparé cette belle manifestation, dispersés sur tous les chantiers, payant de leur personne, témoignaient hautement leur satisfaction.
Au milieu du jour avait eu lieu la vénération des reliques du Bienheureux, et le salut solennel du Très Saint-Sacrement donné par le vénérable recteur de Larré couronne cette belle journée. Quelle touchante harmonie que ces mille voix de croyants n’en formant qu’une pour chanter le Dieu de l’Eucharistie !
Puis, c’est le départ, long défilé auquel nous assistons du pied même du Calvaire. Le dernier groupe est composé de jeunes gens, au milieu desquels, un jeune ecclésiastique, vicaire d’une des paroisses que nous avons nommées. Au sommet de la côte, le groupe tout entier fait un court arrêt. On entend ces trois acclamations : Vive Jésus-Christ ! Vive sa Croix ! Vive le Père de Montfort ! puis, ce dernier mot jeté vers le Calvaire, par des voix vibrantes : Nous reviendrons !
P.-S. — Nous regrettons de n’avoir eu que trop tard sous les yeux les pages écrites par M. Arthur de la Villeboisnet, dans son Journal, le soir même du 29 avril. On y trouve, avec des sentiments pleins de noblesse et de foi, des épisodes charmants qui prouvent bien le dévouement, la générosité des braves travailleurs bretons auxquels il commandait.
N° 9 Juin 1897
Travaux et pieux pèlerinage au Calvaire
Nous plaçons à dessein, sous un seul titre, le mouvement de travail et de piété dont la lande de la Madeleine a été témoin pendant ce mois. C’est qu’en réalité la distinction devient de plus en plus difficile. Pas de journée de travail qui n’ait de pieux exercices, et pas de groupes pieux de pèlerins, venus surtout pour prier, qui n’aient à cœur de mettre, au moins quelque temps, la main à l’œuvre, et qui n’ambitionnent l’honneur d’être inscrits au Livre d’or des travailleurs. Il n’y a pas même d’exception pour les noces endimanchées, qui, de temps en temps, viennent des bourgs voisins, en excursion pieuse, au Calvaire.
Ceci dit, voici, selon leur date, les journées qui, pendant ce mois de mai, ont eu au Calvaire, ce double cachet du travail et de la piété.
†
Mardi, 4 mai. — M. le Curé de Marsac qui, il y a un peu plus d’un mois, nous venait à la tête d’un si vaillant groupe de travailleurs, reparaît aujourd’hui avec les travailleuses de sa paroisse, non moins actives et dévouées. Marsac est loin du Calvaire ; bon nombre d’entr’elles ne connaissaient pas encore le pèlerinage. Aussi, est-ce avec un pieux intérêt qu’elles en parcourent processionnellement les stations, dans le temps de repos qui suit la réfection, au milieu du jour.
†
Mercredi, 5 mai. — La paroisse de Limerzel était déjà représentée, paraît-il, au grand pèlerinage breton du mois dernier. Ce qui n’a pas empêché le bon Recteur de nous amener aujourd’hui un beau groupe de travailleurs. Malgré la fatigue d’une longue route, il a voulu attendre l’arrivée des dernières voitures pour monter à l’autel et dire la sainte messe. Dans cette journée bien occupée, bon nombre de pierres moussues ont été amenées de loin pour former le rocher du Saint-Sépulcre.
†
Jeudi, 6 mai. — Nous avions vu, il y a peu de temps, les hommes de Nozay. Les femmes ont aujourd’hui leur tour. Elles l’emportent en nombre et ne le cèdent pas en bonne volonté, en activité. Pour le nombre, on nous donne le chiffre de cent trente-six. Toutes, venant par le chemin de fer, forment dès l’arrivée une véritable procession.
Tout se passe admirablement dans cette belle journée si bien remplie par le travail et la piété. Qu’il nous soit permis de dire que le zèle et l’activité de M. l’abbé Guillou, vicaire, ont eu une bonne part à cet excellent résultat.
†
Vendredi, 7 mai. — Paroisse de Saint-Lyphard — Il faut nous répéter, ici, nous contentant de dire que le zèle de Mlle Bretault-Billou pour l’œuvre du Calvaire est toujours le même, et que les généreuses chrétiennes, qui l’ont suivie pour donner une nouvelle journée de travail au bon Père d Montfort, sont toujours animées de la même ardeur Elles sont aujourd’hui une centaine. Elles prient elles travaillent, elles chantent, avec le même ensemble, le même élan que nous avons dû déjà noter plus d’une fois.
†
Lundi, 10 mai. — Ce sont les femmes de la Chapelle-des-Marais qui sont convoquées aujourd’hui pour donner une nouvelle journée de travail au Calvaire. Elles ont répondu en bon nombre l’appel, et leur activité est connue. Mais, elles ne seront pas seules à mettre dans cette journée, du mouvement et de la vie, sur la lande de la Madeleine. C’est aussi le jour choisi pour le pèlerinage annuel de la maison Saint-Jacques de Nantes. Ce pèlerinage compte au moins deux cents personnes.
Tous les âges y sont représentés, depuis les petits orphelins enfants de chœur, jusqu’aux pensionnaires les plus âgés. Les Sœurs de la Sagesse qui tiennent ce grand établissement y sont en nombre. Le vénérable aumônier, M. le chanoine Himène, dit la messe, pendant laquelle des pieux cantiques sont chantés. Sont aussi présents le R. P. Supérieur et le R. P. maître des Novices des Prémontrés de Nantes, accompagnés de quelques jeunes novices.
Vers le milieu du jour, tous sont réunis à la chapelle pour la procession d’usage, la visite aux diverses stations du pèlerinage. Avant le départ, le R. P. Augustin, Supérieur des Prémontrés fait entendre à l’auditoire si bien disposé qui est devant lui une allocution des plus touchantes, sur les souffrances de Notre-Seigneur, sur l’amour qui lui a fait accepter volontairement ces souffrances pour nous. Il rappelle aussi de quel amour de la croix et des souffrances était épris le B. Montfort. Et, c’est sous l’émotion de ces pieuses paroles que les pèlerins visitent successivement Gethsémani, le Prétoire et remontent la Voie douloureuse jusqu’au Calvaire. C’est là que, pendant le reste de la soirée, rivalisent, d’ardeur au travail les femmes de la Chapelle-des-Marais, et les pèlerins et les pèlerines de Saint-Jacques de Nantes.
Cette pieuse journée se termine par un salut solennel du Très Saint-Sacrement, donné par M. l’abbé Himène. Pour ce salut a été offert à la Chapelle un fort bel encensoir en cuivre doré. C’est le don d’un certain nombre de personnes de la maison de Saint-Jacques, très désireuses de venir aussi au Calvaire, et qui, en étant empêchées, ont voulu avoir ainsi leur part des grâces du pèlerinage.
†
Mardi, 11 mai. — Ils sont quarante braves venus de Pénestin, sous la conduite de leur excellent vicaire, remplaçant M. le Recteur. M. Geffriau, maire, est présent, ainsi que M. de la Roche et son fils. C’est une de ces journées dans lesquelles le travail se faisant avec beaucoup d’ordre, avance rapidement.
†
Mercredi, 12 mai. — Encore deux paroisses morbihannaises qui montrent bien leur dévouement, en nous venant de si loin. L’une est Berric, que nous n’avions pas vue encore, et l’autre Noyal-Muzillac que nous connaissions déjà.
Nous sommes heureux de recevoir, en même temps que les deux vénérés Recteurs de Berric et de Noyai, et leurs vicaires, M. le Doyen de Questembert, qui, n’ayant pu venir le 29 avril, avec ses paroissiens, a choisi ce jour-là pour faire sa visite au Calvaire. M. Le Gouvello, maire de Berric, est aussi présent.
†
Jeudi, 13 mai. —Paroisse de la Chevallerais. — A-t-on oublié les sonneries de clairons et le chant de marche si entraînant des vaillants travailleurs de la Chevallerais, nous arrivant ici au mois de février? Pour nous, nous nous rappelons très bien un couplet qui commençait ainsi :
Nos femmes viendront à leur tour,
Mais, il leur faut un beau jour :
Ce beau jour, elles l’ont véritablement aujourd’hui, les travailleuses de la Chevallerais, et elles en profitent pour se montrer, par leur activité et leur dévouement, dignes en tout de ceux qui les avaient annoncées. M. le Curé et son vicaire président à cette belle journée.
Le même jour, un petit pèlerinage de la Roche-sur-Yon, et un groupe de jeunes élèves du Collège des Eudistes de Redon se trouvaient au Calvaire. De part et d’autre on sollicita l’honneur de mettre la main aux travaux, et il fallait voir, en particulier, avec quelle ardeur les jeunes collégiens montaient et descendaient les wagons au flanc de la colline.
†
Vendredi, 14 mai. — Nous connaissions déjà les travailleuses de Saint-Gildas-des-Bois. Mais aujourd’hui elles semblent vouloir se surpasser elles-mêmes en activité et en dévouement. Journée très fructueuse.
†
Lundi 17 mai. — Paroisse d’Arzal. — Nous connaissons les travailleurs d’Arzal. Aujourd’hui ce sont les travailleuses, infatigables malgré la chaleur du jour. Félicitations à M. l’abbé Boudaud, vicaire, qui a montré lui-même dans cette journée tant d’activité et de zèle.
†
Mardi 18 mai. — Paroisse de Péaule. — Nous avons vu, d’autres fois, cette grande et chrétienne paroisse représentée, ici, bien plus largement qu’aujourd’hui. M. le nouveau Recteur et son excellent vicaire, M. l’abbé Jollivet, nous en donnent la raison. Tous les bras sont, en ce moment, occupés à l’ensemencement du sarrasin, ou blé noir, dont la récolte est si importante pour cette contrée. Ceux qui sont venus n’en méritent que plus d’être félicités pour leur bonne volonté et leur dévouement.
†
Mercredi 19 mai. — Paroisse de Crossac. — Il n’y a plus à louer les travailleuses de Crossac. Elles viennent aujourd’hui avec le même enthousiasme que tant d’autres fois. Elles-mêmes avaient demandé à offrir une journée au bon Père de Montfort, pendant le mois consacré à Marie.
†
Jeudi 20 mai. — Paroisse de Blain. — Par une chaleur accablante, plus de cent vaillantes travailleuses de cette paroisse montrent, dans cette journée, leur foi, leur piété et leur courage. M. l’abbé Bonnet, vicaire, paie largement de sa personne.
†
Mardi 25 mai. — Paroisse de la Roche-Bernard. — La petite ville de la Roche-Bernard est aujourd’hui représentée par environ soixante-dix travailleuses pleines de dévouement, et qui nous donnent le même spectacle édifiant qu’il y a peu de jours nous donnaient les travailleuses de Blain. M. le Recteur-doyen est venu, dans la journée, encourager ses pieuses paroissiennes.
†
Samedi 29 mai. — Paroisse de Saint-Victor. — M. l’abbé Thomas, vicaire, qui s’occupe si activement et si heureusement des œuvres rurales, nous avait, deux fois déjà, amené les braves travailleurs de Saint-Victor. Aujourd’hui c’est un groupe de travailleuses qui nous montrent bien la foi, l’esprit chrétien et le dévouement de cette excellente paroisse.
N° 10 Juillet 1897
Derniers travaux et pieux pèlerinage
Bien que la saison des grands travaux de la campagne soit déjà ouverte, quelques paroisses ont néanmoins tenu dans ces commencements du mois de juin à donner leur journée de travail au Calvaire, d’autant plus méritoire qu’il fait couler plus de sueurs, sous les rayons ardents du soleil.
Mardi, 1er juin. — C’est d’abord la grande et belle paroisse de Vay, représentée par quatre-vingts travailleuses bien décidées. Si les mains travaillent, les langues ne chôment pas. Hâtons-nous de dire que c’est surtout pour dire les louanges de Dieu et de son serviteur Montfort. Les couplets succèdent aux couplets, les refrains aux refrains. Il semble que le travail ainsi accompagné du chant est moins pénible; mais, surtout, il ne saurait être mieux sanctifié, puisque chacun de ces chants est une véritable prière qui monte du pied de la colline vers le Ciel. Le vénérable Pasteur de Vay est là au milieu de cette fraction d’élite de son troupeau, animant tout le monde au travail par son exemple. Il est heureux de clôturer, avant le départ, une journée si bien employée, par la bénédiction du Très Saint-Sacrement.
Mercredi, 2 juin. — Quelques personnes seulement venues du village de Bergon, en Missillac, continuent la tâche de la veille avec toute l’activité, le dévouement dont ce petit village nous a donné tant de fois la preuve depuis que les travaux du Calvaire sont commencés.
Jeudi, 13 mai. —Paroisse de la Chevallerais. — A-t-on oublié les sonneries de clairons et le chant de marche si entraînant des vaillants travailleurs de la Chevallerais, nous arrivant ici au mois de février? Pour nous, nous nous rappelons très bien un couplet qui commençait ainsi :
Nos femmes viendront à leur tour,
Mais, il leur faut un beau jour :
Ce beau jour, elles l’ont véritablement aujourd’hui, les travailleuses de la Chevallerais, et elles en profitent pour se montrer, par leur activité et leur dévouement, dignes en tout de ceux qui les avaient annoncées. M. le Curé et son vicaire président à cette belle journée.
Le même jour, un petit pèlerinage de la Roche-sur-Yon, et un groupe de jeunes élèves du Collège des Eudistes de Redon se trouvaient au Calvaire. De part et d’autre on sollicita l’honneur de mettre la main aux travaux, et il fallait voir, en particulier, avec quelle ardeur les jeunes collégiens montaient et descendaient les wagons au flanc de la colline.
†
Vendredi, 14 mai. — Nous connaissions déjà les travailleuses de Saint-Gildas-des-Bois. Mais aujourd’hui elles semblent vouloir se surpasser elles-mêmes en activité et en dévouement. Journée très fructueuse.
†
Lundi 17 mai. — Paroisse d’Arzal. — Nous connaissons les travailleurs d’Arzal. Aujourd’hui ce sont les travailleuses, infatigables malgré la chaleur du jour. Félicitations à M. l’abbé Boudaud, vicaire, qui a montré lui-même dans cette journée tant d’activité et de zèle.
†
Mardi 18 mai. — Paroisse de Péaule. — Nous avons vu, d’autres fois, cette grande et chrétienne paroisse représentée, ici, bien plus largement qu’aujourd’hui. M. le nouveau Recteur et son excellent vicaire, M. l’abbé Jollivet, nous en donnent la raison. Tous les bras sont, en ce moment, occupés à l’ensemencement du sarrasin, ou blé noir, dont la récolte est si importante pour cette contrée. Ceux qui sont venus n’en méritent que plus d’être félicités pour leur bonne volonté et leur dévouement.
†
Mercredi 19 mai. — Paroisse de Crossac. — Il n’y a plus à louer les travailleuses de Crossac. Elles viennent aujourd’hui avec le même enthousiasme que tant d’autres fois. Elles-mêmes avaient demandé à offrir une journée au bon Père de Montfort, pendant le mois consacré à Marie.
†
Jeudi 20 mai. — Paroisse de Blain. — Par une chaleur accablante, plus de cent vaillantes travailleuses de cette paroisse montrent, dans cette journée, leur foi, leur piété et leur courage. M. l’abbé Bonnet, vicaire, paie largement de sa personne.
†
Mardi 25 mai. — Paroisse de la Roche-Bernard. — La petite ville de la Roche-Bernard est aujourd’hui représentée par environ soixante-dix travailleuses pleines de dévouement, et qui nous donnent le même spectacle édifiant qu’il y a peu de jours nous donnaient les travailleuses de Blain. M. le Recteur-doyen est venu, dans la journée, encourager ses pieuses paroissiennes.
†
Samedi 29 mai. — Paroisse de Saint-Victor. — M. l’abbé Thomas, vicaire, qui s’occupe si activement et si heureusement des œuvres rurales, nous avait, deux fois déjà, amené les braves travailleurs de Saint-Victor. Aujourd’hui c’est un groupe de travailleuses qui nous montrent bien la foi, l’esprit chrétien et le dévouement de cette excellente paroisse.
N° 10 Juillet 1897
Derniers travaux et pieux pèlerinage
Bien que la saison des grands travaux de la campagne soit déjà ouverte, quelques paroisses ont néanmoins tenu dans ces commencements du mois de juin à donner leur journée de travail au Calvaire, d’autant plus méritoire qu’il fait couler plus de sueurs, sous les rayons ardents du soleil.
Mardi, 1er juin. — C’est d’abord la grande et belle paroisse de Vay, représentée par quatre-vingts travailleuses bien décidées. Si les mains travaillent, les langues ne chôment pas. Hâtons-nous de dire que c’est surtout pour dire les louanges de Dieu et de son serviteur Montfort. Les couplets succèdent aux couplets, les refrains aux refrains. Il semble que le travail ainsi accompagné du chant est moins pénible; mais, surtout, il ne saurait être mieux sanctifié, puisque chacun de ces chants est une véritable prière qui monte du pied de la colline vers le Ciel. Le vénérable Pasteur de Vay est là au milieu de cette fraction d’élite de son troupeau, animant tout le monde au travail par son exemple. Il est heureux de clôturer, avant le départ, une journée si bien employée, par la bénédiction du Très Saint-Sacrement.
Mercredi, 2 juin. — Quelques personnes seulement venues du village de Bergon, en Missillac, continuent la tâche de la veille avec toute l’activité, le dévouement dont ce petit village nous a donné tant de fois la preuve depuis que les travaux du Calvaire sont commencés.
Paroisse de Bouée
Jeudi, 3 juin. — Aujourd’hui, M. le Curé de Bouée nous arrive à la tête d’un groupe de vingt-cinq vaillantes travailleuses qui ne connaissaient pas encore le Calvaire. Aussi après s’être acquittées courageusement de leur tâche, c’est avec un pieux intérêt qu’elles parcourent les diverses stations du pèlerinage, sous la conduite du R. P. Directeur.
Paroisse de Beausse (diocèse d’Angers)
Ce même jour, les Enfants de Marie de la paroisse de Beausse, au nombre d’environ quarante, accomplissaient une pieuse excursion au Calvaire. Elles étaient conduites par M. le Curé de la paroisse et son vicaire. Dès leur arrivée, elles entendent la messe dite par le P. Sarré. C’est lui aussi qui les accompagne, pendant la journée, sur la lande de la Madeleine, donnant aux diverses stations les explications pieuses qui sont écoutées avec une religieuse attention.
Vendredi, 4 juin. — C’est, on peut le dire, la dernière grande journée de travail de cette saison. C’en est le digne couronnement.
Les travailleuses de Nivillac dépassent de beaucoup la centaine. Elles déploient au travail, selon leur habitude, une grande activité, et montrent partout leur grand esprit de foi.
Le vénérable Recteur est, à bon droit, heureux et fier de présider et de bénir cette belle réunion.
7 juin— Ce jour a toujours été fêté d’une manière spéciale au Calvaire, et marqué par l’affluence de nombreux pèlerins. Cette année, la Compagnie d’Orléans leur accordait une réduction importante. Beaucoup en ont profité venant de Nantes, de Riantec (Morbihan), de Saint-Nazaire. Mais, ceux venus en voiture d’au-delà de la Vilaine, nous semblent encore plus nombreux. Ils viennent de Penerf, d’Ambon, de Muzillac, de Damgan, etc. Du diocèse de Nantes, outre Nantes et Saint-Nazaire déjà nommés, le Croisic, Notre-Dame-des-Landes, sont particulièrement représentés.
Comme toujours, lorsque les pèlerins sont trop nombreux pour être réunis à la chapelle, la messe est dite à la Scala Sancta, décorée pour la circonstance. Le célébrant est M. l’abbé Gourier, recteur de Pénerf, dont les paroissiens forment un groupe considérable. On y entend les cantiques usuels du pèlerinage toujours chantés avec un entrain admirable ; quand, soudain, de nombreuses voix entonnent un refrain dont les paroles sont pour nous une énigme; mais, nous devinons du moins que c’est un de ces pieux chants bretons, dans cette vieille langue celtique, qui se prête si bien à la poésie, et surtout à la poésie religieuse. Chose curieuse, il nous semble que les couplets succèdent aux couplets, la foule toute entière prend part au refrain, tant il est chantant. On se croirait, un instant, transporté sous les voûtes de la grande basilique de Sainte-Anne d’Auray.
Il est bien entendu qu’à la cérémonie du soir, les chants bretons alterneront avec les chants français, et ils auront le même succès.
Le temps est des plus favorables pour le déploiement de la procession, en l’honneur du Bienheureux Montfort. Sa statue est portée en triomphe, au milieu d’oriflammes, par un groupe de jeunes gens. Très vibrantes sont les acclamations à Jésus-Christ, à sa Croix, au Père de Montfort, jetées du haut du Calvaire. M. le chanoine recteur de Riantec, qui a présidé la procession, donne le salut du Très Saint-Sacrement, à la Scala. Impossible de ne pas voir sur tous les fronts, à la fin de cette belle journée, l’expression d’une véritable et douce joie.
La journée du jeudi 10 juin Paroisse du Gavre, paroisse de Lavau
Pèlerinage des ouvrières fleuristes de St-Joachim
Cette journée mérite une mention particulière. Malgré la saison avancée, deux paroisses bien dévouées au Calvaire, celle du Gâvre et celle de Lavau, envoyaient, ici, chacune leur groupe de travailleuses bien dévouées. Bientôt les deux groupes n’en font qu’un. La chaleur est accablante; mais le courage et le dévouement triomphent de tout. M. le Curé du Gâvre est là, donnant l’exemple. Les instruments de travail ne chôment pas. C’est sur le nom de ces vaillantes que se ferme, pour cette année du moins, le livre d’or des travailleurs du Calvaire.
Ce même jour, d’un point opposé, arrivait au Calvaire, dans un ordre parfait, un pieux pèlerinage. Ce sont les jeunes ouvrières fleuristes de Saint-Joachim. C’est une pensée vraiment chrétienne et qui fait le plus grand honneur à M. Julien Mahé, directeur de cet atelier important, d’avoir donné à tout son personnel ce pieux congé. On peut dire que toutes les jeunes ouvrières, au nombre de quatre-vingt-dix, en ont profité pour venir au Calvaire.
A leur arrivée, la messe est dite à leur intention par M. le Curé de Saint-Joachim qui, en la terminant, leur a fait entendre une paternelle allocution. S’adressant à des ouvrières, c’est le travail des mains, la sanctification de ce travail qui en fait le sujet : « On glorifie Dieu de plus d’une manière, par le travail des mains comme par la prière. Ce travail est lui-même une prière, si on a soin de l’offrir à Dieu. Ne pas y manquer dès le matin, et souvent durant la journée.
» Pour que le travail glorifie Dieu, il faut de plus qu’il soit accepté avec résignation, sans jalousie.
» En regardant autour de vous, vous pouvez en voir qui peinent plus que vous : les mineurs au fond des mines, privés de la contemplation des beautés de la nature, dans des jours comme celui-ci.
» Sans doute, il en est qui, peut-être, vous sembleront plus heureux, parce qu’ils n’ont pas besoin pour vivre de recourir au travail des mains. Eux aussi ont leurs épines.
» Votre travail est un travail caché, et ressemble d’autant mieux au travail de Jésus, pendant les trente années de sa vie à Nazareth.
» Priez bien aujourd’hui le grand travailleur Montfort qui, en si peu de temps, a fait tant de grandes choses pour son maître Jésus, Montfort, à qui nos contrées doivent d’avoir conservé leur foi. Du haut du ciel, où il est maintenant, qu’il vous entende et vous obtienne la grâce de sanctifier toujours votre travail en l’acceptant avec résignation, en obéissant aux règlements de l’atelier qui demandent de vous l’activité et le silence. C’est pour bientôt, à la fin de votre vie, la récompense assurée à quiconque accomplit chrétiennement sa tâche sur la terre. »
Elles étaient capables de comprendre et de goûter ce langage, ces jeunes ouvrières qui, nous le savons, dans leur atelier, gardent fidèlement un règlement qui ressemble en plus d’un point aux règlements des communautés religieuses.
Après leur réfection, elles font ensemble, avec grande ferveur, leur visite aux stations du pèlerinage. Signalons seulement une attention gracieuse de leur part. A Nazareth, chacune d’elle vient déposer aux pieds de la bonne Mère un petit bouquet de fleurs confectionnées à l’atelier. Ces fleurs seront montées, et en ornant l’autel de la sainte Maison, rappelleront l’intention des pieuses fleuristes de consacrer leur travail à Jésus par Marie.
M. le Curé de Saint-Joachim avait dû quitter le Calvaire peu de temps après avoir célébré la sainte Messe. Il était remplacé, dans l’après-midi, par M. l’abbé Blois, vicaire. Sous sa conduite, et celle de leur excellent directeur, M. J. Mahé, les fleuristes, après avoir satisfait leur piété, vinrent prêter main-forte aux travailleuses du Gâvre et de Lavau, que l’on n’a pas oubliées.
†
A la date du 19 juin, une note mentionne sans détail le pèlerinage d’une trentaine de jeunes filles, conduites par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, et venant de Redon.
†
Pour achever de donner la physionomie de ce mois au Calvaire, rappelons que le mois de juin est le mois des examens pour brevets et certificats. On aime à invoquer, en pareille circonstance, celui qui a si bien mérité le titre d’Instituteur de l’enfance et de la jeunesse, et c’est ce qui explique, dans ces dernières semaines, la présence au Calvaire de divers groupes d’enfants, de jeunes filles, venus des paroisses environnantes et de Nantes même, conduits soit par un bon Frère de l’Instruction chrétienne, soit par de bonnes institutrices religieuses ou laïques.
Touchant cadeau offert à NOTRE-DAME-DE-NAZARETH
Le samedi, dans la soirée, 24 juin, veille du jour où nous célébrons, ici, la fête du Cœur très pur de Marie, ou nous invite à entrer à Nazareth, pour y voir un cadeau offert à la Reine et Maîtresse de céans… Oui Reine et Maîtresse, bien qu’on lise tout jours, en auréole, autour de son front, le titre qu’elle-même a choisi, de petite servante du Seigneur, Ecce ancilla Domini.
– D’où vient ce beau tapis, qui couvre le marchepied de son autel et s’étend jusqu’à son humble escabeau, semblable à un parterre émaillé de fleurs fraîchement épanouies?
– De la maison de Saint-Jacques de Nantes.
– Mais encore?… Dans ce grand établissement, il y a bien du monde, bien des catégories de personnes plus ou moins affligées, plus ou moins souffrantes ?
– Hé bien, vous savez, ces pauvres enfants, ces jeunes filles, desquelles on dit… quelles tombent…, c’est ainsi qu’elles-mêmes désignent leur mal…
– Ce sont elles?…
– Chacune a reçu son carreau d’étoffe et l’a décoré, brodé selon son goût ; et les carreaux réunis ont formé le parterre que vous avez sous les yeux.
Ici, de fraîches marguerites, là des boutons de rose qui s’entr’ouvrent, une touffe de lilas, beaucoup de myosotis. La bruyère qui fleurit si bien sur la lande de la Madeleine, n’a pas été oubliée. Çà et là, certains arbustes dont le type est peut-être introuvable dans la nature, et qui portent sur la même branche des fleurs de couleurs variées. Au centre, enfin, plusieurs corbeilles pleines de pensées veloutées, de frais liserons, de jolis bleuets.
Que de patience il a fallu dépenser, et quelle délicatesse dans les doigts agiles qui ont confectionné ce petit chef-d’œuvre !
Pauvres enfants, si vous voyiez avec quel aimable sourire la bonne Mère regarde, en ce moment, les gerbes de fleurs que vous avez répandues, avec profusion, à ses pieds ! Elle connaissait à l’avance votre dessein. Elle a compté chacun des coups d’aiguille qu’elle savait être pour elle.
Ce sera son tapis des jours de fêtes, de ces jours où elle aussi répand à profusion les grâces les meilleures. N’en doutez pas, ces grâces vous atteindront, iront jusqu’à vous. Puissent-elles diminuer, adoucir vos souffrances ! Du moins, elles vous aideront sûrement à les rendre de plus en plus méritoires pour le Ciel, où votre bonne Mère ceindra un jour vos fronts d’une couronne de fleurs bien autrement belles que celles de la terre et qui ne se flétriront jamais.
N° 1 Octobre 1897
Derniers travaux
Nous avons dit plus haut que, dans l’Ami de la Croix, se trouvait le compte rendu, jour par jour, des travaux du Calvaire. Nous nous reprocherions de passer sous silence ces dernières journées d’autant plus méritoires qu’elles ont été données au moment où, à la campagne, il y a du travail pour tous les bras.
†
La première de ces journées a été donnée le jeudi 12 août, par les vaillantes travailleuses de Saint-Joachim. Elles étaient nombreuses et ont tracé et aplani en peu de temps la large voie qui permet maintenant d’aller plus directement de Nazareth à Gethsémani et au Prétoire. Elles ont eu le temps encore de monter et de placer plusieurs pierres qui manquaient au couronnement de la colline.
†
La seconde journée est due aux femmes de Sainte-Reine, qui en ont donné bien d’autres. C’était le mardi 31 août, huit jours seulement avant la fête. Elles étaient aussi fort nombreuses. Leur travail a été surtout un travail de nettoyage, débarrassant les différentes voies de tout ce qui pouvait offusquer l’œil ou gêner la circulation. Elles s’en sont acquittées admirablement bien.
†
Mentionnons encore, à la date du 2 août, un groupe de personnes de Nantes, renforcé par un autre groupe venu de la Roche-Bernard. Ayant sollicité comme une faveur de pouvoir monter quelques wagonnets chargés au sommet du Calvaire, cette faveur leur fut accordée sans peine.
†
Enfin, une autre demande du même genre ne pouvait manquer d’être bien accueillie par le R. P. Directeur du Pèlerinage.
Neuf Filles de la Sagesse désignées pour la mission d’Haïti, où leurs devancières ont déjà fait tant de bien, en donnant l’instruction et l’éducation chrétiennes à une foule de jeunes Haïtiennes, avaient déjà quitté la Maison-Mère de Saint-Laurent pour aller s’embarquer à Saint-Nazaire.
Par suite d’un ajournement dans leur départ, elles durent passer quelque temps au Calvaire. Leur présence, certes, ne fut pas inutile pour les préparatifs de la fête, à laquelle elles assistèrent. Mais, le moment de s’embarquer venu, elles déclarèrent qu’elles aussi voulaient emporter, là-bas, le titre de travailleuses volontaires, et avoir leur pierre au Calvaire de leur saint Fondateur.
La pierre fut extraite de la carrière, chargée sur Wagon, montée et mise en place au sommet de la Colline. Si quelqu’une d’entr’elles, repassant un jour l’Océan, vient prendre, ici, quelque repos, elle pourra la reconnaître. Puissent, du moins, ces souvenirs être pour toutes un réconfort, au milieu de leurs travaux si pénibles, de leurs fatigues si accablantes !
Mlles furent aidées dans leur travail par un certain nombre de jeunes filles de la paroisse de Saint-Jean-de-Boiseau qui se trouvaient très opportunément, ce jour-là, en pèlerinage au Calvaire.
N° 2 Novembre 1897
Pour les Statues du Chemin de Croix
Il n’est presque pas de visiteurs qui après avoir parcouru, en compagnie de l’un de nous, le Pèlerinage et admiré les beaux groupes de statues déjà placés sur la Voie douloureuse, ne fasse cette question : « Et, quand compléterez-vous les autres groupes, quand achèverez-vous ce beau travail? »
— La réponse est toujours la même : — « Quand les ressources du Pèlerinage nous le permettront. »
— « Chacun de ces groupes complets doit, en effet, coûter fort cher !» — « Assurément, il faut compter pour chacun nue somme considérable. »
« Quel peut être le prix d’une de ces statues? »
« Il en est qui sont estimées plus, d’autres moins, mais on peut dire que la moyenne est de huit cents francs. » — « Et, il vous en faudrait encore…? » — « Une trentaine environ. »— « Des dons vous sont faits? » — « Sans doute quelques mains généreuses se sont ouvertes en faveur de notre Œuvre, et nous espérons que l’exemple qui a été si bien donné sera suivi, mais nous comptons beaucoup sur les modestes offrandes. »
Après cela, il ne peut pas y avoir lieu, n’est-il pas vrai? de s’étonner si l’on songe à recourir à un moyen bien connu de faire participer à la bonne Œuvre les plus humbles bourses : Une petite loterie Ou tombola, à vingt-cinq centimes le billet.
C’est; il est vrai, la seconde fois ; mais, la première date déjà de quatre ans. Nous venons, pour nous en assurer, de consulter la Collection des vieux Amis de la Croix. C’est le 10 septembre 1893 qu’eut lieu le grand tirage des billets, au milieu d’un concours très nombreux de pèlerins.
Ce fut un véritable succès ; et le résultat fut l’achat immédiat d’un certain nombre des grandes et belles statues de notre Chemin de Croix.
Il est certain qu’en les voyant, nul ne regrette se, vingt-cinq centimes, quand même il ne s’est pas trouvé parmi les numéros gagnants.
Au moment où nous écrivons ces lignes, la nouvelle loterie ou tombola commence, déjà à s’organiser. On prépare les lots, dont nous pourrons donner, dans un prochain numéro, une liste non dépourvue d’intérêt. On commence à distribuer des listes, et nous pourrions citer des aujourd’hui telles paroisses, où elles circulent et sont très bien accueillies, d’où même on a écrit pour en demander de nouvelles.
Tout présage donc, dès maintenant, un succès. Mais, pour que ce succès soit sérieux et complet, il nous faut, on le comprendra sans peine, le concours d’un grand nombre de bonnes volontés. Nous espérons bien que ce concours ne nous manquera pas.
Telles personnes auront la bonne pensée d’offrir un ou plusieurs lots. Les unes, en regardant autour d’elles, verront tel objet dont elles peuvent se défaire sans grande difficulté. D’autres songeront à en fabriquer elles-mêmes, de leurs mains. On sait qu’en pareil cas, vases, tableaux, vêtements, bibelots de divers genres, tout est accepté avec reconnaissance.
D’autres personnes dévouées à l’Œuvre du Calvaire, comme il en est certainement un bon nombre parmi les lecteurs et les lectrices de l’Ami de la Croix, voudront bien se faire zélateurs et zélatrices de l’Œuvre, en se chargeant d’une liste et en sollicitant les souscriptions de leurs proches, de leurs voisins, de leurs connaissances. Il y a déjà des listes prêtes, et les personnes qui se sentent cette bonne volonté sont instamment priées d’en faire la demande.
Tous enfin, selon leurs moyens, auront à cœur de contribuer à la bonne Œuvre. Le Bienheureux Montfort, qui ne manquera pas d’y mettre la main, fera le reste.
Il ne peut pas être question, en ce moment, de fixer un temps pour la clôture des listes, ni de marquer un jour pour le tirage des billets. On attendra sans doute le retour de la belle saison, et l’on a du temps devant soi; mais il est toujours bon de s’y prendre à l’avance, et plus tôt que trop tard.
Probablement, on songera à organiser une petite exposition des lots. L’Ami de la Croix tiendra ses lecteurs au courant de tout.
Toutes les précautions seront prises, cette fois, pour que les souscripteurs éloignés ne reçoivent pas trop tardivement les lots qui leur seront échus et auxquels ils ont droit de tenir, quelque minime qu’en soit la valeur, comme souvenir du Pèlerinage du Calvaire.
Et maintenant, à l’œuvre ! pour le triomphe de Jésus crucifié, et de son serviteur Montfort!
N°3 Décembre 1897
Travaux du Calvaire
²Ainsi que nous l’avons annoncé, la reprise des travaux a eu lieu pendant ce mois. Mais, pour diverses raisons, le R. P. Directeur du Pèlerinage a dû se borner à convoquer un petit nombre de paroisses, bien qu’un bon nombre aient témoigné le désir de venir, désir qui sera satisfait à bref délai.
Pour aujourd’hui, nous n’avons à enregistrer que six journées de travail. On peut en constater l’heureux emploi dès à présent, en voyant l’élargissement du sentier qui conduit de la plate-forme sur laquelle s’ouvre la grotte d’Adam, au sommet du Calvaire, dont l’accès est maintenant plus facile.
Paroisse de Saint-Malo-de-Guersac
Les braves travailleuses de cette paroisse avaient, croyons-nous, sollicité elles-mêmes l’honneur de donner cette première journée et de commencer la campagne. Elles ont bien montré qu’elles en étaient dignes par leur dévouement et leur ardeur au travail.
Mercredi 10 novembre. — Le nom de cette paroisse si dévouée ne pouvait tarder plus longtemps à paraître. Ce n’est pourtant guère que les hommes d’un seul village qui ont été convoqués, village qui mérite d’être nommé: Quémené. Et ils forment à eux seuls un groupe digne de représenter une paroisse entière. M. le Maire de Crossac est à leur tête, et pour le travail ne cède son rang à personne. La vaillance de tous est connue.
Jeudi 11 novembre. — On avait oublié, paraît-il, de faire la convocation, comme il était d’ordinaire, du haut de la chaire, le dimanche. Pour y suppléer, les enfants des écoles ont été chargés de la faire connaître dans les différents villages. On voit que la commission a été bien faite. Mais, de plus, il est évident que bon nombre de fillettes ont profité de l’occasion pour solliciter la faveur d’accompagner la mère ou les grandes sœurs. Grandes et petites travailleuses montrent égale activité et bonne volonté.
Mardi 16 novembre. — Voici, certes, un beau bataillon de travailleurs sous la conduite de l’excellent Curé et du Vicaire de la paroisse. Quelle foi et quel dévouement ne faut-il pas supposer dans le cœur de ces braves chrétiens ! Il leur a fallu pour venir ici prendre le chemin de fer de bonne heure, au de la de Redon.
Ils ne s’épargnent pas à la besogne, déracinant et roulant des pierres énormes qui avaient résisté à d’autres bras. Ils les montent en chantant jusqu’au sommet de la colline. Ce soir, ils vont rentrer dans leurs demeures à une heure un peu tardive, mais heureux et contents, nous le savons, de cette journée donnée à Dieu et si bien sanctifiée par la prière et le travail.
Paroisse de Crossac
Mercredi 17 novembre. — Nous pensions bien que, la semaine dernière, ce n’était pour Crossac qu’un début, qu’un commencement. La compagnie des travailleurs d’aujourd’hui, recrutée dans une autre partie de la paroisse, ne le cède en rien à la première.
Cependant la chaleur est vraiment extraordinaire pour la saison. Lorsque, dans l’après-midi, nous traversons le chantier, nous voyons la sueur ruisseler sur tous les fronts.
Jeudi 18 novembre. — Ce sont les braves volontaires de Montoir en Bretagne. Ils méritent bien ce titre, se groupant, s’organisant eux-mêmes, demandant seulement qu’on leur assigne un jour à l’avance. Ici, travailleurs d’un côté, travailleuses de l’autre rivalisent d’ardeur. Ils ont donné, une fois de plus aujourd’hui, la preuve d’une foi bien vive, et d’une générosité au-dessus de tout éloge.
†
Le vendredi 19 novembre: Le temps a bien changé. Un brouillard épais entoure le Calvaire, et il n’y a pas de travailleurs annoncés pour aujourd’hui. Et cependant on entend de ce côté des chants animés. Puis, peu à peu, à travers la brume, on distingue des pioches qui se lèvent, des wagonnets qui roulent. Ce sont nos jeunes novices auxquels le R. P. Maître a jugé bon d’accorder cette distraction bien désirée. C’est une journée joyeuse et bien remplie pendant laquelle ils courent, chantent, travaillent avec tout l’entrain de leurs dix-huit ou vingt ans, et en vrais apprentis de la vie apostolique de Montfort.
N° 4 Janvier 1898
Travaux du Calvaire
Paroisses de Pierric et de Beslé
La première semaine de l’Avent a compté deux pèlerinages de travail vraiment remarquables. En ce moment, les paroisses voisines qui ont montré, plus d’une fois, leur zèle et leur dévouement, cèdent la place aux paroisses plus éloignées, qui n’ont étés invitées que plus tardivement.
Et celles-ci ont à peine entendu l’appel qu’elles y répondent avec enthousiasme.
Nous ne savons pas au juste la distance qui nous sépare de Pierric et de Beslé.
Mais nous savons que pour avoir la réduction au chemin de fer, il a fallu traiter avec les deux Compagnies de l’Ouest et de l’Orléans, et que pour arriver, ici, à huit heures, on s’est levé à deux heures du matin. Tous les obstacles ont été surmontés, toutes les difficultés vaincues.
Le premier bataillon, de quatre-vin-dix hommes, est conduit par M. l’abbé Grelet, vicaire de Pierric»
Le second ayant à sa tête, M. le Curé de Beslé en compte cent dix. Tous arrivent, en groupe, au Calvaire, leur outil sur l’épaule, et chantant joyeusement. Que dire de leur ardeur au travail ? C’est à peine si l’on peut suffire à leur tracer la besogne, tant elle est expédiée promptement.
L’un et l’autre groupe ont extrait, traîné des pierres énormes qui méritent d’avoir un nom : Ici la pierre de Beslé, là, la pierre de Pierric.
Dans ces belles journées, la piété a eu aussi sa large part. M. le Curé de Beslé a dit en arrivant la messe pour ses travailleurs. Au milieu du jour, la visite des stations du pèlerinage s’est faite au chant des cantiques redits par toutes les voix, formant un chœur vraiment imposant. Il en a été de même pour les chants liturgiques au Salut du Très-Saint-Sacrement.
L’accent même avec lequel tous, en partant nous disaient : Au revoir ! montrait assez combien ils étaient heureux et contents de leur journée donnée à Dieu et au B. Père de Montfort.
Paroisses de Crossac, de St-Vincent-sur-Oust et de St-Péreux
La seconde semaine de l’Avent a eu aussi ses deux belles journées de travail.
La première a été donnée, le mardi 7 décembre, par la paroisse de Crossac, dont le nom est déjà revenu deux fois sous notre plume depuis la reprise des travaux, cette année. Précédemment, quelques villages seulement avaient été convoqués ; mais aujourd’hui, c’est à tout le reste de la paroisse qu’il a été fait appel. Aussi, les travailleurs sont-ils nombreux. Que dire de plus de nos bons et excellents voisins ? On connaît leur attachement à la mémoire du saint missionnaire, qui, jadis transforma leur paroisse, leur confiance entière en son intercession, et leur dévouement pour l’Œuvre de son Calvaire. Ils en donnent une fois de plus aujourd’hui une preuve éclatante.
Ce sont de nouvelles recrues qui nous arrivent, le jeudi dans la même semaine.
Les paroisses Morbihannaises de St-Vincent-sur-Oust et de St-Péreux, qui autrefois n’en faisaient qu’une, ont formé ensemble ce beau bataillon de cent soixante-dix travailleurs volontaires. Comme équipe de travail, c’est beau. Comme chœur de chant, c’est magnifique. Nous savions déjà qu’à St-Vincent-sur-Oust, et à St-Péreux, tous chantent aux offices de l’Eglise, qui sont toujours très suivis. Mais, il faut les entendre, ici, à la messe, le matin, sur la lande dans la journée, et au salut du soir. En vérité, les chœurs formés à grands frais, dans certaines paroisses, ne valent pas cette masse de voix d’hommes chantant les hymnes de l’Eglise, ou les cantiques du B. Père de Montfort.
Quant au travail, inutile de dire que tant de bras vigoureux ont fait grande et bonne besogne.
M. le Recteur de St-Péreux était présent. M. le Recteur de St-Vincent-sur-Oust était représenté par son digne vicaire. Nous savons que ces Messieurs ont été très heureux du succès de la journée. Et les braves travailleurs qui venaient de voir le Calvaire une première fois, le quittaient en disant : Nous reviendrons !
Paroisses de Besné, de Guénouvry et de Ste-Reine
Dans la troisième semaine de l’Avent, les trois paroisses que nous venons de nommer ont donné chacune leur journée au Calvaire. Il en est deux, inscrites, depuis longtemps déjà, et plusieurs fois au Livre d’or des Travailleurs. Elles nous permettent bien de saluer tout d’abord Guénouvry qui nous vient, pour la première fois des bords éloignés de la Vilaine. Les bons habitants de Guénouvry ont répondu sans retard, et avec un empressement admirable au premier appel qui leur a été fait. Ils ont à leur tête en arrivant, et pendant toute la journée, leur excellent Pasteur et son jeune vicaire. Au travail, l’ordre est parfait. Ils sont prêts à tout, qu’il s’agisse de traîner les wagons pour achever certains terrassements au flanc de la colline, ou de tracer de nouvelles voies sur le terrain qui s’étend en face du Calvaire. Aux exercices religieux, tout est édifiant, toutes les voix s’animent pour chanter la Croix et les louanges du Bienheureux Montfort qu’ils invoqueront désormais plus souvent et avec une plus grande confiance. Bien que, nous dit-on, les travailleurs de Guénouvry habitent un pays très beau, et fort pittoresque, ils partent enchantés d’avoir vu notre lande qu’ils ne connaissaient que par ouï-dire, et qu’ils se proposent bien de revoir.
Dans les deux autres journées, Besné et St-Reine ont affirmé une fois de plus, leur bonne volonté et leur dévouement bien connu à l’Œuvre du Calvaire. Merci, en particulier, à M, le Curé de Besné et à son nouveau vicaire, que n’ont point arrêtés, ainsi que leurs braves, plusieurs ondées abondantes tombées, le matin.
Paroisses de Rieux, de St-Jean de la Poterie, de Drefféac, et villages de Casso en Pontchâteau.
La quatrième semaine de l’Avent a eu aussi ses trois journées de travail.
Pour deux de ces journées, le mercredi et le jeudi, c’étaient des travailleurs anciens et émérites qu’il nous était donné de revoir. Le froid assez rigoureux n’a pas empêché un certain nombre d’hommes dévoués de Drefféac et des environs de Casso de venir donner encore un bon coup de main pour l’achèvement des travaux du Calvaire.
La journée du mardi avait été plus mouvementée. C’étaient de nouveaux travailleurs, nous venant encore de l’excellent pays morbihannais. Les deux paroisses de Rieux et de St-Jean de la Poterie ont formé, pour ce jour-là, une belle compagnie de cent trente hommes : Les deux bons recteurs en ont confié la direction à leurs vicaires M. l’abbé Lafolye et M. l’abbé X…. Ils ont pris le train de Bretagne, à Redon, et parcouru d’un pas rapide le chemin de Pontchâteau au Calvaire, où ils arrivent à une heure bien matinale, pour la saison. La journée commence par l’assistance à la sainte messe.
Et, telle est l’ardeur au travail de ces braves bretons, qu’ils se plaindraient presque de n’avoir pas assez de pierres et de terre à remuer. C’est avec enthousiasme qu’ils acclament â plusieurs reprises la Croix et le Bienheureux Montfort.
Et le soir, en partant, ils redisent encore, avec entrain, les refrains de la journée.
N° 5 Février 1898
Les travaux
Nous venons de dire tout-à-l ‘heure, que les malades ont été, malheureusement très nombreux, pendant ce mois, dans toute la contrée environnante. C’est la raison pour laquelle les journées de travail ont été peu nombreuses, dans ce même laps de temps. Comment quitter le village, quand, presque dans chaque maison, il y avait quelque malade à soigner ?
Cependant, les pèlerins, qui, dès les premiers beaux jours du printemps, vont venir visiter le Calvaire, s’apercevront, au premier coup-d’œil, de changements et d’améliorations notables.
Tout d’abord le terrain qui s’étend entre le Calvaire et la route de Guérande, vient d’être entouré d’une clôture. Cette clôture n’est pas riche, mais suffisante pour empêcher les animaux qui passent continuellement sur la route, de s’approcher du Calvaire. Du reste, elle est provisoire, et disparaîtra lorsque la haie d’aubépine, qu’on vient de planter, et qu’elle protège, formera elle-même, une clôture verdoyante.
Entre les deux grandes voies dont, l’une n’est autre que la voie douloureuse, aboutissant au Calvaire, et l’autre donnant accès au Saint-Sépulcre, s’étend une vaste pelouse, coupée par de larges allées déjà tracées. Au point d’intersection de ces allées, un massif de fleurs tranchera sur la verdure. Les deux voies dont nous venons de parler, ont déjà leurs rangées d’arbres plantées.
Enfin, aux deux extrémités, il reste assez d’espace pour deux bosquets, qui encadreront le tout. L’un de ces bosquets est déjà, en partie aménagé.
Pour tout ce travail, il n’y a eu, pendant ce mois, nous l’avons dit, que quelques journées, mais très bien employées ; aussi, est-ce un devoir pour nous de les mentionner avec éloges :
Paroisse de Missillac 29 décembre
Les habitants de Missillac avaient, ces temps derniers, en construction, leur église. Leur concours devait d’abord aller là. Mais, maintenant cette magnifique église est achevée. Sa flèche d’une blancheur éclatante est un des points les plus remarqués dans le vaste horizon qu’on embrasse du haut du Calvaire. Missillac en donnant cette dernière journée de l’année 1897 a montré qu’il n’oubliait point le Calvaire du Bienheureux Montfort. Les travailleurs, malgré le temps peu favorable, étaient nombreux, et se sont montrés pleins de courage et d’ardeur.
Paroisse de Campbon 11 Janvier
Un appel fait aux Campbonnais est toujours entendu. Ils forment aujourd’hui, une belle compagnie de travailleurs excellents au milieu desquels, nous voyons M. l’abbé Varron, vicaire, toujours très actif, lui-même. Aucun travail ne leur est étranger. Ce sont eux qui font la clôture dont nous avons parlé plus haut, enfonçant solidement, à grands coups de masse, les pieux, tendant avec adresse les fils de fer. Ce sont eux aussi qui ont tracé, en partie, les allées de la pelouse.
Paroisse de St Roch 20 janvier
Ce sont aussi des travailleurs prêts à tout faire, que nos bons amis de la paroisse de St-Roch. Tandis que les uns achèvent le tracé des allées et le nivellement de la pelouse, les autres s’occupent de plantations. Les trous sont faits selon les règles. Chaque espèce de terre qui en est extraite est mise à part, celle qui doit recouvrir immédiatement les racines, et celle qui sera mise au ras du sol. On dirait vraiment des gens du métier.
*
Le lendemain, quelques-uns de nos bons voisins du village des Métairies, village spécialement béni autrefois par le Père de Montfort, sont venus continuer les plantations. Ils se sont acquittés de leur tâche avec la même dextérité que les travailleurs de la veille.
La dernière semaine de janvier dont nous ne pouvons pas rendre compte, dans le présent numéro, s’annonce comme devant être très avantageuse pour l’avancement des travaux.
Les Statues
Mais, avec l’avancement de ces travaux, ce que l’on désire très vivement, nous le savons, c’est de voir se compléter les groupes de notre chemin de Croix monumental, de voir mis en place ceux qui manquent encore totalement. Nous sommes heureux d’annoncer qu’on pourra voir prochainement la quatorzième station: Jésus porté au tombeau. Ce groupe qui se compose de sept grandes statues est complètement achevé et prêt à être expédié de la fonderie. Il est probable que nous le recevrons, dans les premières semaines du Carême, et qu’il sera en place, aux abords du Saint – Sépulcre, avant les fêtes de Pâques.
Nous ne le connaissons que par une photographie qui nous est passée sous les yeux. Nous en parlerons plus tard.
Il n’y aura plus ensuite à attendre que la première et la neuvième station. La première : Jésus est condamné à mort par Pilate, est déjà à l’étude, et la neuvième suivra, sans doute, dans un assez bref délai.
Il restera encore, il est vrai, à compléter plusieurs stations, et pour cela, un certain nombre de statues sont nécessaires.
Il ne faut pas s’étonner qu’une Œuvre aussi considérable ait demandé un laps de temps assez long, surtout si l’on sait qu’elle ne dispose d’autres ressources que celles mises, au jour le jour, à sa disposition, par ceux qui veulent bien s’y intéresser.
Mais, c’est surtout lorsqu’on est ainsi près d’atteindre le but, que toutes les bonnes volontés s’animent, s’encouragent mutuellement, et nous avons bien la confiance qu’il en sera ainsi.
N° 6 Mars 1898
Travaux
Le bienheureux Montfort, si mortifié pour lui-même, était, comme tant d’autres saints, très doux et plein de compassion pour les autres. Il paraît bien que cette année, il a dû plaider, en haut lieu, pour que ses chers travailleurs n’eussent pas trop à souffrir des intempéries de la saison. Pas une journée ne se termine, sans qu’on entende dire et répéter au départ : « Comme nous avons été favorisés ! Quel magnifique temps nous avons eu! »
Parmi ces journées, il en est qui ont été données par des paroisses dont nous avons transcrit le nom déjà bien des fois ; mais il est aussi des noms nouveaux que nous sommes heureux de voir sur notre liste, pour la première fois.
25 janvier. — Appelés dès la première heure, les hommes de la Chapelle-des-Marais sont bien de ceux sur lesquels on peut compter jusqu’à la dernière. Ils aiment le bienheureux Montfort, et restent toujours attachés à son Calvaire. On les voit exécuter aujourd’hui les travaux qui leur sont demandés avec l’ardeur et le savoir-faire que nous leur connaissons depuis longtemps.
26 janvier. — Tout ce que nous venons de dire des hommes de la Chapelle-des-Marais peut se dire aussi des braves travailleurs de Saint-Joachin. Il nous semble même qu’ils sont aujourd’hui plus nombreux que jamais. L’activité est grande, et ne fait que s’accentuer, lorsque M. l’abbé Blois, qui n’avait pu venir dès le matin, apparaît sur le chantier. La satisfaction est telle, à la fin de la journée, que plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une nouvelle convocation à bref délai.
27 janvier. — C’est pour la première fois que Cordemais se met en campagne, pour venir au Calvaire. Mais, comment cette expédition ne réussirait-elle pas, ayant à sa tête, les deux autorités religieuse et civile, M. le Curé et M. le Maire. Aussi, est-ce un succès complet. Les hommes de Cordemais ont travaillé à merveille, aux nivellements, aux plantations. Ils ont parcouru avec un intérêt marqué, les stations du pèlerinage que la plupart d’entre eux ne connaissaient pas. Ils partent, après le salut du soir, tous enchantés d’avoir donné cette journée au bienheureux Montfort. Celui-ci, nous n’en doutons pas, saura bien le leur rendre, en protégeant leurs cultures, si bien soignées, nous dit-on, que le blé de Cordemais est toujours réputé le plus beau de la contrée.
31 janvier. — Parmi les amis du Calvaire, il n’en est certainement pas de plus dévoués, de plus constants, de plus fidèles que l’excellent Curé de la Chapelle-Launay et ses bons paroissiens. Qu’ils soient bénis du ciel, une fois de plus, pour le concours qu’ils donnent encore aujourd’hui à nos travaux ! Quels braves gens, et quels excellents chrétiens, disent ceux qui les ont vus à l’œuvre, pendant la journée, ou qui, même, ont eu simplement l’occasion de leur dire un mot, en passant. Nous ne pouvons que nous associer à cet éloge.
3 février. — Nom nouveau, mais qui, assurément dès la première fois, mérite d’être mentionné très honorablement. Qu’on en juge : Ces bons bretons nous arrivent au Calvaire à une heure plus matinale que d’ordinaire nos proches voisins. Et nous savon cependant que Saint-Gorgon est bien loin d’ici, loin même de la voie ferrée. M. le Recteur nous donne l’explication : On s’est levé à deux heures du matin, il le fallait bien pour ne pas manquer lu train; et l’on s’est mis en chemin, qui à pied, qui en carriole, et à la gare, pas un inscrit ne manquait à l’appel. Et, en ce moment, tous dispos pour le travail, qui ne commencera, il est vrai, qu’après l’assistance à la messe dite par M. le Recteur. La journée est très animée, cela va sans dire. Les refrains de cantiques sont redits avec enthousiasme, aussi bien que les chants liturgiques au salut du Saint-Sacrement le soir, avant le départ.
Au revoir, et bon retour, braves travailleurs du Saint-Gorgon !
9 février. — Les travailleurs de Sévérac sont pour nous d’anciennes connaissances. Mais ils ont aujourd’hui à leur tête leur nouveau pasteur qui les guidera dans la bonne voie, comme l’ancien, ont il était, nous dit-on, l’ami et le confident. Sévérac montre bien, par cette excellente journée de travail, que rien n’est changé pour son attachement et son dévouement au Calvaire du bienheureux Montfort.
10 février. — Encore une de ces paroisses où le souvenir du bon Père de Montfort se conserve très vivant, et où il a des clients très dévoués. On le voit bien chaque fois que Donges est convoqué. Et il nous semble que les travailleurs sont aujourd’hui plus nombreux et plus actifs que jamais. M. le Curé est remplacé par M. l’abbé Oheix, vicaire, dont l’ardeur au travail ne saurait passer inaperçue dans la journée. Nous ne croyons pas commettre une indiscrétion, en nous passant le plaisir d’ajouter que nous avons aussi, dans cette journée, une preuve bien frappante que, dans le personnel des écoles laïques, il y a encore de bons et vaillante chrétiens.
Guenrouët
15 février. — Très heureux de revoir à la tête du groupe de travailleurs qui nous vient aujourd’hui M. l’abbé Babin, naguère vicaire à Besné, qui était de toutes ces brillantes journées de travail, présidées toujours, il est vrai, par son ancien curé. Il remplace à Guenrouët un autre ami du Calvaire le regretté M. Avenard. Si, en quittant Besné, il a gardé toutes les sympathies et son zèle pour l’œuvre du Calvaire, il retrouve dans les travailleurs d’aujourd’hui la même bonne volonté, le même dévouement que dans ceux qu’il accompagnait, ici, autrefois.
Théhillac
16 février. — C’est une paroisse morbihannaise d’en deçà de la Vilaine, qui nous vient pour la première fois. M. l’abbé Guyot, ancien vicaire de Férel, nouvellement nommé recteur, porte un nom qui n’est pas oublié dans la famille religieuse de Montfort. Il ne pouvait manquer d’accueillir chaudement le projet de faire concourir sa paroisse aux travaux du Calvaire. La population de Théhillac n’est pas grande, et des raisons particulières au jour, et d’imprévues, ont arrêté quelques bonnes volontés. Ce n’est donc pas une nombreuse troupe, mais un petit corps d’élite que nous avons, en ce moment, sous les yeux, et qui s’acquitte admirablement de sa tâche, à la satisfaction de tous, et en particulier du bon recteur. Du reste, Théhillac ne nous a pas dit son dernier mot.
17 février. — L’éloge des travailleurs de Saint-Gildas n’est plus à faire. Disons seulement que leur nombre aujourd’hui dépasse les prévisions du Père Directeur. On en profite pour mettre en place les énormes rochers, qui n’avaient pu être traînés, les jours précédents, à cause de l’insuffisance des bras. Etaient présents M. le Doyen, son vicaire, les bons Frères de la Doctrine Chrétienne, qui nous ont témoigné, plus d’une fois, qu’ils n’avaient pas du meilleur congé qu’une journée de travail au Calvaire.
Que de générosité on trouve parfois dans les hommes du peuple! Un brave ouvrier du chemin de fer, assistant le matin au départ, retenu par le devoir, et ne pouvant être de la partie, remet au Frère Directeur pour l’Œuvre du Calvaire, une pièce de deux francs, le prix de sa journée !
18 février. — Nous avons vu naguère les hommes du Saint-Roch, aujourd’hui ce sont des travailleuses qui nous viennent de la même paroisse. La tâche qui leur est confiée demande un soin spécial et semble aussi particulièrement leur convenir. Pour rompre la monotonie rocheuse des flancs de la colline, il faut un peu de verdure, et par conséquent quelques plantations. Des trous sont d’abord creusés, puis garnis d’une terre plus friable que les travailleuses apportent dans des paniers, et l’arbuste vient prendre la place qui lui est ainsi préparée. Tout cela se fait avec beaucoup d’ordre. Et, il ne reste plus qu’à faire des vœux pour que les lauriers, les aucubas, les fusains, les youcas reçoivent assez de fraîcheur pour prendre racine et prospérer.
Village de Bergon en Missillac
23 février. — Le jour des Cendres, après la pieuse cérémonie du matin, les travailleuses de Bergon, toutes si dévouées, continuent très heureusement les plantations d’arbustes commencées par les travailleuses de Saint-Roch. Elles y apportent la même ardeur, et le même soin. Et les flancs dénudés de la colline se transforment peu à peu.
Les bonnes travailleuses prennent tellement à cœur ces plantations, qu’elles s’engagent à venir nettoyer leurs parterres, comme elles disent, arracher les mauvaises herbes, etc.
24 février. — Il nous faudrait plus d’espace que nous n’en avons pour rendre compte de cette dernière et belle journée, qui n’est encore que commencée au moment où nous écrivons ces lignes. Ils sont cent cinquante hommes, tous munis de leurs instruments de travail, arrivant ici dès avant huit heures. Après une courte visite à la chapelle, et une halte à l’hôtellerie, on monte la colline pour acclamer la Croix. Puis les pioches et les pelles sont en mouvement. Nul doute que les derniers nivellements à faire autour du Calvaire ne touchent bientôt à leur fin. Dans la soirée, de gros blocs de pierre seront mis en place. Les plus forts ne résisteront pas à tant de bras vigoureux.
On comptait sur la présence du vénérable recteur doyen d’Allaire. Peut-être arrivera-t-il par un autre train. Il est remplacé, en ce moment, par H. l’abbé Lorgeaux, premier vicaire.
Nous ne disons rien de la piété de ces excellents chrétiens à la visite des diverses stations du pèlerinage. Leurs voix forment un chœur magnifique .m chant des cantiques.
†
En parlant des travaux du Calvaire, un don fait récemment mérite d’être signalé.
On comprend sans peine que, sur un chantier aussi animé, l’outillage s’use vite et a besoin d’être renouvelé.
Une bonne personne de Montoir voyant le triste état de la plupart des pelles anciennes, a eu la bonne pensée d’en faire déposer, ici, trente-six nouvelles, qui ont déjà rendu de très appréciables services.
Au nom de l’Œuvre, qu’elle soit remerciée !
†
Merci aussi pour les divers envois de lots qui ont eu lieu dans ces dernières semaines, notamment d’une caisse venant de Paris, admirablement garnie d’objets utiles et de bibelots intéressants.
N° 7 Avril 1898
Travaux du Calvaire
Paroisses des Fougerets et de Saint-Martin.
3 mars. — A mesure que les travaux du Calvaire approchent de leur fin, il semble que cette œuvre si belle suscite des actes de générosité et de dévouement de plus en plus admirables. Les deux paroisses que nous venons de nommer sont bien loin du Calvaire, et même à une grande distance de la voie ferrée. Cependant, l’administration du Chemin de fer d’Orléans a consenti à faire partir de Saint-Jacut, gare la plus rapprochée, le train qui d’ordinaire part de Redon pour Nantes. Même pour s’embarquer à ce point plus rapproché, il faudra partir dès deux heures du matin, et de meilleure heure encore. Quelques-uns même ne prendront pas de repos cette nuit ; mais tous sont fidèles au rendez-vous à l’heure fixée.
Ce pèlerinage de travail devait se composer uniquement d’hommes ; mais une circonstance non prévue, en fixant le jour, ne l’a pas permis.
C’était le jour de la révision au chef-lieu de canton. La compagnie d’Orléans, en accordant la faveur dont nous venons de parler, exigeait le chiffre de deux cents personnes. Ce chiffre a été bien vite dépassé lorsque les travailleuses ont été admises à se faire inscrire. Et c’est une procession très édifiante de deux cent soixante personnes que nous voyons arriver, dès avant huit heures, au Calvaire. Tous assistent pieusement à la messe dite par M. le Recteur des Fougerets. On y entend chanter de pieux cantiques ; et plus d’une fois dans la journée, les mêmes voix les feront redire aux échos de la lande. Bientôt, tous les bras sont en mouvement autour de la colline. D’un côté, le groupe des travailleurs, de l’autre le groupe des travailleuses qui rivalisent d’activité et d’ardeur. Il va sans dire que le temps est donné à tous pour satisfaire leur pieuse curiosité et leur dévotion en visitant les stations du pèlerinage, que tous, en partant, se promettent de venir revoir.
Outre M. le Recteur des Fougerets, étaient présents M. l’abbé Serviget, vicaire de Saint-Martin, et un de ces Messieurs vicaires de Malansac, que personne n’avait oublié au Calvaire, depuis la journée des mille, l’année dernière, journée dans laquelle il commandait un bataillon d’élite.
4 mars. — Nous avions vu, il y a quelques semaines, les travailleurs de Besné, nous ne pouvions tarder longtemps à voir les vaillantes travailleuses de la même paroisse. Elles se montrent aujourd’hui dignes de la réputation de foi et de dévouement qui leur est acquise et qu’elles ne peuvent manquer de conserver, sous la conduite de leur zélé Pasteur.
C’est pour la première fois que cette grande et belle paroisse vient apporter son concours aux travaux du Calvaire. Elle est certes bien représentée par cette compagnie de soixante-dix hommes bien détermines. M. l’abbé Loyer et M. l’abbé Lesage, vicaires, donnent admirablement l’exemple et encouragent de la voix. Et tous, à la fin de la journée, paraissent enchantés de la manière agréable et édifiante dont elle s’est passée.
Paroisses de Conquereuil et de Guenrouët.
11 mars. — Comme il est arrivé quelques autres fois, deux paroisses se trouvent à venir le même jour. L’inconvénient n’est pas grave, si même il y en a. Le terrain est assez vaste pour former deux chantiers, et la journée n’en sera que plus belle et plus animée.
M. le Curé de Conquereuil et son vicaire, M. l’abbé Durand, débarqués de bonne heure à Pontchâteau par le chemin de fer, arrivent les premiers, avec cinquante braves travailleurs. Un peu plus tard, ce sont deux cents travailleuses de Guenrouët qui apparaissent au Calvaire. Les bras ne manquent pas pour former la chaîne et faire passer les paniers chargés de main en main. Du reste, les femmes de Guenrouët sont habituées déjà à cette manœuvre, et tout se passe dans un ordre parfait. D’autre part, les hommes de Conquereuil s’acquittent avec autant d’adresse que d’activité des divers travaux qui leur sont demandés. C’est vraiment une journée très avantageuse pour l’avancement des derniers embellissements du Calvaire.
M. le Curé de Guenrouët, M. l’abbé Martin, son vicaire, aussi bien que ces Messieurs de Conquereuil, qui n’avaient pas encore assisté à un pèlerinage de travail, témoignent hautement de leur satisfaction.
17 mars. — C’est le jour de la Mi-carême, jour réservé, depuis plusieurs années déjà, aux volontaires si dévoués de Montoir. Leur piété envers le bienheureux de Montfort, leur ardeur au travail, leur générosité sont connus de tous nos lecteurs. Et bien qu’absent du Calvaire en ce moment, nous savons que cette journée a été pour eux, comme les précédentes, remplie d’édification et d’une douce joie.
État présent du Calvaire
Voici le retour de la saison des pèlerinages. Les pèlerins qui n’ont pas visité le Calvaire depuis l’année dernière pourront constater, en le voyant, qu’on n’a pas inutilement travaillé depuis à son achèvement, à son embellissement.
On se rappelle qu’à la grande fête du 8 septembre le sommet seul de la colline avait reçu sa formé définitive et son couronnement de statues représentant le Dépouillement, le Crucifiement et la Mort de Notre-Seigneur, que complétait le groupe touchant du corps de Jésus descendu de la Croix et remis entre les bras de sa mère.
Par ailleurs, les abords du Calvaire, le pied et les flancs de la colline, ne ressemblaient que trop à un vaste chantier, où l’on voit des amoncellements de terre et des matériaux divers jetés pêle-mêle. A peine si les deux voies d’entrée et de sortie offraient au visiteur un passage convenable.
Grâces à Dieu et au dévouement, à la constance de nos travailleurs volontaires, il n’en est plus ainsi.
Et, tout d’abord, les deux voies dont l’une est le prolongement de la voie douloureuse montant au Calvaire, et l’autre qui doit être suivie pour en descendre, en passant au Saint-Sépulcre, sont non seulement dégagées et aplanies, mais plantées d’arbres et d’arbustes qui, dès cette année, nous donneront sinon de l’ombre, du moins un peu de verdure.
Entre ces deux voies, devant le Calvaire, s’étend une vaste pelouse bien gazonnée, sillonnée de larges allées, et séparée de la route par une clôture, ce qui permettra aux pèlerins d’y circuler à l’aise, sans être troublés dans leur dévotion.
Sur les flancs de la colline, de petits sentiers bordés de cailloux et disposés de manière à laisser entre-eux d’étroits espaces où l’on a pu semer, planter quelques fleurs vivaces ou arbustes, achèvent de donner à l’ensemble l’aspect d’un monticule naturel.
Et, au moment où nous écrivons, on met la dernière main aux travaux du Saint-Sépulcre, et l’on pose à l’entrée le groupe de la quatorzième Station, la mise du Corps de Notre-Seigneur dans le tombeau, ou plutôt le Corps de Jésus porté au tombeau.
Absent du Calvaire en ce moment, nous regrettons de ne pouvoir donner d’autre détail à nos lecteurs sur ce beau groupe que l’indication des personnages qui le composent, d’après une photographie qui nous est passée sous les yeux. Mais cette énumération suffira à ceux de nos lecteurs qui ont déjà vu les autres groupes de notre Chemin de Croix monumental, pour s’en faire une idée.
Le corps de Notre-Seigneur étendu sur un linceul est porté par Joseph d’Arimathie et Nicodème, aidés tous les deux par le disciple bien-aimé, l’apôtre saint Jean. Suivent Marie, sa divine Mère, accompagnée de Marie-Madeleine et de Marie de Cléophas, toutes les trois dans l’attitude de la plus grande douleur.
Ce groupe doit donner à cette partie du Calvaire le cachet profondément religieux qui lui manquait jusqu’à ce moment, et l’on n’en approchera désormais qu’avec un souverain respect.
Une fête aura lieu dans le cours de la saison pour l’inauguration et la bénédiction de cette nouvelle station du pèlerinage.
En dehors du Calvaire, les pèlerins ne verront pas de changements bien notables. Nazareth, Gethsémani et le Prétoire, avec sa Scala Sancta, continueront d’attirer leur dévotion. Toutefois, la saison ne passera pas sans que le Prétoire se soit enrichi du groupe représentant la Condamnation de Jésus par Pilate. Et ce sera, croyons-nous, dans un bref délai.
On pourra remarquer aussi que dans plus d’un endroit les grandes avenues ont été aplanies, rendues plus praticables, et que de nombreuses plantations nouvelles d’arbres et arbustes promettent de l’ombrage pour les jours où le soleil darde ses rayons sur la lande.
†
Un dernier détail qui n’est pas sans intérêt pour les nombreux pèlerins du Calvaire. Outre l’abri qu’ils connaissent déjà et qui longe l’allée des tilleuls, une grande salle, nouvellement construite, largement aérée, pouvant contenir deux cents personnes, est mise à leur disposition, tous les jours.
N° 8 Mai 1898
Inauguration et bénédiction du Saint-Sépulcre
Un mot, maintenant, de la fête qui s’annonce et se prépare. Il s’agit de l’inauguration et de la bénédiction du Saint-Sépulcre, et en même temps du groupe représentant la XIVe station du Chemin de la Croix. Nos lecteurs connaissent déjà la composition de ce groupe. Joseph d’Arimathie, Nicodème et saint Jean portent à demi enveloppé dans un linceul le corps inanimé de l’Homme-Dieu. En arrière la Mère des douleurs, Marie Madeleine, et Marie de Cléophas forment le cortège funèbre.
Ce groupe placé à l’entrée même du Saint-Sépulcre achève de donner à ce monument le cachet profondément religieux qu’il doit avoir. Il a été admiré par les pèlerins du 28 avril ; et tous s’accordent à dire que l’ensemble est d’un grand effet.
La fête d’inauguration est fixée au lundi de la Pentecôte, 30 mai.
Comme à toutes nos grandes fêtes, il y aura ce jour-là, messe en plein air à la Scala, procession solennelle, et prédication.
Travaux du Calvaire
Grand Pèlerinage de travail du canton de Malestroit.
Ce nouveau grand pèlerinage de travailleurs bretons rappelle celui des mille de l’an dernier. S’ils n’atteignaient pas tout à fait ce chiffre, ils n’en étaient pas bien éloignés. Près de huit cents billets ont été distribués pour le train spécial, partant de, Malestroit. Et, de plus, un certain nombre de travailleurs pèlerins ont préféré, malgré la distance, faire le trajet en voiture.
Par suite d’un oubli fâcheux, de la part des agents de la Compagnie, la distribution des billets pour ceux qui faisaient partie du train spécial, n’a pu être faite qu’à l’arrivée en gare de Pontchâteau. Cette distribution a demandé un assez long temps et les derniers servis ont eu quelque peine à rejoindre le gros de la colonne en marche pour le Calvaire.
Le défilé sur la lande ne laisse pas que d’être brillant. Tout est préparé à l’avance pour la célébration de la messe à la Scala Sancta ; et la colonne, au lieu de descendre vers la communauté, se dirige immédiatement vers le monument du Prétoire, en suivant l’une des grandes allées de la Voie douloureuse. En tête, la musique instrumentale de Lizio ouvre la marche. Tout à l’heure, elle accompagnera et soutiendra très heureusement le chant des cantiques pendant la messe.
C’est toujours un beau spectacle que celui d’une foule pieusement recueillie, agenouillée sur le gazon de la cour du Prétoire, pendant que le prêtre office le divin sacrifice au sommet de la Scala. Ce spectacle qui se renouvelle, ici, de temps en temps, à aujourd’hui son cachet particulier. Ce sont des pèlerins travailleurs, et la plupart ont au bras le petit panier de provisions, et, en se courbant, s’appuient sur l’instrument de travail qu’ils ont à la main.
La messe est dite par M. le Curé-doyen de Malestroit. Lorsqu’elle est terminée, le R. Père directeur du pèlerinage, après avoir souhaité à tous la bienvenue, indique l’ordre de la journée. Il est un point qui ne peut être oublié, ni retardé plus longtemps. La plupart des pèlerins se sont levés de grand matin, et l’heure est déjà avancée dans la matinée et le besoin d’une réfection, avant de se mettre au travail, se fait généralement sentir, beaucoup s’installent simplement sur le gazon, non loin de la fontaine où se réunissaient jadis les travailleurs du P. Montfort. Les autres vont s’asseoir sous l’abri ou dans la nouvelle grande salle de l’hôtellerie du pèlerinage.
C’est un déjeuner bien court, et à peine a-t-on entendu les premiers sons de la musique instrumentale qu’on voit une longue colonne se diriger d’abord vers le Jardin de Gethsémani, puis se replier bientôt sur le Calvaire où, grâce à l’habileté de ceux qui en sont chargés, le travail s’organise en un clin d’œil.
Sur le devant du Calvaire, une très nombreuse équipe dirigée par M. Gerbaud travaille à l’achèvement de la pente douce qui doit remplacer les anciennes douves et donner plus d’élancement, plus d’élévation à la colline. Là les pioches et les pelles manœuvrent à l’envi.
Un peu plus loin une autre équipe, sous les ordres de M. A. de la Villeboisnet, est occupée à l’aplanissement d’une des allées latérales de la Voie douloureuse. Là, les wagonnets se chargent, roulent et se déchargent avec un entrain admirable.
Une colonne volante, conduite par le P. Sarré, disparaît un instant au-delà du Jardin des Oliviers ; mais c’est pour reparaître bientôt traînant, sur un chariot, un de ces gros blocs de pierre qui serviront de borne, aux diverses entrées de l’enceinte du Calvaire.
Enfin, le nombreux groupe des travailleuses, sous les ordres du R. P. Barré, fait merveille aux alentours du Saint-Sépulcre. Les paniers, chargés de la terre encore humide du fond de la douve, passent de main en main ; et la plate-forme du pieux monument s’élargit, s’aplanit peu à peu. Parmi les signataires de ce groupe, on pourra trouver répétés, sur le Livre d’or, plusieurs des beaux noms de la noblesse de Bretagne; et l’on a remarqué que celles qui les portent ne choisissaient pas au travail la tâche la moins difficile.
Pendant le second repas qui a été retardé jusqu’à 1 h. 1/2, pour mieux partager la journée, quelques nuages ont recouvert le ciel qui était si clair et si beau dans la matinée. Les braves travailleurs et travailleuses ne se laissent pas effrayer par quelques grains de pluie. Ils ont repris leur poste, et ne l’abandonnent qu’au moment où la cloche les appelle à la Chapelle du pèlerinage, pour le salut solennel du Très Saint-Sacrement, qui est donné par le vénérable recteur de Saint-Abraham.
A l’issue de la cérémonie, les nuages ont presque disparu, et le départ pour la gare s’effectue au milieu de grandes démonstrations de joie qui témoignent hautement de la satisfaction de tous.
Après ce court aperçu, qui ne donne assurément qu’une bien faible idée de la pieuse animation de cette belle journée de travail, il ne nous reste plus qu’à donner les noms des différentes paroisses morbihannaises qui y ont pris part.
Ce sont les paroisses de Malestroit, de Sérent, de Lizio, de Ruffiac, de Caro, de Missiriac, de la Chapelle, du Roc Saint-André, de Saint-Guyomard, de Saint-Abraham, de Saint-Marcel, de Saint-Laurent, de Bohal, toutes du canton ou du moins des environs de Malestroit.
Le plus grand nombre des prêtres attachés au service de ces différentes paroisses, recteurs oui vicaires, étaient présents. On remarquait aussi plusieurs Frères de l’Instruction Chrétienne, dont la Maison-Mère est à Ploërmel.
En terminant, nous croyons devoir adresser des félicitations particulières à M. le Recteur de Lizio, dont le groupe d’hommes était incontestablement le plus nombreux. Parmi eux les musiciens, dirigés par M. le Recteur lui-même, n’ont pas peu contribué à l’entrain et à l’éclat de cette brillante journée.
Du reste, il ne faudrait pas croire que ces braves jeunes gens n’ont pas fait autre chose que nous donner d’harmonieux accords, avec leurs instruments de musique. Nous les avons vus, après avoir soigneusement déposé ceux-ci sur le gazon de la pelouse, se mettre immédiatement à l’œuvre, en manier les instruments de travail, avec la même dextérité et la même ardeur.
Paroisses de Crossac et de Sainte-Reine.
L’éclat exceptionnel du grand pèlerinage di travail, dont nous venons de parler, ne doit pas nous faire oublier des dévouements plus modestes, mais assurément très méritoires.
Que de fois on a fait appel aux travailleuses des Villages voisins de Crossac et de Sainte-Reine ! Et, cette fois, c’est la veille au soir seulement que cet appel leur est parvenu. Le lendemain matin, elles sont là, remplies comme toujours de bonne volonté. Et le soir, malgré la fatigue, elles s’en retournent heureuses d’avoir accompli la tâche qui leur a été demandée, au nom du bon Père de Montfort.
11 avril. — Consacrer cette fête du Lundi de Pâques à un pèlerinage de travail, tandis qu’un trop grand nombre d’autres attirées par le bruit et la dissipation iront à l’assemblée mondaine de la ville voisine, telle est la bonne pensée qui amène aujourd’hui au Calvaire ce groupe choisi de femmes et des jeunes filles de la paroisse d’Allaire. Elles ont fait preuve, dans cette journée, d’une foi, d’une bonne volonté, d’un dévouement au-dessus de tout éloge. Nous tenons à dire que le pèlerinage de Saint-Nazaire, qui avait lieu ici le même jour, ne les y a point fait oublier.
Encore une paroisse du diocèse de Vannes qui a montré un dévouement admirable pour apporter son concours à notre Œuvre du Calvaire. Béganne est au-delà de la Vilaine. Pour venir, ici, en directe ligne, la distance est déjà grande. En voiture, c’est un long voyage à faire. Au jour fixé, les pèlerins travailleurs se sont partagés en deux groupes. D’un côté, ceux qui ont pu se procurer des voitures-, de l’autre, ceux qui ont résolu de faire la route à pied. Une rude épreuve attendait ces derniers. Arrivés sur les bords de la rivière, à l’endroit où l’on trouve d’ordinaire un bac qui transporte les voyageurs d’une rive à l’autre, on leur déclare que le passage est impossible à cause de la marée basse. Retourner sur leurs pas, ils n’y songent pas, et ils n’hésitent point à s’allonger de deux lieues pour trouver un gué, connu d’un certain nombre d’entre eux, et qui leur permet d’atteindre l’autre rive. Leur principale privation est de n’arriver ici qu’après la messe, dicte par M. le Recteur, qui faisait partie du premier groupe. Au travail, tous rivalisent d’activité, et c’est aussi l’un des jours où l’on a remarqué le plus d’élan et d’ensemble pour le chant des cantiques.
Paroisses de Saint-Péreux et de Saint-Vincent-sur- Oust.
Nous avions vu, il y a quelque temps déjà, les] travailleurs de ces deux paroisses morbihannaises. Il était bien juste que les femmes eussent aussi leur pèlerinage de travail. Certes, ce n’est pas en vain que les deux vénérables Recteurs de Saint-Vincent! et de Saint-Péreux leur ont fait appel. Elles sont du nombre de deux cents environ, formant une longue procession. La journée est comme à l’ordinaire remplie par les exercices de piété et par le travail. Et, le soir, au départ, toutes paraissent enchantées de leur pieuse excursion au Calvaire du Bienheureux Montfort.
Paroisse de Saint-Jean de la Poterie
26 avril. — C’est la dernière journée qu’il nous est permis d’enregistrer, presque à la veille de la fête du Bienheureux. Elle est une des plus méritoires. Il a plu pendant la nuit, et il pleut encore, au moins par intervalles, dans la matinée. Personne ne songe à s’en plaindre. C’est une pluie bienfaisante, dit-on de tous côtés. Mais le sol n’en est pas moins détrempé autour du Calvaire. Et le travail qui presse, en ce moment, ce sont des remblais autour du Saint-Sépulcre, dont la fête d’inauguration approche. Pour les remblais, il faut aller prendre la terre au fond des douves. Nos travailleuses y descendent hardiment, et forment différentes chaînes sur les bords escarpés. Partout règne une activité incroyable. Les pelles étant insuffisantes pour charger de terre les paniers, l’on en voit pour les remplir se servir tout bonnement de leurs deux mains. Le bon Recteur qui reçoit, à ce sujet, des félicitations, nous explique comment ses paroissiennes sont en effet mieux préparées que d’autres à un genre de travail qui nous semble si méritoire. Le nom même de Saint-Jean de la Poterie indique la principale industrie de sa paroisse. Là, bien des mains ont appris de bonne heure à pétrir l’argile qui prend ensuite la forme des divers ustensiles de ménage que tout le monde connaît. Mais le dévouement de ces vaillantes travailleuses ne mérite pas moins d’être signalé ; et nul doute que le Bienheureux Montfort, qu’elles sont venues, ici, honorer et invoquer, ne leur ait accordé, à elles et à leurs familles, sa protection spéciale.
N° 9 Juin 1898
La fête du lundi de la Pentecôte
Cette journée marque un nouveau pas fait vers l’achèvement complet du Chemin de Croix monumental, dont l’exécution se poursuit, depuis plusieurs années déjà, sur la lande de la Madeleine encouragée par des approbations et des sympathies toujours croissantes, et avec le concours de plus en plus généreux d’innombrables bonnes volontés.
A l’année prochaine, s’il plaît à Dieu, la grande fête de l’inauguration et de la bénédiction générale et solennelle ! C’était, aujourd’hui, l’inauguration et la bénédiction particulière du monument du Saint-Sépulcre, et du groupe de statues qui en fait comme partie, représentant la scène émouvante de Jésus porté au tombeau.
Le temps est à souhait, le ciel est légèrement voilé, mais il n’y a pas à craindre de pluie ni à se défendre contre les rayons d’un soleil trop ardent. Nous n’avons pas à refaire, ici, pour nos lecteurs une description qui ne serait que la répétition de celle de nos autres fêtes.
Le prédicateur de la journée, le R. P. Boutillier, de la compagnie de Marie, et de la résidence d’Orléans, a pris la parole, dès le matin, à la messe célébrée en plein air, à la Scala Sancta. Et c’a été pour faire entendre un beau et très instructif commentaire du texte sacré que l’Église redit plusieurs fois dans son office de la Pentecôte :
Loquebantur variis linguis Apostoli magnalia Dei. « Ici, comme à Jérusalem, depuis qu’un apôtre, le B. Montfort, est passé, tout redit, tout proclame les merveilles, les grandeurs, les magnificences de Dieu. Mais, c’est le devoir du chrétien de glorifier Dieu, non pas seulement ici, en chantant ses louanges, mais partout et toujours : Par la parole, sachant, quand il est besoin, affirmer sa foi, défendre les droits de Dieu méconnus, attaqués plus que jamais par l’impiété : Par la prière, qui est la grande force du chrétien, et sans laquelle nous ne pouvons rien : Par les actes, conformant toujours sa conduite à ses croyances ; la foi sans les actes est une foi morte ; la foi du vrai chrétien est une foi toujours agissante.
Heureusement, a fait remarquer le prédicateur, c’est bien cette foi que l’on retrouve, ici, accomplissant, comme au temps de Montfort, ces immenses travaux, avec un dévouement, un désintéressement incroyables, à ce point que, lorsqu’il lui est arrivé, bu loin, d’en toucher quelques mots, chacun se récriait disant : « Vous nous parlez du moyen âge… »
C’est un regret pour nous de ne donner à nos lecteurs qu’une analyse froide et sèche d’une allocution pleine de chaleur et de vie.
Vers deux heures de l’après-midi, nous avons sous les yeux un spectacle tout à la fois édifiant et pittoresque. La procession partant de la Chapelle du Pèlerinage a contourné le Calvaire, pour descendre au Saint-Sépulcre. Là, les premiers arrivants ont bien vite rempli l’espace assez restreint que bornent les anciennes douves. Cependant, comme tous veulent voir et entendre, ceux qui suivent n’hésitent pas, en assez grand nombre, à descendre dans les douves heureusement à sec, en ce moment, et reparaissent bientôt sur l’autre bord, où ils viennent se masser en face du pieux monument. D’autres, suivant d’étroits sentiers, montent au-dessus, et s’installent comme ils peuvent sur les rochers très abrupts, de ce côté du Calvaire.
C’est alors qu’apparaît, sur le sommet même de la voûte du saint édicule, le R. P. Boutillier. Dès le début, sa parole nette et vibrante est entendue des plus éloignés. Si nous avions, ici, à louer, bien placé pour en juger, nous dirions que le plus bel éloge de ce discours a été l’attitude même d’un auditoire si varié et installé comme nous venons de le dire. Du commencement à la fin, pas la moindre marque d’inattention, pas le plus léger chuchotement, comme il arrive trop souvent en semblable occurrence.
« C’est d’abord le récit simple et sublime de la mise au tombeau du Divin Crucifié, avec le luxe de précautions prises par les Juifs, la pierre scellée, les gardes placés à l’entrée. Puis, au moment où Scribes et Pharisiens s’applaudissent d’en avoir fini avec le Galiléen, la terre qui tremble, l’énorme pierre qui roule sur elle-même, les gardes renversés, et le triomphateur de la mort qui sort du tombeau. C’est l’Alléluia qui commence pour se continuer à travers les âges par le double applaudissement du sang et de l’amour en l’honneur de-Jésus ressuscité.
« L’applaudissement du sang, ce sont les millions de martyrs qui rougissent de leur sang toutes les plages, pour affirmer leur foi à Jésus ressuscité, ce sont ces nuées de vaillants croisés qui vont aussi verser leur sang pour la conquête du grand tombeau, et de nos jours mêmes, après bientôt dix-neuf cents ans, cet applaudissement du sang est encore offert à Jésus ressuscité.
» L’applaudissement de l’amour toujours vivant, ne se refroidissant jamais. A rencontre de ceux que le monde appelle ses grands hommes et qui, après avoir, un moment, excité l’enthousiasme autour d’eux, ont cessé d’être aimés alors qu’était à peine refroidie leur dépouille mortelle, le seul nom de Jésus ressuscité n’a pas cessé de faire palpiter des millions de cœurs de l’amour le plus sincère, le plus ardent, le plus invincible.
» Et ce double applaudissement du sang et de l’amour n’aura de fin sur la terre que pour se continuer dans l’Alléluia des éternelles joies du Ciel.
» Le triomphe de Jésus ressuscité assure aussi le triomphe de tous les siens. Est-ce que ses ennemis les jansénistes ne crurent pas en avoir fini avec Montfort et son œuvre, lorsqu’ils eurent obtenu la destruction de son Calvaire ? Et pour qui est le triomphe aujourd’hui ? Est-ce qu’il y a cent ans, l’Église de France ne semblait pas comme anéantie ? Elle s’est relevée promptement de ses ruines. Confiance donc, malgré les menaces de l’heure présente !
» Le prédicateur termine par une ardente prière au B. Montfort, le conjurant de continuer sa protection aux religieuses contrées qu’il évangélisa jadis, et qui lui sont restées si fidèles, ainsi qu’aux familles religieuses dont il est le Fondateur et le Père. »
C’est sous l’impression de cette chaude parole que la foule, toujours profondément recueillie, entend prononcer les prières liturgiques de la bénédiction du pieux monument, par M. le Curé de St-Clément de Nantes.
Désormais, le Saint-Sépulcre sera une des stations vénérées de notre pèlerinage. De nombreux pèlerins tiendront s’y agenouiller, pour y méditer et prier avec ferveur et confiance.
†
Au soir de cette fête, des mains discrètes déposaient à la sacristie de la Chapelle du Pèlerinage un riche et bel ostensoir mesurant près d’un mètre de hauteur.
Sa forme est élégante, et d’un goût parfait. Ce qui lui donne son cachet particulier, ce sont les nombreux médaillons, peints en miniature, qui l’enrichissent.
Douze de ces médaillons, représentant les douze apôtres, forment cercle entre la lunule et les rayons. Le pied de l’ostensoir est décoré de trois statuettes symbolisant la Foi, l’Espérance et la Charité. Elles alternent avec trois autres médaillons représentant le Sacré-Cœur, la Ste-Vierge et St-Joseph.
Les sujets choisis pour l’ornementation du nœud se rapportent plus spécialement au Calvaire : Ste Hélène élevant dans ses mains la Croix, St Louis portant la couronne d’épines, et un troisième personnage tenant déplié sur ses bras le Saint Suaire.
Enfin, sur la croix qui s’élève entre les rayons du soleil, un dernier médaillon représentant l’Agneau triomphant.
Qu’on ne demande pas le nom des donateurs ou donatrices. Ils sont de ceux qui veulent être inconnus de la terre pour être mieux connus du ciel. Le Bienheureux Montfort a dû les inscrire sur la liste de ses clients de choix.
Paroisse d’Herbignac
Le mardi 3 mai, ce sont les travailleuses d’Herbignac, bien connues pour leur dévouement à l’Œuvre du Calvaire. Si elles sont aujourd’hui moins nombreuses que nous les avons vues à certains jours, ce n’est pas que leur zèle se soit refroidi. Des raisons très légitimes en ont retenu un grand nombre. Du reste, celles qui sont présentes semblent vouloir y suppléer, en déployant une activité plus grande. Elles continuent le travail de la veille, travail pénible dont nous avons déjà parlé, et qui consiste à extraire, du fond des douves, la terre qui manque encore pour achever les remblais aux alentours du Saint Sépulcre.
Nous avions vu, en plein hiver, les travailleurs de Massérac, et M. le Curé, en nous quittant, avait demandé, à l’avance, un jour du mois de mai, pour un pèlerinage de travailleuses, connaissant bien le désir de ses paroissiennes. C’est aujourd’hui, 4 mai, que joyeuses et nombreuses, elles donnent leur journée de travail au bon Père de Montfort. C’est aussi avec grande piété qu’elles font les stations du pèlerinage qui, pour elles, ont tout l’attrait de la nouveauté.
C’est la fin de l’octave de la fête du Bienheureux. En cette journée, trois diocèses sont représentés, ici, pour lui offrir, en même temps que leurs hommages, leurs chants et leurs prières, le concours de leurs bras pour l’achèvement de son Calvaire.
Paroisse de Saint-Jacut et de Peillac (Diocèse de Vannes)
C’est le train de Bretagne, qui, le premier débarque en gare de Pontchâteau les pèlerins travail- I leurs de Saint-Jacut et de Peillac, du diocèse de Vannes. Saint-Jacut, paroisse éminemment chrétienne, a eu l’honneur de servir de berceau à l’une de ces pieuses congrégations de religieuses enseignantes, qui se livrent avec tant de dévouement et de succès à l’instruction et à l’éducation des jeunes filles de la campagne. Comme on l’a pu voir dans les journaux, l’humble maison-mère de Saint-Jacut a été l’une des premières à soutenir glorieusement les attaques du fisc, pour l’exécution de l’inique loi d’abonnement.
Le vénérable Recteur de St-Jacut, craignant de ne pas atteindre, dans sa seule paroisse, le chiffre de deux cents pèlerins exigé par la Compagnie pour faire remonter le train, qui part ordinairement de Redon, à la gare de St-Jacut, a fait appel à son voisin, M. le Recteur de Peillac. Le chiffre est dépassé, et ce sont deux cent soixante travailleurs qui nous arrivent.
Ils assistent, tout d’abord, à la sainte messe, dans la chapelle du Pèlerinage. Puis après un léger déjeuner, tous sont bientôt au poste qui leur est assigné pour le travail autour du Calvaire. Pendant toute la matinée, les deux groupes de travailleurs et de travailleuses rivalisent d’activité, le premier dirigé par M. Gerbaud, le second manœuvrant sous les ordres du R. P. Barré. Quelle somme de travail eût été accomplie dans cette journée, si, dans la soirée, la pluie n’avait pas tout arrêté ! A ce moment du moins, les travailleurs de St-Jacut et de Peillac avaient eu le temps de visiter tous les sanctuaires, formant avec les autres pèlerins de la journée une longue procession. Et, après avoir assisté au salut donné par M. le Recteur de St-Jacut, ils partaient enchantés de leur excursion au Calvaire.
Congrégation des Enfants de Marie de St-Laurent du Mottay (Diocèse d’Angers)
A peine les travailleurs bretons sortaient-ils de la chapelle, où ils avaient assisté à la messe, que les Enfants de Marie de St-Laurent du Mottay, conduites par les Sœurs de la Sagesse, y entraient pour avoir aussi leur messe de Pèlerinage. Elles ont fait entendre de beaux et pieux cantiques. Elles ont ensuite la journée pour satisfaire leur curiosité et leur piété. Mais, ce ne sera pas sans demander à mettre la main, elles aussi, aux travaux du Calvaire. La permission leur est accordée sans peine; et l’on voit bien qu’avec le mérite d’une bonne action, en sera pour elles un souvenir joyeux de plus.
Dans la matinée du même jour, de nouveaux pèlerins viennent prendre à la Chapelle la place laissée libre par les Congréganistes de St-Laurent du Mottay.
L’Église du Pouliguen a l’avantage de posséder un chœur de chanteuses qui, d’après ce qu’il nous a été donné d’en juger, doit être d’un concours bien précieux pour la solennité des offices paroissiaux. Le pèlerinage a été, nous dit-on, organisé en leur faveur, comme récompense. Mais, des parents, des connaissances ont voulu s’y adjoindre et forment, en ce moment, une assez nombreuse assistance.
Pendant la première partie de la messe, qui est dite par M. le Curé du Pouliguen, le chœur des chanteuses nous fait entendre le Kyrie, puis le Gloria in excelsis. C’est de la musique de Gounod, et bien interprétée, bien chantée, c’est-tout dire.
Après l’Évangile, les chants se taisent, mais l’on écoute encore, et avec la plus vive attention, une allocution, toute de circonstance, de M. l’abbé Radigois, aumônier du Pensionnat des Frères de Bel-Air, à Nantes.
« Le Bienheureux Montfort, lui aussi, a chanté, beaucoup chanté. Surtout, il a fait beaucoup chanter. Que de merveilles accomplies par le chant de ses cantiques ! Merveilles intérieures dans les Ames, au cours de ses missions. Merveilles extérieures : son Calvaire, ici, en fut une. La fable a raconté que les murs d’une antique ville s’élevèrent un jour aux accords d’une lyre. Ici, la vérité est que son gigantesque Calvaire s’éleva au chant de ses cantiques.
Montfort n’eut jamais d’autre but dans ses chants que de procurer la gloire de Dieu C’est aussi le but que doit se proposer toujours le chœur des chanteuses du Pouliguen.
Pour bien chanter à la gloire de Dieu, il faut chanter, non seulement avec sa voix, mais avec son cœur, selon la parole du prophète : Psallam spiritu, psallam et mente, comprenant, goûtant et sentant les paroles que la bouche prononce. »
Il nous a semblé qu’il en était ainsi pour les chanteuses musiciennes du Pouliguen, tout particulièrement dans leurs chants en l’honneur de la divine Eucharistie, au salut du Très Saint-Sacrement, avant leur départ.
Elles aussi ont voulu, dans la journée, conquérir l’honneur d’être inscrites au livre d’or des travailleurs.
Seconde semaine du mois de mai
La température est loin d’être encore à souhait et cependant les jours de cette semaine sont bien remplis.
Paroisse de l’Immaculée-Conception de Saint-Nazaire
Dès le lundi 9 mai, c’est un pèlerinage organisé comme clôture d’une retraite paroissiale prêché dans cette paroisse de l’Immaculée, par le R. P. Brény. Tous les grands omnibus de la ville de Saint-Nazaire ont été réquisitionnés pour le transport des pèlerins. Ceux-ci ont tous sur la poitrine une image du Sacré-Cœur, qu’encadre un Rosaire.
Après la messe dite par M. le Curé, le R. P. Brény rappelle , en quelques mots, à l’auditoire le but du pèlerinage: « Ranimer dans les cœurs le souvenir de la Passion de Notre-Seigneur, dont les grandes scènes sont, ici, représentées d’une manière si frappante, s’attacher de plus en plus à la dévotion du Saint Rosaire qui fut, avec la passion de Notre-Seigneur, la grande dévotion du Père de Montfort et dont les mystères sont déjà ou seront bientôt représentés aussi sur la lande, et enfin rendre hommage et donner sa confiance au saint Protecteur de la contrée qui évangélisa leurs ancêtres. »
Ce sont bien, en réalité, les sentiments qui animent les pèlerins de l’Immaculée, pendant toute cette journée. Leur attention religieuse aux explications, aux exhortations du R. P. Barré, à chaque station du pèlerinage, leurs chants, leurs acclamations enthousiastes au sommet du Calvaire, le disent assez haut ; et nul doute que cette clôture de retraite n’ait laissé les meilleures impressions dans les âmes.
10 mai. — Le dévouement et l’activité des travailleurs d’Escoublac sont bien connus. Que pouvons-nous dire de plus des vaillants, qui, malgré le temps peu favorable, ont suivi aujourd’hui leur zélé vicaire au Calvaire, sinon qu’ils ont bien soutenu la réputation des anciens.
Paroisse de Saint-André-des-Eaux
La nuit a été mauvaise, une succession de coups de vent et d’averses. Le matin, les nuages sont encore très menaçants, et Saint-André est bien loin d’ici, au-delà de la Grande-Brière. C’est égal, on dit : Ils viendront. L’intrépide abbé Philippe, leur vicaire, n’est-il pas à leur tête? Et, en effet, quelques-uns, plus hardis encore que les autres, ont traversé le grand marais et arrivent les premiers. Puis on aperçoit sur la route vingt-quatre voitures, le suivant de près, et d’où descendent bientôt cent vingt travailleurs, tous bien dispos. Sans doute avec un temps plus favorable, sur un sol moins détrempé, ils eussent fourni une tache bien plus considérable encore. Mais, la besogne accomplie n’est pas peu de chose ; et surtout, ils ont montré une bonne volonté, un courage au-dessus de tout éloge.
12 mai. — Plus d’une fois, en sondant le vaste horizon, que l’on découvre du haut du Calvaire, en voyant la bande argentée que trace d’un côté la Loire, au-dessus de laquelle apparaissent parfois les sommets les plus élevés de l’autre rive, on s’était dit : Pourquoi les paroisses d’au-delà, ne viendraient-elles pas un jour ou l’autre, jusqu’à nous?
C’est la belle paroisse du Pellerin qui ouvre aujourd’hui brillamment la marche. Et c’est accompagné de ses deux vicaires, suivi par deux cent dix de ses paroissiens que nous arrive aujourd’hui le vénérable doyen.
Au sortir de la messe du pèlerinage, à laquelle tous ont assisté pieusement, nous entendons cette réflexion : « Que l’on chante donc bien au Pellerin ; il semblerait qu’on y naît musicien ! » Car ce n’est pas un chœur, ce ne sont pas seulement quelque voix, mais pour ainsi dire toutes les voix qui s’unissent pour former de merveilleux accords. Le matin, ce sont de pieux cantiques ; mais, le soir, il en est de même pour les chants liturgiques, au salut solennel du Très Saint-Sacrement.
Toutefois, les Pellerinois (est-ce ainsi qu’il faut dire) disent bien haut qu’ils ne sont pas venus seulement pour chanter, mais aussi pour travailler. Cette satisfaction leur est accordée bien que le temps soit peu favorable, au moins pendant quelques heures. Ils y mettent comme à tout le reste beaucoup d’entrain. Et, le soir, après avoir bien prié, bien chanté, bien travaillé, Pasteur et troupeau nous quittent, redisant à l’envi combien ils ont été satisfaits de cette bonne journée.
Paroisse de Notre-Dame-de-Grâces
13 mai. — Félicitations très particulières à ce groupe de travailleurs de Notre-Dame-de-Grâces qui, sans convocation spéciale, sans avoir entendu comme tant d’autres, du haut de la chaire, prêcher la sainte croisade, mais en ayant seulement recueilli quelques échos, sont venus d’eux-mêmes offrir leurs bras au Calvaire. Ils ont fait preuve, dans la journée, de la plus grande bonne volonté, d’un vrai dévouement et aussi d’une habileté spéciale dans les travaux qui leur ont été demandés. On pourrait en appeler au témoignage du R. P. Lhénoret qui, bien que convalescent au Calvaire, ne manque aucune occasion de se rendre utile à l’Œuvre, et qui en a employé plusieurs au travail délicat de rafraîchir, selon son expression, les plates-bandes de nos allées plantées d’arbustes.
Tous ces braves sont repartis heureux, ayant avec raison, la confiance que cette journée attirerait sur eux et sur leurs familles de précieuses bénédictions.
Dans cette troisième semaine, semaine des Rogations et de l’Ascension, les travaux du Calvaire ont été suspendus. Nous ne pouvons cependant la passer complètement sous silence. Le dimanche 15 mai n’était-il pas le jour choisi, cette année, pour fêter Jeanne d’Arc, et pouvait-on l’oublier au Calvaire. Sans doute la vénérable héroïne a été fêtée ailleurs avec plus d’éclat et de magnificence, mais non avec plus de vrai et pieux enthousiasme.
Le soir, une procession aux flambeaux, improvisée par notre noviciat et notre Ecole apostolique a bientôt réuni tous les habitants des villages voisins. Dans le parcours qui est celui de la Voie triomphale du pèlerinage, les chants se succèdent. Ils sont si nombreux les chants composés en l’honneur de la Vierge de Domrémy, depuis la complainte naïve jusqu’à l’ode aux accents inspirés l
Aux différentes haltes, se font entendre, des vivats, des acclamations sans fin. Ces acclamations redoublent encore au sommet du Calvaire, et vont redire au loin qu’ici battent des cœurs qui aiment tout ce que Jeanne a tant aimé : Jésus-Christ son vrai roi, l’Eglise sa mère, la France sa patrie, et lui font les vœux les plus ardents pour la voir bientôt placée sur les autels.
Quatrième semaine de mai Pèlerinage de Saint-Jacques de Nantes
Qui habite depuis quelque temps au Calvaire et n’a pas remarqué ce groupe de pèlerins pieux, qui reparaît chaque année, avec sa physionomie spéciale? A part quelques personnes de la ville, tous sont sortis ce matin de la grande Maison hospitalière, Sœurs de la Sagesse, infirmiers, infirmières, pensionnaires, infirmes, orphelins. Et tout ce monde arrive très joyeux, bien disposé à prier, à chanter, et s’en acquitte admirablement pendant la journée. La messe est dite par M. l’abbé Gaillard, l’un des aumôniers de l’Hospice. Il préside aussi la procession que dirige le P. Sarré, chargé des explications et exhortations aux divers sanctuaires. Rien n’a été omis pour donner de l’éclat à cette procession. Il y avait croix et bannière, et la statue du Bienheureux s’avançait, entourée de blancs étendards. De plus, après les exercices de piété, plusieurs ont pu satisfaire leur désir de mettre la main aux travaux du Calvaire.
Ce même jour, 24 mai, un bataillon de plus de deux cents travailleurs, arrivé de bon matin, après avoir entendu la sainte messe, manœuvrait autour du Calvaire. Pendant la matinée, pioches et pelles ont fait merveille. La soirée tout entière a été occupée autour d’une pierre géante qu’on est allé chercher assez loin sur la lande, et qu’on est parvenu à traîner jusque sur le chantier, où elle attend qu’on lui trouve une place.
Les bons habitants de Plessé ont tout visité, ici avec d’autant plus d’intérêt, qu’ils paraissaient pour la première fois.
M. le Curé et M. l’abbé Noblet, l’un de ses vicaires, étaient présents. Après avoir pris une part active à tout ce qui s’est fait dans la journée, ils se montraient, le soir, très satisfaits.
Encore une de ces bonnes paroisses bretonnes, dont les ferventes chrétiennes ont laissé venir en avant les maris et les frères, mais à la condition qu’elles auraient aussi leur jour. Après avoir entendu la messe, dite par leur bon Recteur, elles ont montré, dans la matinée, la meilleure bonne volonté, à l’activité la plus grande. Une pluie abondante a empêché la reprise des travaux dans la soirée. Mais, en ce moment, elles avaient au moins terminé leur pèlerinage de piété. Il ne leur restait plus qu’à recevoir la bénédiction du Très Saint-Sacrement, à la chapelle, et malgré la pluie qui tombait encore, elles repartaient joyeuses.
Ecole apostolique et Scolasticat
Souvent on nous a demandé des explications sur les « Œuvres de formation » de la Compagnie de Marie, nous avouant ingénument ne pas bien saisir le sens de ces dénominations d‘Ecole apostolique et de Scolasticat. Nous comprenons que ces termes, nouveaux pour bon nombre de personnes jettent quelque confusion dans l’esprit ; aussi demandons-nous encore aujourd’hui l’hospitalité de l’Ami de la Croix pour donner deux mots d’explication à ce sujet.
Personne n’ignore combien longue est la préparation au sacerdoce ; combien sérieuses sont les études et rigoureux le noviciat que doit faire le ministre de Dieu avant de monter au saint autel. Il ne lui faudra pas moins que les 12 à 14 plus belles années de sa jeunesse pour accomplir cette tâche et atteindre son but. Pour le clergé séculier, ce long trajet se partage en deux étapes, le petit et le grand Séminaire. Chez nous, ces étapes s’appellent l’École apostolique et le Scolasticat.
L’École apostolique correspond donc au collège ou petit Séminaire, puisqu’elle a la même organisation, le même programme d’études préparatoires au sacerdoce que ces établissements ; elle en diffère seulement par le but particulier qu’elle se propose : les enfants qui y sont admis de 10 à 13 ans se destinant à devenir missionnaires de la Compagnie de Marie. Pour cette raison l’École apostolique pourrait tout aussi bien être appelée Juvénat ou Petit-Noviciat, puisqu’elle répond aux fins de ces pépinières religieuses.
Les humanités achevées dans nos Ecoles apostoliques, nos jeunes gens de 17, 18, 19 ans suspendent un moment leurs éludes pour faire un an de noviciat. Cette année de probation écoulée, les novices émettent leurs premiers vœux simples de pauvreté, chasteté et d’obéissance ; et dès lors, ils sont vraiment religieux, enfants du Bienheureux Père de Montfort, quoiqu’ils ne soient pas encore prêtres. Ils appartiennent à la Compagnie de Marie où on leur donne le titre de Frère, nom qu’ils n’échangeront pour celui de Père qu’après avoir été revêtus du sacerdoce, à 24 ans au plus tôt.
En attendant, il leur reste à faire leurs études philosophiques et théologiques dans un grand séminaire qui, dans les communautés religieuses, porte le nom de scolasticat. La Congrégation possède deux scolasticats entre lesquels elle répartit ses sujets au sortir du noviciat, l’un au Canada et l’autre en Algérie. Dans ce dernier, les Français, soumis à la loi militaire, sont obligés de passer une année sous les drapeaux, dans le régiment de zouaves.
Nous pourrions ajouter, pour être complet, que d’ores et déjà la Compagnie de Marie possède à Rome une résidence où vont être envoyés incessamment plusieurs de nos scolastiques et jeûnes Pères pour y perfectionner leurs études sacrées en suivant les cours du collège romain.
Nous croyons avoir dissipé, par ces simples explications, les confusions auxquelles nous faisions allusion en commençant; et du même coup, nous avons pu indiquer la nature, le but et l’importance de ce que nous avons appelé nos « œuvres de formation ». Nous souhaitons à ces lignes bon accueil auprès de nos amis nombreux parmi les lecteurs de l’Ami de la Croix.
N° 10 Juillet 1898
Travaux et Pèlerinages
D’ordinaire, les travaux du Calvaire finissent avec le mois de mai, et restent suspendus jusque vers la seconde moitié de l’automne. Toutefois, cette année, dans la semaine de la Pentecôte, les 1ers, 2 et 3 juin ont été de belles journées de travail qui demandent à être signalées.
Après le récent et beau pèlerinage de travail des hommes de Guémené, nous pensions bien que les femmes de cette même paroisse ne tarderaient pas à réclamer le leur. Nous sommes dans les longs jours, et pour nos travailleuses, surtout celles qui viennent pour la première fois, ces jours semblent courts. La piété en prend une bonne part : l’assistance à la messe, en arrivant, le salut du Très Saint-Sacrement, avant le départ, la promenade pieuse aux divers sanctuaires, après le repas de midi, avec chant de nombreux cantiques. On chante encore en tirant la chaîne, ou, en faisant passer les paniers.
MM. les abbés Loyer et Lesage, vicaires, qui paraissent pour la seconde fois sur le chantier, semblent passés maîtres dans la direction des travaux, et ont une part très active dans cette journée.
Depuis longtemps déjà Saint-Lyphard a sa place marquée parmi les paroisses qui montrent le plus de zèle et de dévouement pour l’Œuvre du Calvaire. Le beau pèlerinage d’aujourd’hui montre bien que ce zèle et ce dévouement ne se refroidissent pas. Les travailleuses sont nombreuses et aussi actives que jamais. Il y a aussi un certain nombre de travailleurs. Ce sont les conducteurs des nombreuses voitures, mais qui ne s’en tiennent pas à ce rôle, et se chargent des tâches les plus lourdes. Rien n’a manqué à cette journée pour en faire une journée dos plus édifiantes. Et l’excellente organisatrice a dû en éprouver une véritable joie.
Nous avons été frappés, en particulier, de l’accent de foi et de piété, avec lequel a été chanté, le matin à la messe, le beau cantique du P. Montfort : O l’auguste Sacrement…
Pensionnat des Sœurs de la Sagesse de Rennes.
Ce même jour, jeudi 2 juin, les Sœurs de la Sagesse de Rennes, avec leurs pensionnaires, accomplissaient pieusement leur pèlerinage au Calvaire. Au-dessus de l’autel du Bienheureux, dans notre chapelle, est suspendue, depuis deux ans au moins, une élégante bannière qui porte cette inscription : Amour au B. Montfort. Et, au revers on peut lire : Pensionnat de la Sagesse de Rennes. Nous avons, aujourd’hui, sous les yeux, la preuve que dans cette excellente maison les sentiments sont toujours les mêmes, et qu’on continue d’y aimer, d’y invoquer le bienheureux Montfort.
Arrivées trop tard pour avoir la messe, les pèlerines de Rennes font du moins processionnellement la visite des sanctuaires, qui a lieu aujourd’hui avec d’autant plus d’éclat que les nombreuses travailleuses de Saint-Lyphard y prennent part, en même temps. De leur côté, les jeunes pensionnaires de Rennes veulent aussi avoir leur part des travaux qui s’y exécutent et conduire leur pierre jusqu’au Saint-Sépulcre.
Un pèlerinage venant de ce côté est salué, ici, avec d’autant plus de plaisir que, jusqu’à présent, bien que la limite de l’archidiocèse de Rennes ne suit pas éloignée, bien peu de pèlerins la franchissent pour venir prier au Calvaire de leur Bienheureux Compatriote. Il est vrai qu’ils ont son Ermitage de Saint- Lazare, où, nous le savons, ils aiment à l’entourer d’honneur et à l’invoquer.
Paroisse de Conquereuil
Ce pèlerinage des travailleuses de Conquereuil, le vendredi des Quatre-Temps de la Pentecôte, est vraisemblablement le dernier des pèlerinages de travail de cette saison. Il la termine très bien. Signalons un trait seulement. C’est un pèlerinage de travailleuses, nous l’avons dit. Mais le bon curé de Conquereuil s’est fait accompagner de deux ou trois hommes, qui, en se relayant, ont porté la croix de procession, de la gare jusqu’au Calvaire. Lui-même a revêtu le, surplis ; et, dans tout le parcours, la récitation du Rosaire n’a cessé d’alterner avec le chant des pieux cantiques. N’est-il pas vrai que ce sont là de belles journées, sanctifiées, comme le doivent être toutes les journées du chrétien, par le travail et la prière.
†
Ici, donc, s’arrête, pour quelque temps, du moins, cette partie de notre chronique qui a pour titre : Les Travaux du Calvaire ou Pèlerinages de travail au Calvaire. Le trait le plus saillant, peut-être, de cette dernière campagne, c’est le grand nombre de noms nouveaux que nous avons eu à enregistrer, de paroisses venant ici pour la première fois. La plupart de ces paroisses sont à de telles distances qu’elles ne pouvaient songer à venir donner une journée de travail au Calvaire que par le chemin de fer. Aussi les trains de pèlerins travailleurs ont été créés. N’est-ce pas une nouveauté qui mérite d’être notée, à notre fin de siècle, surtout après l’affirmation non encore oubliée, bien que démentie par les faits d’une manière si éclatante, que les pèlerinages n’étaient plus dans nos mœurs. Présentement, le nombre des paroisses qui sont venues ainsi en pèlerinage de travail au Calvaire est d’environ cent cinquante. La plupart ont reparu plusieurs fois, quelques-unes jusqu’à dix et vingt fois. C’est donc un vaste mouvement, religieux avant tout, qui a soulevé toute une contrée, et qui n’a pu manquer d’être fécond en bons résultats.
Pour en juger, il ne faut pas s’arrêter uniquement au résultat matériel qu’ont sous les yeux ceux qui visitent le Calvaire, c’est-à-dire aux travaux exécutés sur la lande de la Madeleine, par cette multitude de bras mis en mouvement, toujours pleins de bonne volonté, mais aussi toujours plus au moins bien outillés, plus ou moins inexpérimentés.
Nous ne craignons pas de nous tromper en affirmant que l’effet moral produit par ces manifestations de foi répétées a été excellent dans toute la contrée. Quelle meilleure réponse pouvait être faite à ceux qui prétendent renfermer de plus en plus notre sainte religion dans ses églises et ses sacristies, et de ne nous permettre à nous, catholiques, d’exister qu’à la condition de ne pas paraître tels en dehors de nos maisons et de nos Églises ! Et quel meilleur exemple, quel meilleur encouragement pour les timides qui sont tentés d’obtempérer à de pareilles prétentions ! Que dire de ceux qui ont pris une part active à ces démonstrations? Quand on s’est trouvé par centaines dans les gares, avec les insignes de pèlerin travailleur, quand on a traversé villes, bourgs et villages, pasteur en tête, en chantant des cantiques, quand, dans la journée, on a mêlé sa voix à cent autres qui acclamaient Jésus et sa Croix, quand on a travaillé à côté de prêtres pas fiers du tout, maniant eux aussi la pioche et la pelle, sans nul doute, on est rentré chez soi, non seulement heureux et content de sa journée, mais se sentant plus heureux et plus fier d’être chrétien, mieux disposé à remplir les devoirs et les obligations attachés à ce titre et même à s’en glorifier à l’occasion.
Ceci nous remet en mémoire une petite scène qui avait récemment pour théâtre un de ces wagons de troisième, dans lesquels trente, quarante personnes peuvent se voir et même s’entendre. C’était en gare de Savenay, et jour de foire dans la petite ville. Au beau milieu du wagon susdit, un prêtre était assis. Sur le même banc que lui, il n’y avait encore qu’un voyageur occupant le coin à gauche, quand un brave paysan à la figure épanouie vient prendre place entre les deux, accompagnant sa prise de possession des paroles suivantes, dites à très haute voix : « Il y en a qui n’aiment pas à monter dans un compartiment où ils voient un prêtre… Moi, au contraire, j’aime bien ça. Je me dis que s’il y avait accident… Qui sait ? Il y aurait au moins un prêtre, là, pour nous donner l’absolution. »
On croira sans peine que ce petit monologue avait fait lever plus d’une tête au-dessus des demi-cloisons. Il se peignait sur les visages un peu d’étonnement et surtout une certaine attente curieuse de ce qui suivrait. Le prêtre s’était contenté d’un sourire qui voulait dire à son voisin qu’il ne trouvait pas ses réflexions mauvaises du tout. Seul, le voyageur du coin avait grommelé quelques mots in intelligibles entre ses dents, et avait rapproché un peu plus près de ses grosses lunettes bleues, son journal ouvert.
Il n’en fallait pas tant pour mettre en verve le brave ami des curés. Et bien que le coup de sifflet eut été donné, et que le train fût déjà en marche, une voix se faisait parfaitement entendre : « Eh bien ! Oui, ce n’est pas que je suis meilleur chrétien qu’un autre…, j’ai mes défauts…, mais j’aime ma religion, j’aime les prêtres qui nous l’enseignent, qui nous rappellent nos devoirs, et qui ne veulent que notre bien, même quand ils nous reprennent… Je ne comprends pas ceux qui disent du mal d’eux…, qui les combattent… » A une exception près l’auditoire était visiblement sympathique à l’improvisateur. Il ne pouvait pas l’arrêter en si beau chemin, d’autant que dans ces jours, et très particulièrement dans ce milieu, la question qu’il touchait était à l’ordre du jour. Poursuivant donc sa pensée : « Oui, ce sont ces francs-maçons qui font tout le mal…, des renégats, qui, parce qu’ils ont renié leur religion, voudraient la détruire, s’ils pouvaient…, empêcher de l’enseigner, nous forcer à mettre nos enfants dans leurs écoles laïques… Ah! ce n’est pas les miens qu’ils auront!… Avec ça…, des hypocrites qui, pour tromper les gens, voudraient encore se faire passer pour catholiques, et osent se dire bons catholiques !… »
Du coup, le voyageur du coin avait laissé tomber sa feuille sur ses genoux, et sans regarder en face celui à qui il s’adressait, mais d’un ton de pédagogue irrité: « Qui vous a dit ça?… Qui vous a enseigné ces choses-là?… Qui vous a dit que les francs-maçons n’étaient pas catholiques? »
Sous ces interrogations, se cachait un piège. Le bon avocat des curés ne s’y laissa pas prendre. Comprenant tout de suite qu’il valait mieux ne pas mettre en cause son voisin de droite, il s’en tira à merveille : « Qui m’a dit ça?… Eh bien! si vous voulez le savoir, c’est… c’est ma femme, oui, ma femme, qui n’est pas sotte, non…, qui sait bien ce qu’elle dit. »
A cette réponse inattendue, il y eut un franc éclat de rire dans tout le wagon. Un seul riait jaune et se tint coi, pendant que continuait l’éloge bien senti de la ménagère « très bien instruite de sa religion et qui élève parfaitement ses enfants. »
Cependant, on arrivait en gare de Pontchâteau, et comme le bon paysan et le prêtre son voisin s’apprêtaient à descendre, on entendit sortir du coin cette phrase qui voulait être méchante, mais dont on ne fit que rire et à laquelle on ne répondit pas : « On voit bien que vous êtes de Pontchâteau !… »
Dans la pensée du pédagogue laïque, ou rond-de-cuir, (l’un ou l’autre) qui filait vers la petite ville voisine, cette phrase en disait long : « Vous êtes de Pontchâteau, c’est-à-dire de cette paroisse au fameux calvaire, où se passent des choses d’un autre âge, où des gens vont travailler sans recevoir de paie, où l’on entend souvent, (et bien nourries !) les acclamations séditieuses de Vive Jésus! Vive sa Croix ! Vive le Pape! Vive l’Eglise! et même vive la France ! d’où les gens reviennent tellement fanatisés qu’on les entend chanter sur les routes des cantiques et des litanies! »
Oui, il en est ainsi, et nous espérons bien qu’il continuera d’en être ainsi, que cela plaise ou non aux FF…, et à leurs amis.
Le héros de cette petite, scène n’était pas en réalité de Pontchâteau, mais d’une paroisse voisine inscrite bien des fois au Livre d’or de nos travailleurs. Sur le quai de la gare, en quittant le prêtre, il lui disait: « Nous nous reverrons au Calvaire! » Et la main qui écrit ces lignes sent encore la chaude i étreinte de sa loyale main.
†
23 juin. — C’est dans le prochain mois surtout que l’on voit de nombreux trains de pèlerins se diriger vers Auray, pour aller saluer et prier, dans son magnifique sanctuaire, la bonne Mère sainte Anne. En attendant, nous sommes heureux de voir ses clients les plus proches, venir invoquer, ici, le bienheureux Montfort et prier à son Calvaire. Et ce n’est pas pour la première fois. C’est une affirmation nouvelle de l’union qui existe entre les deux pèlerinages. Le vénérable curé-doyen a bien voulu, comme il l’avait déjà fait, présider la pieuse caravane. L’un de ses vicaires dit, en arrivant, la messe du Pèlerinage.
C’est une belle journée d’été. Elle se passe rapidement pour les pèlerins en processions ou pieuses excursions sur la lande. Il est certains cantiques en l’honneur de sainte Anne et du bienheureux Montfort qui ont le même air. Il nous semble qu’ils sont encore mieux chantés que les autres.
M. le Curé qui donne le salut, avant le départ, fait prier à diverses intentions, et notamment pour les malades de la paroisse.
Pèlerins de Pont-Saint-Martin
Ils sont partis de bonne heure, en ce jour de la fête de saint Jean Baptiste, 24 juin. Pont-Saint-Martin est situé sur les bords de l’Ognon, non loin de l’embouchure de cette petite rivière, dans le lac de Grandlieu.
Ils ont laissé à Nantes leurs voitures, et sont ici, par le chemin de fer, à une heure qui leur permet de consacrer la journée presque entière à leurs dévotions, et à leur pieuse curiosité. Ils ont leur messe spéciale de pèlerinage dite par M. l’abbé Menti, leur vicaire. Ils prennent part ensuite à tous les exercices ordinaires, en même temps que les autres pèlerins venus, ce jour-là, de divers côtés. Ils partent avec la pensée de revenir plus nombreux, se proposant de se faire dans leur entourage les zélateurs du Pèlerinage au Calvaire du bienheureux Montfort. Ils habitent, du reste, une contrée qu’a dû être sillonnée par les pas du saint missionnaire. Si Pont-Saint-Marlin ne se trouve pas sur la liste des missions données par lui, on y lit les noms de Vertou, de La Chevrolière, de Bouguenais, qui sont à de faibles distances, et où son souvenir n’a pas cessé d’être très vivant.
N° 11 Août 1898
La première Station du Chemin de Croix
Les statues formant le groupe de la Condamnation à mort de Jésus par Pilate viennent enfin être débarquées au Calvaire, après une assez longue attente. On n’a pu, jusqu’à présent, leur donner qu’une installation provisoire, au Prétoire, au sommet même de la Scala Sancta.
Quatre statues seulement composent tout le groupe : Le Divin accusé et le Soldat qui en a la corde, Pilate sur son tribunal et l’Enfant qui, sur sa demande, apporte un Lavabo. Jésus-Christ devant Pilate : le sujet a été traité bien des fois, et, naguère encore, le tableau d’un artiste célèbre, portant ce titre, attirait l’attention et l’admiration de tous.
Mais, dans cette comparution de Notre-Seigneur devant Pilate, il y eu des phases diverses, qui supposent des attitudes très différentes. Autre dut être l’attitude du Gouverneur romain affirmant son droit suprême de vie ou de mort sur l’accusé, que lorsque, tremblant de peur, il prononça lâchement le mot décisif qui livrait à la mort celui qu’il venait de reconnaître innocent.
Bien différente aussi l’attitude du Divin accusé au moment où il revendique avec majesté son titre de Roi, qu’au moment où il est ramené, après la flagellation et le couronnement d’épines, devant son juge pour entendre prononcer une sentence, qu’il sait (il l’a dit lui-même), tomber de bien plus haut que des lèvres tremblantes de Pilate.
Le seul énoncé de la première station du Chemin Croix : Jésus est condamné à mort par Pilate, indiquait à l’artiste qu’il s’agissait de rendre cette dernière phase, ce dernier trait des grandes scènes du Prétoire, marqué dans l’Evangile par ces simples mots : Tradidit ut crucifigeretur... Il le livra pour être crucifié. C’est au public de juger si l’artiste a atteint ce but, et nous n’avons nullement l’intention de prévenir son appréciation.
Mais qu’il nous soit permis, tout d’abord, de citer quelques lignes sinon de l’auteur même du groupe, du moins de celui qui avait à en surveiller de près l’exécution. On vient de dire, pour expliquer un retard, que pour la statue de Pilate, la maquette a été recommencée trois fois, les deux premiers essais ne répondant pas aux indications précises qui avaient été données. Et la lettre ajoute : « Nous espérons cette fois y être arrivés. » Voyez cet homme à la mine couarde. Il a la tête basse. Une pensée louche se reflète, indécise, sur un masque manquant de dignité, et dans le regard oblique, fuyant et sournois d’un œil qui pic pas fixer ceux qui l’entourent.
« On sent la honte qui le tient à la gorge comme un étau. L’attitude est contrainte, et se résume en un geste vague, mal dessiné, évasif, vide de sens, qui, s’il signifiait quelque chose, se traduirait par « je n’y suis pour rien. »
» C’est, tout bien examiné, l’attitude qui, logiquement, a dû précéder d’une façon immédiate la phrase traditionnelle dont le pilori de l’histoire a stigmatisé Pilate, comme d’un soufflet perpétuel. »
Dans cette même scène, il est une autre figure qui doit faire oublier celle de Pilate.
C’est celle du Divin accusé. Quand il s’agit de représenter l’Homme-Dieu, Peut-on demander à l’artiste de nous satisfaire complètement?
Ici, c’est l’Ecce Homo, que Pilate montrait tout à l’heure au peuple. Les mains sont garrottées, le front est ceint de la couronne d’épines. Le manteau d’écarlate est sur ses épaules, drapé peut-être un peu trop de soin. La souffrance est empreinte sur tout le visage. Mais, on y lit surtout une résignation, un calme profond. Indifférent à la sentence de Pilate qu’il ne paraît pas même entendre, on voit qu’il pense à l’accomplissement d’un décret tombant de plus haut et qu’il y répond par la parole du Jardin des Olives: Non mea voluntas, sed tua fiat… Me voici prêt à monter le Calvaire !…
Quant au soldat, c’est l’homme de la consigne qui n’attend qu’un mot pour conduire le condamné au supplice. Sa consigne, il l’accomplira jusqu’au bout, impassible; car c’est lui que nous retrouvons la lance au poing, sur le Calvaire, pendant que les bourreaux enfoncent les énormes clous dans les mains et les pieds de la Divine victime.
Si Pilate a eu le loisir d’y penser, il a dû envier l’ignorance inconsciente de cet enfant qui s’approche pour lui laver les mains, et dont la figure naïve, insouciante, contraste, si fortement, en ce moment, avec la sienne.
Enfin, et c’est le point important, nous avons la conviction que ceux qui s’agenouilleront devant ce groupe, pour commencer le saint exercice du Chemin de Croix, y trouveront un sujet de sérieuses réflexions, et ne s’en éloigneront pas sans que cette vue ait produit en eux de salutaires impressions.
Les lecteurs de l‘Ami de la Croix savent déjà et ne peuvent oublier que cette station est le don généreux de Sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Nantes à l’Œuvre du Calvaire du bienheureux Montfort.
N° 2 Novembre 1898
Les travaux
Absent du Calvaire pendant ce mois, c’est par correspondance seulement qu’il nous a été donné de connaître les faits qui alimentent, d’ordinaire, cette chronique.
Les deux lettres suivantes, la première datée du 24 octobre, la seconde du 26 du même mois, en feront, pour cette fois, presque tous les frais :
†
« M. R. P., En dehors de l’affluence ordinaire des pèlerins, dans ce mois du saint Rosaire, nous avons eu deux journées de travail.
La première a été donnée par les femmes de St-Joachim, le mardi 11 octobre ; la seconde par celles de St-Malo de Guersac, le 18 du même mois. MM. les curés de St-Joachim et de St-Malo de Guersac, si dévoués pour l’œuvre du Calvaire, étaient, avec leurs vicaires, MM. les abbés Blois et Fabré, à la tête de leurs courageuses paroissiennes Nous avons travaillé à paver le sommet du Calvaire avec d’assez forts cailloux. Maintenant, ni le vent, ni la pluie, ne pourront dégrader la plateforme.
Deux ou trois autres journées termineront le haut de la montagne.
Notre vrai travail de l’année aura pour objet la Voie douloureuse.
Nous allons exhausser les groupes, en leur donnant des piédestaux rustiques qui, je l’espère, seront d’un bon effet.
Quant à la Voie elle-même, nous allons la modifier, suivant les désirs que j’entends exprimer de toutes parts.
Nous allons la mettre au niveau des deux allées parallèles, en la laissant néanmoins un peu plus rebombée. Les cailloux seront remplacés par du sable rouge.
Nous aurons ainsi une triple voie avec quatre rangs d’arbres. Nous planterons au plus tôt les deux rangs qui vont encadrer l’allée du milieu, avec les stations. Je crois que le coup d’œil n’y perdra rien. Mais ce sera surtout beaucoup plus commode pour les foules faisant l’exercice du Chemin de la Croix.
Je désire aussi beaucoup pouvoir, dès cette année, m’occuper de la fontaine de notre Bienheureux l’ère de Montfort.
De tout temps, vous le savez, elle a été l’objet de la vénération des fidèles.
C’est là que le serviteur de Dieu allait se désaltérer avec ses travailleurs. C’est là qu’il prêchait, faisait réciter le Rosaire. C’est là surtout qu’il a opéré le miracle de la multiplication des pains, nourrissant, selon les paroles de M. Grandet, une multitude de pauvres, qui, sans lui, seraient morts de faim dans cette année de disette.
Depuis lors, Dieu n’a pas cessé d’accorder de nombreuses et insignes faveurs par l’eau de cette fontaine. Les anciens nous affirment que jamais on ne faisait le pèlerinage du Calvaire sans aller boire de, cette eau.
La restauration du Calvaire appelle la restauration de la fontaine.
C’est à la Commission pour l’exécution des travaux du Calvaire de décider ce qui doit être fait.
Mais il est évident qu’il faut assurer la propreté de l’eau, et fournir aux pèlerins un moyen facile de satisfaire leur dévotion.
Un autre désir m’a été exprimé. On serait heureux de voir placer au-dessus de Pédicule de la fontaine la statue de notre bienheureux Père de Montfort. Il me semble, en effet, que ce serait bien sa place. N’est-ce pas lui qui donne à cette eau merveilleuse son étonnante vertu ?
Nous avons là de quoi nous occuper l’hiver et le printemps prochains.
Mais, avec la grâce de Dieu, et le concours des amis du Calvaire, nous viendrons à bout de cette tâche avant notre grande fête.
N° 3 Décembre 1898
Chronique du mois
D’ordinaire, ici comme ailleurs, la saison dos pèlerinages prend fin avec le mois d’octobre. Mais, celte année, la première quinzaine de novembre a été si belle que l’on aurait pu se croire revenu au printemps.
Bien des personnes, qui avaient remis jusqu’à celte époque leur visite au Calvaire, ont pu accomplir leurs dévotes pérégrinations sur la lande, dans les conditions les meilleures et les plus agréables.
Et puis, il est des pèlerinages qui ne se remettent pas, quelle que soit la saison, quand il s’agit, par exemple, d’obtenir une guérison.
C’est ainsi que nous étions témoins, il y a peu de jours, d’un spectacle qui suppose une foi bien vive chez ceux qui nous le donnaient. Une pauvre paralytique montait, portée dans une chaise par deux hommes, jusqu’au sommet du Calvaire, pour lui permettre de prier aux pieds mêmes de Jésus crucifié, entourée de ceux et celles qui l’accompagnaient. Elle a été portée ainsi aux diverses stations du pèlerinage. On nous a dit qu’avant son départ, près de la Scala Sancta, on l’avait vue marcher quelques instants. Si la guérison se continuait, quelqu’un nous en informerait sans doute de Saint-Nazaire; car c’est de Saint-Nazaire qu’avait été amenée cette infirme.
Ici, par exception, quand les autres pèlerinages prennent fin, nos pèlerinages de travailleurs volontaires sont bien près de commencer. Et, de fait, ils ont commencé le 17 novembre.
On sait que le travail projeté pour cette année consiste dans l’exhaussement des différents groupes de statues de la Voie douloureuse, dans le but de les faire ressortir davantage, et apparaître dans toute leur sévère beauté.
A ce sujet, nous sommes heureux de pouvoir donner l’appréciation d’un artiste bien connu et désintéressé, qui, après un examen très attentif, disait récemment : « Dans tout ce nombre de statues il n’y en pas une qui soit mauvaise, et il en est de fort belles. »
Cette parenthèse fermée, nous avons à signaler le dévouement de ceux qui marchent en tête, dans J cette, nouvelle campagne de travaux.
Peut-être est-il quelqu’un, parmi nos lecteurs, qui nous prévient, et qui a déjà dit tout bas: « Oh! ce sont sans doute encore les bravos paroissiens de Crossac! » Ce quelqu’un a deviné juste. Oui, ce sont eux qui, cette fois encore, ont mis les premiers la main à l’œuvre, et qui, venant village par village, ont fourni jusqu’à huit journées de travail presque consécutives, du 17 au 26 novembre.
Quand on placera une plaque commémorative des niveaux du Calvaire, est-ce que les noms de tous ces villages ne mériteraient pas d’y être inscrits en lettres d’or? En attendant, inscrivons-les sur cette de l’Ami de la Croix, où on pourra les retrouver un jour,
Ce sont :
Le jeudi 17 novembre : le village de Quémené.
Le vendredi 18 : le village de la Brionnière.
Le samedi 19 : les villages de Riom et de la Moudrais.
Le mardi 22 : les villages de Rault et du Souchet.
Le mercredi 23: le village de la Riotais.
Le jeudi 24: le village de la Haye.
Le vendredi 25 : les villages de Bosselas et de Lornais.
Le samedi 26: les villages de la Cossonnais, de Coimoux et de Quinta.
Venant village par village, ce n’étaient sans doute que de petites escouades de huit, dix, douze hommes au plus.
Le travail qui se fait, en ce moment, n’en réclamait pas davantage. Un plus grand nombre même eût pu gêner, embarrasser. Mais, précisément, à raison de ce petit nombre, n’y avait-il pas pour ces braves un mérite de plus? Venant et travaillant sans bruit, sans éclat, sans cet entraînement qui existe toujours quand c’est une paroisse entière qui s’ébranle à la fois !
Pour nous, il nous semble que c’est bien là l’acte de pur dévouement pour l’œuvre du Calvaire, dans l’unique but de plaire à Dieu et de s’assurer la protection du Bienheureux Montfort.
En dehors de ce travail, il en est un autre qui ne peut manquer d’intéresser ceux qui aiment à venir ici, à la belle saison, passer la journée, en parcourant les allées du pèlerinage. Ce sont les plantations nouvelles. Ceux qui ont vu la lande toute nue sont étonnés de ce qui a été fait en si peu de temps, sur ce point. Mais, il n’en est pas moins vrai qu’il y a encore beaucoup à désirer.
A chaque automne, ou fait en sorte de comblera quelques lacunes. Cette année, ce sont surtout des jeunes plants de hêtre, qu’on a mis en ligne, un peu partout. Dans quelques mois, il y aura aussi plantation de jeunes arbres verts.
L’homme plante, mais c’est le Ciel qui fait croître et grandir. Comptons sur lui pour donner le plus promptement possible de beaux ombrages aux pèlerins.
Qu’on nous permette, à cette occasion, de faire remarquer combien il est de l’intérêt de tous de ménager ces jeunes plantations, d’éviter tout ce qui pourrait en arrêter la croissance. Plus d’une fois, on a eu à constater, avec peine, de regrettables dommages, qu’il faut attribuer, sans doute, à l’étourderie plutôt qu’à la malice.
Nous espérons bien que ces faits ne se renouvelleront plus.
†
P.-S. — Les travailleuses de Drefféac, qui étaient attendues le mercredi 15 novembre, arrivent aujourd’hui, mercredi 23. Il y a eu sans doute erreur dans la date pour la convocation. Quoi qu’il en soit, leur arrivée est bien accueillie. Le R. P. Directeur leur trace immédiatement leur tâche. Elles s’y mettent avec ardeur. On les voit d’ici monter et remonter la colline, portant de lourdes charges. On voudrait achever le pavage de la plate-forme du Calvaire.
Malheureusement, le ciel s’est couvert de nuages. Les travailleuses tiennent bon sous la pluie jusqu’à midi. Mais, après leur légère réfection, il parait évident que le travail ne pourra être continué dans la soirée. Elles se réunissent à la chapelle pour recevoir la bénédiction du Très-Saint-Sacrement et partent avec le regret, sans doute, de n’avoir pas donné une journée entière, mais consolées, en pensant que Celui qui récompense voit surtout la bonne volonté.
N° 4 Janvier 1899
Travaux
Dans notre chronique du mois de novembre, nous avons fait l’éloge des bons habitants de Crossac, qui ont ouvert la nouvelle campagne de travaux. Ceux qui leur ont succédé, dans la première semaine de l’Avent, ne méritent pas moins d’être loués. C’est la paroisse de Drefféac qui, partagée en quatre sections, a fourni à elle seule, dans cette semaine, quatre bonnes journées. Tous les gros blocs de pierre amassés, la semaine précédente, sur les bords de la Voie douloureuse, ont été relevés, mis en place, consolidés. Et, déjà pour plusieurs groupes, les statues étant exhaussées, on peut constater que ce changement produit un excellent effet.
Notons que, dans ces jouis, nous avions le bonheur et l’avantage de posséder M. Gerbaud.
†
La seconde semaine de l’Avent débute aussi très bien. Il ne pouvait en être autrement quand il avait Blé fait appel aux bons habitants des villages qui entourent le château de Casso, en Pontchâteau. Ils sont assez nombreux pour qu’on puisse dire que chaque maison, chaque famille est représentée. De plus, on nous fait remarquer comment plusieurs sont forts et bien taillés. C’est bien ce qu’il faut pour le travail d’aujourd’hui. Après avoir exhaussé, comme nous l’avons dit, la Voie douloureuse à chaque station, il s’agit d’élever les statues elles-mêmes. Et l’on sait que chacune de ces statues est d’un poids considérable. Quoi qu’il en soit, cette opération difficile se fait avec ordre, et sans le I plus léger accident. Il n’est pas étonnant que le R. P. Directeur du pèlerinage se montre particulièrement satisfait de cette bonne journée.
†
Bien satisfaisante aussi est la journée du mercredi 7 décembre. Elle est donnée par les habitants de certains villages de Crossac, qui n’avaient pas paru la semaine dernière, manque d’avis. Le travail est bien différent de celui d’hier. On a pensé non sans raison, qu’il convenait de disposer, à chaque station, une espèce de marche pouvant servir d’agenouilloir à un certain nombre de personne. On devine sans peine que ces agenouilloirs ne sont pas des plus moelleux ; mais qui voudrait se servir de coussins moelleux, en faisant le Chemin de la Croix !
Tandis que les uns s’occupent de ces marches devant la station du Cyrénéen et devant la rencontre de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère autres travaillent à niveler celle des voies latérales longeant la Voie douloureuse, qui est la plus fréquentée. Ce travail a pour but de favoriser l’écoulement dans la prairie voisine de l’eau qui séjournait parfois sur la voie elle-même.
Tous s’acquittent de leur tâche, comme s’ils étaient vraiment du métier.
†
Le mardi de la troisième semaine, les travailleurs de Besné, toujours si fidèles et dévoués, sont attendus. Malheureusement, il pleut, et quand apparaît une éclaircie, il est vraiment trop tard pour partir. La route est longue et les jours sont si courts. Néanmoins quelques braves se sont mis en chemin, et donnent dans l’après-midi une bonne, demi-journée de travail. Assurément, les bons paroissiens de Besné voudront avoir leur revanche un autre jour.
†
Nous avons nommé bien des villages de Crossac, mais pas encore celui des Eaux, le plus éloigné, situé comme son nom l’indique au milieu des eaux, sur les bords du marais que traverse le Brivet. Le mercredi, 14, les bons travailleurs de ce village continuent le nivellement des allées de la Voie douloureuse. Il y a parmi eux de tout jeunes gens qui se font remarquer par leur activité, et auxquels le R. P. Directeur croit devoir donner une récompense spéciale.
†
Crossac encore aujourd’hui, jeudi 15 décembre! Mais ce sont des travailleuses qui commencent le travail très intéressant du nouveau pavé de la Voie douloureuse. On espère bien le faire cette fois de telle manière qu’il ne puisse pas désormais être envahi par la lande et diverses plantes. Sans doute, il faut du temps pour placer chacune de ces pierres l’une à côté de l’autre, et les faire se rejoindre. Mais, avec la patience et la persévérance, on vient à bout de tout ; et, rien qu’à voir à l’œuvre aujourd’hui les travailleuses de Crossac, on peut se dire que la patience et la persévérance ne manqueront pas.
†
Vendredi, 16 décembre, vraiment nous étions bien persuadés que nous en avions fini avec les travailleurs de Crossac. Pour les travailleuses, nous savons qu’elles n’ont pas dit leur dernier mot. Et voici que visitant le chantier, lorsque nous demandons quels sont ces braves gens qui font un bon usage de leurs instruments le long de la Voie douloureuse, on nous répond que ce sont les habitants des deux villages de la Gaine et de la Giraudais, auxquels la première convocation n’était pas parvenue, et qui, avertis depuis, donnent, en ce moment, généreusement leur journée. Que Dieu les récompense !
†
Le mardi, 20 décembre, par un temps beau et clair, après un brouillard qui a duré deux jours, les hommes de St-Roch ouvrent les travaux de la quatrième semaine de l’Avent. Nous venons de les voir à l’œuvre. En entreprenant le nivellement des grandes allées latérales de la Voie douloureuse, on devait compter sur un travail de longue haleine, mais les pelles manœuvrent si bien qu’il suffira du quelques journées comme celle-ci. Et tout en travaillant on chante : Priez pour nous, bienheureux Montfort !
Quel contraste avec certaines bandes de chemineaux travaillant sur les routes ou les voies ferrées.
†
Aujourd’hui jeudi, 21 décembre, les travailleurs sont de Sainte-Reine. Sainte-Reine comme Saint-Roch, dont nous parlions hier, faisait partie de la grande paroisse de Pontchâteau, au temps de Montfort, et est restée également fidèle à son souvenir, toujours prête à répondre au premier appel fait en son nom.
La journée ressemble à celle d’hier. Le travail est le même, et sanctifié également par le chant des cantiques et par la prière. Le temps s’est un peu refroidi et n’en est que plus favorable pour les travaux qui se font en ce moment.
†
Au moment où nous traçons ces lignes, aujourd’hui jeudi, 22 décembre, arrivent les travailleuses du quartier de Casso, en Pontchâteau. Elles vont continuer le pavé de la Voie douloureuse, en remontant vers la station de la Véronique. Ce travail, qui a été commencé par les femmes de Crossac, va se poursuivre aujourd’hui, nous n’en doutons pas, avec la même activité et avec un semblable succès.
†
Plusieurs autres escouades de pèlerins travailleurs sont annoncées pour ces derniers jours de l’année. *
N° 5 Février 1899
Travaux
On a vu que déjà, en novembre et décembre de l’année qui vient de finir, notre Voie douloureuse avait été en partie transformée. Ce travail préparatoire, à la grande fête que verra l’année présente c’est continué depuis, et c’est notre devoir de faire connaître ceux qui, avec tant de générosité, malgré les rigueurs de la saison, sont venus y prendre part.
29 novembre 1898. — Ce sont les Bergonniers, ainsi qu’on les nomme, qui paraissent en tête de cette, nouvelle liste, et ils méritent bien cet honneur. Le village de Bergon, situé à l’extrémité de la grande paroisse de Missillac, forme comme un petit peuple à part dans son îlot de verdure. Et ce petit peuple s’est toujours montré très dévoué au Calvaire du B. Montfort. Ils sont là les travailleurs de Bergon, par une journée très froide. La terre est gelée, mais non au point de résister aux vigoureux coups de pelle et de pioche qui lui sont donnée. On se réchauffe vite à un semblable exercice. De temps en temps quelques refrains de cantique réchauffent aussi les cœurs.
27 décembre. — Au surlendemain de Noël, en la fête de saint Jean l’Evangéliste, les Saffréens ont-ils pensé, pour se donner du cœur, à cet apôtre qui seul eut le courage de suivre son maître jusqu’au sommet du Calvaire? Il est certain qu’il leur en a fallu, du cœur et de la générosité, pour venir eux aussi donner leur journée de travail au Calvaire du Père de Montfort. Qu’on en juge : Saffré est au moins à quinze lieues d’ici. Pour se rendre à la gare la plus proche, il y a deux lieues et pour plusieurs trois lieues à faire, et le train passe à six heures du matin. Là, il faut payer sa place; et pour l’ouvrier c’est le prix d’une bonne journée de travail sacrifié, pour pouvoir en donner une autre gratuitement. En gare de Pontchâteau, encore une lieue à faire à pied avant d’arriver au Calvaire ! Et tout cela s’est accompli gaiement. On les entend, ces braves pèlerins du travail, venir de loin, au chant des cantiques, et ils chantent encore à la messe qu’ils entendent dès leur arrivée. Puis, le travail commence et se poursuit avec ardeur. Il se prolongera jusqu’au départ après le coucher du soleil. Il est interrompu seulement dans le milieu de la journée par une légère réfection suivie de la visite aux différentes stations du pèlerinage, visite laquelle les travailleurs s’intéressent d’autant plus que, pour la plupart d’entre eux, tout est nouveau. Les trois bons vicaires de Saffré, dont le zèle avait préparé, organisé ce beau pèlerinage de travail, étaient présents et ne se sont pas ménagés dans la journée. Nous savons aussi que le vénérable Pasteur de la paroisse accompagnait la pieuse expédition de tous ses vœux.
La première journée de travail de l’année 1899, mardi, 3 janvier, est donnée par des travailleuses tenues des villages voisins. Elles continuent très soigneusement le pavé de la Voie douloureuse, entre la station du Cyrénéen et celle de la Véronique. Plus ce travail avance, plus il semble qu’on a bien sous les yeux le pavé des rues de Jérusalem inversées par Notre-Seigneur, portant sa croix. On souvient qu’il faudra des soins pour l’entretenir dans le même état. Mais n’est-il pas permis de compter pour cela sur le dévouement de celles qui se dépensent, aujourd’hui, sans compter, pour le faire? Les travailleuses de cette journée auraient certainement le droit de réclamer, si nous ne donnions pas les noms de leurs villages. Les voici : Travers, la Buronnerie, la Pitevinerie, la Noë, la Gossonnais, la Tanière.
†
Le mercredi, 4 janvier, le travail de la veille est continué par quelques travailleuses, en petit nombre, il est vrai, mais bien dévouées, venues des villages de Lornais, Bosla et Coismeux.
Elles se souviendront qu’elles ont pavé de leurs mains la Voie douloureuse, dans l’espace qui sépare la première chute de la rencontre de Notre Seigneur avec sa sainte Mère.
†
Le 6 janvier, en la fête de l’Epiphanie de Notre Seigneur, les travailleuses du village de Bergon qu’on attendait dès la semaine dernière, mais qui avaient été retenues par la pluie, arrivent ce matin. Elles se montrent comme toujours très actives et dévouées. Elles travaillent autour de la statue de Jésus tombant pour la première fois sous le poids de sa Croix. C’est Lui, c’est le même qui, à pareil jour, dans la Grotte de Bethléem, recevait les présents des Mages, après avoir reçu, quelque temps auparavant, les offrandes plus modestes dei bergers. Les uns et les autres s’en retournèrent comblés de bénédictions. Nul doute que le Divin Jésus ne bénisse aussi les pieuses chrétiennes qui sont venues, dans sa fête de l’Epiphanie, lui offrir cette journée de travail.
Elles sont courageuses les travailleuses de Saint-Roch. Elles sont parties ce matin sous la pluie, et elles ne pouvaient compter sur le beau temps, le beau soleil, qu’elles ont en arrivant ici. Elles en profitent au mieux pour continuer de paver la Voie douloureuse. Leur nombre est restreint, mais elles y suppléent par leur activité. Plusieurs retenues aujourd’hui pour diverses causes tiendront, sans doute, à se dédommager un peu plus tard.
11 janvier. — Les habitants de Saint-Guillaume sont nos plus proches voisins. Cependant, il nous semble, en inscrivant ce nom, que depuis assez longtemps il n’a pas paru sur les fastes des travailleurs du Calvaire. Et la raison ? Oh! la raison est des meilleures et toute à l’honneur de cette excellente paroisse. Regardez plutôt presque en face du Calvaire, sur ce joli côteau, cette belle église neuve, avec son clocher roman à jours, blanc Comme neige, mais muet encore. Bientôt les voix argentines de ses cloches viendront réveiller les échos de notre lande. Mais, tout cela ne s’est pas fait sans travail, et sans qu’on ait eu souvent recours au dévouement des bons paroissiens, pour charrois de pierres, charrois de sable, etc. Le R. P. Directeur du Pèlerinage ne pouvait songer à les convoquer alors. Du reste il savait bien qui leur attachement au Calvaire est toujours le même. Les travailleuses venues ici aujourd’hui le montrent bien. Malheureusement le temps est des plus défavorables. Elles sont nombreuses et le seraient bien davantage si toutes celles qui se sont mises en chemin étaient venues jusqu’au Calvaire. Un grand nombre arrivées au bourg, voyant les nuages s’amonceler de plus en plus, ont jugé que ce serait faire un voyage inutile. Cependant celle qui sont présentes n’ont pas le regret de partir sans avoir mis la main à l’œuvre. Dans la matinée elles ont chanté si dévotement le Rosaire à la chapelle ! Et voici que dans l’après-midi, une éclaircie leur permet de sortir et de se rendre à la Voie douloureuse, où elles font large et bonne besogne.
M. l’abbé Marchand, qui a bravé le mauvais temps pour venir, dès ce matin, prend une part très active au travail.
M. le Curé de Saint-Guillaume est là pour clôturer la journée. Il donne le salut du Très-Saint Sacrement.
Les Pontchâtelaines devaient venir nombreuses ce vendredi 13 janvier. Mais la pluie qui tombe le matin ne cesse pas. Il a fallu tout le courage bien connu du R. P. Directeur, aidé seulement de quelques bras, pour faire encore avancer un peu, dans cette journée, le pavé de la Voie douloureuse.
Paroisse de Sainte-Reine
17 janvier. — C’est vraiment le premier beau jour de l’année 1899. Aussi, encouragées par ce soleil de printemps, les ferventes chrétiennes de Sainte-Reine sont-elles venues nombreuses. Le souvenir des saintes femmes que Notre-Seigneur rencontra sur le chemin du Calvaire se présente naturellement en voyant avec quel dévouement, quelle piété on travaille aujourd’hui à la restauration de notre Voie douloureuse. Plusieurs sur lesquelles on ne comptait pas, parce qu’elles avaient déjà fait partie d’un autre groupe, reparaissent pour une seconde fois. Le R. P. Sarré remplace dans la direction des travaux le R. P. directeur qui a dû faire une courte absence, mais qui est à temps de retour pour donner le Salut et remercier, au nom du Père de Montfort, les bonnes ouvrières de cette journée.
En ne faisant appel qu’aux ferventes chrétiennes de Crossac qui n’avaient pas encore mis la main aux travaux de la Voie douloureuse, on ne pouvait compter sur une affluence aussi nombreuse pour aujourd’hui. Nous nous doutons un peu que, comme hier, il en est qui paraissent pour la seconde fois. Toutes s’occupent activement, les unes transportant les pierres dans des paniers, les autres les plaçant avec goût sur la Voie. C’est autour de Jésus chargé de sa Croix qu’on travaille aujourd’hui.
L’église de Besné, qui abrite les tombeaux de saint Friard et de saint Second, nous apparaît d’ici à une assez petite distance. Mais, dans cette saison surtout, alors que la rivière du Brivet est débordée, il faut faire un long détour pour venir au Calvaire. Ni la distance à parcourir, ni la pluie qui menace n’ont arrêté, ce matin, les travailleuses de Besné. Elles ont à leur tête M. l’abbé Laur, leur excellent curé. Si, de temps en temps, quelques grains les obligent à chercher un abri, elle, n’en ont pas moins fourni une somme de travail considérable à la fin de la journée. Le pavé qui sépare la station de la Véronique de la seconde Chute est leur œuvre spéciale.
Construction nouvelle au Calvaire
En arrivant de Pontchâteau au Calvaire, on voit une construction nouvelle, encore inachevée, présentant une assez large façade ayant vue sur le jardin de Nazareth. Plusieurs demandent quelle en est la destination. Nous croyons pouvoir sans indiscrétion satisfaire leur curiosité.
Cette construction nouvelle est destinée à servir de Maison de Retraite pour les Sœurs de la Sagesse.
Comme il est d’usage dans toutes les Congrégations religieuses, les Filles de la Sagesse se réunissent chaque année pour suivre les saints exercices de la Retraite. Cette réunion se fait par province, et comme la province de Nantes est très nombreuse, ce n’est pas sans difficultés que lui Retraitantes pouvaient être reçues par groupes successifs dans une même maison de la ville de Nantes.
Ayant à choisir un second centre de réunion, la Révérende Mère Supérieure générale a jugé, non sans raison, qu’il n’en était pas de plus favorable que le Calvaire. Le Calvaire avec tous ses souvenirs ! Le Calvaire avec ses stations et sanctuaires pieux ! Le Calvaire avec son silence et son calme habituels interrompus seulement par d’édifiantes manifestations de piété et de foi !
Où les Filles spirituelles du Bienheureux Montfort pourraient-elles mieux se pénétrer de l’esprit du leur saint Fondateur, que sur cette lande arroser de ses sueurs, dans ces lieux sanctifiés par la pratique de ses héroïques vertus, et, en particulier, de son humilité, et où, pour cela même, Dieu semble accorder à son intercession de plus merveilleuses faveurs ?
Là, tout parle de lui, et il semble qu’il y parle encore lui-même, prêchant Jésus et sa Croix, Marie et son saint Rosaire.
Nul doute aussi que les ferventes prières des Retraitantes n’obtiennent du Ciel de précieuses et abondantes grâces pour les différentes œuvres du Calvaire.
Enfin, ajoutons encore que, par très gracieuse concession, cette maison spacieuse, bien qu’ayant une destination spéciale, pourra s’ouvrir, dans certaines circonstances, pour donner l’hospitalité et être d’une grande utilité surtout à certains jours de grands pèlerinages.
N° 6 Mars 1899
Les travaux
Voici les Campbonnais ! disait-on en les voyant passer le mardi matin 24 janvier, la pelle sur l’épaule, se rendant au Calvaire.
Les Campbonnais, c’est un nom qui sonne bien, rappelant des dévouements héroïques, envers le Chef de l’Eglise, qui sont encore dans toutes les mémoires.
Et que dirait aujourd’hui le Bienheureux Montfort en entrant dans la splendide Eglise de Campbon, lui qui autrefois y trouva Notre-Seigneur si mal logé, qu’il ne put retenir les plaintes amères qui remplissent son cantique d’Amende honorable au Saint-Sacrement composé à Campbon même ?
Bref, les Campbonnais ne pouvaient manquer de répondre à l’appel qui leur a été fait dimanche dernier, du haut de la chaire, par le vénérable pasteur. Et c’est un beau bataillon de travailleurs conduit par M. l’abbé Apert, vicaire, qui arrive au Calvaire. Par une heureuse fortune, M. Gerbaud, l’ancien officier aux zouaves pontificaux est là, retrouvant sans doute parmi les travailleurs d’anciennes connaissances faites à Rome, sous le même drapeau. Inutile de dire que, dans cette journée, les pioches et pelles ne chôment pas. Les uns travaillent à des terrassements et nivellements jugés nécessaires, les autres roulent d’énormes pierres pour donner à la huitième et à la neuvième station, les piédestaux qui leur manquaient encore. Mais, ce n’est pas seulement une journée c’e travail que le Vénérable Doyen de Campbon avait bien voulu promettre au R. P. Directeur du pèlerinage, pour cette semaine. Le jeudi était encore réservé aux Campbonnais. Et voilà en effet, ce jour-là, un nouveau bataillon de braves, peut-être un peu moins nombreux mais tout aussi actif et dévoué que le premier. Du reste, les travaux sont du même genre que ceux de leurs devanciers : terrassements, nivellements, transport et placement d’énormes pierres, à la huitième station.
Pour le côté religieux, nous nous reprocherions de ne pas noter le chant d’un cantique en l’honneur de la Croix, au milieu de la journée, sur le sommet du Calvaire, et le salut du Saint-Sacrement toujours si beau lorsqu’il est chanté par une masse de voix d’hommes, comme ces jours-là.
Villages de Pontchâteau voisins du Calvaire
On a pu voir dans le dernier numéro que les Pontchâtelaines n’avaient pu venir au jour qui leur avait été fixé, à cause du mauvais temps. Or, entre les deux journées des Campbonnais, le mercredi, un certain nombre d’entre elles, qui habitent plus près du Calvaire, averties en particulier, sont venues continuer le pavé de la Voie douloureuse entre la septième et la huitième station. Elles ont montré un courage non ordinaire en ne cessant de placer une à une, de leurs mains, ces pierres presque glacées par un froid très piquant.
Paroisse de Campbon
Après les Campbonnais, les Campbonnaises ne devaient pas tarder à venir. Pouvaient-elles, du reste, ne pas être appelées à prendre part à ce travail, spécialement réservé, comme nous l’avoir, dit, aux femmes chrétiennes, de construire le pavé de la Voie douloureuse. Deux jours leur ont été assignés ainsi qu’aux hommes. Le premier jour, vendredi 3 février, la terre est tellement glacée qu’on ne compte voir venir personne. Cependant, un petit groupe s’est mis bravement en chemin. Sa confiance n’est pas trompée. En peu de temps, un beau soleil a ramolli le sol, ce qui permet, grâce à l’activité des quelques travailleuses présentes, de faire avancer le pavé de la Voie douloureuse, jusque vers la huitième station.
Paroisse de la Chapelle-Launay
La Chapelle-Launay compte assurément parmi les paroisses les plus dévouées à l’œuvre du Calvaire. Voyez, ce matin, lundi 4 février, une grosse averse tombait sur tout le pays. Ils ne viendront pas par ce temps, disait-on ; et voici le bon curé, si connu pour son activité et sa générosité, qui a pris les devants en descendant du train, et qui annonce la caravane qui le suit. Les nuages se sont dissipés, le soleil brille. A l’œuvre donc ! Actifs et généreux comme leur pasteur, les paroissiens de in Chapelle-Launay ne s’épargnent pas. Aussi, les allées s’aplanissent et la huitième station reçoit son revêtement d’énormes et beaux blocs de pierre. Le R. P. Directeur qui, certes, s’entend à la pose de ces lourdes masses, avoue qu’il a trouvé aujourd’hui des maitres. Belle journée, que couronne le salut du Très Saint-Sacrement, donné par M. le Curé.
7 février. — Nous ne nous trompions pas, en supposant que les Campbonnaises viendraient nombreuses, au second jour fixé. Elles dépassent certainement la centaine. Cependant, elles partaient, ce matin, sous la pluie; mais, comme hier, le temps s’éclaircit de bonne heure et la journée est très belle. Le travail de cette journée a été surtout de tout préparer pour la pose des statues de la neuvième station, qui sont annoncées à la gare, mais non encore arrivées malheureusement. On pût été si content de les voir en place, avant de partir. Au moins, on les verra à la grande fête que l’on se propose bien de ne pas manquer. M. l’abbé Warron était présent et a donné le salut.
Cette journée du vendredi, 10 février, a été marquée par la pose du groupe de statues représentant la neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois. Nous parlons ailleurs de ce groupe. Les bonnes travailleuses qui étaient venues, ce jour-là, de Camer et de Camérin, ont aidé à le mettre en place. Dans la matinée, elles avaient travaillé avec une activité admirable à préparer le socle qui devait le recevoir. Elles s’en souviendront et le bon Maître ne l’oubliera pas.
Jeudi, 16 février. — Grande activité aujourd’hui, dans l’espace qui s’étend de la huitième à la neuvième station. C’est dans cet espace seul que la Voie douloureuse manque encore de pavés. Les pieuses chrétiennes de St-Gildas, qui sont venues nombreuses, travaillent avec ardeur à combler ce vide. Les unes vont à une certaine distance chercher les pierres, les autres les présentent à celles qui finalement les mettent en place une à une, sur la Voie. Si le soir, le travail n’est pas complètement achevé, il est du moins bien avancé. Cette première journée de travail en carême, éclairée par un beau soleil de printemps, a été bien employée.
Elles sont moins nombreuses qu’on eût pu le supposer, les Pontchâtelaines qui sont venue, aujourd’hui travailler à la Voie douloureuse. Celles qui sont présentes méritent d’autant mieux d’être félicitées. On ne leur voit pas perdre une minute. Il faut dire qu’elles ont à paver la partie, de la Voie qui est le plus en vue. C’est la partie que l’on voit en arrivant au Calvaire, sur le bord de la route; on pourra constater que rien n’a été négligé pour que ce travail fût irréprochable.
Dans la soirée, le nombre des travailleuses avait doublé. Dans la soirée aussi, M. le Curé est venu les encourager de sa présence.
†
Nous avions pensé pouvoir annoncer à la fin de cette chronique des travaux, l’achèvement du pavé de la Voie douloureuse. Mais, il y a eu interruption, pour ce travail du moins, dans le commencement de cette première semaine de Carême. Peut-être, l’honneur d’y mettre la dernière main est-il réservé à une paroisse morbihannaise très dévouée et qui est annoncée pour vendredi, 24 février. Ces jours-ci, il n’y a pas eu chômage complet. Nous devons signaler le service rendu par quelques bons voisins qui, dans une soirée, ont amené sur la Voie douloureuse quatorze tombereaux de sable ou gravier.
Aujourd’hui mercredi, quelques braves ouvriers de Sévérac mettent en état, avec beaucoup de soin, l’allée qui conduit de la route au Saint-Sépulcre ; c’est un passage très fréquenté, et les pluies de l’hiver l’avaient rendu presque impraticable. Paraissant pour la première fois au Calvaire, le jeune vicaire de la paroisse a payé de sa personne au milieu des travailleurs.
La neuvième Station du Chemin de Croix
Enfin, depuis longtemps attendues, les statues qui composent la neuvième station de notre Chemin de Croix monumental sont arrivées.
Elles viennent d’être posées sur le piédestal qui leur a été préparé d’avance.
L’emplacement choisi, d’après la tradition, est à l’extrémité même de la Voie douloureuse proprement dite, là où commence la montée du Calvaire. A Jérusalem, d’après le Guide de Terre-Sainte, le Chemin de Croix est fermé au-delà de la huitième station.
Il faut revenir sur ses pas, prendre une autre rue, et c’est après divers détours que l’on arrive à l’endroit fixé par la tradition, comme étant la neuvième.
Ici, bien qu’il n’y ait pas à revenir sur ses pas on peut dire que la Voie douloureuse est aussi interrompue entre la huitième et la neuvième station. Elle est coupée par les deux routes de Saint Nazaire et de Guérande, qu’il faut traverser pour se rendre au Calvaire.
Ce que l’on constate tout d’abord avant d’examiner de près le nouveau groupe, c’est qu’il produit un excellent effet sur son piédestal rustique, dans cet espace auparavant trop nu qui s’étend devant le Calvaire.
Mais, approchons-nous ; car c’est de près seulement qu’on peut voir la Divine Victime, tant elle est affaissée, sur le dur pavé. Là, les yeux ne voient plus le soldat qui fait machinalement le mouvement de tirer son glaive, ni le bourreau qui a déposé vivement sa boîte à outils, marteau et clous destinés au supplice, et qui soutient, en ce moment, la lourde croix, en attendant que se relève celui qu’il va y clouer, tout-à-l ‘heure. Le regard se concentre tout entier sur la Divine Victime, sur ce visage meurtri dont les traits expriment tout à la fois la souffrance la plus intense, et la plus navrante douleur.
Il n’est personne, croyons-nous, qui, comprenant le sens mystérieux des trois chutes de notre Divin Sauveur sur le chemin du Calvaire, ne se sente, ici, particulièrement touché. En les contemplant, l’une après l’autre, on verra que l’artiste y a mis une gradation éloquemment significative. A la première, les genoux seuls ont fléchi. L’une des mains s’est portée en avant, et a trouvé un appui. A la seconde, la tête au moins s’est redressée avant de toucher le sol, mais à la troisième, le visage et le front lui-même ont été meurtris.
Devant cette troisième chute ainsi représentée, l’on dira, ce qui déjà a été dit de plus d’un des groupes du Calvaire : Cette vue seule est une touchante prédication.
A partir de ce moment, notre Chemin de Croix a donc ses quatorze stations marquées ; que ne pouvons-nous dire complètes. Il faudrait pour cela encore une dizaine de grandes statues. Deux seulement ont pu être commandées et sont attendues prochainement. Elles prendront place à la seconde station où la statue de Jésus chargé de sa Croix est seule encore.
Quant aux travaux de la Voie douloureuse, ils avancent rapidement et seront achevés dans un bref délai.
Il ne nous est pas permis de terminer ces quelques lignes, sans rappeler que la neuvième station est le don d’une noble famille dont la munificence généreuse pour toutes les bonnes Œuvres est connue de toute la contrée.
N° 7 Avril 1899
Les travaux
La paroisse morbihannaise que nous annoncions, en terminant notre dernière chronique des travaux, comme devant venir le 24 février, est Férel. Nous avions bien raison de la signaler comme très dévouée à l’Œuvre du Calvaire. Les travailleurs de dette journée en ont donné une preuve bien convaincante. Ici, nous finissons par regarder comme ordinaires des actes de dévouement qui paraissent incroyables à ceux qui en entendent parler, ou qui en sont témoins pour la première fois. Ce jour-là, nous avions à dîner de vénérables prêtres étrangers, qui avaient vu à l’œuvre les pieuses chrétiennes de Férel pendant la matinée. S’adressant à M. le Vicaire qui cette fois remplace son excellent recteur : — Vous avez, dites-vous, cinq lieues d’ici Férel ? — Oui, cinq bonnes lieues. — Et, comment tout ce monde, cette centaine de femmes, ont-elles fait la route ? — Les unes en carriole, et les autres à pied, et… en sabots. — Toutes, cependant, étaient arrivées pour entendre la messe que vous avez dite vous-même? — Aussi, plusieurs, les plus éloignées, étaient-elles parties dès deux heures, d’autres à trois heures du matin. — Quelle foi ! et quel courage pour affronter une telle fatigue ! — Il faut ajouter que M. le Recteur avait dit du haut de la chaire que pour celles qui feraient ce pèlerinage de travail, il n’y avait pas de jeûne, ce jour-là. Sans cet avis, il en est qui auraient tenté l’aventure.
Pendant qu’on échangeait à leur sujet ces paroles, les travailleuses avaient pris leur légère réfection, et profitaient des courts instants qui suivent pour faire à genoux l’ascension de la Scala Sancta»! Elles reprennent ensuite le travail et le continuent jusqu’à ce que la cloche les appelle à !a Chapelle pour chanter le salut, et recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement. Puis, elles partent joyeuses, sans paraître inquiètes du long chemin qu’elles ont à faire avant de prendre leur repos.
Missillac n’a pas oublié que pendant la construction du Calvaire le Bienheureux Montfort donnait en même temps la mission dans sa vieille église, reconstruite aujourd’hui sur un plan magnifique. Chaque semaine, le saint missionnaire prenait un jour pour venir ici diriger et encourager ses travailleurs. Les habitants de Missillac devaient l’y suivre en masse. Vraisemblablement, ce furent les fermiers de cette paroisse qui fournirent l’attelage légendaire de vingt-quatre bœufs, qui, des bords de la Vilaine, amena jusqu’ici triomphalement l’arbre géant, dont Montfort avait fait choix pour la grande croix de son Calvaire. Tous ces souvenirs sont encore très vivants dans cette grande et chrétienne paroisse. Aussi, n’y a-t-il qu’à faire un signe pour obtenir d’elle un acte de dévouement de plus pour l’Œuvre du Calvaire. Les travailleuses des deux belles journées du 27 février et du vendredi 8 mars, l’ont bien montré. Très nombreuses, et en même temps très actives, elles ont mis la dernière main au pavé de la Voie douloureuse, et beaucoup travaillé pour certaines plantations au pied même de la colline du Calvaire. Si, dans ces deux journées, on a bien travaillé, on a aussi bien chanté sur le sommet du Calvaire, et à la Chapelle du Pèlerinage.
Bien qu’à une assez grande distance du Calvaire, la paroisse de Guenrouët est une de celles qui, dès la première heure, sont venues, avec empressement, prendre part à nos travaux. Aussi, n’a-t-on pas craint de lui adresser un nouvel appel quand ces mêmes travaux touchent à leur fin. Travailleurs et travailleuses, venus en même temps, ont rivalisé d’ardeur et d’activité dans la journée du mercredi 1er mars. Ce sont eux qui ont commencé l’ornementation du pied de la colline du Calvaire.
On regrettait que le Pasteur, retenu par des circonstances imprévues, n’eût pu venir. Du moins, dans l’après-midi, M. l’abbé Martin, vicaire, a paru ; et c’est lui qui, au départ, a donné le salut, dans la Chapelle du Pèlerinage.
Encore une paroisse qui eut l’immense avantage d’avoir une mission donnée par le Bienheureux Père Montfort, pendant qu’il s’occupait de la construction de son Calvaire, sur la lande de la Madeleine, et qui n’en a jamais perdu le souvenir. Elle l’a bien montré chaque fois qu’on a fait appel à son dévouement pour les travaux en cours. Aujourd’hui, 6 mars, c’est un groupe peu nombreux, il est vrai, mais plein de bonne volonté, qui nous est venu sous la conduite de M. l’abbé Paré, vicaire de la paroisse. Ces braves travailleurs ont été occupés sur la plate-forme du Calvaire et aussi à quelques plantations.
Le lundi 13 mars était jour de congé pour les novices du Calvaire. En se rappelant la date, il en est certainement parmi les lectrices de l’Ami de la Croix qui devineront à quelle occasion ce congé leur était accordé. Mais, ce que nous avons seulement à mentionner ici, c’est la bonne pensée qu’ils ont eue de l’employer à l’achèvement de la Voie douloureuse.
Nous avons déjà dit que cette Voie est coupée, entre les huitième et neuvième stations, par la route de Saint-Nazaire et de Guérande. Or, entre ces deux routes, restait une langue de terre qu’il s’agissait de raccorder, de mettre en rapport avec le reste de la Voie. C’est ce que nos novices ont fait, très heureusement, dans leur journée de travail. Le soir, ce petit coin de terre, très en vue, puisqu’il se trouve à l’entrée même du pèlerinage, était vraiment transformé. Les jeunes aspirants missionnaires de la Compagnie de Marie étaient d’autant plus heureux de travailler sur ce terrain que c’est l’emplacement qui semble désigné naturellement pour l’érection d’une statue à leur Bienheureux Père.
Quelqu’un se demandera peut-être si c’était bien là un véritable congé pour cette jeunesse. Remuer, transporter de la terre et des pierres, cela ne se fait pas sans fatigue. Le soleil était déjà chaud, ce jour-là, la sueur perlait sur les fronts, nous pouvons l’attester. Mais, nos jeunes novices ne sont pas de ceux qui font consister la récréation dans le, farniente. C’était pour eux un changement de travail, d’occupation très agréable. Aussi, du matin au soir, la plus franche gaieté n’a pas cessé de régner parmi eux, et leurs refrains joyeux de se faire entendre.
On nous affirme que la paroisse de Donges compte un bon nombre d’abonnés à l’Ami de la Croix, et qu’on aime à y lire la petite revue. C’est à dire qu’on y est aussi très dévoué à l’œuvre du Calvaire, très attaché au culte du Bienheureux à Montfort. Aussi, malgré la saison avancée, le R. P. Directeur du Pèlerinage n’a-t-il pas hésité à demander là encore une journée de travail. Aujourd’hui, mercredi 15 mars, les Dongeoises, comme nous pouvons le constater, ont répondu en grand nombre à son appel. Nous les voyons formant une chaîne qui embrasse une grande partie de la colline. Elles se font passer de main en main des paniers chargés de terre végétale, qu’on déverse dans les anfractuosités des rochers, qui pourront ainsi se revêtir peu à peu de fleurs, arbustes et plantes grimpantes. Ce faisant, on a beaucoup chanté et à bien travaillé sous les rayons d’un beau soleil d’été.
Le pasteur était représenté par ses deux vicaires. Aux journées de Donges, on est toujours assuré de voir çà et là, dans les rangs des travailleuses, l’habit gris des bonnes sœurs de la Sagesse. Ajoutons ce petit détail. Nous avons dit qu’on se faisait passer de main en main des paniers chargés de terre. En voyant l’état de délabrement d’un bon nombre de ces vieux instruments de labeur, quelques bonnes âmes ont été touchées. Une petite quête a été faite dans les rangs pour leur procurer une honorable retraite, en leur donnant des remplaçants. Avis aux habiles vanniers de la Chapelle-des-Marais.
Les excellentes travailleuses de Drefféac avaient eu à se plaindre de ce qu’elles n’avaient pu accomplir qu’une faible tâche, à cause du mauvais temps, lors d’une première convocation. Elles prennent leur revanche aujourd’hui, favorisées par un beau soleil. Elles travaillent en même temps au sommet du Calvaire, au jardin de Nazareth, dans diverses allées qui demandent un nettoyage complet pour les fêtes de Pâques qui approchent, puisque nous sommes au mercredi de la semaine de la Passion. Elles partent visiblement contentes de cette journée donnée à Dieu et au bon Père de Montfort.
N° 8 Mai 1899
Les quatorze croix qui doivent être bénites le 24 juin
On sait que, pour l’érection d’un Chemin de croix, quatorze croix doivent être bénites et fixées à chacune des stations. C’est même à ces croix que sont attachées les nombreuses indulgences que peuvent gagner ceux qui font pieusement le saint Exercice du Chemin de croix. Les quatorze croix qui seront bénites le 24 juin, et fixées à chacune des stations de notre, Voie douloureuse, ont leur histoire, que les lecteurs de l’Ami de la Croix aimeront à connaître, comme tout ce qui touche à notre pèlerinage du Calvaire.
Quelques-uns se rappelleront peut-être qu’on 1892, l’Ami de la Croix a mentionné la visite, au Calvaire du T. R. Père. Jérôme, franciscain, alors vicaire custodial de Terre-Sainte. Notre Voie douloureuse n’était encore qu’à l’état de projet. Elle fut tracée sous ses yeux, et l’emplacement de chaque station marqué d’après les indications qu’il voulut bien nous donner lui-même. Nul autre n’en pouvait donner de plus précises et de plus sûre que celui qui, tant de fois, avait dirigé les pèlerins sur la Voie douloureuse de Jérusalem, les édifiant de sa parole à chaque, station.
Le Révérend Père nous quitta, témoignant hautement sa satisfaction de ce qu’il avait vu, et faisant des vœux pour l’exécution complète des projets du Bienheureux Montfort. Mais, il ne s’en est pas tenu là. Quelques mois après, de retour à Jérusalem, selon sa promesse, il faisait, ici, l’envoi de plusieurs précieux souvenirs de Terre-Sainte, et entre autres de quatorze petites croix, destinées à notre Voie douloureuse, et qui toutes ont été taillées dans le bois des vieux oliviers du jardin de Gethsémani.
Or, voici comment le Fr. Liévin, si bien documenté, parle de ces vieux oliviers dans son Guide de Terre-Sainte : « Ces arbres sont les plus vénérables qui existent, après l’arbre de la vraie Croix. Selon la tradition, c’est sous leur ombrage que Notre-Seigneur réunissait souvent les Apôtres, pour les instruire peu à peu des mystères du royaume des cieux, et pour vaquer à la prière. Fréquemment encore ils ont été les témoins des soupirs et des élans d’amour que son cœur adorable faisait monter vers son Père éternel. Enfin, ils ont été nourris dans une terre arrosée des pleurs et du Sang de l’Homme-Dieu, pendant cette nuit si lugubre et si précieuse qui a précédé sa mort. Voilà que dix-huit siècles et plus se sont écoulés depuis celte nuit mémorable, et, néanmoins, ces derniers témoins de l’agonie du Sauveur sur la terre sont encore là debout, portant sur leurs troncs et sur leurs branches la trace d’autant de siècles.
Quelques auteurs ont essayé, il est vrai, de leur ravir la vénération dont ils sont si justement entourés, et pour cela ils se sont appuyés sur un passage mal interprété de la guerre des Juifs. L’histoire rapporte que Titus, voulant en finir au plus tôt avec l’opiniâtreté des juifs, fit couper tous les arbres des alentours de la ville, pour construire de nouvelles plates-formes, et que les soldats durent aller en chercher jusqu’à la distance de 90 stades (quatre heures et demie de marche). Mais, cette citation, au lieu d’amoindrir la tradition, ne l’ai que la confirmer. En effet, celui qui a visité Jérusalem et qui connaît la position des lieux comprendra de suite qu’il était impossible aux soldats de Titus d’aller couper des arbres à une si faible distance des assiégés. Evidemment, ils auraient été tous écrasés dans la vallée et pas un seul n’eût pu regagner le camp. D’ailleurs, qui sait si, au temps de Notre-Seigneur, ces oliviers n’étaient pas trop jeunes encore pour servir à la construction des plates-formes, quoiqu’ils fussent assez fort déjà et assez vigoureux pour fournir un épais ombrage ? On sait que l’olivier n’a jamais une plus belle couronne de feuillage que dans sa jeunesse, quoique le tronc ne paraisse pas en rapport avec le grand développement de ses branches. En outre, les habitants do la Ville Sainte veillaient jour et nuit de ce côté-là pour ne pas laisser l’ennemi approcher de leurs murailles. L’hypothèse de la destruction des oliviers de Gethsémani est donc insoutenable, tandis que par contre s’explique très bien par là leur conservation. Mais, supposons qu’ils aient été abattus, leurs souches restaient toujours dans la terre, car, selon Pline, l’olivier ne meurt pas. Dans ce cas, les oliviers actuels seraient les rejetons de ceux qui existaient au temps de Notre-Seigneur, ce qui suffirait grandement à expliquer le respect, et je dirai la vénération, dont ils ont été l’objet dans tout le cours des siècles. Une chose est absolument certaine, c’est que ces mêmes arbres étaient là où ils sont aujourd’hui, alors que l’islamisme s’est emparé de la Palestine ; en voici la preuve. Les sectateurs du Coran ont ordonné, dès le principe, que tout arbre qu’on planterait désormais serait soumis à l’impôt. Or, les oliviers de Gethsémani n’ont jamais été l’objet d’aucun tribut. Donc, ils n’ont pas été plantés depuis l’invasion de l’islamisme, et par là seul, ils justifient déjà plus de douze siècles d’existence.
Ces oliviers, qui ont assisté à toutes les révolutions de Jérusalem sont mentionnés dans nos anciennes archives et dans les relations de nos vieux pèlerins. On en comptait neuf au XVIIe siècle ; le neuvième a péri depuis par suite de la dévotion indiscrète des pèlerins. Leurs troncs sont énormes, le plus gros a huit mètres de circonférence. Ils n’ont que peu d’écorce, et si l’on n’y voyait pas des branches et des feuilles, on les prendrait facilement pour des quartiers de roche ; ils en ont la tournure et la couleur. Pour leur conserver autan de vigueur que possible, on ne leur laisse que peu de bois. Néanmoins, presque tous les ans, ils fournissent encore une assez bonne récolte. »
Nous avons pensé que la connaissance de ce détails ne laisserait pas indifférents les pieux pèlerins qui monteront notre Voie Douloureuse e faisant leur Chemin de Croix, et que plusieurs trouveront dans ces souvenirs un aliment de plus pour leur piété.
En même temps que les quatorze croix faites du bois des oliviers de Gethsémani, le R. P. Jérôme nous envoyait aussi quatorze petites pierres détachées et recueillies à chacune des stations de la Voie douloureuse de Jérusalem.
Ainsi que les croix, ces pierres, assurément précieuses, seront fixées d’une manière apparente à chacune des stations correspondantes de notre Voie douloureuse.
C’est ainsi que peu à peu tout se prépare, tout concourt pour que notre Jérusalem bretonne (puisqu’on l’a ainsi surnommée), rappelle de plus en plus la Sainte Cité de l’Orient. Les monuments déjà existants, les grandes scènes qui y sont représentées, ces reliques ou religieux souvenirs dont nous venons de parler, est-ce qu’il n’y a pas là tout ce qu’il faut pour mettre au cœur des pèlerins du Calvaire quelque chose du moins des grandes et saintes émotions qu’éprouvent en ce moment ceux qui s’embarquaient naguère sur la Nef du Salut, et qui parcourent en ces jours la Terre-Sainte ? Et, il en sera ainsi de plus en plus à mesure qu’avancera l’exécution des projets du Bienheureux Montfort.
N° 9 Juin 1899
Fête du 24 Juin 1899 au Calvaire de Pontchâteau
Arrivée de Son Eminence et de Nosseigneurs les Evêques, la veille à 5 heures 15 à Pont-Château.
1° A10 heures 1/4 Son Eminence et Nosseigneurs les Evêques seront conduits processionnellement à la Scala Sancta.
Les paroisses venues avec croix et bannières devront alors se trouver devant le Prétoire, où elles seront rangées selon l’ordre d’arrivée.
L’avenue en face des statues, à gauche de la Voie douloureuse, devra rester libre durant toute la cérémonie.
A l’arrivée des Prélats, cantiques : Dieu le veut… — Vive Jésus, vive sa Croix…
2° Messe à 10 heures 1/2. Cantiques : Priez pour nous. — Oh! l’auguste Sacrement, — Je suis chrétien.
3° Le R. P. BOUVIER adressera la parole aux pèlerins après la messe.
4° Bénédiction des croix et érection du Chemin de la Croix.
Plusieurs prêtres placés de manière à être entendus de tous les pèlerins, liront en même temps une courte formule et réciteront un Pater et un Ave à chaque station.
Tous les pèlerins répondront aux prières et prendront part au chant du cantique et du Sancta Mater.
Entre les stations, dont la distance est plus considérable, ou ajoutera quelques couplets du cantique : Vive Jésus, vive sa Croix.
Nos seigneurs les Evêques, précédés du Christ, du Bienheureux, s’avanceront par l’avenue à gauche dol la Voie douloureuse.
En même temps les fidèles se dirigeront lentement vers le Calvaire.
On ne montera pas sur la Voie douloureuse.
Pendant l’érection du Chemin de la Croix, aucun laïc ne pénétrera dans l’enceinte du Calvaire.
5° La cérémonie se terminera par le salut du Très Saint-Sacrement donné du haut du Calvaire et la bénédiction de Son Eminence et de Nosseigneurs les Evêques.
Après le salut, cantiques : Honneur, amour, gloire à la Croix… — O Montfort, ô Bienheureux Père.
Durant toute la matinée des messes seront célébrées dans les Chapelles du Pèlerinage. On y distribuera la sainte communion. .
Pèlerinage de la Vendée à Sainte-Anne d’Auray et à Pontchâteau
sous la présidence de Mgr l’Evêque de Luçon 22-23 juin 1899
Sous ce titre, la Semaine catholique de Luçon, du samedi 27 mai, donne un caractère officiel à l’annonce déjà faite d’un pèlerinage vendéen au Calvaire, à l’occasion de la fête du 24 juin.
« Le 24 juin prochain, dit-elle, la Bretagne et la Vendée s’uniront pour affirmer leurs antiques croyances, pour former une escorte d’honneur à l’étendard de Jésus-Christ et pour acclamer leur glorieux apôtre sur le théâtre même de ses plus grandes épreuves.
» Ce sera pour le Bienheureux Montfort un magnifique triomphe, auquel les Vendéens auront à cœur d’apporter une large part, la part qui leur revient de droit. »
Les pèlerins de la Vendée iront d’abord à Sainte-Anne d’Auray saluer et vénérer, dans son illustre sanctuaire, la grande patronne de la Bretagne. Quatre trains sont retenus : l’un au départ d’Evrunes-Mortagne ; deux autres au départ de la Roche-sur-Yon, par Clisson ; et le quatrième enfin, au départ de la Roche-sur-Yon, par Challans.
Le départ de Vendée aura lieu le jeudi matin, 22 juin.
Voici, sauf quelques modifications de détail qui pourront s’imposer plus tard, le programme arrêté pour ce qui concerne le Calvaire de Pontchâteau.
1° Arrivée à Pontchâteau, le vendredi, vers 4 heures du soir.
2° A 8 heures, réunion au Calvaire pour la procession aux flambeaux. La grotte de Gethsémani, le Prétoire, la Voie douloureuse et le Calvaire seront illuminés aux feux de Bengale. Ces diverses stations du pèlerinage pourront être visitées à loisir par les pèlerins de la Vendée, le vendredi soir et le samedi matin avant la grande cérémonie.
3° Le samedi 24, vers 7 heures du matin, Monseigneur dira la messe de communion au Prétoire, pour le pèlerinage vendéen.
Après cette messe spéciale, les pèlerins se disposeront à assister à la cérémonie générale du l’inauguration du Chemin de la Croix.
4° Départ de Pontchâteau le samedi 24, vers trois heures de l’après-midi.
N. B. — Le vendredi soir, la chapelle du Pèlerinage sera ouverte aux pèlerins qui auront la dévotion de prendre part à l’Adoration nocturne.
†
Désormais, quelques jours seulement nous séparent de cette grande fête du 24 juin.
Nous sommes heureux de pouvoir dire à nos lecteurs que toutes les nouvelles, arrivant eu ce moment de tous côtés au Calvaire, font prévoir que rien ne manquera à cette fête pour en faire une splendide manifestation de foi.
D’après les nombreuses réponses d’adhésion déjà reçues, il est permis d’affirmer qu’aucune ou presque aucune des cent vingt paroisses qui ont pris part aux travaux du Calvaire ne manquera à l’appel. Toutes seront là avec leur clergé et leur bannière.
De plus, des trains spéciaux sont organisés sur les diverses lignes qui abordent à Pontchâteau, en dehors des quatre trains de la Vendée dont nous parlons plus haut.
Le Comité des pèlerinages de Nantes a obtenu de la Compagnie des chemins de fer d’Orléans la mise en marche d’un train spécial partant de Nantes vers 7 heures du matin, et arrivant à Pontchâteau à 8 heures 20 minutes.
Le même Comité est en pourparlers avec la même compagnie pour un autre train spécial partant de la Poissonnière (Maine-et-Loire), et s’arrêtant à toutes les autres gares jusqu’à Pontchâteau. Le départ de la Poissonnière aurait lieu vers 5 heures du matin, l’arrivée à Pontchâteau à 8 heures 40.
L’annonce de ce train nous fait compter sur la présence d’un certain nombre de pèlerins du diocèse d’Angers faisant cortège à Sa Grandeur Monseigneur Rumeau, qui a bien voulu accepter l’invitation d’assister à la fête.
D’autres trains spéciaux sont organisés sur une ligne de l’Ouest dans la direction de Châteaubriand ou de Saint-Nazaire.
D’autres enfin sont annoncés venant par Redon, de Ploërmel et des environs.
N’y a-t-il pas dans ce magnifique élan des populations pour venir, ici, acclamer la royauté de Jésus-Christ par sa croix, de quoi consoler un peu au milieu des tristesses de l’heure présente?
Des voix impies rugissent plus que jamais le Nolumus hunc regnare super nos, Nous ne voulons pas qu’il règne sur nous, faisons entendre plus haut le Vivat Christus qui diligit Francos ! Vive le Christ qui aime les Francs !
Les travailleurs de Plessé, du Coudray et de Saint-Joseph-du-Dresny
Le mercredi 17 mai nous a remis sous les yeux le spectacle des plus belles journées offertes au Bienheureux Montfort, pour la continuation de son œuvre. Le travail ne manque jamais au Calvaire, et si la discrétion ne permet pas au R. P. Directeur d’inviter lui-même, en cette saison, il se garde bien de refuser les offres qui lui sont faites spontanément.
Dans le cas présent, l’initiative est due, croyons-nous, à M. le Curé de Plessé, qui n’a pas eu de peine à s’entendre avec MM. les curés du Coudray et de St-Joseph-du-Dresny, dont les paroissiens forment une même commune avec la paroisse de Plessé. Le matin, quel beau défilé de voitures portant deux cents hommes, tous armés de leurs instruments de travail. Ils les déposent pour entrer à la chapelle du Pèlerinage, où tout d’abord ils entendent dévotement la sainte messe. Mais ils les reprennent bientôt. Tout a été heureusement prévu pour la direction d’un si grand nombre de bras. M. Gerbaud est là et fait manœuvrer une escouade au pied même du Calvaire. Le R. P. Guihéneuf en occupe une autre à l’aplanissement de la voie centrale du pèlerinage.
Les RR. PP. Barré et Sarré se sont réservé le chargement et le transport des pierres choisies à l’avance, que M. Gerbaud fera mettre en place plus tard autour de notre fontaine, avec le savoir-faire qu’on lui connaît.
Après la réfection de midi, tous font l’ascension du Calvaire, en chantant et acclamant Jésus et sa Croix. Puis les travaux reprennent pour se continuer jusqu’à l’heure fixée pour le départ, précédé comme toujours de la bénédiction solennelle du Très-Saint-Sacrement.
†
Notons l’apparition très édifiante au Calvaire des jeunes retraitants, anciens élèves de l’Externat des Enfants nantais, réunis au Prieuré de Pontchâteau. La retraite était donnée, cette année, par le R. P. Chambellan, de la Compagnie de Jésus. Il semble être d’usage désormais, dans ces pieuses retraites, de venir, la veille de la clôture, faire un Chemin de Croix au Calvaire.
N° 10 Juillet 1899
Érection et inauguration du Chemin de la Croix au Calvaire de Pontchâteau
L’extrémité d’un large plateau d’où le regard aperçoit, dans de lointains horizons, les vastes marais de la Grande-Brière, les flots de l’Océan, la Loire descendant vers la mer entre les ondulations du sillon de Bretagne et les collines du pays de Retz, les plaines ombragées de Besné, Campbon, Pontchâteau, Missillac, enfin des landes qui fuient vers la Vilaine et le pays breton, voilà l’emplacement choisi par le Bienheureux Montfort pour y dresser la Croix.
Quand on suit les événements qui se sont succédé là, on a le droit de conclure que la lande de Pontchâteau est un terrain d’élection providentielle. Le premier ouvrier disparu, d’autres reprirent la tâche, avec une mystérieuse et opiniâtre conviction que c’était obéir à une disposition d’En Haut.
Les dix dernières années de ce siècle auront vu renaître les scènes de foi de la première heure : travailleurs venus en foule de tous les points de l’horizon, tous les âges, toutes les conditions donnant leur concours au milieu des cantiques et des prières.
Ne jugez point ce qui a été exécuté avec des principes d’art. A part la Scala Sancta, tout est simple, naïf, populaire. Populaire ce chemin vers la montagne, sur lequel sont espacées les diverses stations ; populaires le torrent de Cédron, la grotte de Gethsémani ; populaires l’amoncellement gigantesque de terre, la grotte d’Adam, le sommet où sont retracées les scènes finales de la Passion, dominées elles-mêmes par trois croix, portant haut dans les airs le Christ et les deux larrons.
Mais nous entendons plus d’un lecteur dire : que comprenez-vous par ce mot populaire ? Il veut dire, en la circonstance, une œuvre ayant jailli du cœur de la foule, exécutée par elle avec foi, enthousiasme, naïveté, simplicité, en dehors des règles qu’a fixées l’humaine raison, ambitieuse de réaliser le beau ; une œuvre qui saisira la foule, l’attirera fortement et mettra, en ses mille poitrines, de fortes résolutions, fera pleurer et prier. Maintenant que l’artiste raisonne, discute, passe en méprisant ; il y a là une beauté mystérieuse qui se dégage de l’ensemble, que perçoivent, que percevront les âmes chrétiennes. Cette beauté, qui se sent, dont on emporte avec soi la vision puissante, est la meilleure, c’est la seule qu’on ambitionné de réaliser tous les amis du Calvaire, la seule dont ils poursuivront avec patience, dévouement, opiniâtreté, l’entière exécution.
Pourtant la fête du 24 juin 1899 a été déjà un couronnement, parce que, si chaque détail de l’œuvre est encore inachevé, l’ensemble se présente avec assez de caractères définitifs pour avoir mérité une solennelle dédicace.
Ainsi l’avait compris le Révérend Père Barré, directeur des travaux du Calvaire et des pèlerinages, de même que ses dévoués collaborateurs. Ils avaient crié haut et loin: Venez au Calvaire, la montagne est prête ; le Chemin de la Croix est achevé.
Chers amis, tressaillons d’allégresse,
Nous avons le Calvaire chez nous.
Tout un peuple s’est mis en mouvement et s’est rencontré dans l’enceinte sacrée, sous la présidence de ses chefs dans la foi, Son Eminence le cardinal-archevêque de Paris, l’illustre enfant de l’Eglise de Nantes, de NN. SS. les évêques de Nantes, de Luçon, d’Angers et de Vannes. Combien vous avez dû être fier, Monseigneur de Nantes, de donner à vos frères dans l’épiscopat le spectacle d’une telle revue de vaillants chrétiens! Sont-elles plus belles, Messeigneurs, vos assemblées soit sur la lande d’Auray, soit dans la prairie du Marillais, dans la vallée de Saint-Laurent-sur-Sèvre, ou au sommet de la montagne des martyrs ?1
La grande fête a eu sa vigile pieuse, sa nuit d’adoration et de prières, sa procession aux flambeaux, ses supplications, ses prédications, des messes et des communions nombreuses dans la chapelle des Révérends Pères.
Enfin le jour s’est levé. Le ciel demeure chargé de nuages assez élevés pour dissiper toute crainte de pluie, et rassurer les timides contre les ardeurs du soleil. La Providence maintiendra suspendu, durant tous les exercices, cet immense et soyeux vélum. Dans toute la région qui environne le Calvaire, les cloches s’éveillent dans leurs tours et jettent à travers les espaces le signal du départ des processions paroissiales. La matinée est clémente aux pieux voyageurs : nulle poussière; dans les airs, les bannières voyagent immobiles aux mains des robustes jeunes gens.
Vers 7 heures, le premier flot des arrivants vient s’arrêter sur la lande ; puis d’autres flots se succèdent sans interruption, toujours plus nombreux, plus animés, plus variés à mesure que nous approchons de l’heure fixée pour la cérémonie.
Quel ensemble pittoresque! C’est le pays nantais, c’est la Bretagne, c’est l’Anjou, c’est la Vendée ; ce sont les villes, ce sont les campagnes ; sous les costumes d’autrefois mêlés aux modes du jour, toutes les conditions groupées dans la fraternelle unité de la foi, de la prière, du cantique.
Combien de paroisses étaient là, conduites par leurs pasteurs, ayant marché de longues heures, souvent bannières déployées, aux joyeux accents d’une fanfare, le chapelet à la main, la Croix ou le Sacré-Cœur sur la poitrine? Il faut bien citer des noms; même une sèche nomenclature dira mieux que des épithètes accumulées la magnificence de la cérémonie, l’ampleur et la profondeur du mouvement vers le Calvaire du Bienheureux Montfort.
Du diocèse de Nantes, toutes les paroisses des cantons de Pontchâteau, de Saint-Gildas, d’Herbignac, de Blain, de Nozay, de Guérande, du Croisic, de Saint-Nazaire, de Savenay ; les paroisses de Paimbœuf, de Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Sainte-Pazanne, la Chevrolière, Rezé, Saint-Herblain, Basse-Indre, tout le canton de Saint-Etienne ; Marsac, Jans, Massérac, les environs de Plessé, de Guémené. Au premier rang des paroisses nantaises, la paroisse de Pontchâteau, fière de son privilège, jalouse des droits que lui a créés le passage du Bienheureux Montfort. Du pays Vannetais, Nivillac, Fôrel, Pénestin, Saint-Dolay, Théhillac, Péaule, Biliers, Muzillac, Ambon, la Roche-Bernard, tambours et clairons en tête, Pénerf, Peillac, Malensac, Pluerlin, Lizio avec une nombreuse musique instrumentale. C’est le canton de Malestroit, Josselin, les Fougerets, Saint-Martin-sur-Oust, Saint-Gorgon, Rochefort-en-Terre. Il y a aussi des Rennais, particulièrement ceux de Janzé; des Vendéens venus malgré tous les contretemps, accourus des rives de la Loire ou des champs du Bocage.
C’était un océan humain venant battre de ses flots les murs de la Scala, et débordant dans la plaine entre des vignes verdoyantes, des chênes nouvellement plantés et les blés qui mûrissent.
A10 h. 1/2, cinquante bras robustes soulèvent le lit d’honneur où est couché le Christ du Bienheureux Montfort. Le cortège s’avance, formé de jeunes apostoliques, des novices de la Compagnie de Marie, des RR. PP. Mineurs, des prêtres des paroisses, des RR. PP. Missionnaires de l’Immaculée-Conception, des chanoines des diocèses de Nantes et des diocèses étrangers, de Nosseigneurs les évêques, de Son Eminence, enfin d’une foule compacte redisant un même cantique, où l’on entend se mêler les noms de Montfort, de la Croix, de Jésus, de Marie.
Au sommet de la Scala se massent les prêtres. Les évêques prennent rang à leurs trônes, entourés des dignitaires ecclésiastiques. Aussitôt commence le Saint Sacrifice de la Messe, offert par Monseigneur l’Evêque de Nantes, assisté de M. l’abbé Leroux, vicaire général, et du R. P. Renaud, supérieur des Missionnaires diocésains.
Quel enthousiasme dans le chant des cantiques ! quel recueillement au moment de la Consécration ; tous les fronts sont à terre. L’autel, à cette heure, est le vrai Calvaire. Une sonnerie de clairons passe sur la foule; c’est une acclamation royale au divin Immolé, au divin Crucifié.
Le Sacrifice achevé, le R. P. Bouvier, de la Compagnie de Jésus, apparaît au sommet des degrés de la Scala. La taille du religieux est moyenne ; mais les traits du visage sont mâles profondément, accentués. Le geste est vif, brusque parfois, mais s’adapte merveilleusement à toutes les nuances de la pensée. A le voir, à l’entendre surtout, on sent une âme pénétrée de la force de la vérité, la jetant à la foule dans un langage clair, précis, logique, animé, avec toutes les audaces d’un apôtre qui s’oublie pour ne songer qu’à son maître et à son triomphe.
C’est bien le triomphe de Jésus-Christ par la Croix qu’a célébré le Père Bouvier, triomphe précédé d’humiliations qui le font plus éclatant aujourd’hui. Le Calvaire du Bienheureux, c’est un trône, c’est un rempart; un trône vers lequel montent l’adoration et la réparation, un rempart derrière lequel s’abriteront victorieusement les croyances et les mœurs. La voix de l’orateur atteignait les extrémités de la foule. Une heure il a parlé, une heure il a tenu en suspens ces cinquante mille chrétiens. Quels frémissements, quand il évoquait en cris ardents le passé de la Bretagne et de la Vendée ! A un moment, le Père ayant jeté aux quatre coins de l’espace le cri de « Vive la Croix ! » la foule a répondu par une immense acclamation. C’était comme un grondement de tonnerre dont les éclats roulaient au loin. Est-ce donc qu’à la voix des assistants se mêlaient la voix de tous les travailleurs de deux siècles, la voix de tous les amis du Calvaire depuis 1709, pour donner à nos vivat une intensité inouïe ? Ah ! ceux qui étaient là n’oublieront jamais cet instant d’enthousiasme !
Au Révérend Père succède Monseigneur l’Evêque de Nantes. En quelques paroles, Monseigneur rappelle son premier pèlerinage au Calvaire, son émotion à la vue des travailleurs, comment il s’agenouilla et baisa la poussière sanctifiée par les pas du Bienheureux. Puis Sa Grandeur adressa à Son Eminence le Cardinal Richard et à ses vénérés confrères dans l’épiscopat les plus gracieux remerciements. Ces prélats étaient bien à leur place dans ce triomphe de l’œuvre chère au Père Montfort, qui est un breton de naissance, qui prêcha dans l’Anjou et alla mourir dans le Luçonnais.
Tout cela, dira le lecteur, devait être bien long. Sans doute; mais, qui s’en est plaint? qui en a eu conscience? Voici l’heure de l’inauguration canonique du Chemin de la Croix. Chaque croix est bénite, le cortège des prêtres et des pontifes remonte la Voie douloureuse, suivi par la foule priant, chantant et se prosternant. Les larmes tombaient des yeux à la vue de Son Eminence, des Evêques prosternés à chaque station, les genoux et le front dans la poussière du chemin.
Combien fut émouvante la montée du Calvaire! On n’apercevait plus les lacets de la montagne, plus les pierres du monument, c’est une immense grappe humaine suspendue aux lianes du tertre grandiose, toutes les enceintes sont combles. Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que, dans cette manœuvre où tout est improvisé, il n’y a eu que du recueillement, que des prières, que des cantiques. Mon Dieu ! que la foi est donc puissante pour discipliner les foules et mouvoir les âmes dans une harmonieuse unité !
L’érection du Chemin de Croix achevée, Son Eminence présida le salut du Très Saint-Sacrement, donné au sommet du Calvaire. Quel moment quand, tenant dans ses mains l’ostensoir d’or, le Cardinal laissa tomber sur la foule immense, joyeuse, la bénédiction royale de Jésus-Christ ! Ah ! oui, louez le Seigneur, ô peuples privilégiés de la Bretagne, de la Vendée, de l’Anjou ! Qu’il règne sur vous et au-delà, sur la Patrie française ! L’émouvante cérémonie s’acheva par la bénédiction papale à laquelle Nosseigneurs ajoutèrent leur commune bénédiction.
A la fin du repas, offert en leur communauté par les Pères de la Compagnie de Marie, le R. P. Maurille, supérieur général des fils de Montfort, adressa à Nosseigneurs les Evêques des actions de grâces, empreintes d’une grande délicatesse et d’une pénétrante émotion. Combien elles devaient aller au cœur de l’Archevêque, ces paroles qui lui rappelaient qu’il y a trente ans passés, comme vicaire-général du diocèse de Nantes, il présidait aux premiers travaux de la chapelle, à la bénédiction d’une cloche qui devait y sonner tant de joyeuses fêtes. Le vicaire-général d’alors y apportait les vœux et la bénédiction de son évêque bien-aimé, Mgr Jacquemet. Cette bénédiction du pontife et les prières de son fils d’élection ont fait fleurir le désert, ont peuplé la solitude. Dans sa réponse, Son Eminence ne se fit point faute de revenir vers le passé, d’évoquer des noms toujours en honneur dans nos annales nantaises, et de rappeler enfin au P. Bouvier que, s’il a du lustre entre les grands orateurs, ses maîtres ont été des prêtres nantais, son examinateur et son juge fut souvent le Vicaire général qui environna d’un zèle si éclairé l’enseignement chrétien.
Monseigneur de Nantes voulut parler encore, dire à tous sa joie, sa fierté, ses consolations. Enfin il rendit, comme il était juste, hommage au R. P. Barré, qui a été, selon le témoignage de Sa Grandeur, le vaillant ouvrier que rien ne décourage, l’âme de tout ce grand mouvement de pèlerinages vers le Calvaire, mouvement dont rien n’arrêtera plus les bienfaisants accroissements.
M. Gerbaud, ancien zouave pontifical, ancien pèlerin de Jérusalem, l’auxiliaire laïque du R. P. Barré dans les diverses constructions du Calvaire, résuma en quelques paroles les phases vraiment héroïques de tant de travaux.
Ce compte rendu, le R. P. Barré nous a prié de le faire ; nous n’avons donné que des notes: un fils du Bienheureux Montfort ou un associé de son œuvre eût dit mieux avec son esprit et son cœur; c’est la pensée qui nous obsédait pendant que nous écrivions ces lignes.
Votre œuvre, mon Père, vous me permettrez de vous l’avouer, n’est pas achevée; mais vous avez résolu de vous recueillir, de vous reposer, et aussi d’attendre les interventions de la Providence. « Combien de temps durera cette période? » Vous en serez juge. A tout hasard, je forme un vœu en terminant : 1910 sera l’anniversaire de la grande humiliation du Calvaire ; que 1910 soit le grand triomphe du Calvaire ; que Jérusalem soit vraiment reproduite sur la lande ; que la montagne soit élargie, surélever encore; que plus haut se dresse l’image du Christ pour bénir plus loin ; que chaque station se complète, apparaisse avec plus de relief, de majesté, de vérité-, que vous soyez, mon Père, à ce triomphe, et que la définitive et solennelle consécration en soit faite par l’Evêque bien-aimé que Dieu réserve longtemps encore pour la joie et le bonheur de l’Église de Nantes !
L’abbé Jarnoux.
TRONE ET REMPART DISCOURS PRONONCÉ
AU CALVAIRE DE PONTCHATEAU
le 24 Juin 1899 Par le R. P. BOUVIER, de la Compagnie de Jésus
Eminence2,
Messeigneurs3,
Mes Frères,
Ce n’est pas la première fois que ces landes sont sillonnées par des légions incalculables de pèlerins. Les pèlerins y affluaient aussi nombreux peut-être qu’aujourd’hui, le 14 septembre 1710. En ce temps-là, un grand missionnaire, un de ces hommes que Dieu tient en réserve aux heures décisives, pour les peuples qui en sont dignes, évangélisait la Bretagne et la Vendée, affermissant la foi contre l’orage qui s’annonçait, élevant partout des Calvaires, pour perpétuer le souvenir de son passage et de ses prédications. Mais, dans son audace apostolique, il avait conçu un dessein grandiose : il voulait ériger sur un point favorable une croix monumentale qui fût, pour ces contrées, le rendez-vous général de la piété populaire, et, cédant à une inspiration du ciel, c’est sur cette lande qu’il se détermina à réaliser son projet. Le lieu était bien choisi, à l’extrémité de la Bretagne et en face de la Vendée, au milieu d’un peuple dont le caractère combine harmonieusement les qualités des deux races, et chez lequel Bretons et Vendéens se croient également sur leur propre sol.
A son appel, vos pères répondirent avec cet enthousiasme que suscite toujours chez vous une grande pensée religieuse. De longs mois, on vit des escouades de travailleurs se succéder ici sans interruption. Armés de cette foi qui transporte les montagnes, ils élevèrent un tertre colossal sur lequel se dressa majestueusement la croix. Et le jour fixé pour la bénédiction solennelle du monument était arrivé.
Mais, hélas ! ce sera perpétuellement la condition du zèle de rencontrer ici-bas des entraves. Un ordre supérieur, transmis d’office par l’Evêque de Nantes, vint inopinément interdire la cérémonie projetée. Cette montagne, que la piété avait élevée comme un trône au Dieu crucifié, la malveillance l’avait représentée au loin comme un rempart derrière lequel pourraient s’embusquer avantageusement les ennemis de la France, s’ils venaient quelque jour à débarquer sur les côtes de Bretagne.
A la déception et à la consternation générale, on dut se séparer sans avoir appelé les bénédictions du ciel sur des travaux qu’un second ordre enjoignit bientôt de renverser.
Cependant, que Montfort se console, sa pensée est tombée en des âmes dont la ténacité justement proverbiale aura raison de la malveillance, de la politique et du temps. Ici la volonté participe à la vigueur des chênes et à l’immobilité des rocs. Ce peuple y mettra deux siècles, s’il le faut, deux siècles pendant lesquels on le verra reprendre, poursuivre, interrompre et reprendre encore l’œuvre commencée ; mais il ne s’arrêtera qu’après lui avoir donné « toute sa perfection et toute sa splendeur.
Enfin, enfin, l’heure de la Providence a sonné. Le jour que vos pères avaient désiré de voir s’est levé. Et c’est votre gloire de l’avoir hâté par un dévouement qui rappelle ce que nos annales ont, consigné de plus admirable aux plus beaux siècles chrétiens. On dit que, depuis sept années, sous l’impulsion du zèle qu’un fils de Montfort semble avoir hérité de son Bienheureux Père, vous avez consacré ici plus de cent vingt mille journées du travail volontaire. Je comprends que vous soyez, fiers de votre œuvre : le plan du grand missionnaire, cette fois, est réalisé et dépassé.
Autour de cette croix gigantesque vous avez reproduit, avec une rare fidélité topographique, les principaux théâtres de la Passion, depuis le jardin et la grotte de l’Agonie jusqu’au Sépulcre qui reçut la dépouille sacrée du Sauveur. Le long de la Voie douloureuse, reconstituée dans ses proportions naturelles, du prétoire de Pilate au lieu du Crucifiement, vous avez représenté toutes les scènes dont la tradition a conservé le souvenir. Désormais, on peut le dire, grâce à vous Jérusalem est transportée en France.
Il ne restait plus qu’à donner à ce merveilleux ensemble le sceau d’une consécration définitive.
Plus heureux que votre prédécesseur du XVIIIe siècle, Monseigneur de Nantes, loin d’avoir à intervenir pour suspendre cette fête, vous avez tout disposé pour en rehausser la splendeur, avec cette sagesse et ce zèle qui distinguent et qui fécondent tous les actes de votre épiscopat. Ce doit être pour votre cœur si paternel et si pieux une consolation ineffable que ce triomphe sans précédent, qui fait tant d’honneur à votre peuple et qui procure à Dieu tant de gloire. Vous avez mis le comble à votre délicatesse et vous avez rempli tous les vœux, en conviant à ces solennités l’éminent Pontife, que l’Eglise de Paris est fière de voir à sa tête, mais que l’Eglise de Nantes s’honore de regarder comme le plus illustre de ses fils.
Eminence, je ne me trompe pas en affirmant que cette sole unité vous est doublement chère : car, en même temps qu’elle réalise l’un de vos désirs les plus ardents, elle vous apparaît comme le prélude du jour prochain où il vous sera donné de bénir une autre croix, qui dominera la coupole de Montmartre et rayonnera de là sur la Capitale et sur la France.
Votre place était marquée naturellement dans cette fête, Monseigneur de Luçon, car tout ce qui rappelle la mémoire du Bienheureux de Montfort rejaillit sur l’Eglise qui garde si fidèlement sa tombe, et sur l’évêque dont la piété contribua si puissamment à le faire monter sur les autels.
Votre place y était aussi, Monseigneur d’Angers, car les travaux apostoliques de l’homme de Dieu ont exercé sur une partie de votre peuple une influence encore sensible après bientôt deux siècles.
Enfin, vous ne pouviez manquer à ce triomphe de la Croix, Monseigneur de Vannes, car pour le préparer vos fidèles ont souvent rivalisé d’ardeur avec les populations voisines, et vous n’ignorez pas que, sans l’évêque de Sainte-Anne, une fête religieuse est incomplète sur toute l’étendue de la Bretagne.
I
Les deux mots qui résument la pensée du Bienheureux de Montfort, quand il entreprit l’œuvre que nous avons sous les yeux, ont été prononcés dans cette triste journée du 14 septembre 1710. C’est un trône, disaient les uns ; c’est un rempart, disaient les autres. En un sens, ils avaient également raison. Cette montagne, élevée de main d’homme, est tout ensemble un trône et un rempart : un trône pour Jésus-Christ et un rempart pour les âmes.
Trône incomparable, dressé au milieu d’une contrée chrétienne pour le Dieu qu’elle reconnaît, qu’elle acclame et qu’elle adore comme son Maître souverain et comme son Roi légitime.
Trône grandiose, avec le ciel pour dôme et ces landes immenses pour marchepied, qui élève l’image du Christ dans les airs afin que, du haut de sa Croix, dominant vos campagnes et vos rivages, vos villes et vos hameaux, vos habitations seigneuriales et vos demeures rustiques, il puisse constamment vous embrasser de son regard paternel et vous accompagner de ses bénédictions divines.
Trône superbe et magnifique, enrichi désormais par votre piété inépuisable de tous les ornements que comporte cette construction pyramidale, entouré de ces mille détails qui s’unissent pour donner à la pensée religieuse son expression la plus touchante et la plus complète.
Trône imposant et majestueux, qui emprunte aux circonstances où il s’achève un caractère que les générations précédentes n’avaient pas prévu. En mettant la dernière main, avec une pareille ardeur, à cette œuvre deux fois séculaire, personne ne s’y méprend, vous avez voulu élever un ex-voto monumental qui fût à la fois une protestation et une réparation.
Oui, c’est une protestation. L’histoire dira, à la stupéfaction des âges à venir, qu’un peuple s’est rencontré qui, après avoir reposé, durant quatorze siècles, sur des fondements cimentés par la Religion, trouvé dans la protection divine le principe d’une gloire incomparable et d’une prospérité sans égale, s’est demandé, en des jours d’affolement, s’il ne devait pas enfin se suffire à lui-même, aspirer à l’émancipation et signifier son congé au Dieu qui l’avait soutenu et conduit à travers toutes les péripéties de son histoire. Question formidable, qui domine en ce moment foutes les autres, et qui s’agite avec une acuité inouïe. En vain le sentiment national s’émeut, se scandalise et réclame contre une apostasie qui mettrait la France au ban des peuples civilisés, il y a des hommes qui s’obstinent dans cette tentative désastreuse et qui ont voué leur vie à cette guerre infernale. Ils ont déjà la main à leur œuvre sacrilège.
En présence des assauts qui se livrent sous nos yeux avec une audace croissante, votre foi s’est alarmée, votre piété s’est indignée, votre patriotisme s’est soulevé. Et, puisqu’aujourd’hui la parole est au peuple, vous avez entendu user de votre droit pour exprimer les protestations les plus énergiques et les plus retentissantes, pour redire à tous les échos: Nous voulons Dieu! Nous voulons Dieu, c’est notre Père ; nous voulons Dieu, c’est notre Roi.
Nous voulons Dieu dans la famille, car c’est Lui qui est la Providence du foyer; il n’y a que Lui pour y maintenir la pureté des mœurs, pour y garantir la fidélité mutuelle, pour y inspirer le courage du dévouement, pour y répandre les joies saines et les consolations fortifiantes.
Nous voulons Dieu dans les écoles, car l’enfance élevée sans Dieu préparerait une génération sans principes, sans vaillance et sans honneur.
Nous voulons Dieu dans nos armées, car c’est Lui qui éveille et conserve dans l’âme du guerrier le sentiment du devoir, le respect de la discipline et l’intrépidité du sacrifice.
Cette protestation pacifique, mais expressive, vous l’avez fait entendre dans vos champs et dans vos demeures, vous l’avez répétée dans vos réunions publiques et dans vos fêtes religieuses, et je l’ai recueillie avec émotion sous les voûtes de votre superbe Cathédrale.
Mais il fallait lui donner une forme plus frappante et plus durable. Voilà pourquoi vous avez entrepris de compléter ce trône qui atteste à tous les regards la foi d’un peuple fermement résolu à rester Catholique et Breton toujours. Qui vous a vus à l’œuvre, ne comptant ni avec la fatigue, ni avec les sacrifices, et qui vous contemple en ce moment, rassemblés au pied de cette Croix, rayonnant de bonheur et frémissant d’enthousiasme, n’en saurait douter, oui, vous voulez Dieu !
Ah ! si du haut de ce trône, Jésus-Christ vous interrogeait, comme il interrogeait autrefois ses Apôtres : « Qu’est-ce que les hommes disent de moi? — Hélas! lui répondriez-vous, les uns vous regardent seulement comme le premier des grands hommes, d’autres comme un perturbateur public, ceux-ci comme un initiateur de génie, ceux-là comme un législateur importun. — Et si Jésus ajoutait: Mais vous, qui dites-vous que je suis? — Qui vous êtes, Seigneur? Mais vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant ; vous êtes notre Dieu, vous êtes notre Roi. C’est pour vous que nos pères ont vécu, c’est pour vous qu’ils sont morts; grâce au Ciel, les fils de la Bretagne et de la Vendée n’ont pas dégénéré, c’est pour vous que nous voulons mourir. — Ainsi donc, au milieu de la défection générale, vous, du moins, vous ne voulez pas m’abandonner? — Mais à qui irions-nous, Seigneur ? Vous seul avez les paroles de la vie éternelle; pour les âmes, pour les familles, pour les sociétés, il n’y a de salut qu’en vous ! »
Ah ! il me semble que Jésus, consolé par ce témoignage d’amour et de fidélité, abaisse sur vous un regard d’ineffable complaisance, et je crois l’entendre vous adresser le mot de son prophète : « Que tu es heureux, ô mon peuple, d’avoir conservé le Seigneur pour ton Dieu ». Beatus populus cujus Dominus Deus ejus !
Et, autour de Jésus, ce sont tous les saints de cette contrée qui planent, en ce moment, comme une nuée de témoins sur vos têtes ; penchés du haut du ciel, ils contemplent ravis l’admirable spectacle que vous donnez aujourd’hui à la Patrie et à l’Eglise. Ce sont tous les apôtres qui vous ont apporté la foi, tous ces pieux solitaires qui ont vécu dans les ermitages voisins et qui vous ont laissé comme un patrimoine sacré le double trésor de leurs exemples et de leurs mérites, tous ces héros de nos guerres Saintes, ces géants qui se sont sacrifiés pour vous conserver vos foyers et vos autels ; il est là au premier rang le pieux missionnaire qui a conçu le projet et jeté les fondements de cette œuvre colossale. Ah! ils peuvent vous contempler avec amour et avec fierté! Ils vous reconnaissent pour les fils de leur apostolat et de leur dévouement ; non, vous n’avez pas dégénéré, vous avez toujours au cœur la foi qu’ils ont enracinée chez vos pères.
Sous leurs regards, renouvelez donc, plus solennellement que jamais, vos engagements d’éternelle fidélité, et chantez à plein cœur le refrain de votre protestation catholique : Nous voulons Dieu !… (On chante).
Puisse cette protestation de tout un peuple voler d’écho en écho et retentir jusqu’aux dernières extrémités du pays !
Mais à cette protestation qui s’adresse aux hommes, vous voulez ajouter une réparation qui monte jusqu’au ciel.
Les siècles, en passant, nous ont laissé une leçon effrayante, devenue de nos jours plus opportune que jamais : la justice divine n’a pas coutume de, laisser impunies les fautes nationales. Les chemins de l’histoire sont jonchés des ruines de tous ces peuples prévaricateurs, rejetés par la Providence et tombés en dissolution pour faire place à des races plus jeunes et plus fidèles.
Eh bien ! où en sommes-nous de notre soumission séculaire au Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a si constamment comblés de ses faveurs?
Je ne voudrais pas assombrir cette fête par un tableau trop attristant. Mais comment dissimuler des fautes qui crient sans cesse vengeance?
Quoi qu’il en soit de notre passé, en ce siècle du moins il semble que nous ayons eu à cœur de fatiguer la patience divine, et de forcer le tonnerre de la justice céleste à éclater sur nos têtes.
Dieu avait contracté avec nous une alliance qui nous plaçait au premier rang parmi les nations. Cette alliance, nous l’ayons dédaignée, nous l’avons dénoncée, nous l’avons désavouée article par article ; nous avons déchiré de nos mains, l’une après l’autre, chacune des pages de ce contrat solennel ; nous avons ajouté l’insulte à la déloyauté.
Nous avons systématiquement écarté le nom et la pensée de Dieu de toutes nos lois ; Nous avons renoncé à invoquer officiellement son secours ; Nous avons violé, au scandale de l’univers entier, le jour qu’il s’était choisi et réservé;
Nous avons traqué ceux qui représentent sou autorité souveraine ;
Nous lui avons disputé les enfants qui naissent, les moribonds qui agonisent, jusqu’aux soldats qui tombent sur les champs de bataille.
Enfin, pour que rien ne manquât à cette série d’outrages, nous avons laissé insulter la Croix, la Croix, ce drapeau glorieux du Christ; la Croix, ce drapeau de la patrie universelle des âmes.
Ce n’est point ici qu’il faut rappeler le sens et la majesté du drapeau. Dans ce lambeau d’étoffe teint aux couleurs nationales, vous ne l’ignorez pas, c’est l’âme d’un peuple qui palpite, c’est la patrie qui se personnifie avec toutes ses grandeurs, tous ses souvenirs et toutes ses gloires. Qu’il se déploie sur un champ de, bataille, sa vue suffit à électriser une armée et à l’entraîner, â travers tous les périls, jusque sur le sommet sanglant du sacrifice. Qu’on le rapporte en triomphe, après une longue et rude campagne, noirci par la poudre, troué par les balles, déchiré par la mitraille, sacré par le sang des braves, à son aspect un frisson d’enthousiasme patriotique circule dans les rangs pressés de la foule, les épées s’inclinent, les tambours battent aux champs, le respect est sur tous les fronts et l’émotion dans tous les cœurs, l’enthousiasme devient du délire, on salue, on acclame : on dirait la patrie qui passe, recevant les hommages d’un peuple.
Gardez, gardez toujours, et développez encore, s’il est possible, ce culte, cette religion du drapeau. Une nation est finie quand elle ne considère plus comme la dernière des injures celle qui s’adresse à son drapeau. Tant qu’il reste une étincelle d’honneur au fond des âmes, celle-là ne se venge que sur les champs de bataille et ne se lave que dans le sang.
Eh bien! il y a dans le monde un drapeau dont la majesté rayonne d’un éclat qui fait pâlir tous les autres. Arboré par Jésus-Christ, c’est ce drapeau-là qui nous a frayé la route du Ciel. Un jour, les Apôtres l’ont pris sur le Calvaire, encore ruisselant du sang d’un Dieu; ils l’ont planté dans la capitale, de l’Empire romain et à toutes les frontières de la civilisation antique. Depuis lors, il a consolé les premiers chrétiens dans les Catacombes, il a fortifié les martyrs dans les amphithéâtres, il a vu crouler devant lui toutes les puissances vaincues du paganisme, il a conduit l’Europe à la conquête de Jérusalem, il a fait reculer la barbarie jusqu’aux dernières limites du monde, et il flotte aujourd’hui au-dessus de la société chrétienne, portant dans ses plis la gloire accumulée par dix-huit siècles de luttes héroïques pour la cause du droit, de la charité et de la liberté. Or, ce drapeau, trois fois sacré et par l’idée qu’il représente, et par les souvenirs qu’il rappelle, et par les espérances qu’il confirme, ce drapeau qui commande de nos jours le respect, même aux peuples les plus rebelles à l’influence de l’Evangile, nous l’avons vu honni, lacéré, piétiné dans la nation qui porte encore son titre de très chrétienne; on l’a arraché ignominieusement, sous nos yeux, au prétoire, à l’hospice, à l’école ; on l’a renversé jusque dans le champ des morts.
Cette fois, la mesure était comble, et je ne suis pas surpris que tous les peuples de la terre aient en ce moment les yeux fixés sur nous, et se demandent à tout instant s’ils ne vont pas entendre dans le ciel les craquements de la foudre qui renverse les nations coupables, et si, de décadence en décadence, nous n’allons pas être précipités dans ces abîmes où les peuples s’ensevelissent pour toujours.
Ah ! c’est l’heure ou jamais de tenter un suprême effort pour désarmer la colère, de Dieu. Un jour le peuple de Paris ramassa la Croix profanée et, voulant égaler la réparation à l’outrage, la porta en triomphe à travers les rues ensanglantées de la Capitale. Vous avez fait mieux. Vous avez complété ce piédestal gigantesque et vous êtes accourus de toutes parts pour faire à la Croix l’une des ovations les plus éclatantes qu’elle ait encore reçues dans le monde. Saluez-la donc, saluez-la d’une acclamation enthousiaste, et que ce cri, poussé par tout un peuple, comme un témoignage unanime de son amour et de sa fidélité, la venge de toutes les profanations et de toutes les trahisons. (L’immense foule crie par trois fois : Vive, la Croix I)
Il est vrai, vous êtes moins coupables que d’autres, et les prévaricateurs, dont je viens de faire la scandaleuse nomenclature, ne vous sont guère connus que par la renommée. Mais de la Bretagne à la Provence, de la Flandre aux Pyrénées, nous ne formons qu’un peuple et nous partageons la solidarité de toutes les fautes comme de toutes les gloires. Voilà pourquoi il vous appartient de prendre une part abondante à la réparation commune. Montant d’une terre qui n’a pas provoqué la vengeance divine, vos cris suppliants pénétreront le ciel. Autour de cette Croix, chantez donc avec l’accent du repentir, chantez au nom de la France :
Pitié, mon Dieu ! c’est pour notre patrie
Que nous pleurons au pied de cet autel.
(On chante).
II
Ce Calvaire est un trône d’où Jésus-Christ régnera désormais avec bonheur, comme un souverain respecté, au milieu de ses sujets fidèles ; mais c’est aussi un rempart derrière lequel vous pourrez défendre victorieusement ce que vous avez de plus cher en ce monde, votre religion et vos âmes.
Tant que vous garderez cette Croix, soyez assurés qu’elle vous gardera.
Hélas ! cette protection vous est plus nécessaire aujourd’hui que jamais. Vos marins sont habiles à distinguer sur vos côtes les pronostics de la tempête. Il y a dans la direction des nuages, dans les teintes du ciel, dans l’épaisseur de l’atmosphère, dans le vol et les cris des oiseaux riverains, des indices qui ne les trompent pas. Eh bien ! j’aperçois à l’horizon des signes qui ne sont ni moins sûrs, ni moins menaçants. Manifestement le ciel se charge et l’ouragan va éclater. Mais abrités derrière ce rempart de la Croix, encore une fois, soyez sans crainte. Les vagues les plus houleuses viendront se briser à ses pieds, comme les flots en fureur vont se briser là-bas sur la roche de granit apostée par la Providence à la garde de vos rivages. Ah ! s’il s’agissait d’une guerre déclarée, d’ennemis venant à vous enseignes déployées et les armes à la main, je ne vous ferais pas l’injure de redouter pour vous leur nombre, leur habileté ou leur audace. Le sang des vieux Bretons et des vieux Vendéens garde toujours son ardeur dans vos veines, et vos traditions de courage, renouvelées et enrichies sur les champs de bataille les plus fameux de nos dernières guerres, ne sont pas perdues. Vous trouveriez encore ici des chefs intrépides pour vous conduire, des familles de héros pour se passer de main en main un fanion criblé de balles et empourpré de sang, et au besoin quelque paysan pourrait, comme autrefois, se mettre, à votre tête avec assez de prudence et de sang-froid pour organiser la résistance et assurer la victoire. Que si la fortune venait à vous trahir, vous sauriez succomber vaillamment, et à qui vous demanderait de vous rendre vous répondriez, comme, ce paysan du Landreau : « Rendez-moi mon Dieu ! » Du reste, en tombant, vous auriez la consolation du devoir accompli et vous emporteriez l’espérance d’un triomphe prochain, car, vous le savez plus que d’autres, les causes pour lesquelles on sait mourir sont des causes immortelles.
Mais non, l’heure n’est plus aux batailles sanglantes et aux engagements chevaleresques. Ils viendront à vous cette fois dans des conditions d’autant plus dangereuses qu’elles seront moins violentes, et d’autant plus redoutables qu’elles vous trouveront moins défiants. Ils s’attaqueront à ce double trésor qui fait la gloire et la force d’un peuple et qui doit vous être, plus précieux que la vie: à la pureté de voire foi et à l’austérité de vos mœurs.
Voilà les deux assauts que je prévois et que je devais signaler. Mais, grâce à Dieu, pour ces assauts-là, cette croix vous sera un inexpugnable rempart ; In hoc signo vinces !
Il y a quelques jours, en présence d’une véritable armée de chrétiens, rassemblés aux pieds de N.-D. de Lourdes, je dénonçais l’affaiblissement ou la disparition de la foi comme le péril de notre temps, comme la cause de tous les ébranlements qui se produisent et de toutes les ruines qu s’accumulent.
Dieu soit loué ! le souffle d’indifférence et d’incrédulité qui a ravagé une partie de la France n’est pas parvenu à ébranler votre foi séculaire. Elle a été si profondément enracinée dans ce sol consacré par la vertu de vos saints et abreuvé par le sang de vos martyrs ! Vous pouvez l’affirmer avec une fierté légitime, oui, les bases de la foi ont été fortement consolidées chez vous : Testimonium Christi confirmatum est in vobis (I Cor., 1. 6,).
C’est cette foi qui vous a donné et qui vous conserve une énergie de conviction et une vigueur de caractère devenues votre marque distinctive, au milieu d’une génération hésitante et amollie; c’est cette foi qui a fait surgir de terre toute une végétation d’églises dont on admire ici même de toutes parts l’élégance et la fraîcheur; c’est cette foi qui vous a fait reconquérir un jour, aux applaudissements de la France, la liberté des manifestations religieuses dans votre bonne ville de Nantes ; c’est cette foi qui vous a fait sacrifier si généreusement vos fils pour l’évangélisation dei nations infidèles; c’est cette foi qui vous a lui contribuer plus que d’autres à ramener les pèlerinages dans nos mœurs; c’est cette foi qui vous a fait construire récemment des écoles où vos enfants continuent de s’instruire sans respirer l’atmosphère pestilentielle de l’indifférence.
Conservez avec un soin jaloux l’inappréciable trésor que vous ont transmis de longs siècles de christianisme; n’omettez rien pour le laisser intact aux générations qui viendront après vous ; repoussez vaillamment tout ce qui pourrait le corrompre ou l’amoindrir, et ayez à cœur de mériter toujours l’éloge qu’un évêque du VIIIe siècle adressait à vos pères : In bello fortes, in fide fortiores.
Ils viendront à vous au nom de la science, comme si la science consistait à rejeter les vérités les plus élevées et les plus nécessaires, ou à déchirer les pages les plus authentiques de l’histoire.
Ils viendront à vous au nom du progrès, comme si le progrès consistait à renverser tous les soutiens de l’ordre moral, tous les appuis de la famille, tous les contreforts de la société, à enlever à l’âme humaine la conscience de sa dignité, le souvenir de son origine, la gloire de ses espérances immortelles.
Ils viendront à vous au nom de la civilisation, comme si la civilisation consistait à étouffer toutes les vertus qui ennoblissent notre nature et à favoriser tous les vices qui la dépriment.
Ils viendront à vous au nom de l’autorité, comme si l’autorité n’avait pas pour mission de promouvoir le respect des lois divines, et comme si nous ne devions pas obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Non, non, les yeux fixés sur la Croix, vous ne sacrifierez aucune de vos croyances. Dans ce livre grandiose, vous continuerez de lire toutes les vérités qu’il vous est indispensable de connaître : l’amour d’un Dieu qui a porté le dévouement jusqu’à se sacrifier pour notre salut ; la grandeur de nos âmes qu’il n’a pas dédaigné de racheter au prix de pareilles humiliations et de pareilles souffrances ; la gravité du péché qui n’a été expié que par l’immolation d’une victime infinie ; nos droits au Ciel que Jésus-Christ nous a conquis par sa Passion el par sa mort. Car tout cela est écrit en caractères sanglants sur ce livre sublime, déployé depuis dix-huit siècles sous les yeux du monde, et dont on a pu dire que chaque trait est une lumière, chaque ligne une révélation, chaque page une vision de Dieu et de l’éternité.
Ainsi les grandes leçons qui descendent de la Croix vous rendront invincibles devant toutes les attaques du sophisme et de l’erreur ; elles vous aideront à maintenir votre foi ; elles vous inspireront le courage de la pratiquer, de l’arborer et de la défendre.
Protégés par la Croix, vous ne serez pas moins intrépides pour repousser les assauts du sensualisme. Le sensualisme est, avec l’incrédulité, le fléau de la génération contemporaine. Déjà il précipite ses eaux fangeuses sur notre société et il menace d’emporter ce qui nous reste encore de vertus chrétiennes et d’habitudes religieuses. Il en doit être ainsi. A mesure que les croyances diminuent, le sensualisme se développe ; quand tels esprits ne sont plus soutenus dans les hauteurs sur les ailes de la foi, ils rampent à terre et ne tardent pas à subir l’humiliante tyrannie de la chair.
Aussi que voyons-nous? La jouissance et le bien être devenus la préoccupation universelle, la recherche du plaisir dominant toutes les aspirations, la poursuite à outrance de la vie facile et joyeuse remplaçant toutes ces vertus qui autrefois fleurissaient, pour ainsi dire, d’elles-mêmes, dans l’action réputée la plus chevaleresque du monde.
Je ne l’ignore pas, et j’aime à vous rendre, encore ce témoignage, malgré ce relâchement général, sans méconnaître et sans dédaigner ce qu’il y d’acceptable dans les progrès de l’économie et de l’industrie contemporaines, vous avez su conserver jusqu’ici votre simplicité antique, et vos mœurs patriarcales. Chaque fois que l’Eglise et la Patrie ont fait appel à votre, dévouement, vous avez pu montrer par votre endurance et par votre héroïsme de quels sacrifices est capable un peuple resté profondément chrétien.
Avec ces qualités de race et ces vertus robustes, vous êtes fortement armés contre la tentation qui vous menace, et j’ai la confiance que vous saurez résister aux séductions de ce luxe énervant et meurtrier qui ne pénètre jamais dans une famille ou dans une société sans y introduire à sa suite un triste cortège de déceptions et de ruines; à cette frénésie de la richesse qui fausse les consciences, sacrifie l’honneur et pousse à toutes les abdications; à cette contagion de l’exemple qui tyrannise une génération sans vigueur et sans caractère ; à cette littérature malsaine qui porte la corruption dans tous les rangs de la hiérarchie sociale.
1Ceux qui sont habitués à compter les grandes foules estiment le nombre des pèlerins réunis dans la circonstance que l’on peut, sans exagération, porter aux environs de 50.000.
2Son Eminence le cardinal-archevêque de Paris.
3NN. SS. les évêques de Nantes, de Luçon, d’Angers et de Vannes.
Mais, pour conserver cette dignité incorruptible, s’il vous faut un modèle qui vous anime et une force qui vous soutienne, vous vous tournerez vers cette montagne où Jésus, du haut de sa croix, vous offrira l’idéal du sacrifice chrétien et vous communiquera le courage d’une, résistance invincible.
En présence d’un Dieu crucifié, comment oublieriez-vous que la lutte est la condition du devoir, et le renoncement la voie royale, de la vertu? Grande et capitale leçon, que Montfort expliquait à vos pères, quand décrivait cette lettre admirable « Aux Amis de la Croix », où il commentait la parole de l’Evangile qui résume toute la morale de Jésus-Christ : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il porte sa Croix et qu’il me suive ».
Comme vos pères, vous aurez à cœur de vous dire et de vous montrer les « amis de la Croix » ; comme eux, vous vous rappellerez toujours à quoi ce titre vous engage.
Régnez donc, ô Croix, régnez à jamais sur notre vaillante et catholique Bretagne. Ce n’est pas d’aujourd’hui que vous prenez possession de ce vieux sol. Depuis des siècles, les générations qui se succèdent ici n’ont cessé de vous entourer de leurs hommages, heureuses de vivre et de mourir à votre ombre. Dans ses joies et dans ses peines, dans ses fêtes et dans ses deuils, ce peuple n’a jamais manqué de se tourner vers vous et de vous associer aux émotions les plus intimes de sa longue et rude existence.
Recevez, une fois encore, la promesse de son inébranlable attachement. Nous sommes sur la terre classique de la fidélité. L’Océan pourra ronger le granit de ces côtes, la tempête déraciner les chênes de ces campagnes, le temps ne brisera pas l’affection que la Bretagne vous a jurée. Nulle part vous n’aurez d’adorateurs plus fervents, de disciples plus dociles, de défenseurs plus dévoués.
En retour, vous lui continuerez votre protection tutélaire, vous veillerez sur l’intégrité de ses croyances et sur l’austérité de ses mœurs, vous serez tout ensemble un phare pour éclairer sa route et un refuge pour l’abriter contre ses ennemis.
Vous étendrez aussi votre influence au-delà de ces frontières et de ces horizons. Un jour, en traversant une de nos villes normandes, j’ai vu sur son blason un cep de vigne planté au pied d’une croix ; une branche s’enroule autour de la croix et se couvre de pampres et de grappes, une autre rampe à terre et se dessèche dans l’épuisement. Au bas, un exergue traduit ce symbole déjà transparent : Tali fulcimine crescet : il lui faut cet appui pour grandir.
Et je pensais, à part moi : N’est-ce pas là la figure de la France? Tant qu’elle s’est appuyée sur son divin tuteur, la grâce du ciel l’a pénétrée comme une sève vigoureuse, et elle a étalé aux yeux du monde émerveillé la splendeur de sa force et la fécondité de ses œuvres. Mais voilà qu’ils veulent séparer ce que vingt générations avaient uni, ou plutôt ils veulent consommer une séparation commencée depuis un siècle Ne s’aperçoivent-ils pas que cet arbre autrefois si vivace se dessèche et languit? Le feuillage n’a plus ses teintes verdoyantes et le fruit se détache sans atteindre à sa maturité. Manifestement la corruption gagne, la vie s’en va.
Tel est le spectacle auquel nous assistons : la France qui délaisse Dieu, Dieu qui délaisse la France, et ce mutuel abandon entraînant des revers précurseurs d’irréparables catastrophes.
O mon pays, si la voix du dernier de tes fils pouvait te parvenir, j’oserais l’adjurer de n’oublier jamais qu’il n’y a que la Croix pour rajeunir ta force et raviver ta gloire. Rattache-toi donc de nouveau à l’appui de tes jours prospères, enlace encore tes bras autour de ce tronc robuste et immortel. Soutenu par Dieu, il ne redoute ni la violence des orages ni les incertitudes de l’avenir, et il est prêt à te communiquer sa vigueur et sa durée !
Pour satisfaire plus tranquillement leur dévotion, il est des groupes de pèlerins qui ont, à dessein, devancé la grande fête.
C’est ainsi que le lundi 19 juin, les Sœurs de Charité de Redon sont venues avec leurs nombreuses orphelines passer la journée au Calvaire.
Le jeudi 22, c’était un groupe assez nombreux de la paroisse de Louvigné-de-Bais (diocèse de Rennes). En faisaient partie plusieurs Filles de la Sagesse. Leur établissement à Louvigné fut une des premières fondations de la Mère Marie-Louise de Jésus. Elles ne le quittèrent pas même aux plus mauvais jours de la première Révolution, et la population de Louvigné n’a pas cessé de témoigner aux Filles de Montfort le plus fidèle attachement. M. le Recteur était présent et a dit lui-même la messe du Pèlerinage. Le R. P. Guihéneuf, chargé de recevoir ces deux groupes de pèlerins, les a également édifiés par de pieuses et chaudes exhortations.
Au lendemain de la fête, dimanche 25 juin, on voit encore sur la lande une foule de douze à quinze cents personnes. Le plus grand nombre suit la Voie douloureuse en faisant l’exercice du Chemin de croix. C’est le milieu du jour, et le soleil darde ses plus chauds rayons. La foule pieuse n’en écoute pas moins religieusement la parole du R. P. Breny, qui se fait entendre à chaque station.
N° 11 Août 1899
L’exercice du Chemin de la Croix au Calvaire
Un mois déjà s’est écoulé depuis la fête du 24 juin. Les lecteurs de l’Ami de la Croix en ont eu sous les yeux le merveilleux récit. Jamais, peut-être, l’érection d’un Chemin de Croix n’avait été accomplie au milieu d’un tel concours de peuple, et avec un semblable éclat. Nulle part aussi, peut-être, jusqu’à ce jour, n’avait été offerte à la piété des fidèles une représentation aussi frappante des différentes scènes de la douloureuse Passion de notre divin Sauveur.
Un discours admirable a fait ressortir la foi, la générosité de tous ceux si nombreux qui ont concouru, de leurs bras ou par leurs aumônes, à cette belle œuvre.
Tout cela est beau sans doute, mais appelle une suite, sans laquelle il semble que tout ce qui a précédé n’avait pas sa raison d’être. Et l’on est en droit de nous adresser ces questions: Cette Voie douloureuse, ouverte à si grands frais, inaugurée avec tant d’éclat, enrichie de si précieuses indulgences, de souvenirs si touchants, est-elle aujourd’hui fréquentée, suivie non pas par de simples curieux attirés par le bruit de la fête, mais par de vrais amis de Jésus et de sa Croix ? Y prie-t-on à genoux ? Fait-on redire aux échos de la lande la touchante prière à la Mère des douleurs, la suppliant d’imprimer dans les cœurs les plaies du divin Crucifié ? Sancta Mater istud agas… ?
Nous n’avons guère, en ce moment, à donner autre chose à nos lecteurs que la réponse à ces questions. Heureusement que cette réponse est facile et les édifiera, même présentée dans les termes les plus simples.
Oui, c’est par milliers qu’il faut compter les Chemins de Croix faits pieusement, pendant ce seul mois de juillet, sur la lande de la Madeleine. Pas un jour où l’on n’ait vu quelques familles, quelques groupes pieux gravir à genoux la Scala Sancta, puis se prosterner devant le divin condamné du Prétoire, et l’accompagner jusqu’au sommet du Calvaire, jusqu’au tombeau où l’on va déposer le corps de la divine Victime.
Mais, à certains jours, chaque dimanche, en particulier, ce ne sont plus quelques pèlerins isolés, c’est une foule qui forme de longues files le long de la Voie douloureuse et que l’on voit se grouper, pendant quelques minutes, à chaque station, pour recueillir les courtes, mais édifiantes paroles qui lui sont adressées. Après s’être prosternée pour la récitation du Pater et de l’Ave, elle se relève au chant du Sancta Mater, suivi de deux ou de trois couplets du beau cantique : Vive Jésus ! Vive sa Croix !
Le pieux exercice du Chemin de Croix ainsi fait demande un peu plus d’une heure. C’est un parcours de six cents mètres, en comptant l’ascension de la Scala et du Calvaire. Et pendant tout ce mois de juillet, en particulier, le soleil dardait ses plus chauds rayons sur tout ce parcours presque sans ombrage encore.
Mais, qui se plaindrait d’avoir arrosé de quelques gouttes de ses sueurs cette Voie douloureuse que le Maître arrosa jadis de son sang? Ce ne sont assurément pas ceux que l’on voit, après l’exercice terminé, se rendre en chantant si fièrement, si allègrement, à la chapelle du pèlerinage, pour y recevoir la bénédiction du Très Saint-Sacrement. C’est le beau cantique : Je suis chrétien, voilà ma gloire, qui semble adopté pour la circonstance, et très heureusement, rendant bien les sentiments de cette foule qui vient de montrer, en plein soleil, sa foi au divin Fondateur du christianisme, et son amour pour Jésus crucifié.
Assurément, l’exercice du Chemin de Croix, tel qu’on peut s’en faire une idée par ce que nous venons de dire, et qui se renouvelle non seulement chaque dimanche, mais chaque fois que se trouve réuni un nombre assez considérable de pèlerins, émeut toujours fortement les âmes, et ne peut manquer d’être fécond en fruits de salut. Mais que d’impressions profondes aussi et salutaires pour ceux qui suivent, silencieux et solitaires, cette Voie douloureuse. « Oh ! nous ont dit plus d’une fois des âmes pieuses habituées à se servir d’un livre pour faire leur Chemin de Croix, ici pas n’est besoin d’un livre, il suffit de voir. » Et cette vue seule a déjà fait couler bien des larmes. Larmes précieuses! Un saint Docteur n’a-t-il pas dit qu’une seule larme versée au souvenir de la Passion de Notre-Seigneur valait mieux (devant Dieu) qu’une année de jeûne au pain et à l’eau !
Puissent de telles larmes couler de plus en plus abondantes sur notre lande de Sainte-Madeleine ! Puissent-elles être agréées du Cœur de Jésus, comme autrefois les larmes de l’illustre et sainte pénitente, dons nous célébrons la fête au jour même où nous écrivons ces lignes!…. 22 juillet!
N° 2 Novembre 1899
Chronique du mois
L’an dernier et les années précédentes, dès cette époque, nous nous faisions l’écho des appels si bien entendus, des convocations adressées aux paroisses pour les travaux du Calvaire. Il parait certain que cette année va être une année de repos, ou, si l’on aime mieux, une suspension d’armes.
Toutefois, il ne faudrait pas en conclure, que rien ne sera fait pour compléter, pour embellir le pèlerinage.
Dès maintenant, on trace des allées nouvelles, on sème, on plante des arbres ou arbustes, on pique çà et là des plantes d’ornementation. Toutes choses qui pour le dire en passant ne sont pas toujours suffisamment respectées par certains promeneurs. Le motif allégué par quelques pèlerins de bonne foi peut-être, n’est pas admissible : Emporter un souvenir du Calvaire. Mais, à ce compte-là, nous n’aurions bientôt que des arbres et arbustes dénudés, des plantes dépouillées de tout ce qui fait leur beauté.
Nous demandons pardon à nos lecteurs d’avoir ouvert cette parenthèse, et nous nous empressons de la fermer.
Pour en revenir aux travaux sur la lande, il est plus que probable que, malgré la suspension d’armes dont nous venons de parler, il faudra recourir à quelques bonnes volontés, pour le nivellement, l’aplanissement des voies nouvelles ; mais on et assuré d’avance que ces bonnes volontés ne manqueront pas.
Nous avons déjà dit que l’on peut aussi compter voir, dans le cours de cette année, s’élever le sanctuaire de la Visitation de Marie à sa cousine sainte Elisabeth, second mystère du Rosaire.
Ce sera une attraction pieuse ajoutée à celles déjà si nombreuses de notre pèlerinage.
Il restera, sans doute, encore beaucoup à faire ; mais avec, la constante bonne volonté de tous ceux qui s’intéressent « à l’œuvre, et surtout avec l’aide de Dieu, le but sera atteint.
N° 3 Décembre 1899
Travailleurs du village de Quémené (Paroisse de Crossac)
Nous avons donc sous les yeux une fois de plus ce que d’aucuns croyaient n’avoir été possible qu’à un autre âge, le spectacle de braves chrétiens, heureux de donner leur journée de travail au bon Dieu et au bon Père de Montfort. Pour nous qui, au contraire, y avons été habitués, il semble que la saison paraîtrait plus longue si ce spectacle ne se renouvelait de temps en temps.
Il s’agit d’ouvrir, de niveler et d’aplanir une nouvelle avenue donnant accès plus directement au Jardin des Oliviers, à la Grotte de Gethsémani. Il fallait, pour ce travail, le concours de quelques bonnes volontés ; et les bonnes volontés ne manquaient pas.
Le R. P. Directeur du Pèlerinage a cru devoir s’adresser une fois encore à nos bons et très proches voisins de Quémené, en Crossac.
Ils ont répondu à cet appel avec leur dévouement ordinaire et bien connu. Le mercredi 15, ils étaient là de bonne heure, et après une courte prière et quelques couplets de cantique, on les voyait à l’œuvre.
M. le curé de Crossac, son vicaire et M. l’abbé Tual, prêtre habitué, dont la famille habite le village même de Quémené, étaient présents, à la grande satisfaction de tous.
Le temps était à souhait. Aussi, avant même que le soleil eût disparu à l’horizon, bien que dans cette saison, il se hâte de nous quitter, la nouvelle avenue était non seulement ouverte et aplanie, mais plantée. On y voyait même, avec surprise, de distance en distance, de beaux arbustes verts qu’on eût dit avoir grandi là depuis des années.
Si nous ne craignions d’être indiscret, nous donnerions le nom de celui à qui était due cette agréable surprise. Qu’il veuille bien, du moins, agréer les remerciements que nous lui présentons, ici, au nom de l’Œuvre du Calvaire.
Quant aux bons travailleurs, à qui le Ciel a déjà accordé un temps si favorable pour leurs semailles, ne leur est-il pas permis d’avoir confiance que cette journée leur comptera pour obtenir un temps également favorable pour faire grandir et mûrir leurs moissons.
N° 4 Janvier 1900
Chronique du mois
Ceux qui savent de quels faits s’alimente d’ordinaire la première partie de notre Chronique, Travaux et Pèlerinages, ne peuvent compter en trouver beaucoup dans celle du mois de décembre.
Notre lande a eu, elle aussi, pendant d’assez longs jours, son manteau de neige ; on ne pouvait se risquer à faire l’ascension de la colline du Calvaire, sans danger de chute. Quelques imprudents, nous dit-on, en ont fait l’expérience à leurs dépens.
Cependant, avant ces jours de grand froid, avait été exécuté un travail intéressant pour le pèlerinage que nous devons noter. Dans notre dernier numéro, nous parlions d’une belle avenue nouvelle conduisant directement au Jardin des Oliviers, et devant servir surtout pour les processions si nombreuses qui s’y font à la belle saison. Cette voie de procession en demandait une autre pour le retour. Personne n’ignore combien il est difficile de faire revenir sur ses pas, en se repliant sur elle-même, une procession tant soit peu nombreuse. Cette voie de retour existe aujourd’hui. Elle débouche à l’extrémité du Jardin opposée à l’entrée par le pont du Cédron et vient se relier à la grande avenue circulaire, surnommée dès le commencement l’avenue triomphale, et qui descend au prétoire.
Cette nouvelle voie de plus de cent mètres de long, sur dix mètres de large a été tracée, aplanie, plantée dans une seule journée, par les braves travailleurs du village de Bergon, en Missillac, qui se sont toujours montrés si dévoués à l’Œuvre du Calvaire du Bienheureux Montfort. Une fois de plus, ils se sont acquis des droits à sa protection, à laquelle, du reste, ils ont recours avec une confiance sans bornes.
Un Manuscrit
On nous a fait parvenir de Saint-Laurent-sur-Sèvre un manuscrit de trois feuilles du R. P. Fonteneau, ancien missionnaire de la Compagnie de Marie, auteur de plusieurs très beaux cantiques, devenus très populaires. Ainsi que l’indique une note, ces feuilles sont la copie faite à Saint-Pompain (Deux-Sèvres), en décembre 1889, sur un manuscrit bien plus ancien de M. Gusteau, autrefois curé-prieur de Doix (Vendée). Le nom de l’ancien prieur de Doix est bien connu en Vendée et dans tout le Poitou, comme auteur de chants et autres poésies en patois poitevin ou vendéen.
Son manuscrit porte ce titre :
Cantique qu’on chanta à Pontchâteau en Bretagne, suivi de cette note : Il avait été commencé par M. Grignon de Montfort, et il a été achevé par M. Audubon, supérieur de la mission de Saint-Laurent.
Ceux qui ont lu la Notice sur le Calvaire, publiée en 1891, savent qu’au milieu du siècle dernier, quarante ans environ après la mission donnée à Pontchâteau par le Bienheureux, ses successeurs dans l’apostolat en donnèrent une seconde à la même paroisse. Cette mission était présidée par le P. Mulot, premier successeur de Montfort ; mais ce fut le P. Audubon, successeur du P. Mulot lui-même, qui fut chargé de relever les ruines du Calvaire. Il y travailla pendant dix-huit mois, et vit renaître, dans les populations d’alentour, l’enthousiasme du temps de Montfort.
En se rappelant ces faits, la note, du vieux manuscrit que nous avons donné plus haut, s’explique de la manière la plus facile.
La plupart des cantiques du Bienheureux lui ont été inspirés par les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Une circonstance assurément marquante dans sa vie apostolique, fut la préparation à la grande fête d’inauguration de son Calvaire dont il ne fut pas témoin. Nul ne songe à contester la tradition qui rapporte à cette circonstance solennelle la composition d’un de ses chants les plus beaux : Chers amis, tressaillons d’allégresse… ; mais rien n’empêche de supposer que dans la même circonstance d’autres strophes se soient présentées à lui, sur un rythme différent, et qui devaient entrer dans un autre chant resté inachevé. Est-ce que la précipitation avec laquelle il dut quitter le Calvaire, la veille de la fête, ne suffirait pas à expliquer le fait ?
Quarante ans plus tard, le P. Audubon recueillait ces strophes et les faisait entrer dans un long cantique qui dut être le chant de l’inauguration du Calvaire restauré par lui, en 1748. Du reste, cette fête par suite d’oppositions venant encore des Jansénistes, n’eût pas l’éclat sur lequel il était permis de compter.
On a pensé, non sans raison, que l’Ami de la Croix devait faire connaître ce chant comme document intéressant le Calvaire. Nous le donnons intégralement d’après le manuscrit qui nous a été envoyé.
Tout y est simple et pieux comme tous les cantiques du Bienheureux. Mais, on n’y trouve pas, ce nous semble, le souffle puissant qui en anime plusieurs, notamment le Chers amis, tressaillons d’allégresse.
Pour le chanter, le manuscrit indique ainsi deux airs connus : Dans ce jour de réjouissance ou loin du monde, en cet ermitage.
CANTIQUE CHANTÉ A PONTCHATEAU A la première restauration du Calvaire en 1748
Chantons avec réjouissance
Un Dieu régnant sur la Croix,
Que nos cœurs et nos voix
Rendent hommage à sa puissance ;
Chantons avec réjouissance
Un Dieu régnant sur la Croix.
Que ce jour a pour lui de charmes !
Qu’il aime ce mont sacré,
Qui lui fut consacré
Par notre amour et par nos larmes !
Que ce jour, etc…
Ce n’est plus cet affreux Calvaire
Où l’on ne voyait qu’horreurs ;
Mille objets enchanteurs
Ornent celui qu’on vient de faire.
Loin d’ici ce peuple barbare
Qui fit insulte à son Dieu !
On trouve dans ce lieu
Un peuple saint qui la répare.
Autrefois d’infâmes injures
Flétrirent un Dieu mourant ;
Ici l’homme lui rend
Un tribut de louanges pures.
Mille voix qui chantent victoire
Disent : Jésus est vainqueur.
Des excès du pécheur
Et des ennemis de sa gloire.
Il triomphe sur le Calvaire,
Il triomphe dans nos cœurs.
Il offre ses faveurs ;
Et nous, ne cherchons qu’à lui plaire.
Mort cruelle, baisse la lance,
Ton aiguillon s’est brisée ;
Jésus-Christ méprisé
Règne malgré ta résistance.
Sur la Croix Dieu perdit la vie,
Un le vit fermer les yeux.
Il les ouvre en ces lieux
Pour voir le fidèle qui prie.
Cette Croix autrefois infâme
Brille plus que le soleil ;
Son éclat sans pareil
Va luire jusque dans notre âme.
C’est à cette savante école
Que l’on apprend à mourir.
A constamment souffrir.
Elle est l’objet qui nous console.
Elle est le titre de noblesse
Que produisent les chrétiens ;
Elle leur sert de biens,
C’est leur précieuse richesse.
Jésus-Christ en fait ses délices,
Il s’en sert pour ornement.
Au dernier jugement
Les bons vivront sous ses auspices.
C’est le trône de la sagesse,
Elle est son lit de repos,
La fin de ses travaux
Et la preuve de sa tendresse.
Assis sur ce douloureux siège,
Il y paraît plein d’amour ;
C’est là que, chaque jour,
Il montre bien qu’il nous protège.
S’il paraît incliner la tête,
C’est pour baiser ses enfants.
Tendant ses bras souffrants,
A les caresser il s’apprête.
De son flanc le beau sang qui coule
Cherche à laver le pécheur.
Anathème, malheur,
A l’ingrat aux pieds qui le foule.
S’il est nu, c’est qu’il abandonne
Les biens qu’on voit ici-bas,
Montrant qu’ils n’ont d’appas
Que ceux qu’un faux éclat leur donne.
Sur le bois s’il veut qu’on l’attache,
C’est pour nous instruire tous.
Qu’on trouve dans ses clous
Les biens que le monde nous cache.
Exaltons donc cette croix sainte
Dans ce vénérable jour.
Aux peuples d’alentour
Annonçons sa gloire sans crainte.
Imitons l’amour et le zèle
Du grand prince Héraclius ;
Cet empereur n’est plus,
Mais son ardeur se renouvelle.
Lui-même autrefois dans les rues
Porta la Croix du Sauveur ;
Portons-là dans le cœur,
Et poussons nos voix dans les nues.
Disons cent fois : Croix adorable,
Vous triomphez dans les cieux.
Triomphez dans ces lieux,
Soyez-nous toujours favorable.
Grand Dieu, recevez cet hommage
Du peuple de Pontchâteau ;
Ce calvaire nouveau
De nos cœurs soumis est l’ouvrage.
Du haut de votre cité sainte
Bénissez notre présent,
Et d’un œil complaisant
Regardez toujours cette enceinte.
Dans ce lieu si quelqu’un vous prie,
Soyez propice à ses vœux ;
Sur nos besoins nombreux
Que votre âme soit attendrie.
Si le Ciel refuse sa pluie,
Rompez la nue aussitôt
Qu’il viendra comme il faut
Montrer que sur vous il s’appuie.
Si ce peuple éprouve la guerre,
Ecartez ses ennemis,
Quand il viendra soumis,
Ici vous faire sa prière.
N° 7 Avril 1900
Chronique du mois
Dès le premier jour, lendemain des Cendres, premier jeudi de Carême, la lande est très animée. Ce sont les pieuses chrétiennes de Crossac, au nombre de cent-cinquante environ, qui inaugurent le temps de pénitence, en offrant à Dieu et au R. P. de Montfort, une journée de travail. Cette journée rappelle les grandes et belles démonstrations en ce genre des années précédentes. On travaille avec ardeur, on chante avec entrain. Au milieu du jour ont lieu les acclamations ordinaires sur le sommet du Calvaire.
Etaient présents M. le Curé de Crossac et son nouveau vicaire, ainsi que M. l’abbé Tual.
Avant le départ, salut solennel du Saint-Sacrement, à la chapelle du Pèlerinage, donné par M. le Curé.
N° 10 Juillet 1900
Le sanctuaire de la Visitation
Lorsqu’on lira ces lignes, la bénédiction de la première pierre du Sanctuaire de la Visitation (maison de Ste-Elisabeth) sera un fait accompli. La première pensée était bien de fixer la cérémonie, au jour même de la fête de la Visitation qui, cette année, tombe le lundi. Réflexion faite, pour avoir une assistance plus nombreuse, on l’a fixée au dimanche, veille de la fête, à l’heure des premières vêpres du lendemain.
La petite construction ne demandera pas un long temps, et l’on compte la voir terminée fin juillet. A ce moment nous pourrons en donner la description ainsi que du groupe représentant le second mystère joyeux du Rosaire.
Rien n’est encore fixé pour l’inauguration de ce nouveau sanctuaire qui aura lieu certainement dans le cours de l’été.
Dès aujourd’hui, le R. P. Directeur du Pèlerinage témoigne le désir que l’Ami de la Croix adresse des félicitations et des remerciements, à tous nos bons amis des villages voisins du Calvaire, qui ont bien montré, dans la circonstance, que leur dévouement à l’Œuvre du Bienheureux Montfort est toujours le même.
Au premier appel, comme par le passé, ils ont attelé leurs bœufs, et sont allés prendre à la carrière, assez éloignée, pour les amener à pied-d ‘œuvre, les pierres qui vont entrer dans la construction du nouveau sanctuaire.
Dieu et son fidèle serviteur Montfort savent leurs noms. C’est à quoi ils tiennent le plus. Nous ne nommerons, ici, que leurs villages Inscrits plus d’une fois déjà au Livre d’or des travailleurs du Calvaire.
Ce sont : La Cossonnais, Travers, Coimeux, La Basinais, Quinta, Les Métairies, Lanoë, La Vioterie, La Berneraie, La Plaie et La Pintaie.
N° 11 Août 1900
Le sanctuaire de la Visitation
Ainsi que nous l’avions annoncé, la bénédiction de la première pierre de la Maison de Sainte Elisabeth a eu lieu le dimanche 1er juillet, à l’heure même des premières Vêpres de la Fête di la Visitation.
A deux heures, on part en procession de la Chapelle du Pèlerinage pour se rendre sur l’emplacement du nouveau sanctuaire. L’Ecole apostolique marche en tête, précédée par la croix et les acolytes. Vient ensuite la bannière du Bienheureux Montfort, entourée d’un groupe d’hommes portant à la main des étendards.
Tout le long du parcours, on entend les chants les mieux appropriés à la circonstance :
Pour aller à Jésus,
Allons, chrétiens, allons par Marie !
ou bien :
Par l’Ave Maria,
Le péché se détruira…
Cet Ave Maria, commencé au Ciel, apporté par l’Ange dans la petite maison de Nazareth et que termine sainte Elisabeth recevant la visite de Marie.
Bientôt, la nombreuse assistance est réunie autour du chantier ouvert, au milieu duquel apparaît la croix de bois plantée la veille, selon les prescriptions du rituel romain, à la place même que doit occuper l’autel dans le futur sanctuaire.
Tout d’abord, dans une allocution pleine de doctrine et d’excellentes conclusions pratiques, le R. P. Directeur du Pèlerinage rappelle, d’après l’Evangile, les différentes circonstances du second mystère joyeux du Rosaire. Puis, revêtu de la chape, il procède lui-même à la cérémonie liturgique. Après le chant de plusieurs antiennes et des Litanies des Saints, on lui présente tour à tour le goupillon, la truelle et le marteau. La pierre, aspergée d’eau bénite, est mise en place et fixée. C’est alors que le marteau passe de main en main et que chacun, à son tour, en déposant son obole, vient frapper quelques coups sur la pierre bénite.
La rentrée à la chapelle a lieu au chant bien connu et mille fois répété :
Ave, Ave, Ave Maria.
+
Dès le lendemain, les ouvriers mettaient la main à l’œuvre et, depuis ce jour, les murs se sont élevés peu à peu. Ils atteignent aujourd’hui la hauteur voulue pour recevoir le petit dôme qui doit couronner le modeste édifice.
Lorsqu’il s’agit de la représentation du premier des mystères joyeux, l’Annonciation, il n’y avait pas place à la moindre hésitation. La Sainte Maison où s’accomplît l’adorable mystère, préservée miraculeusement de la destruction et transportée par les Anges, d’Orient en Occident, est toujours debout à Lorette. Il n’y avait qu’à en prendre exactement les dimensions, puis à chercher les matériaux offrant le plus de ressemblance avec ceux employés dans la construction de la Sancta casa, et enfin, en s’aidant de la tradition, à disposer l’entourage de manière à ce qu’on eût sous les yeux l’aspect de la maison de Nazareth, telle qu’on la voyait autrefois. Le cadre était tout prêt pour recevoir la représentation de l’Apparition de l’Ange à la divine Vierge.
Il n’en allait pas ainsi pour la représentation du second des mystères joyeux, la Visite de Marie à sa cousine sainte Elisabeth.
Et, d’abord, il ne reste aucune trace de la maison habitée par le prêtre Zacharie et son épouse sainte Elisabeth. Nous savons par l’Evangile qu’ils habitaient une ville lévitique de Juda et, pour s’y rendre de Nazareth, il fallait traverser un pays de montagnes, per montana. On ne sait pas même d’une manière certaine quelle était cette ville, bien que la plupart des commentateurs croient que c’était Hébron. On suppose bien raisonnablement, semble-t-il, d’après la différence des fonctions exercées, que le prêtre Zacharie était logé plus confortablement que le simple ouvrier charpentier Joseph. Partant de cette donnée, ou verra dans le petit monument qui s’élève aujourd’hui pour servir de cadre à l’entrevue de la sainte Vierge et de sainte Elisabeth, comme l’atrium, le vestibule de la maison de Zacharie. C’est un pavillon carré, présentant 4 m. 50 sur chaque côté. Sa toiture, arrondie en forme de cône, lui donne sa physionomie orientale. L’espace intérieur, étant très restreint, une large porte d’entrée permettra, non seulement de voir à distance, du dehors, le groupe de la Visitation, mais même le prêtre à l’autel placé en avant du groupe, lorsque la messe y sera dite pour une assistance nombreuse.
Quant au groupe lui-même, nous ne pouvons encore en parler, n’ayant eu sous les yeux qu’une photographie, simple essai de l’artiste.
C’est dans notre prochain numéro, sans doute, qu’il nous sera permis d’indiquer à nos lecteurs le jour fixé pour l’inauguration du nouveau sanctuaire et, en même temps, de compléter ce que nous venons brièvement de leur en faire connaître.
N° 12 Septembre 1900
Après dix ans
« Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles ! »
Bienheureux de Montfort.
Bien triste, bien solitaire était la lande de la Madeleine, aux premiers jours de l’année 1890, quand je venais m’agenouiller au pied du Calvaire du Père de Montfort. Si l’on montait l’escalier de pierres qui conduisait au sommet de la montagne sainte, le regard étonné ne trouvait, pour se reposer, qu’une vaste forêt s’étendant à perte de vue vers le Nord-Ouest, les blancs clochers des paroisses environnantes, et, fermant l’horizon au sud, un long ruban argenté, qu’on me disait être la Loire. Mais là, à mes pieds, rien, rien que la lande stérile avec sa monotonie silencieuse. A la belle saison la bruyère fleurissait ; mais l’été passait et ce charme des landes bretonnes passait avec lui.
Aujourd’hui, après une longue absence, je suis revenu au Calvaire. Qu’elle n’est pas ma surprise, qu’elle n’est pas mon émotion, en voyant les étonnantes transformations de la lande solitaire ! Tout a changé d’aspect! La lande était morte : elle vit ; la lande était muette : elle parle avec éloquence. Au sourd et grave murmure du vent se jouant dans les pins de la forêt, est venue s’ajouter une voix plus puissante et plus mélodieuse. Qu’est-il donc arrivé ?
Un souffle d’en haut a passé sur ce désert aride et les projets de Montfort, ensevelis pour toujours — croyait-on — sous les rochers sauvages que couvrait un épais manteau de mousse, ont commencé à reprendre vie, se sont développés, ont grandi et sont devenus cette vivante actualité, qui attire aujourd’hui la foule empressée des pieux pèlerins.
Montfort voulait représenter sur la lande de Pontchâteau les principaux mystères de la vie, de la Passion et de la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ, afin de tenir constamment sous les yeux des populations chrétiennes, qu’il était venu évangéliser, le précieux souvenir de notre Rédemption. Mais il fut entravé dans l’exécution d’un plan si magnifique, par les cabales jalouses de ses ennemis et il dut céder devant l’orage. Ce plan voulu de Dieu devait pourtant se réaliser : le Bienheureux l’avait prédit.
Quel est ce monument qui s’élève là-bas, au fond de la lande ? Autrefois l’on n’y voyait que la fontaine du P. de Montfort, surmontée d’une humble construction au toit rentrant, et maintenant se dresse à côté d’elle, fier et majestueux, le péristyle d’un palais romain. C’est le prétoire de Pilate. Deux escaliers permettent d’entrer sous les arcades. Le premier, en face, est la « Scala Sancta », qu’on ne monte qu’à genoux. Le second, situé à l’est, sert d’escalier ordinaire. Montons. Le prétoire m’assure-t-on, commença cette longue série de monuments, qui doivent peupler et rendre éloquente la lande de la Madeleine. Il fut rapidement construit, et sa bénédiction solennelle attira une foule considérable, qui s’accoutuma depuis à revenir au Calvaire, se grossissant chaque fois de nouvelles recrues. Mais le prétoire seul, sans aucune trace des souvenirs douloureux qu’il rappelait, eut été bien froid, aussi deux groupes, celui de la Flagellation et de la Condamnation de Notre-Seigneur, y sont déjà installés. D’autres, sans doute, viendront à leur tour, et quand la série sera complète, les pèlerins pourront, sans peine, suivre le Sauveur dans toutes les phases cruelles de son séjour au tribunal du procurateur romain.
En descendant l’escalier du prétoire on se trouve sur une large allée bordée d’arbres. Suivons-là ; elle nous conduit à peu près au sommet de la lande. Quelles transformations sur tout le parcours ! Il y a dix ans, on ne voyait là que quelques ajoncs chétifs, émergeant à peine du milieu de la bruyère, et quelques broussailles rabougries desséchées par le soleil. Maintenant de jeunes bosquets fournissent déjà au pèlerin une retraite charmante. Le chêne et le pin, le sapin et le mélèze, le cèdre et plusieurs autres espèces de plans forment une variété qui réjouit le coup d’œil, en mêlant les diverses nuances des couleurs particulières de leur feuillage. C’est le jardin de Gethsémani. A un détour du sentier qui traverse le bosquet, on me fit passer sur un pont construit avec des roches informes. C’est le torrent de Cédron que nous venions de franchir. Que de travail il a fallu pour le creuser à cette profondeur ! Tout en cheminant on me racontait le dévouement des nombreux travailleurs volontaires, qui sont venus répandre leur sueur sur cette lande stérile. J’aurais voulu les voir à l’œuvre, avec cet entrain et cette bonne humeur, que les lecteurs de l’Ami de la Croix leur connaissent.
Nous arrivons an grand rocher, qui dominait seul autrefois cette partie de la lande. Qu’est-il donc devenu ? On ne l’a pas fait disparaître ; il est là encore, mais à peu près complètement dissimulé par un grand nombre d’autres, entassés à ses côtés, pour former la grotte de l’Agonie.
C’est surtout à la construction de cette grotte que commença le magnifique mouvement des populations voisines venant, avec amour, apporter à la réalisation de la grande idée de Montfort le concours de leurs bras et de leur bonne volonté. On me dit que ce concours n’a pas diminué, que cette bonne volonté ne s’est pas refroidie un seul instant, pendant toute la durée des grands travaux. Au lieu de décroître, l’ardeur augmentait, car l’émulation s’était mise de la partie, aiguillonnant les retardataires. Que de temps il aurait fallu pour tracer les allées, les niveler, creuser le torrent du Cédron, nettoyer le terrain pour la plantation des arbres, transporter au loin ces quantités considérables de terre et ces immenses blocs de rocher, sans les nombreux pèlerinages de travailleurs volontaires, venant sur la lande, comme au temps de Montfort, en chantant et en priant, afin de mieux travailler ! Hommes et femmes, jeunes enfants et vieillards, nobles et paysans, tous y sont venus donner ce témoignage d’affectueuse vénération au Bienheureux, et l’on en vit qui, empêchés de suivre le groupe qui partait le matin de l’église, remettaient à un parent ou à un ami le prix d’une bonne journée de travail. On aimerait à connaître nombre d’autres détails édifiants qui durent se produire au cours de ces laborieuses journées. Que ce concours fut précieux pour réaliser le plan de la grotte, tel qu’il a été exécuté ; car où trouver les instruments appropriés à ce genre de travail ? Mais, grâce aux bras robustes des fils des vieux Celtes qui élevaient des dolmens, les blocs de rocher se sont entassés avec art et ont formé cette grotte solitaire, image fidèle de celle où Jésus-Christ priait et pleurait au jardin de Gethsémani. Elle est jetée là, au fond d’un bosquet naissant, dans la solitude, invitant à la prière. Quand je pénétrai dans cette retraite silencieuse, mes regards furent frappés comme d’une vision d’en haut : au fond, un Ange montre le ciel de la main droite et baisse son regard vers le Sauveur du monde, à genoux, écrasé et comme anéanti sous le poids des iniquités du genre humain. Comme tout naturellement, vous tombez à genoux ; la prière vous monte aux lèvres à la vue de ce groupe vivant, qui représente la première des grandes douleurs auxquelles était en proie l’Homme-Dieu, la veille de s’offrir en sacrifice pour nos péchés.
De Gethsémani, Jésus fut conduit à Jérusalem par des chemins détournés. En revenant sur nos pas, nous le retrouverons au prétoire de Pilate.
C’est au prétoire que commence le chemin de Croix. La première station : Jésus condamné par Pilate, y occupe la place qui lui était destinée. La voie douloureuse porte déjà l’empreinte des grandes foules qui ont dû la parcourir pour suivre Jésus montant au Calvaire. De distance en distance sont groupées les statues qui forment les quatorze stations. Elles sont placées sur une légère élévation, afin que les fidèles puissent les considérer facilement et recueillir toutes les saintes impressions qu’elles sont destinées à produire. La voie douloureuse passe à travers la lande et aboutit au Calvaire.
C’est au Calvaire surtout que la transformation est complète. Il y a dix ans, ce n’était qu’un monticule en forme de cône tronqué parfaitement symétrique. Les proportions sont devenues plus grandioses; sa base est plus large et son sommet sensiblement plus élevé. Ce n’est plus l’escalier en pierres, c’est un large chemin en pas de vis qui finit au pied de la croix. Actuellement, c’est une masse plus ou moins informe, hérissée de rochers, mais bientôt les plantations faites au milieu des rochers auront grandi, et la verdure lui donnera l’aspect charmant d’une colline naturelle surmontée de trois croix. J’avais lu dans l’Ami de la Croix le détail de toutes les transformations, à mesure qu’elles se sont produites ; mais en voyant le résultat des travaux, je suis obligé de reconnaître que la foi, et une foi robuste, est seule capable d’inspirer tout le dévouement qu’il a fallu, pour conduire à bonne fin cette gigantesque entreprise.
D’autres monuments sur la lande attirent encore les regards, tout en causant une agréable surprise : c’est l’humble maison de Nazareth, où fut prononcé le « fiat » rédempteur ; c’est la maison de sainte Elisabeth, avec sa « kouba » orientale, où Jésus Christ appliqua, par Marie, les premiers fruits de l’Incarnation. D’autres, je l’espère, intéresseront bientôt les pèlerins du Calvaire, car l’œuvre de Dieu ne dépend pas des hommes.
*
Considérés au point de vue purement matériel, les travaux du Calvaire resteront une preuve sensible de l’influence persistante que le Bienheureux de Montfort exerce sur les populations environnantes. Son nom a été comme un mot d’ordre, que se communiquaient, de paroisse en paroisse, les ouvriers pèlerins, et c’est ce nom qui a maintenu, en l’étendant, le merveilleux élan qui a poussé vers le Calvaire les descendants de ceux qu’il évangélisa autrefois.
Mais ce point de vue n’est pas le seul qui doit attirer l’attention. Si Dieu a voulu un si grand concours de fidèles, au lieu même où le saint missionnaire a été le plus profondément humilié, ce n’est pas seulement pour que son Serviteur soit glorifié ; mais aussi et surtout, c’est pour que ces pieux pèlerins soient eux-mêmes pénétrés de l’esprit de foi, que Montfort sut inculquer avec tant de succès à leurs ancêtres. Sans Montfort, que serait maintenant toute cette population au point de vue religieux ?
Serait-elle croyante, serait-elle pénétrée du véritable esprit du christianisme comme elle l’est ? Sans le Calvaire de Pont-Château, qui fait vivre la mémoire du Bienheureux, quel fruit serait-il resté, après deux siècles, des missions données par le Serviteur de Dieu ? Longtemps le Calvaire a été le feu près de s’éteindre, caché sous la cendre et réchauffant seulement ceux qui en étaient tout près. Aujourd’hui, c’est le brasier ardent, qui répand au loin sa chaleur bienfaisante et qui attire par le vif éclat de sa flamme. Autrefois sans doute le bien se faisait au Calvaire, mais sur une petite échelle et timidement : aujourd’hui c’est toute la contrée qui vient y puiser le grand esprit de foi qu’on lui connaît.
Qu’on me permette d’en juger par la comparaison du mouvement des populations vers le Calvaire, il I y a dix ans et aujourd’hui.
Le Calvaire a toujours été un centre d’attraction ; mais, il y a dix ans, bien rares étaient les pèlerinages et bien peu nombreux les pèlerins. De loin en loin un petit groupe faisait son apparition. Il entrait à la chapelle du pèlerinage, montait au Calvaire, puis il se dirigeait vers la fontaine du P. de Montfort et disparaissait pour longtemps. Aujourd’hui la scène a changé d’aspect. Ils sont rares les jours de la semaine, où l’on ne voit pas un ou plusieurs groupes d’étrangers venir visiter les divers monuments et prier au Calvaire, Mais c’est surtout le dimanche que l’affluence est considérable Dès le matin les pèlerins arrivent par groupes séparés. Ils se dirigent vers la chapelle qu’ils ont bientôt remplie. Vers dix heures, la procession traditionnelle s’organise et se met en mouvement, au chant des cantiques. Elle fait une station à la maison de Nazareth, à celle de sainte Elisabeth, puis elle continue sa marche jusqu’à la grotte de l’Agonie, où elle s’arrête un peu plus longtemps.
De là elle se dirige vers le Prétoire, où elle s’arrête encore avant de rentrer à la chapelle pour la sainte messe.
A chacune des stations on adresse aux pèlerins une courte allocution appropriée au mystère représenté sous leurs yeux.
Dans l’après-midi, une seconde procession s’organise. Elle se dirige vers le Prétoire, se grossissant des retardataires, pour suivre l’exercice si salutaire du Chemin de Croix. Du Calvaire elle revient assister à la bénédiction du Très Saint-Sacrement, à la chapelle, trop petite pour la nombreuse assistance. Dans la soirée les pèlerins s’en retournent contents et désireux de revenir encore au Calvaire, car, après avoir considéré les grandes scènes de notre rédemption, représentées avec des développements si sublimes, elle sent sa foi retrempée, son espérance raffermie et sa charité rendue plus généreuse.
Voilà le prédicateur que les pèlerins de toutes les langues peuvent entendre tous les jours. Mais quand les foules s’ébranlent à la voix de leurs pasteurs et qu’elles viennent ici, chantant et priant comme savaient prier les vieux chrétiens, alors elles sont vraiment — apôtre — auprès d’elles-mêmes et auprès des indifférents qui passent en haussant les épaules. La foule prie ; mais elle fait aussi prier. Après tout, le cœur humain subit des lois, et si un homme ne peut être témoin des misères et des souffrances de ses semblables, sans éprouver un serrement de cœur, il ne peut pas non plus voir prier comme on prie au Calvaire, sans tomber à genoux, ou tout au moins, sans se reprocher son indifférence. D’ailleurs, combien de con versions opérées sur ces landes !
Le miracle ! C’est encore un prédicateur puissant. Ou sait assez son influence ; mais ce qu’on ne sait pas peut-être, c’est la façon habituelle dont on l’obtient au Calvaire et, par conséquent, tout le bien qu’il y fait.
Or tout cela c’est la foi ; c’est la foi vive et agissante ; c’est la foi venant se rallumer et s’embraser à un Calvaire, comme à son foyer naturel. Mais le nom de Montfort est inséparable du Calvaire de Pont-Château ; aussi ce Calvaire est-il comme la survivance de Montfort. C’est Montfort poursuivant toujours son œuvre de missionnaire par le souvenir de l’ascendant que lui avaient acquis sur ce peuple religieux son dévouement et sa sainteté. C’est Montfort prêchant encore par son influence le règne de Jésus par Marie.
G. B. Pèlerin.
La Visitation
Dans les derniers jours du mois d’août, les échos du Calvaire se sont tout à coup réveillés au chant des cantiques de Montfort. C’était un groupe de travailleuses venues de Quémené, en Crossac, qui portaient des pierres et du sable dans la chapelle de la Visitation. Elles étaient accourues dès la première invitation pour exhausser l’intérieur du modeste sanctuaire, le niveler et le mettre à point pour le carrelage. Grâce à l’infatigable ardeur des ouvrières, une journée a suffi pour terminer lu besogne.
D’ores et déjà tout est prêt pour recevoir les statues de sainte Elisabeth et de la sainte Vierge. Elles arrivent à l’heure où nous écrivons ces lignes. Ainsi bientôt la piété aura sur notre lande du Calvaire un nouveau foyer de lumière et une nouvelle source de grâces spirituelles.
Déjà nous avions Nazareth, le mystère de l’Incarnation, Marie devenant la mère de Jésus, ou Jésus se mettant sous la dépendance de Marie. C’est là le premier mot de la « dévotion parfaite » de Montfort à la Très Sainte Vierge : Jésus s’est mis sous la conduite de Marie, chrétiens, imitons cet exemple.
Dans le mystère de la Visitation le plan divin s’éclaire d’un nouveau jour. Notre-Seigneur ne s’était donné à la Très Sainte Vierge que pour se donner à nous par l’entremise de son auguste Mère. Il faut que cette disposition divine ait son effet dès les premières heures de la Rédemption. Il est décidé que Jean-Baptiste, le précurseur, sera sanctifié dès avant sa naissance. Pour que ce miracle s’accomplisse, il faut que Marie se lève, il faut que Marie traverse une contrée montagneuse, il faut que Marie se hâte. C’est à la voix de Marie que Jean-Baptiste sera purifié et que son âme tressaillira d’allégresse. C’est à la voix de Marie que sainte Elisabeth est saisie d’un saint respect pour le Dieu présent et quelle se sent envahie par l’esprit prophétique.
Ainsi la Très Sainte Vierge est à peine en possession du Dieu Sauveur qu’elle le porte aux âmes et Dieu n’est pas plutôt le Fils de Marie qu’il se sert de son saint ministère pour les œuvres de sa grâce.
C’est ici que l’Esprit-Saint complète la salutation de l’ange par la bouche de sainte Elisabeth: « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est bénie. » La sainte Vierge y répond par le cantique du « Magnificat » où son âme déborde de reconnaissance et s’abîme dans la profondeur de son néant. Aussi louons Marie avec les Anges, louons Marie avec les Saints, Mari retourne tout à Dieu.
Ces pensées et d’autres s’élèveront dans les âmes lorsqu’elles viendront s’agenouiller à la chapelle de la Visitation, le chapelet à la main et la louange de Dieu sur les lèvres. Que sera-ce quand nous aurons exécuté tous nos projets, lorsque les fidèles pourront dire leur rosaire et le méditer en parcourant la série complète des quinze mystères ? Alors la pensée du Bienheureux de Montfort sera réalisée toute entière : la croix rayonnera au sommet de la Voie Douloureuse, la croix enguirlandée du Rosaire.
N° 1 Octobre 1900
Bénédiction du Sanctuaire de la Visitation
C’est au second dimanche d’octobre, mois du Saint Rosaire, qu’est fixée définitivement l’inauguration et la bénédiction du nouveau sanctuaire ouvert à la piété des pèlerins du Calvaire. Les lecteurs de l’Ami de la Croix savent qu’il est dédié au second des mystères joyeux du Rosaire, La Visitation de Marie à sa cousine sainte Élisabeth.
L’humble monument, de forme carrée, est surmonté d’une petite coupole. La Vierge-mère y apparaît légèrement inclinée ; et dans l’auréole qui entoure son front, on lit, en lettres d’or, ces deux mots: Pax tibi ! La paix soit avec vous ! L’Evangile dit seulement qu’elle salua, en entrant, sa cousine Elisabeth ; mais, d’après le récit même, le salut fut accompagné de quelques paroles. Et, vraisemblablement, ces paroles ne furent autres que la formule usitée chez les Juifs : Pax tibi ou Domus tecum, La paix soit avec vous ou le Seigneur soit avec vous.
Sainte Elisabeth plus profondément inclinée porte aussi au front une auréole, avec ces mots : Benedicta tu inter mulieres, vous êtes bénie entre toutes les femmes, paroles déjà apportées du Ciel par l’Archange, au jour de l’Annonciation, et que redit Sainte Elisabeth, en y ajoutant et benedictus fructus ventris tui, et le fruit de vos entrailles est béni, complétant ainsi l’Ave Maria, tel que nous le récitons aujourd’hui.
Tout en contemplant cette représentation de la rencontre de Marie avec Sainte Elisabeth, les pèlerins pourront lire sur le mur en face, le texte même de l’Evangéliste Saint Luc, qui leur facilitera la méditation de ce doux mystère de la Visitation, dont le fruit doit être en nous une grande charité envers le prochain, d’après la demande qui en est faite en récitant le chapelet selon la méthode du Bienheureux Montfort.
Nombreux, nous l’espérons, sont les amis du Saint Rosaire et du Bienheureux Montfort qui auront à cœur de prendre part à cette fête du dimanche 14 octobre, et de s’unir à nous dans la prière.
Dans ces jours où tout en parlant beaucoup d’union, de solidarité, de fraternité, rien n’est épargné de ce qui peut semer la division, attiser les haines, ne convient-il pas de s’unir afin d’obtenir, par l’intercession de Marie, un accroissement dans les âmes de cette charité vraie que son divin fils est venu enseigner à la terre, et qu’elle-même a pratiquée d’une manière si parfaite !
+
Cette fête du 14 octobre sera présidée par M. le curé-doyen de Pontchâteau.
La cérémonie aura lieu dans l’après-midi, et commencera à 1 h. 1/2.
Les paroissiens de Pontchâteau, invités spécialement, viendront processionnellement et se rendront directement au Prétoire.
Après l’allocution qui sera prononcée par M. l’abbé Rochet, vicaire, on se remettra en procession pour se rendre au sanctuaire de la Visitation.
Bénédiction solennelle du sanctuaire.
Salut du Très Saint-Sacrement.
N° 2 Novembre 1900
Bénédiction du Sanctuaire de la Visitation Dimanche 14 Octobre
Bien que fixée à une époque un peu tardive, dans l’année, rien n’a manqué de ce qui pouvait donner de l’éclat à cette fête de l’inauguration du second mystère joyeux du Rosaire.
Dès la veille, quelques oriflammes flottant au sommet du Calvaire annonçaient à toute la contrée environnante la fête du lendemain. L’humble monument qui abrite la rencontre de Marie et de sainte Elisabeth, entouré aussi d’oriflammes, est comme transformé. Son petit dôme, jusqu’alors de couleur sombre, apparaît maintenant d’une blancheur resplendissante sous les rayons du soleil.
La cérémonie de la bénédiction solennelle, ainsi qu’il a été annoncé, ne doit avoir lieu que dans l’après-midi. Mais, dès la matinée, l’affluence des pèlerins venus de plus de vingt paroisses différente est telle, que la chapelle du Pèlerinage est tout à fait insuffisante pour les contenir. Pour que tous puissent y assister, la messe est dite, en plein air, a la Scala Sancta.
Cependant l’heure fixée pour la cérémonie est venue. L’Ecole apostolique, le noviciat, la Communauté toute entière du Calvaire s’est rendue processionnellement au Prétoire suivie de la foule des pèlerins qui, tout à l’heure, y assistaient à la sainte messe. On chante, avec un entrain extraordinaire, les quelques strophes qui traduisent simplement le récit de la visite de Marie à sainte Elisabeth.
L’attente n’est pas longue. Voici qu’apparaissent au sommet de la côte la croix et les bannières de Pontchâteau. Les enfants de l’école des Frères marchent en tête après la croix, puis les femmes sur deux longues files suivant la bannière de la sainte Vierge et, enfin, le groupe nombreux des hommes entourant la bannière de saint Martin, patron de la paroisse.
Ainsi qu’il convenait, la foule, déjà massée dans la cour du Prétoire, ouvre ses rangs pour permettre à la procession de Pontchâteau de s’avancer jusqu’au pied de la Scala.
Toutes les voix s’unissent pour chanter encore quelques couplets et redire les deux mots qui servent de refrain, et que l’on répète toujours sans se lasser : Ave, ave, ave Maria !
Mais le silence se fait. M. l’abbé Rochet a pris la parole, et bientôt il a captivé son nombreux auditoire. Tous écoutent, avec une religieuse attention, ce beau commentaire de l’Evangile de saint Luc, dont chaque verset devient matière à un enseignement lumineux, et d’où ressortent d’excellentes conclusions pratiques. Le vœu exprimé par l’orateur, avant de terminer, ne peut manquer d’avoir son accomplissement : Que les habitants de Pontchâteau restent toujours fidèles à la pieuse dévotion du Saint Rosaire, enseignée, prêchée autrefois par le Bienheureux Montfort à leurs pères, et pour la réchauffer, qu’ils aiment à venir à son Calvaire, à prier dans ce sanctuaire de la Visitation, dans les autres sanctuaires où ils auront sous les yeux la représentation des différents mystères de la vie de Notre-Seigneur et de sa divine Mère.
Quelques instants après l’audition de ce discours, la foule des pèlerins était rangée, en bon ordre, des deux côtés et en face du monument qui allait recevoir les bénédictions de l’Eglise.
M. le Curé de Pontchâteau entonne les chants liturgiques continués par le chœur, pendant que lui-même asperge les murs, à l’extérieur d’abord, puis à l’intérieur. Les litanies des saints sont chantées à deux chœurs, et le célébrant prononce les dernières oraisons prescrites par le rituel.
Le nouveau sanctuaire est bénit. Le Dieu de l’Eucharistie ne tarde pas à en prendre possession ; la foule ouvre ses rangs et s’agenouille sur son passage. Déposé sur l’autel qu’on vient de parer à la hâte pour le chant du Tantum ergo, il s’avance porté par le célébrant, jusque sur le seuil, et bénit la foule prosternée.
Le R. P. Directeur du pèlerinage adresse alors, en quelques mots, ses remerciements et ses félicitations à tous ceux qui sont venus prendre part à la fête, mais tout particulièrement aux paroissiens de Pontchâteau et à leur vénéré pasteur.
Il ne reste plus qu’à entonner le cantique d’actions de grâces de Marie. Le Magnificat s’échappe spontanément de toutes les poitrines, de tous les cœurs.
Charmante fête que notre lande verra se renouveler lorsque, dans un avenir prochain, s’y épanouiront les autres fleurs du Rosaire.
La Grotte de Bethléem
Voici que nous allons entrer dans la saison où nous ne verrons plus, fréquemment, les belles et nombreuses processions se dérouler sur notre lande. Mais c’est aussi la saison dans laquelle nous avons eu, par le passé, le spectacle mouvementé de ces belles journées de travail, dont nos lecteurs n’ont pas perdu le souvenir. Nous sera-t-il donné de voir ce spectacle se renouveler dans un avenir prochain ? Ce que nous pouvons dire, c’est qu’à peine avait eu lieu l’inauguration du second mystère joyeux du Rosaire, on agitait la question de mettre la main à l’œuvre pour la représentation du troisième de ces mystères : La Nativité de Notre-Seigneur dans l’étable de Bethléem.
L’excellent M. Gerbaud, dont tous nos lecteurs connaissent le dévouement à notre œuvre du Calvaire, faisait, dans les jours mêmes, un voyage en Normandie, dont voici le motif: Ancien pèlerin de Terre-Sainte, il a vu autrefois la grotte de Bethléem, il s’y est agenouillé, il y a prié, et l’image de ce sanctuaire trois fois saint ne s’est pas effacé de sa mémoire. Mais pour une reproduction exacte dans les dimensions, dans les détails, cette image lui eût été insuffisante, peut-être.
Or, nous savions, ici, qu’il existait une copie très fidèle de la Grotte de Bethléem, à Aubevoye, petite paroisse du diocèse d’Evreux. C’est un prince de l’Eglise, le cardinal de Bourbon, qui, au siècle dernier, eut la bonne pensée de faire ériger ce pieux monument dans la belle propriété, où il passait ses jours de vacances. Pour être assuré de l’exécution parfaite de son pieux dessein, il envoya, dit-on, successivement, deux architectes en Palestine, pour lever tous les plans nécessaires.
La reproduction se fit, en effet, avec une parfaite exactitude, mais elle avait souffert des injures du temps. Récemment, les propriétaires actuels de la maison de campagne du cardinal y ont pourvu par une restauration bien entendue. Très bien accueilli par eux, M. Gerbaud a pu lever des plans, tracer des croquis qui seront utilisés pour l’œuvre projetée au Calvaire.
A bientôt donc, nous l’espérons, la pose des premières pierres qui serviront de base à la colline et à la grotte de Bethléem !
N° 3 Décembre 1900
Menus travaux
En attendant des travaux plus sérieux, on s’est occupé pendant ce mois, comme chaque année à la même époque, de plantation d’arbres et arbustes. La grande sécheresse de l’été dernier a été funeste à bien des jeunes plants. Il y avait des vides à combler, mais aussi à garnir les allées nouvelles, à créer de nouveaux massifs. Le R. Père Directeur du Pèlerinage a trouvé pour cela, dans ses nouveaux aides, un concours précieux et empressé.
Nous sommes bien loin encore, sur ce point, de ce qui serait désirable pour l’embellissement du pèlerinage, et surtout pour donner plus d’ombrages aux pèlerins. Mais, témoin de toute la peine que l’on se donne pour atteindre ce but, nous nous faisons un devoir de prier une fois de plus les allants et venants d’éviter avec soin tout ce qui peut causer quelque dommage aux plantes, arbres et arbustes.
N° 4 Janvier 1901
Travaux
Nous avions pensé, et nous avions même fait entendre à nos lecteurs que l’année ne se terminerait pas, sans qu’on eut mis la main à l’œuvre, pour la construction d’une Grotte de Bethléem, et la représentation du mystère de la Nativité de N.-S., troisième du Rosaire.
Diverses circonstances, certaines difficultés qu’il était bon d’aplanir avant de commencer, ont amené quelque retard; mais le projet n’en subsiste pas moins, et l’intention de l’exécuter dans un avenir très prochain. Les plans sont tout préparés, et tout fait présumer qu’avec le concours des bonnes volontés sur lesquelles nous pouvons compter comme par le passé, cette exécution sera prompte et facile, et qu’en même temps, le nouveau sanctuaire réunira toutes les conditions qui en feront un attrait de plus pour notre pèlerinage.
+
En attendant, ceux qui en sont chargés ne laissent pas que de travailler, presque journellement à quelques embellissements. On plante encore, puisque la saison le permet. On taille lauriers et fusains. On sarcle, on émonde ; et qui ne sait combien il est nécessaire d’émonder, de sarcler là où la lande et l’ajonc, avec une ténacité incroyable s’obstinent à remettre le pied sur le terrain qui leur a été enlevé.
On aime aussi à voir quelques fleurs dans le pèlerinage, et en particulier au jardin de Nazareth. La main active du P. Servaes, qui en est spécialement chargé, y prépare, en ce moment, si rien n’y met obstacle, une belle floraison, pour le printemps prochain.
+
Précisément on nous adresse, ces jours-ci, des cache-pots artistement travaillés. Ils feront bien, lorsqu’on placera quelques-unes de ces fleurs aux autels de Nazareth et de la Visitation.
N° 5 Février 1901
Travaux
Ce mois de janvier, consacré par l’Eglise à honorer l’enfance du Divin Rédempteur ne pouvait passer sans un commencement d’exécution du projet qui doit enrichir notre pèlerinage d’une Grotte de Bethléem. Au risque d’étonner peut-être un peu, nous devons dire que les premiers travaux ont été des travaux de démolition, et voici comment :
Sur l’emplacement choisi, désigné pour notre Bethléem, s’élevait une petite maison naguère encore habitée ; construction bien humble, bien modeste qu’on eût pu même qualifier de chaumière. Mais, l’Evangile est là. Ce n’est pas dans une maison, dans une chaumière quelque humble et pauvre qu’elle fût, que le Roi de gloire a voulu naitre. La parole de l’Ange aux bergers veillant dans la campagne est formelle : Vous trouverez l’Enfant, enveloppé de langes, couché dans une Crèche. Encore n’était-ce pas une étable proprement dite, confortable, si l’on peut s’exprimer ainsi, mais une de ces excavations très nombreuses dans les montagnes calcaires de la Judée, où les bergers faisaient rentrer leurs troupeaux en temps d’orage.
Il n’y avait donc pas à hésiter, l’humble maison devait disparaître, être démolie. Du reste, quelques heures de récréation données, un jour, par les novices, un autre jour par les jeunes apostoliques ont suffi à ce travail. Les murs assez peu solides, il est vrai, se sont écroulés l’un après l’autre sous l’effort de leurs bras. Au moment où j’écris, il ne reste plus qu’un pan de muraille déchiqueté, qui ne ferait pas trop mauvais effet dans !e paysage, comme ruine, s’il était environné de lierre, mais qui probablement est destiné à disparaître aussi.
C’est donc de ces décombres que doit surgir maintenant le nouveau sanctuaire. On ne pouvait s’arrêter au travail de démolition. Mais, pour construire, il faut d’abord rassembler-les matériaux nécessaires. Et c’est à quoi l’on a songé tout de suite. Et, sans tarder, l’on a fait de nouveau appel à nos bons amis, les travailleurs dévoués du Calvaire.
Le travail qui leur est demandé, pour le moment, ne laisse pas que d’être pénible. Ceux qui connaissent notre Gethsémani, et la grotte, d’Adam savent qu’elles sont formées de gros blocs de quartz, aux formes plus ou moins disparates et rugueuses.
Ces blocs disséminés en grand nombre, à fleur de terre, au sommet de notre lande, semblaient attendre, depuis des siècles, la destination qui leur est donnée de nos jours. Mais, après le large emploi qui en a été fait à Gethsémani, au Calvaire, sur la Voie Douloureuse, ils se font plus rares, il faut aller les chercher plus loin, ou les extraire à une plus grande profondeur.
C’est à ce rude labeur qu’ont été consacrées les six journées données, pendant ce mois de janvier par nos travailleurs volontaires. La première due à une section de la paroisse de Crossac ; la seconde aux hommes du village de Bergon, eu Missillac ; la troisième à une section de la paroisse de Crossac ; la quatrième aux hommes des villages avoisinant le château de Casso ; la cinquième à une section de la paroisse de Drefféac ; et la sixième à une seconde section de la même paroisse. Tous ont rivalisé d’activité et d’ardeur et ont montré le même dévouement.
Pendant ces jours aussi, les deux nouveaux aides du R. P. Directeur, ont fait leur dur et méritoire apprentissage, ayant continuellement, au milieu des travailleurs, le pic ou la barre de fer à la main
Le résultat de ces six excellentes journées est déjà très appréciable. En voyant tous ces monolithes, dont plusieurs sont remarquables, rangés en cercle sur le terrain où doit s’élever notre Grotte de Bethléem, on se dit déjà que l’habile architecte de Gethsémani qui ne peut désormais tarder beaucoup à paraître, ne manquera pas des matériaux nécessaires et qu’avec le talent qu’on lui connaît, il nous donnera un nouveau monument, qui rappellera aux générations futures le dix-neuvième centenaire de la venue du Divin Rédempteur.
+
Ces lignes étaient écrites, lorsque nous arrive M. Gerbaud. Il nous apporte la maquette de la Grotte de Bethléem, qu’il a modelée lui-même. On se représente très bien, en la voyant, le futur monument, dans tous ses détails : la large ouverture qui servait d’entrée, le lieu de la naissance, l’enfoncement où se trouve l’autel des Mages, et la crèche où fut couché l’Enfant-Dieu, etc. Il n’y a donc plus qu’à mettre en place, d’après ce modèle les blocs de quartz maintenant épars sur le terrain. Et c’est ce que nous verrons bientôt, sans doute.
N.-B. — Nous devons réparer, ici, une omission. Au lieu de six journées de travail volontaire dans ce mois, il y en a eu sept, dont l’une, celle du 29 janvier a été donnée par un groupe d’hommes de la paroisse de Saint-Roch. Journée excellente, dans laquelle tous ont montré un dévouement et une activité admirables.
N° 6 Mars 1901
Travaux pour la Grotte de Bethléem
Le mois de janvier, ainsi que nous l’avons dit, a vu s’amonceler les matériaux, les blocs de quartz sur l’emplacement désigné à l’avance, pour notre station de Bethléem.
Le mois de février vient de voir creuser les fondations, et déjà même poser les premières assises du pieux monument.
Bien qu’ayant le plan sous les yeux, il serait prématuré, d’essayer pour nos lecteurs, une description de notre future grotte. Mais pour qu’on ait une idée de l’importance des travaux dirigés, en ce moment, par M. Gerbaud, et auxquels se prêtent avec tant de dévouement, nos travailleurs volontaires, nous pouvons du moins en donner les dimensions qui sont exactement celles de la vraie grotte de Bethléem où naquit le divin Enfant. Cette grotte, taillée dans le rocher, n’a guère en largeur que trois mètres, mais elle s’étend sur une longueur de douze mètres environ. La voûte formée par le rocher est à trois mètres quarante au-dessus du sol.
On a donné aux fondations une largeur de deux mètres, ce qui n’est pas exagéré pour ce genre de construction, et bien qu’on ait trouvé le solide à une petite profondeur, on a calculé qu’il n’a pas fallu moins de cinquante mètres cubes de petites pierres ou cailloux pour les combler.
Mais avant de parler de ce travail des fondations, nous avons à mentionner encore deux journées, ou mieux pour être tout à fait exact, une journée et une matinée employées à la préparation des matériaux.
+
La journée donnée par les bons habitants du village de Cusiac, paroisse de Sainte-Reine, a été des plus fructueuses. Elle a été employée toute entière uniquement à l’extraction de ces gros blocs de quartz semés au sommet de notre lande, mais plus d’à moitié enfouis sous terre. Ce n’est pas un petit travail que de dégager ces masses, de les soulever, de manière à ce qu’il n’y ait plus qu’à les placer sur le traîneau pour les conduire au chantier. Le soir venu, on s’applaudissait d’avoir fait une bonne récolte.
+
Quant à la matinée, ça été, si l’on peut ainsi dire, une improvisation hardie suivie d’un plein succès. M. Gerbaud était venu, ce jour-là, seulement dans le dessein de tracer sur le terrain les fondations de la grotte. Mais, depuis qu’il médite son plan, ses regards s’étaient tournés plus d’une fois vers une énorme pierre, visible au loin de différents points du pèlerinage, et qui attirait le regard par sa blancheur. Il la voyait, à l’avance, à l’entrée de sa grotte, soutenant le cintre de la large baie qui doit y donner accès. Mais, la pierre était à cinq cents mètres de là, et, elle avait déjà son histoire. Un jour, lors des travaux du Calvaire, on avait essayé de l’y amener ; mais l’essieu du traîneau sur lequel on était parvenu à la placer se brisa sous le poids, et l’on dut y renoncer.
Pourquoi ne tenterait-on pas, de nouveau, l’aventure ? On est en possession d’un traîneau plus fort, non pas monté sur des roues avec essieu, mais sur de gros rouleaux de bois. Le temps est des plus favorables la terre est durcie par la gelée, les rouleaux tourneront avec une grande facilité.
Une heure s’était à peine écoulée que tous les hommes des villages environnants étaient venus se joindre aux novices et aux bons frères de la communauté.
Et bientôt on peut voir la pierre convoitée chargée sur le traineau, s’avancer lentement sur la lande. Au coup de l’Angélus de midi, son arrivée sur l’emplacement désignée était saluée par une joyeuse acclamation.
Pour chacun des monuments du pèlerinage, il y a eu une bénédiction solennelle de la première pierre, il en sera ainsi pour la grotte de Bethléem. Et cette pierre qui recevra les bénédictions de l’Eglise sera vraisemblablement celle dont nous venons de parler.
Bien qu’il n’y ait encore rien de tout à fait fixé à ce sujet, nous croyons savoir que cette cérémonie n’aura lieu qu’au lendemain de Pâques ; et, si certains projets se réalisent, nous pouvons espérer voir, ce jour-là, une nombreuse affluence de pèlerins et une belle fête.
+
Mais, revenons à nos travailleurs volontaires.
Deux journées ont été employées au travail des fondations dont nous avons dit un mot plus haut. C’étaient deux jours qui datent dans l’année : le Mardi-Gras et le Mercredi des Cendres. Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer que le premier de ces jours avait été désigné par les invités eux-mêmes, braves ouvriers des villages de Camer et Camerun (paroisse de la Chapelle-des-Marais), qui, pour la plupart travaillent dans les chantiers de Saint-Nazaire, et qui ont ordinairement congé ce jour-là. Parmi eux se trouvait un vieillard de 82 ans, qui n’avait pas voulu manquer cette bonne et peut-être, disait-il, dernière occasion de témoigner sa reconnaissance au bon Père de Montfort. Il avait fait, le matin, trois lieues à pied, et travaillant toute la journée, il se plaignait seulement un peu, le froid étant très vif, de ne pouvoir s’échauffer les mains.
+
Ce sont les vaillantes chrétiennes du village de Bergon, en Missillac, qui sanctifient leur première journée de Carême, ici, d’une manière assurément bien méritoire. Il y a loin d’ici Bergon, et le temps est toujours très froid. Cependant elles arrivent très nombreuses. Elles entendent d’abord la sainte messe, puis se mettent avec ardeur au travail, pour le continuer jusqu’au soir. Elles s’en retournent joyeuses, après avoir reçu la bénédiction du Bon Maître.
+
Enfin, c’est dans la présente semaine, première du Carême, qu’on commence à poser les lourdes assises de notre Grotte de Bethléem.
Le lundi, premier jour, c’est tout un bataillon d’environ cent hommes, qui nous vient de Férel (Morbihan). Le vénéré Pasteur de la paroisse est présent et dit, en arrivant, la sainte messe. Tout le jour, on tire à la chaine, on manie la barre de fer ou les leviers, et à la fin de la journée le résultat : ce sont cinq pierres mises en place.
+
Le mardi, second jour, groupe d’élite de Prinquiau ayant à sa tête l’excellent maire de cette commune. On continue le travail de la veille, et le résultat est le même : cinq pierres mises en place.
+
Le mercredi, troisième jour, groupe peu nombreux, mais bien dévoué de travailleurs de Saint-Gildas. Ils sont aidés, à un moment critique, par les novices qui, pour cela, sacrifient gaiment leur heure de récréation. Le soir venu, on compte : encore cinq pierres fièrement campées à leur place.
Quelqu’un ne peut s’empêcher de faire un innocent jeu de mots, qui ne peut du reste, offenser le bon Saint Pierre, et ne l’empêchera pas de voir d’un bon œil, ce que l’on fait ici pour glorifier son maître.
Aujourd’hui, jeudi, c’est une portion des habitants de la paroisse de Sainte-Reine qui continue le travail commencé.
Le R. P. Directeur du Pèlerinage, toujours infatigable, espère voir, à la fin de la semaine prochaine, la pose des premières assises de la grotte terminée.
Il y aurait alors un temps d’arrêt, pendant lequel se ferait naturellement un tassement jugé nécessaire. Et ce n’est qu’après Pâques qu’on travaillerait à l’achèvement et au couronnement de notre Grotte de Bethléem.
N° 7 Avril 1901
Travaux de Bethléem
En ce même temps, les travaux de Bethléem ont continué à mettre du mouvement et de la vie autour de nous. Nous avons laissé ces travaux déjà en bonne voie, le jeudi de la première semaine de Carême.
Dès le lendemain, une troupe nombreuse de femmes de Crossac, avec un entrain admirable, mettait la dernière main aux travaux de fondation, en réunissant une quantité considérable de petits cailloux, qui étaient aussitôt enfouis en terre pour servir de support aux gros rochers qui forment la première assise de la Grotte.
Ces excellentes travailleuses étaient venues des villages de Quémené, de la Brionnière, de la Peltraie, de la Mondraie et de Riom,
Dans la seconde semaine, malgré la rigueur du temps, le travail a été mené vigoureusement.
Le lundi seulement, la pluie qui n’a pas cessé de tomber, n’a pas permis aux travailleurs attendus de se mettre en route.
Mais, le mardi, un vaillant groupe d’hommes de Missillac a fourni au chantier un bon nombre de ces gros blocs de rocher qui se font de plus en plus rares sur la lande et qu’il faut amener de plus loin.
Le mercredi, le résultat de la journée n’a pas été moins bon. Les travailleurs d’Herbignac toujours si dévoués avaient pour les encourager non pas seulement la présence, mais l’exemple en action des deux excellents vicaires de la paroisse.
La journée du jeudi pouvait, en tout point, être comparée à celle de la veille. Les hommes de Guenrouët avaient aussi à leur tête leurs deux vicaires payant de leur personne, comme leurs confrères d’Herbignac.
Le vendredi enfin a été aussi une bien bonne journée donnée par un groupe d’hommes très actifs de la paroisse de Sainte-Anne de Campbon.
M. Gerbaud nous quittait à la fin de cette semaine, laissant à un ouvrier entendu le soin de relier entre elles les énormes pierres qui forment la première assise des parois de la grotte.
La semaine suivante, ce travail a marché très rondement. Pour l’exécuter, il n’était plus besoin d’un si grand nombre de bras. Il en fallait quelques-uns cependant pour mettre à portée les matériaux. Il a suffi de faire appel aux proches voisins du Calvaire, des villages des Métairies, de la Vioterie, de la Berneraie, de la Plaie, de la Pintaie, appel qui a été entendu de tous.
Nous avons dit plus haut qu’une pluie incessante avait empêché de venir les travailleurs convoqués pour le lundi de la semaine précédente. C’étaient les braves de Quilly, qui ont tenu à venir, avec leur bon vicaire, nous donner une excellente journée de travail, le jeudi 14 mars.
Bref, les travaux de notre Grotte de Bethléem sont avancés, plus avancés même qu’on ne l’espérait en commençant cette première campagne. Ils seront repris après les fêtes pascales, et le pieux monument sera achevé, et aura reçu son couronnement dans un avenir très prochain.
Entre temps, ainsi que nous l’avons déjà annoncé, la bénédiction de la première pierre aura lieu le lundi de Pâques, dans l’après-midi, au milieu du concours des pèlerins, toujours fort nombreux ce jour-là, au Calvaire.
La cérémonie sera présidée par M. le curé de Missillac.
N° 8 Mai 1901
Bénédiction de la première pierre de la Grotte de Bethléem
S’il est vrai que le secours de Dieu nous est nécessaire pour toute entreprise, il semble bien qu’il convient tout particulièrement de demander ce secours, quand on entreprend de construire, de bâtir, et de bâtir une demeure que le Seigneur doit venir habiter lui-même. Le verset du Psalmiste chanté si souvent dans nos divins offices n’est-il pas présent à toutes les mémoires : Nisi Dominus redificaverit domum… C’est en vain que les hommes travaillent à bâtir, si le Seigneur lui-même n’y met la main.
Aussi la sainte Eglise a-t-elle, dans sa liturgie, des prières, une cérémonie spéciale non seulement pour bénir, consacrer chaque nouveau sanctuaire, mais pour en bénir les premières assises, la première pierre, et assurer ainsi le secours d’En Haut, dans la construction même de l’édifice.
Plusieurs fois déjà, cette cérémonie s’est renouvelée sur notre lande, qui voit, presque chaque année, surgir un nouveau sanctuaire.
Nous ne songeons pas à la décrire. Outre le psaume auquel nous faisions allusion tout à l’heure, on y chante le Quam dilecta…
Qu’ils sont aimés, grand Dieu, tes tabernacles !
Dans les antiennes, il est fait allusion à la pierre érigée en témoignage par Jacob, et aussi à la pierre contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas, ne prévaudront jamais. Puis, tous les saints du Ciel, apôtres, martyrs, pontifes, confesseurs et Vierges sont invoqués par le chant des grandes Litanies. Dans les oraisons, l’Eglise n’a pas oublié de demander pour les travailleurs, entr’autres grâces la santé du corps, et que, par conséquent, ils soient préservés de tout accident fâcheux.
Cette bénédiction est une de celles réservées à l’Evêque, et un simple prêtre ne peut accomplir ce rite que délégué par lui. Le délégué, dans la circonstance, était l’excellent Pasteur d’une des grandes et chrétiennes paroisses voisines du Calvaire, et évangélisée autrefois par le Bienheureux Montfort, M. l’abbé Gaudin, curé de Missillac. Nous voudrions pouvoir mettre sous les yeux de nos lecteurs la belle et instructive allocution qu’il nous a fait entendre avant de procéder à la pieuse cérémonie.
Nous en sommes réduits à quelques indications bien courtes, bien incomplètes :
Après un début plein de délicatesse, dans lequel il rappelle tout ce qui a été fait, ici, depuis dix ans, pour réaliser les projets do notre saint Fondateur, l’orateur, abordant le sujet particulier de la réunion de ce jour, transporte son auditoire au-delà des mers, sur la terre des anciens miracles. Non loin de Jérusalem, voici l’humble cité de Bethléem, bâtie en amphithéâtre au sommet d’une colline, dont les flancs sont recouverts de vignes et d’oliviers. Sur l’autre versant, s’étendent de vastes pâturages. La description est animée par les souvenirs bibliques qui se rattachent à ces lieux célèbres à tant de titres, le souvenir en particulier de David qui jadis gardait là les troupeaux de son père Jessé.
Mais, tous les autres souvenirs pâlissent, quand, au jour marqué par les prophètes, par une froide soirée d’hiver, on voit apparaître aux portes de la cité do David, deux pauvres voyageurs, brisés de fatigue, et qui demandent en vain l’hospitalité pour la nuit. On a reconnu Joseph et Marie forcés d’aller, à quelque distance, se réfugier dans une grotte creusée dans le rocher et qui servait parfois d’étable. Et, c’est là, qu’a voulu naître le Fils de Dieu, le Roi du ciel et de la terre. Sa douce Mère n’a sous la main qu’un peu de paille qu’elle étend dans une crèche qui lui sert de couchette.
Puis viennent les conclusions pratiques, l’invitation pressante à venir souvent, ici, méditer, goûter les grandes leçons de la crèche, leçons qui s’adressent à tous, grands et petits, pauvres et riches.
Le temps était loin d’être favorable. Un vent froid soufflait avec une certaine violence. Le prédicateur n’avait pour chaire qu’un monceau de cailloux recouvert d’une légère couche de terre. Il n’en a pas moins captivé, charmé son auditoire, en même temps qu’il l’a instruit et édifié.
+
Et, maintenant que les bénédictions du Ciel sont sûrement descendues sur le chantier, il reste à remettre la main à l’œuvre, avec une nouvelle ardeur, pour continuer et mener à bonne fin la construction du pieux monument. Cette ardeur ne saurait faire, ici, défaut.
Toutefois, pour ce qui est de la construction de la grotte, il a été décidé qu’on attendrait la présence de M. Gerbaud, qui a bien voulu l’annoncer pour le jour même de la fête du Bienheureux, 28 avril. C’est donc au lendemain seulement de cette fête que ce travail spécial sera repris. Les travaux dont nous avons à parler aujourd’hui ne sont donc que des travaux préparatoires, accessoires, si l’on veut, mais qui ne méritent pas moins d’être signalés.
Travailleurs et travailleuses volontaires
On a vu, tout-à-l’heure, qu’il était question d’un monceau de cailloux recouvert d’une couche de terre servant de chaire improvisée, à la bénédiction de la première pierre. C’est le commencement, l’embryon de la colline à laquelle, pour avoir la couleur locale, doit être adossée notre grotte de Bethléem, et qui sera, plus tard, couronnée de quelques arbustes verdoyants. Pour la créer, cette colline, car elle doit l’être de toute pièce, on devine qu’il faudra bien des tombereaux de cailloux et de terre, et aussi bien des bras pour recueillir ces cailloux, les charger, charger aussi la terre qui doit y être entremêlée et les recouvrir. C’est à ce travail que se sont employées courageusement, pendant toute la journée du mardi de la Semaine Sainte, les pieuses chrétiennes de la paroisse de Sainte-Reine, qui avaient répondu en grand nombre à l’appel qui leur avait été fait.
Le jour même du jeudi saint, après avoir sanctifié la matinée d’une autre manière, les femmes des villages de Pontchâteau les plus rapprochés du Calvaire sont venues continuer le même travail, et y ont mis la même activité, montrant le même dévouement. Pourquoi n’inscririons-nous pas, ici, les noms plus ou moins pittoresques de ces humbles villages, qui ont du moins le privilège d’être épars autour de la sainte colline : Ce sont Beaulieu, Les Caves, Beaumard, Malabri, La Moriçais, La Salmonais-de-Pie, Epars, La Madeleine, le Sabot-d’Or.
+
Depuis les fêtes de Pâques, il s’est passé peu de jours sans que le R. P. Directeur du Pèlerinage n’ait eu de l’aide pour extraire les gros blocs de quartz qui doivent entrer dans la construction de la grotte, et pour en amener un certain nombre sur le chantier. On comprend que c’était le travail exigé pendant ce mois, afin qu’au moment de la reprise de la construction on eût tous les matériaux sous la main, n’ayant plus qu’à choisir et à mettre en place.
Ce travail, du moins le travail d’extraction, ne demandait pas un grand nombre de bras. Aussi, le R. P. Directeur se contentait-il de convoquer un, deux ou trois villages. Un jour, c’étaient les hommes du Buisson-Rond, village de la paroisse de Saint-Guillaume ; un autre jour, ceux du village de la Cossonnais, de la paroisse de Crossac ; le lendemain, les travailleurs viennent des villages de Travers, de la Buronnerie, de la Poitevinerie, en Sainte-Reine ; à deux jours de distance, ce sont les hommes de Coimeux et de la Basinais, de la paroisse de Crossac.
Enfin, le vendredi 19 avril, les villages de Lornais, de Bosla, de la Haie, également de la paroisse de Crossac, ont envoyé une escouade plus nombreuse. Le R. P. Directeur en profite pour faire transporter un certain nombre des blocs déjà extraits, jusqu’au chantier.
Honneur à tous ces braves, qui, plus d’une fois, nous assure-t-on, ont dû quitter des travaux pressants, pour répondre à l’appel qui leur était fait. Le Bienheureux Montfort ne peut manquer de leur en tenir bon compte.
+
Entre temps, un groupe de jeunes filles do l’Ouvroir Saint-Similien de Nantes, dirigé par les Sœurs de la Sagesse, venait faire, ici, un pieux pèlerinage. Elles témoignent le désir de conquérir le titre de travailleuses volontaires du Calvaire. On ne pouvait leur refuser cette faveur. Bien qu’habituées à manier des instruments plus légers, elles mettent joyeusement la main à la chaîne. La pierre, une fois chargée, on peut voir le traineau s’ébranler, puis bientôt marcher vers le but à toute vitesse. Elles auront leurs deux pierres, dans la construction de la Grotte de Bethléem.
N° 9 Juin 1901
Travaux de Bethléem
Dans le courant de ce mois, ces travaux ont fait un grand pas et l’on peut heureusement prévoir leur achèvement dans un bref délai. Pour obtenir ce résultat, il faut dire tout d’abord que le R. P. Directeur du Pèlerinage, selon son habitude, s’est dépensé sans mesure. De son côté, M. Gerbaud a montré un dévouement, un courage au-dessus de tout éloge. Bien que légèrement indisposé et souffrant, c’est à peine s’il a quitté par moment, le chantier, pour y reparaître au plus vite.
Ils ont, du reste, été secondés par la générosité des travailleurs et travailleuses volontaires, qui malgré bien des obstacles qu’il est facile de deviner, dans la saison où nous sommes, ont répondu à l’appel qui leur a été fait.
+
Généralement, les hommes sont venus par petits groupes, ainsi qu’on le demandait, le travail à faire n’étant pas de nature à occuper en même temps un grand nombre de bras. C’est ainsi que nous sont venus par groupes un peu plus ou un peu moins nombreux des travailleurs de Limmerzel, de Saint-Omer, de Saint-Guillaume, de Donges, de Théhillac, de Pontchâteau, de Crossac, de Missillac, de Ste-Reine, de Sévérac.
Il faut mentionner à part la journée des hommes de Marzan. Ce jour-là, c’était vraiment un de ces beaux bataillons de travailleurs que nous avons vu plus d’une fois sur notre lande. Il y avait précisément, à ce moment, un travail pour occuper tous les bras, et la journée a été des meilleures.
+
Dans ce même mois, quatre journées ont été réservées aux travailleuses. Les paroisses d’où elles sont venues sont : Saint-Roch, Crossac, Herbignac et Férel. La bonne petite paroisse de Saint-Roch ne pouvait fournir qu’un petit nombre; mais de Crossac, d’Herbignac, de Férel surtout, combien nombreuses et vaillantes en même temps !
Pour tout bien résumer sur ce point, qu’il nous suffise de dire que, comme par le passé, travailleurs et travailleuses ont rivalisé de bonne volonté, de courage et d’énergie au travail.
C’est aussi un devoir pour nous d’ajouter qu’un bon nombre des prêtres des paroisses convoquées ont bien voulu encourager leurs paroissiens par leur présence, et donner, on même temps à notre Œuvre cette marque de sympathie. C’est ainsi qu’au cours de ce mois, nous avons eu l’avantage et le plaisir de voir MM. les Curés de Férel, de Limmerzel, de Saint-Omer, de Crossac, de Sévérac, et MM. les vicaires de Marzan, de Crossac, de Donges.
N° 10 Juillet 1901
La Grotte de Bethléem
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer à nos lecteurs que les travaux de construction de notre Grotte de Bethléem sont heureusement achevés. Les dernières pierres de la voûte ayant été scellées, l’intérieur a pu être complètement dégagé, et l’on peut y pénétrer en assurance. Dès le dimanche 23 juin et le lundi 24, les nombreux pèlerins qui ont suivi la procession ordinaire aux sanctuaires, y ont entendu sur la place des explications intéressantes, la désignation du lieu de la Nativité, et de l’emplacement où était la sainte Crèche, avant d’être transportée à sainte Marie majeure. La Grotte est assez vaste pour que deux cents personnes en se pressant un peu et s’y tenant debout, puissent entendre celui qui parle. Quand nous disons que les travaux de construction sont achevés, nous ne voulons pas dire qu’il ne reste plus rien à faire.
A l’extérieur, un premier travail de dégagement, de déblaiement est tout à fait urgent ; il fera mieux ressortir les premières assises du monument. Le sommet aussi n’a pas reçu son couronnement définitif, qui lui donnera, d’une manière plus parfaite, l’aspect d’une roche naturelle. Enfin, il y aura à tracer et à planter une espèce de square, qui entourera de verdure le nouveau sanctuaire.
A l’intérieur, la représentation des Augustes personnes qui sanctifièrent de leur présence la Grotte de Bethléem, se fera encore quelque temps attendre. La commande en est faite et l’on espère qu’elle sera artistement soignée. Il y a aussi à élever un petit autel, à la place désignée comme étant le lieu même de la naissance du Divin Sauveur, et sur lequel pourra être offert le saint Sacrifice de la Messe.
IL n’y a pas encore de jour fixé pour l’inauguration et la bénédiction du nouveau sanctuaire. Cette fête aura lieu certainement avant la fin de l’été. Mais, nous pouvons dire que dès maintenant, notre Grotte de Bethléem telle qu’elle est, compte parmi les pieuses attractions du Pèlerinage au Calvaire du Bienheureux Montfort.
N° 11 Août 1901
Notre Bethléem du Calvaire
Un mot seulement de notre Bethléem du Calvaire. M. Gerbaud est présent depuis trois jours, et met la dernière main à l’aménagement de cette copie fidèle du Bethléem de Juda.
Çà et là, il y avait quelques irrégularités aux parois ou à la voûte. On vient de les faire disparaître. La petite colonne monolithe qui se dresse près de la crèche demandait à être reliée à la voûte par un semblant de chapiteau. C’est fait et bien réussi.
En même temps, on fabriquait en bois de bouleau brut les cadres des deux portes d’entrée et de la petite baie qui donne jour sur la crèche. Il n’y a plus qu’à les foncer de paille ou de roseaux pour qu’elles aient tout à la fois le cachet rustique et artistique qui convient.
Le petit autel traditionnel que l’on voit à Bethléem au lieu même de la naissance, vient aussi d’être mis en place.
Il reste, sans doute, quelques déblais et remblais à faire à l’extérieur, mais qui ne présentent pas de difficultés et seront terminés sous peu.
Seule, l’incertitude au sujet du temps nécessaire à l’artiste chargé de l’exécution de la Sainte Famille, empêche de fixer définitivement le jour de l’inauguration du pieux monument.
N° 12 Septembre 1901
Une visite au Calvaire
Nouveau Pèlerin de Pontchâteau, vous avez lu que le Calvaire occupait le sommet d’une vaste lande, fleurie de genêts et d’ajoncs dorés; mais ce désert pierreux et les maigres plantes qui l’égayaient un peu, ne sont plus qu’un souvenir. Du haut du chemin, où l’étonnement vous tient un instant immobile, vous voyez à gauche une colline imposante, surmontée de trois croix et peuplée de statues ; au fond, vous découvrez la gracieuse église ogivale du Pèlerinage, encadrée par les demeures sombres où des prêtres, de jeunes élèves, des religieuses travaillent, chacun à leur façon, à la gloire de Dieu et de Montfort. Enfin, à votre gauche, vous apercevez, semées dans les champs, au milieu des arbres, quelques grottes et des constructions d’un cachet exotique qui mêlent à la verdure leurs masses blanches et grises.
Suivez, cher Pèlerin, la route poudreuse qui descend devant vous et entrez dans l’église. Après une courte prière nous allons, de compagnie, parcourir ce coin de terre sacré. Adorons d’abord Notre-Seigneur Jésus-Christ, enfermé par amour pour nous dans le tabernacle ; car, il nous faut reconnaître que cette chapelle, fraiche et gentille, est bien pauvre, comparée à son paradis. Demandons au bon Maître les sentiments de piété et de contrition, nécessaires pour faire avec fruit notre pèlerinage. Mettons-nous aussi un instant à genoux devant l’image du Bienheureux de Montfort afin qu’il nous pénètre de son esprit et de sa dévotion envers Jésus et Marie.
Venez à présent, cher compagnon, nous allons commencer par visiter les mystères joyeux du Rosaire. Tournons à droite, devant ce jardinet tout riant de fleurs ; c’est l’enclos de la sainte Vierge : cette petite maison carrée au toit plat, à la fenêtre étroite, c’est son habitation de Nazareth. Franchissons le seuil de cet humble appartement où le Verbe, fils de Dieu, a daigné se faire homme. Voyez, Marie est assise, comme en extase, ses doigts ont abandonné la quenouille qui gît près d’elle ; un grand lis, emblème de pureté, tourne vers la jeune fille sa corolle immaculée. En face, un ange paraît, les pieds sur un nuage : c’est Gabriel qui vient demander à Marie si elle veut être la Mère du Messie tant désiré. Devant cette touchante scène, disons merci à Dieu d’avoir envoyé son Fils sur la terre pour réparer nos offenses, et félicitons Marie d’avoir été choisie pour mettre au monde le Rédempteur. Jetons un coup d’œil rapide sur la disposition de la maisonnette: cette armoire, au coin, devait contenir les ustensiles de ménage de la sainte Famille ; cette porte, au milieu, donne accès à la petite grotte qui, en Palestine, sert de cave, et dont Joseph fit peut-être son atelier.
Dirigeons maintenant nos pas, cher Pèlerin, vers le Sanctuaire, coiffé d’une coupole blanche, qui émerge près d’ici entre deux touffes de sapins. Il représente la maison de saint Zacharie à Hébron, et il a été témoin du mystère de la Visitation. La chambre intérieure est carrée avec une voûte arrondie comme une « kouba » arabe. Sur l’autel, deux statues représentent la sainte Vierge et saint Elisabeth, au moment où celle-ci dit à sa cousine : « Vous êtes bénie entre toutes les femmes » et où Marie répond : « Mon âme glorifie le Seigneur… Magnificat… » Vous savez qu’à cet instant, saint Jean-Baptiste, encore enfermé dans le sein maternel, fut purifié du péché originel pour devenir un digne précurseur de Jésus. Supplions la Mère de Dieu de nous inspirer envers notre prochain la charité qu’elle a témoignée à sainte Elisabeth.
Suivons le chemin jusqu’au bout, bon Pèlerin ; il nous mène à l’établissement de Bethléem. Ici, la grotte n’a pas été creusée dans le Calvaire, elle a été construite avec de belles pierres ; lorsque les plantes l’auront couverte et entourée de leurs tiges verdoyantes, elle présentera un aspect délicieux. L’intérieur, dans sa forme et ses dimensions, reproduit exactement le premier abri du Sauveur en Judée. L’enfoncement où l’autel est placé marque le lieu même de la naissance de Notre-Seigneur. Sur le banc de pierre, dans l’autre excavation, en face de la fenêtre, était posée la crèche où reposait l’Enfant Dieu. A la tête de ce berceau improvisé, Marie était assise, et elle devait montrer son Fils aux bergers et aux Mages, comme elle le montrera bientôt ici aux pieux visiteurs. Saint Joseph, debout, contemplera dans une douce méditation Jésus et sa Mère. La pauvreté de ce gite émeut profondément notre cœur, demandons ensemble, cher Pèlerin, à notre divin Maître un détachement sincère des biens et des aises de ce monde ; qu’il nous fasse la grâce d’accepter avec résignation, ajoutons avec joie, les dépouillements que nous pourrons avoir à supporter.
Quittons le réduit de Bethléem par la petite porte, près de l’autel. Dans l’allée spacieuse qui s’ouvre devant nous, le temple de Jérusalem se dressera, précédé de son portique ; dans son enceinte seront représentés les mystères de la Présentation et du Recouvrement de Jésus.
Le pont du Cédron, que nous traversons à présent, nous introduit dans le lieu où, pour faire suite aux mystères joyeux, sont représentés les mystères douloureux de la vie du Sauveur. Le torrent qui passe sous le pont, comme tous les torrents des pays chauds, est ordinairement à sec ; l’eau n’y coule qu’à l’époque des grandes pluies. Il sert de limite au jardin de Gethsémani; mais dans ce lieu ne cherchez pas les oliviers, ils ont été remplacés par des cèdres, des sapins, des ioukas, des sycomores qui, avec la vigne, contribuent à donner à ce coin un cachet oriental. Pénétrons dans la grotte, environnée d’une demi-obscurité. Notre-Seigneur parait affaissé sur lui-même, anéanti par son agonie sanglante et la vue des tourments que sa passion lui réserve ; un ange, devant, lui cherche à consoler et à réconforter son Créateur. Oh ! l’admirable leçon qui nous est ici donnée par Jésus ! Il se montre brisé par la souffrance comme nous-mêmes croyons l’être parfois ; mais il se garde bien de murmurer ; après avoir humblement demandé trois fois à son Père que le calice de douleur s’éloigne de lui, il termine sa prière par ces généreuses paroles « Mon Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse ! »
Abandonnons, cher Pèlerin, ce sanctuaire touchant pour suivre les pas du divin Maître jusqu’au Calvaire. Ces trois pierres, à votre gauche, servirent d’oreillers (si elles méritent ce nom) aux apôtres qui dormaient pendant que le Sauveur agonisait. Cet autre rocher marque l’endroit où le perfide Judas trahit son Dieu par un baiser. Enfonçons-nous à droite dans cet étroit sentier ; il a nom : Chemin de la Captivité : Notre-Seigneur y fut conduit, garrotté, par ses bourreaux. Il nous faut franchir de nouveau le Cédron, mais à gué cette fois. Jésus, mettant le pied sur ces pierres, fut poussé par un de ses gardes et tomba la face dans le torrent ; il accomplissait ainsi la prophétie de son ancêtre David : « Il boira dans sa course de l’eau du torrent. »
C’est maintenant vers ce somptueux portique corinthien que nous marchons. Il représente le prétoire de Pilate, ou si vous préférez, la galerie qui précédait la maison de ce magistrat, et sous laquelle il rendait la justice. On accède à ce tribunal, par un escalier construit sur le modèle de la véritable Scala Sancta et que, comme elle, on ne gravit qu’à genoux. De nombreuses indulgences sont attachées à ce pieux exercice. La première station du Chemin de la Croix se trouve là-haut : Jésus parait devant le proconsul romain. L’attitude calme et digne du Seigneur contraste avec l’air embarrassé de son juge, qui n’aime pas commettre une injustice, mais craint beaucoup plus de perdre sa place. Il a beau demander de l’eau à son jeune esclave, tout le contenu de son aiguière n’effacera pas la tache de sang qui souille ses mains. Le magnifique bas-relief, à droite, représente le supplice de la Flagellation. Sous les traits des bourreaux, les péchés capitaux viennent tous tourmenter le Sauveur. Les autres arcades attendent différentes scènes de la Passion : le couronnement d’épines, etc.
Sur le Prétoire, aux jours de grand pèlerinage, le Saint-Sacrifice est offert, et il n’est pas de plus beau spectacle que de voir, en bas, la foule attentive et recueillie sous les chauds rayons du soleil comme sous les froides gouttelettes de pluie.
Suivons, cher pèlerin, la voie douloureuse qui, du tribunal de Pilate, nous conduit au Calvaire. Tout en priant admirez la beauté expressive des statues qui s’y trouvent rassemblées ; vous remarquerez sans doute qu’il reste beaucoup de vides dans les divers groupes ; l’admirable générosité des fidèles se réserve le pieux honneur de les compléter.
Nous voici au Calvaire. Notre-Seigneur a dit dans l’Evangile que la foi transporte les montagnes ; sur la lande de la Madeleine, la loi a élevé une montagne. Les bras vigoureux d’innombrables travailleurs volontaires ont arraché du sol et entassé les uns sur les autres ces blocs énormes qui portent bien haut dans les airs la croix du Sauveur. C’est un Credo, chanté avec des pierres, un hymne à Jésus crucifié, ciselé avec moins d’art que nos vieilles cathédrales, mais qui a demandé autant de foi, de sacrifices et de dévouement. A l’œuvre de leurs mains, beaucoup de chrétiens viennent, le dimanche, ajouter le témoignage de leurs voix et, enflammés par les brûlantes exhortations de notre vénéré Directeur, acclamer Notre-Seigneur, sa croix, sa religion. Soyez assuré, pieux pèlerin, que les anges comptent les larmes de repentir et d’amour, les gouttes de sueur qui sont ici répandues, et que, plus tard, ils les changeront en précieux diamants pour orner la couronne impérissable de ceux qui les ont versées. Le Calvaire est une source abondante de grâces. Le Sauveur mourant y parle au cœur avec une force plus pénétrante, et excite davantage en lui l’horreur du péché ; le bon larron, du haut de son gibet, proche plus éloquemment l’immensité de la miséricorde divine ; et la vue de ce criminel impénitent qui, dans un effort hideux, expire le dos tourné à son Rédempteur, indique mieux la folie et l’orgueil de ceux qui sortent de ce monde en désespérés. Ne quittez pas cette sainte colline, sans contempler le paysage merveilleux qui s’étend autour d’elle. Depuis la Loire qui se déroule là-bas comme un ruban d’argent jusqu’aux coteaux de Fégréac, et à la flèche élancée de Férel, comptez les clochers qui se groupent comme de fidèles vassaux au pied du trône de leur Souverain. Leur ombre couvre des familles qui, depuis les Missions prêchées par Montfort, viennent de génération en génération travailler et prier au Calvaire. Dieu, à ces âmes dévouées, accordes-en ce monde le don d’une foi ferme, en attendant la récompense éternelle.
Achevons, cher pèlerin, notre visite des Saints Lieux par une descente au Sépulcre du Sauveur : dans l’excavation qui précède la chambre mortuaire, se tenait l’Ange qui apprit aux saintes femmes la Résurrection de Jésus.
Venez aussi, avant de vous éloigner de cette terre bénie, vénérer le beau Christ que Montfort fit sculpter pour son premier Calvaire. Il repose dans la pauvre chapelle, devant la sainte montagne. Longtemps il fut caché à Pontchâteau dans une maison particulière, puis emmené à Nantes et à Saint-Laurent. Aujourd’hui, il reçoit les hommages et les adorations de tous les pèlerins, et, dans les grandes solennités, les hommes de bonne volonté le portent en procession sur un lit d’honneur, richement orné.
Pour vous montrer l’œuvre complète du Bienheureux, il faudrait vous guider aux chapelles qui renferment les Mystères glorieux ; mais celles-ci n’existent pas encore, et la persécution ne sera pas un obstacle insurmontable à leur construction. Car rien ne peut entraver l’œuvre de Dieu.
La Grotte de Bethléem
La grotte de Bethléem est définitivement terminée. Il ne reste plus à faire aux alentours que quelques déblais, remblais et plantations qui n’offrent pas de difficultés sérieuses. Les statues sont encore attendues; mais nous espérons bien pouvoir annoncer, sur le prochain numéro, la date fixée pour la bénédiction solennelle de cette grotte qui excite l’admiration de tous.
N° 1 Octobre 1901
Au Calvaire
Nous n’avons guère de travaux à consigner, en ce mois. On a pourtant achevé, derrière la grotte de la Nativité, le remblai qui, maintenant, la fait paraître adossée à une colline.
Nous avertissons nos lecteurs que, par suite de l’incertitude des temps que nous traversons, la bénédiction de cette grotte est ajournée indéfiniment.
N° 3 Décembre 1901
Au Calvaire
Mais, auparavant, nos lecteurs apprendront avec plaisir, comme nous avons appris avec plaisir nous-même, qu’on n’y est pas inactif, et qu’on y travaille toujours à l’embellissement de notre lande. Sans doute, il ne s’agit plus des grands travaux d’autrefois. On ne bâtit pas, mais on plante.
Personne n’ignore que, sur ce point, il y avait et il reste encore beaucoup à faire sur la lande de la Madeleine. On s’en aperçoit d’autant mieux quand comme nous, on a quitté le Calvaire pour venir dans une solitude où les frais ombrages abondent. Mais, il faut bien savoir attendre.
Bref la Grotte de Bethléem jusque-là toute nue, a, déjà, d’après les renseignements que nous recevons une couronne verdoyante formée de lauriers-palmes. Sur les côtés, et en arrière les arbres de diverses essences et quelques arbustes lui feront, au printemps, un bel encadrement. C’est bien ainsi qu’on se représente aux portes de la vraie Bethléem, la sainte Grotte de la Nativité.
Les arbres plantés le long de la voie douloureuse lui donnaient déjà quelque ombrage, mais elle apparaissait bien dénudée surtout après la chute des feuilles. Là aussi des lauriers-palmes plantés en bordure, du moins dans la partie supérieure, ne peuvent manquer de produire un bel effet.
C’est ce qui nous est signalé pour le moment, mais nous supposons bien qu’on ne s’en tiendra pas là. Çà et là, nous le savons, dans les grandes allées, la gelée ou la sécheresse ont fait des vides qui sont à combler. Et puis dans un si vaste espace, il y a toujours place pour quelques plants nouveaux. Puisse le vent du Nord qui souffle, en ce moment même, bien violent et bien froid ne leur être pas trop funeste !
N° 4 Janvier 1902
Au Calvaire
Ecrivant ces lignes à la veille de la grande fêle de Noël, comment notre pensée ne se reporterait-elle pas vers cette grotte de Bethléem que nous avons vu surgir de terre, et s’achever si promptement, grâce au dévouement des travailleurs volontaires.
Elle est si bien préparée pour mettre sous les yeux le grand mystère que l’Ange envoyé du Ciel aux bergers, proclame lui-même la grande joie du monde, gaudium magnum.
Notre-Dame de Toute-Joie, dont nous venons de parler, ne peut manquer de hâter l’inauguration d’un sanctuaire qui doit lui être cher entre tous. Et elle sera de la fête. En attendant, on ne cesse pas de travailler à l’embellissement sur le terrain d’alentour. En réalité, notre Grotte de Bethléem est située à peu près au centre du pèlerinage, presque à égale distance du Prétoire et du Calvaire. Plusieurs allées y aboutissaient sans se rejoindre. On est parvenu, nous dit-on, à faire le raccordement.
Dans les intervalles, on a ménagé, planté divers bosquets. Et autant qu’il est permis d’en juger de loin, l’ensemble devra présenter un coup d’œil satisfaisant.
Viennent les beaux jours, et, nous redirons ave joie à tous nos lecteurs la parole des pieux bergers : Allons jusqu’à Bethléem : Transeamus usque Bethléem ! El la lande de la Madeleine verra une fois de plus une de ces grandes manifestations religieuses, qui laissent dans tous les cœurs les meilleurs, les plus réconfortants souvenirs.
N° 6 Mars 1902
Quelques embellissements du Pèlerinage
On se souvient peut-être que nous avons mentionné, ici, le regret exprimé par plusieurs, de voir disparaître la couronne de verdure représentant le Rosaire autour du Calvaire, et formée par 150 cyprès, séparés de dix en dix par des ifs. Nous faisions observer qu’après l’expérience faite, il paraissait impossible de la conserver, à cause des vents de mer.
Mais voici qu’on reprend l’idée, et qu’on en commence l’exécution dans des conditions meilleures, et nous le supposons bien, à la satisfaction de tous. Au Calvaire, les arbres représentant les Ave étaient tout rapprochés l’un de l’autre, se touchaient pour ainsi dire, et en trois pas on avait parcouru une dizaine.
Il n’en sera plus ainsi. Les arbres verts représentant les Ave seront espacés sur tout le parcours qu’il faut suivre pour visiter les différents sanctuaires consacrés au Rosaire. Ainsi, dix arbres verts plantés à égale distance de la Maison de Nazareth à la Maison de sainte Elisabeth, marqueront les Ave de la première dizaine. Puis, dix arbres verts encore, de la Maison de sainte Elisabeth à la Grotte de Bethléem, et ainsi de suite, sur tout le parcours. Les sanctuaires eux-mêmes compteraient pour le Gloria Patri. Et comme la distance entre les divers sanctuaires est à peu près celle que l’on peut parcourir, à pas lents, en récitant une dizaine, il nous semble que ce sera le Rosaire verdoyant, aussi bien réussi qu’on pouvait le rêver.
+
Nous venons de nommer la Grotte de Bethléem. Le R. Directeur du Pèlerinage parait décidé à y placer le beau groupe de la Nativité, aux fêtes de Pâques. Il s’occupe, en ce moment, des derniers embellissements qu’elle comporte, notamment des portes et fenêtre rustiques qui, jusqu’à présent, n’étaient pas closes et donnaient trop d’entrée à la pluie et au vent.
Mais il nous fait entendre, en même temps, qu’il ne prévoit point encore quand il lui sera permis d’organiser une grande fête pour l’inauguration et la bénédiction de ce pieux monument.
N° 7 Avril 1902
Bénédiction de la Grotte de Bethléem
La bénédiction de la Grotte de Bethléem, au Calvaire de Pontchâteau, aura lieu le Mardi de Pâques, 1er avril.
La cérémonie commencera à 10 heures.
Allocution, par M. le chanoine Cerisier, missionnaire diocésain de Nantes.
Bénédiction de la Grotte et des statues formant le groupe de la Nativité, par M. le curé-doyen de Pontchâteau.
Messe à l’autel de la Grotte.
A 1 h. 1 2. Chemin de la Croix, avec prédication.
Salut du Très Saint Sacrement à la chapelle du Pèlerinage.
†
En nous annonçant que cette belle cérémonie est définitivement fixée an Mardi de Pâques, le R. Directeur du pèlerinage nous dit que le clergé et les fidèles de Pontchâteau et des paroisses voisines assisteront en grand nombre à cette fête.
Il nous témoigne aussi le désir que l’Ami de la Croix paraisse un peu plus tôt que d’ordinaire, afin que l’annonce parvienne à temps à nos lecteurs. Chaque année, aux Fêtes de Pâques, l’affluence des pèlerins au Calvaire du Bienheureux Montfort est considérable. Cette année, il y aura une attraction de plus, qui ne peut manquer d’en attirer un grand nombre.
†
Au dire de notre correspondant, rien ne manquera plus désormais au pieux monument pour que ceux qui n’ont pas le bonheur de faire le pèlerinage des Saints Lieux, aient sous les yeux une représentation aussi exacte que possible du Lieu Saint entre tous de la naissance du divin Sauveur.
On sait quel soin y a mis l’excellent Directeur des travaux du Calvaire, M. Gerbaud, lorsqu’il s’est agi de la construction elle-même.
Non content de ses souvenirs de pèlerin de Terre Sainte, il a voulu tout vérifier, et prendre exactement toutes les dimensions sur une copie très fidèle de la sainte grotte qui existe en Normandie, depuis environ deux-cents ans.
Le même soin a été apporté aux divers détails d’aménagement, ou, si l’on veut, d’ornementation.
Laissons ici parler notre correspondant qui nous écrivait à la date du 25 février.
« Nous avons eu hier une journée pleine de consolation et de joie.
C’était le jour fixé pour l’achèvement des portes de notre grotte de Bethléem.
Dans la craint de manquer le premier train, M. Gerbaud était debout dès trois heures du matin, et il nous arrivait aussi heureux qu’autrefois les Mages en arrivant à Bethléem. Comme eux il apportait son présent à l’Enfant Jésus.
A Bethléem, le lieu de la naissance de Notre-Seigneur est marqué par une étoile aux rayons argentés, avec de petites boules d’or aux extrémités. Autour du noyau de l’étoile, entre deux cercles d’or on lit celle inscription : Hic Christus natus est de Virgine Maria. (Ici, le Christ est né de la Vierge Marie).
C’est cette étoile que M. Gerbaud a fait reproduire exactement et qu’il venait offrir à l’Enfant Jésus. Elle mesure avec ses rayons, 60 centimètres de diamètre. Le noyau nous servira de reliquaire. Nous y mettrons une petite pierre détachée des parois de la vraie grotte de Bethléem que nous devons, vous le savez, au R. P. Jérôme, ancien vicaire custodiate de Terre Sainte.
Comme à Bethléem, notre étoile est fixée sur le sol au-dessous de l’autel de la Nativité.
Rappelons en passant qu’à Bethléem même, il n’est plus permis aux prêtres catholiques de célébrer la sainte messe à cet autel de la Nativité. C’est un droit, entre bien d’autres, qu’à force d’intrigues les Grecs schismatiques sont parvenus à enlever aux catholiques, en se le faisant arroger à eux seuls par le gouvernement turc.
C’est à cet autel, aujourd’hui placé dans la grotte du Calvaire, et imitant aussi bien que possible celui de Bethléem, que la messe sera dite le jour de la fête prochaine.
Mais, reprenons le récit de notre correspondant sur la journée du 24 février.
« Presqu’en même temps que M. Gerbaud, arrivait de son côté, notre brave Mayennais1.
Il s’est mis bien vite à l’œuvre. Les roseaux sont fixés verticalement à l’intérieur, de façon à laisser paraître à l’extérieur les montants et les grosses traverses en bouleau brut. Ils sont maintenus par d’autres petites traverses rattachées par des fils de fer.
Ce sont vraiment bien les portes d’une étable.
Vers le milieu du jour, nous nous apercevons que les roseaux vont, manquer. Bien vite, on dépêche un exprès à Mayun. A 6 heures, le travail était complètement achevé.
Je demandai alors à notre artiste de combien je lui étais redevable. Mais, lui : « Je suis venu bien des fois travailler au Calvaire, me dit-il, je n’y ai jamais travaillé pour de l’argent. Ce n’est pas non plus pour de l’argent que j’y ai travaillé aujourd’hui. — Quant aux roseaux, j’en fais cadeau au bon Père de Montfort. Je ne suis pas riche, mais nous avons encore plus besoin de sa protection et des bénédictions du bon Dieu que d’argent. Vous prierez pour moi et pour ma famille. »
Ce brave chrétien me dit tout cela avec un tel accent de foi, que j’en fus profondément louché. Je lui serrai chaleureusement la main, en lui disant un cordial merci.
Il mérite bien que son nom soit mentionné dans l’Ami de la Croix : « Auguste Bodel, du village de Mayun, en la Chapelle-des-Marais. »
+
D’après une seconde lettre du même correspondant, c’est le mardi 4 mars que le beau groupe de la Nativité ou de la Sainte Famille a pris possession de la Grotte ainsi préparée.
On a posé d’abord la crèche. La vraie crèche de Bethléem, ou du moins, les quelques bouts de planche qui la composaient sont conservés à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, où les pèlerins de la Ville éternelle ne manquent pas d’aller s’agenouiller devant un objet si digne de vénération entre tous ceux qui rappellent la venue et le passage du Dieu Sauveur sur la terre.
L’imitation était facile et n’a pas coûté grand travail. On y a étendu une poignée de paille, et l’Enfant Jésus y est couché, enveloppé de pauvres langes. Marie, la divine Mère, est assise tout près sur un pauvre escabeau. Elle est dans l’attitude qu’elle dut prendre à l’arrivée des bergers dans la Grotte, lorsque ces premiers adorateurs du Dieu fait homme se prosternèrent devant la crèche. Elle soulève doucement le voile dont elle avait couvert son visage adorable, pour qu’ils puissent en contempler les traits. (D’après la photographie que nous venons de recevoir, l’Enfant Jésus est sur les genoux de sa mère.)
Saint Joseph, debout un peu en arrière de sa sainte épouse, le regard fixé sur le divin enfant, semble absorbé dans la contemplation du grand mystère.
L’excellent Directeur du pèlerinage nous écrit que les premiers pèlerins qui, ce jour-là même, pénétrèrent dans la grotte, s’extasiaient devant un si touchant spectacle. L’Enfant Jésus, en particulier, nous dit-il, est d’une beauté ravissante. Ils ne pouvaient en détacher leurs yeux.
+
Nous savons qu’un bon nombre de lecteurs et lectrices de l’Ami de la Croix, des environs du Calvaire, ne se contenteront point de notre description ; et nous les entendrons se dire comme autrefois les pieux bergers : Transeamus usque Bethleem, passons à Bethléem, allons voir nous- mêmes de nos yeux ce qui nous est annoncé.
Pour ceux et celles plus éloignés, qui tout en ayant le même désir n’ont pas la même facilité, nous eussions été heureux de mettre sous leurs yeux les photographies de la grotte de Bethléem sous ses divers aspects, et du groupe de la Sainte Famille.
Les photographies ont été prises, mais l’imprimeur n’aura pas à temps les clichés pour pouvoir les reproduire dans le présent numéro de l’Ami de la Croix.
Ce sera pour le numéro prochain, qui donnera en même temps le compte rendu de la fête qui se prépare au Calvaire.
Chronique du mois
Au cours de ce mois de mars, en dehors de ce qui vient d’être dit sur l’achèvement et l’ornementation de la grotte de Bethléem, nous n’avons guère à signaler d’autre fait au Calvaire de Pontchâteau
Cependant, on a continué, nous assure-t-on, la plantation du rosaire verdoyant, dont nous avons dit un mot le mois dernier.
C’est toujours avec grande satisfaction que nous voyons se faire des plantations nouvelles sur cette lande autrefois si aride. Peu à peu se préparent ainsi des ombrages qui non seulement protégeront les pieux pèlerins contre les rayons trop ardents du soleil d’été, mais donneront aussi à l’ensemble du pèlerinage ce je ne sais quoi de plus mystérieux, qui ne laisse pas que de favoriser la piété.
N° 8 Mai 1902
Bénédiction de la Grotte de Bethléem
Pour donner à nos lecteurs une idée vraie de cette fête, nous ne saurions mieux faire que de transcrire ici notre correspondance du Calvaire.
Elle était à peine terminée, que le vénéré Directeur du Pèlerinage traçait, sous le coup de l’émotion, ces lignes :
« Belle et délicieuse fête, toute parfumée de piété, et qui a ravi, enthousiasmé tous les pèlerins !
A neuf heures, le ciel était couvert de brume, on ne voyait encore arriver personne. J’eus quelques instants d’angoisse.
Mais voici que le soleil se montre, et qu’on arrive de tous côtés.
Notre chapelle se remplit, et nous formons déjà une belle procession en nous rendant à Bethléem.
Toutes les mains se tendent pour avoir le cantique : Allons à Bethléem ! et les 800 exemplaires que j’avais en main sont bientôt épuisés.
De nombreuses mains se tendent encore, et je suis obligé de dire qu’il ne m’en reste plus.
Ce cantique a été chanté avec un entrain admirable. Il est répété vingt fois dans la journée ; et toujours, avec le même enthousiasme, la foule redisait le refrain :
Amour, amour, amour à Jésus !
Que d’actes d’amour exprimés ainsi avec ferveur, dans cette inoubliable journée !
M. le Chanoine Cerisier s’est dépensé sans compter. Il mérite bien les félicitations sincères qui lui ont été adressées.
Combien je regrette que vous n’ayez pas été témoin de cette belle fête !
Tous ceux qui y ont assisté, prêtres et fidèles, en ont été ravis.
Jésus et sa sainte mère, ainsi que notre Bienheureux Père de Montfort, ont dû abaisser des regards satisfaits, durant cette journée, sur la lande de la Madeleine, et bénir affectueusement nos chers pèlerins, qui conserveront de cette fête un précieux et long souvenir. »
+
Voici maintenant, tracés par une autre main, les détails édifiants des diverses cérémonies de cette belle journée du mardi 1er avril.
Avant de commencer son récit, notre correspondant a tenu à faire remarquer que la dernière main avait été mise à l’ornementation de la grotte. C’est pour cela que M. Gerbaud était venu dès la veille, et qu’on l’avait, vu s’employer pendant plusieurs heures de la soirée, à l’humble métier de maçon, pour cimenter horizontalement sous l’autel de la Nativité, l’étoile argentée dont lui-même à fait don, et qui produit un très bel effet dans la grotte.
Mais, venons au récit de la journée :
Il est dix heures, les pèlerins quittent sur deux rangs la chapelle du Pèlerinage et se dirigent vers la Grotte de Bethléem, en chantant le cantique composé pour la circonstance, en l’honneur de la Nativité de Notre-Seigneur.
M. le Curé de Pontchâteau préside la procession : et c’est lui aussi qui, en vertu des pouvoirs accordés par Mgr l’évêque de Nantes, procède à la cérémonie de bénédiction du nouveau sanctuaire.
La foule, massée tout autour, suit avec attention et piété les différents rites, les aspersions, prières liturgiques. Elle s’unit au chant des Litanies des Saints, qui sont tous invoqués pour attirer les bénédictions du Ciel sur l’humble sanctuaire.
Puis, l’officiant revêt la chasuble et célèbre pour la première fois le saint sacrifice dans cette Grotte maintenant dédiée au culte, et qui est une si fidèle représentation de celle de Bethléem.
Ce n’est, pas sans émotion que la foule pieuse assiste à cette descente et immolation du Fils de Dieu fait homme, sur l’autel de l’Etable.
La sainte Messe n’est-elle pas comme une nouvelle venue et naissance de notre cher Sauveur parmi nous, pour nous appliquer les mérites et fruits de sa vie et de sa mort !
Pendant le saint sacrifice, sous la direction du R. P. Cerisier, tous chantent avec piété divers cantiques : Allons à Bethléem ! Que j’aime ce divin Enfant… O l’Auguste Sacrement ! et encore Les Anges dans nos campagnes, qui a pour refrain : Gloria in excelsis Deo.
N’est-ce pas avec un à-propos véritable, que retentissent en ce moment, répétées par tout le peuple, ces paroles autrefois chantées à Bethléem par les Anges : Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Après la sainte Messe, tous se rendent processionnellement à la Scala Sancta, pour entendre le discours du R. P. Cerisier. Il a vraiment devant lui un bel auditoire.
Après un heureux rapprochement entre les mystères de la passion et de la résurrection et celui de la naissance, le Révérend Père expose avec éloquence, dans des aperçus larges et élevés : -1° les raisons providentielles du choix de la Grotte de Bethléem, comme lieu de la naissance du Fils de Dieu fait homme. 2° puis les différentes scènes dans lesquelles s’est déroulé le mystère. Il les peint d’une façon si nette et si saisissante, que tous se les représentent aisément, 3° enfin, il dégage les leçons de haute portée morale que Notre-Seigneur a voulu nous donner en apparaissant en ce monde dans de telles circonstances : leçon d’humilité, contre l’orgueil de la vie, leçon de pauvreté et de détachement contre la cupidité, leçon de mortification, contre la soif insatiable de jouissances.
Ce, discours, donné avec une chaleur communicative, impressionne vivement le sympathique auditoire que redit avec enthousiasme les acclamations que l’orateur lui demande en terminant.
On revient en procession à la Chapelle du Pèlerinage.
Au repas qui suit, M. le Directeur du Calvaire remercie cordialement M. le Curé de Pontchâteau, M. Gerbaud, le R. P. Prédicateur et ces Messieurs du clergé de la contrée, qui ont contribué chacun à leur manière, au succès de la fête de ce jour.
Le R. P. Cerisier fait, amende honorable à M. Gerbaud de n’avoir pas mentionné dans son discours son dévouement et son succès dans la représentation du troisième mystère joyeux, et félicite M. le Directeur du Calvaire de sa persévérante ténacité.
A 1 h. 1/ 2. Chemin de croix solennel, prêché par le R. P. Cerisier. Un millier de fidèles au moins y assistent avec un nombreux clergé.
Avant de le commencer, le Révérend Père fait réciter une prière pour M. Gerbaud, qui a mis tant de dévouement et d’habileté dans la direction des travaux de la Grotte de Bethléem, et pour l’infatigable Directeur de l’Œuvre gigantesque du Calvaire.
Aux différentes stations, le R. P. Prédicateur unit très heureusement la pensée des scènes douloureuses à celle de la Résurrection de Notre-Seigneur, et en tire des leçons et applications très opportunes pour les âmes ressuscitées à la grâce, dans les jours des fêtes pascales.
Le Salut solennel du Très saint Sacrement clôt cette cérémonie du soir.
L’impression générale, et je parle surtout de Messieurs les ecclésiastiques, est que cette fête a été particulièrement pieuse, recueillie, édifiante.
Le groupe de la Nativité de Notre-Seigneur attire, édifie les fidèles, et continuera de les attirer en grand nombre et de les édifier. »
1Mayun est un gros village de la paroisse de la Chapelle-des-Marais. Bon nombre de ceux qui l’habitent gagnent leur vie à tresser des ruches, des paniers. Ils passent aussi pour très habiles à faire des couvertures imperméables en chaume ou en roseau.
N° 6 Mars 1903
Chronique
Le mercredi 4, nous avions des travailleurs Volontaires. Ce jour-là encore, notre Bienheureux Père de Montfort a dû abaisser des regards de particulière satisfaction sur son Calvaire de Pontchâteau. A notre appel, nos bons voisins des Villages de Quémené, la Brionnière, la Monderais et Riom en Crossac, toujours si dévoués, sont venus avec empressement donner du labour aux arbustes des plates-bandes de nos avenues. Toutes les maisons étaient représentées.
Le travail a été ce qu’on doit attendre d’hommes dont le seul but est de mériter la protection du P. de Montfort. Ils ont été très heureux de voir leur cher et vénéré Pasteur venir leur adresser ses félicitations et ses encouragements. La journée, commencée par l’offrande du travail à Jésus dans la grotte de Bethléem, s’est terminée par le Salut du Très Saint Sacrement. Les hommes de Crossac chantent nos cantiques avec un admirable entrain.
Aussi dès le matin, prête-t-on l’oreille au loin et se plaît-on à écouter ces voix mâles qui expriment leur foi avec tant d’énergie.
Le mercredi 11 février est encore une belle journée de travail. Le dévoué M. l’abbé Guibert, curé de Crossac, a dû être heureux de constater ce jour-là encore, combien ses chers paroissiens sont dociles à la voix de leur bien-aimé Pasteur. Ils étaient nombreux à continuer le travail commencé par leurs compatriotes la semaine précédente. Cette journée, parfaite comme celle du 4, ne peut manquer de valoir à la paroisse de Crossac la particulière protection du Bienheureux de Montfort.
Du lieu de la Présentation
Dans le désir de reproduire au naturel les scènes de la Présentation et du Recouvrement, nous nous sommes demandé dans quelle partie du Temple ces mystères se sont accomplis. Nous nous sommes rangés d’abord à l’avis du chanoine Wéber. D’après lui, ces scènes ont eu lieu dans les salles qui se trouvaient sur les côtés du Parvis des Israélites. Nous aurions été heureux de savoir aussi quelle était la forme de ces salles, quelle était leur situation respective.
N’ayant rien trouvé à ce sujet, nous primes le parti d’écrire à M. l’Abbé Vigouroux, professeur d’Ecriture sainte au Séminaire de Saint-Sulpice, appelé depuis par Léon XIII à faire partie de la commission biblique, dont il vient d’être nommé secrétaire. Nous demandions en même temps au savant Sulpicien de vouloir bien nous donner son avis sur la manière dont nous pensions reproduire les scènes de la Présentation et du Recouvrement,
Voici sa réponse :
Séminaire de St-Sulpice, 16 novembre 1902.
Mon Révérend Père,
« Je ne puis, à mon grand regret, répondre pertinemment à vos questions et je ne crois pas qu’il existe des textes et des documents qui permettent d’y répondre. Il n’y a donc aucun moyen de reproduire d’une manière rigoureusement historique la scène de la Présentation et celle du Recouvrement, et par conséquent vous avez plus de liberté pour tout disposer selon ce qui vous paraîtra préférable.
« Voici ce qui me paraît, pour ma part, le plus probable. La Présentation ne dût pas avoir lieu dans une salle, mais dans les parvis du Temple, à la Porte de Nicanor ou de l’Est, qui était réservée à cette cérémonie. D’après la tradition juive, c’est là que la Sainte Vierge dût être reçue par le prêtre de semaine et faire son offrande. Vous pouvez mettre les personnages que vous indiquez. On y met ordinairement le grand-prêtre, et rien n’empêche que vous le fassiez, mais c’était le prêtre de service pour la semaine qui était chargé de la fonction.
« Quant à la salle du Recouvrement, vous pouvez la représenter comme vous le jugerez à propos. On ne connaît des salles annexées au Temple que les noms donnés par le Talmud ».
Que M. l’abbé Vigouroux reçoive tous nos remerciements ! Les précieux renseignements de l’éminent professeur seront notre règle dans la reproduction des scènes de la Présentation et Recouvrement.
N° 7 Avril 1903
Chronique
Le mercredi, 18 février, la troisième frairie de la paroisse de Crossac nous a envoyé une courageuse équipe de travailleurs. Leur éloge n’est plus à faire : leur foi et leur dévouement sont connus des lecteurs de « l’Ami de la Croix. »
Durant cette journée, une guerre sans merci a été faite aux ronces et aux ajoncs : les genêts n’ont pas été davantage épargnés. Pourquoi s’étaient-ils permis d’envahir la voie douloureuse ? Plusieurs arbustes ont été remplacés. Ils ne pourront manquer maintenant de puiser les sucs d’une terre qui vient de recevoir un si excellent guéret.
+
Une autre journée de travail qui mérite plus qu’une mention honorable est celle du 11 mars. C’étaient les femmes des frairies de Bergon et de Sainte-Luce en la paroisse de Missillac, qui étaient, le 11 mars, à travailler au Calvaire. Le Bienheureux de Montfort et son Calvaire, sont aimés à Missillac : beaucoup ont éprouvé plus d’une fois les heureux effets de la puissante intercession du grand Missionnaire. Quelqu’un qui est aussi vénéré et aimé à Missillac c’est le Pasteur : il est si bon ! si dévoué à ses ouailles ! C’est lui qui les a invitées à se rendre travailler au Calvaire !
Mais quel travail pouvait faire en ce moment au Calvaire cette centaine d’intrépides ? Depuis cinq ans, les pluies, sans causer de vrais dégâts, ont enlevé quelque terre. Cette terre doit-être remplacée et pour cela une journée même ne suffira pas.
Après une prière devant l’autel du Bienheureux, on se rend sans retard à l’ouvrage en chantant avec entrain quelques strophes de cantiques. Chacune s’empare à l’instant de son instrument de travail : qui d’une pelle, qui d’une pioche, les autres de paniers, et l’ascension de la montagne commence et se continue jusqu’après 4 heures du soir.
La fatigue n’était pourtant pas sans se faire sentir, mais pour cela le travail n’était pas interrompu : « Plus de fatigue, plus de mérite », disait-on gaîment. L’arrivée du dévoué Monsieur l’Abbé Varon, vicaire de la paroisse augmente encore l’enthousiasme. Il saisit une pioche et donne l’exemple de l’activité au travail. Plusieurs travailleuses avaient trois lieues dans les jambes en arrivant au Calvaire le matin ; c’était autant en perspective pour le soir. L’une d’elle me dit en partant : « il sera plus de huit heures quand j’arriverai chez moi. » Quelle journée riche en mérites !
N° 7 Avril 1905
Travaux du Calvaire : Paroisses de Crossac, de Drefféac, de Saint-Guillaume, et Saint-Joachim.
Le mois de février n’est pas le mois des pèlerinages. Néanmoins, il ne s’est pas écoulé un seul jour, durant ce mois, sans que nous ayons joui de l’édifiant spectacle de quelques groupes de pèlerins se rendant, le chapelet à la main, d’un sanctuaire à l’autre, ou faisant pieusement le chemin de la Croix. N’y eut-il jamais temps d’ailleurs où la prière et la méditation de la Passion fussent plus urgentes ?
Mais pour nous, l’intérêt particulier durant ce mois a été de revivre avec nos chers travailleurs quelques-unes de nos bonnes journées d’autrefois. Il ne s’agissait pas de nouveaux mystères à représenter. Nos lecteurs comprennent quels obstacles nous obligent, à notre grand regret, à suspendre en ce moment l’exécution des projets du Bienheureux de Montfort. Mais il nous faut veiller à l’entretien de l’œuvre commencée. Les arbustes demandent du labour, les plates-bandes ont besoin d’être rafraîchies, la montagne et la voie douloureuse exigent de temps à autre un complet nettoyage, il est nécessaire de remplacer la terre emportée par les pluies.
†
Paroisse de Crossac.
Toujours d’un dévouement inlassable, les hommes de Crossac sont venus les premiers. Tous les bras ne pouvant être occupés à la fois, la paroisse fut divisée en trois sections. Le 8 février fut assigné aux villages de Quémené, la Brionnière, Rion et la Mondrais. Le 15, à ceux de la Guêne, la Giraudais, l’Hôtel-Guérif, Rot et les Eaux. Le 16, enfin, au bourg, à l’Ile-Oliveau, à la Ricortais, à la Haie, Bosta, Lornais, Cunta, Coismeux et la Cossonnais. Ronces, ajoncs, genêts, et toutes herbes malséantes eurent vite disparu sous la bêche de ces braves. Fleurs et arbustes, maintenant à leur aise, vont s’épanouir de concert.
On aime ses prêtres à Crossac : la visite du Pasteur ou de son vicaire, venant chaque fois adresser leurs félicitations et leurs encouragements est reçue avec une grande joie. Après le salut du Saint Sacrement, digne couronnement de la journée, nous avons été heureux d’adresser à ces intrépides chrétiens nos sincères remerciements avec la promesse d’un salaire supérieur à ceux que peuvent donner les hommes, salaire qui leur sera largement octroyé dès ici-bas, et surtout au ciel par le Bienheureux de Montfort, Jésus et sa sainte Mère.
N’ayant pas en ce moment nos wagonnets sous la main, nous avons dû recourir aux petits paniers mayennais pour transporter la terre et remplacer celle entraînée par les pluies. Ce genre de travail convient surtout aux femmes. C’est pourquoi nous nous sommes adressés à elles de préférence, sachant d’ailleurs que nous pouvions compter sur leur dévouement.
Sur l’invitation de M. l’abbé Lezin, leur vénéré Pasteur, les femmes de Drefféac, nous arrivèrent le mercredi, 22 février. Il faisait froid, mais le travail n’en fut que plus actif. Plus d’un panier arrivé de la veille ne put tenir jusqu’à la fin de la journée. Il fallait de la terre, et aussi des pierres, pour empêcher, autant que possible, les ravinements. C’est à qui se mettra à la civière pour les porter sur la montagne. Le travail se poursuit toute la journée, au mépris de la fatigue et avec un admirable entrain qui vaut aux travailleuses, après le salut du Saint Sacrement, de chaudes et sincères félicitations.
Le lendemain, 23, avait été choisi par M. l’abbé Verger, le sympathique curé de Saint-Guillaume. Le mauvais temps, la neige, faillirent compromettre le succès de la journée. Quelques intrépides nous arrivèrent néanmoins, dès le matin, de l’extrémité de la paroisse. Nous prierons, se dirent-elles, si nous ne pouvons pas travailler. Elles constatent à leur arrivée qu’il fait toujours beau à travailler au Calvaire. Les quelques pierres, oubliées çà et là sur la lande, sont vîtes recueillies par une charrette qui les amène au pied de la montagne d’où elles sont bientôt transportées sur le sommet. De son presbytère, M. le Curé, les yeux fixés sur le Calvaire, compte ses travailleuses et se met en route avec le bon M. Mauduit. Ils trouvent le chantier en pleine activité. Les pierres faisant défaut, il avait fallu se mettre à en extraire.
— « Je ne croyais pas, dit M. l’abbé Mauduit étonné, que vous mettiez les femmes à tirer de la pierre ».
En même temps, il s’y met lui-même et fait rouler un bloc pendant que Monsieur le Curé, à la grande satisfaction de ses paroissiennes, s’empare d’une pioche et prépare la terre pour les paniers. Le travail se poursuit toute la soirée avec une étonnante activité. Ce fut encore une bonne, une excellente journée.
Le 28 février et le premier mars sont les jours fixés aux travailleuses de Saint-Joachim. En force, en énergie et en dévouement, les femmes de la Brière entendent bien ne le céder à aucunes. Aussi les premières nous arrivent, peu après sept heures, avec dix kilomètres dans les jambes. Elles demandent à se mettre au travail sans tarder et ne s’accorderont aucun relâche jusqu’à la fin de la journée. Comme les jours précédents, le travail se poursuivra au chant des cantiques. Grande est l’animation : elles sont chaque jour une bonne centaine. Tous les âges sont représentés, mais les jeunes sont naturellement plus nombreuses. On leur a ménagé une surprise, qui n’a pas été pour leur déplaire. On les a photographiées au travail à l’aide d’un instantané. Les photographies sont vraiment bien réussies ; reproduites sur cartes postales, elles donneront une heureuse idée de nos travailleuses du Calvaire. Il est seulement regrettable que l’instrument trop faible n’ait pu prendre le groupe au complet.
Une grande joie pour les braves travailleuses de Saint-Joachim a été l’arrivée de leur bien aimé Pasteur, M. l’abbé Guillard, qui a bien voulu nous consacrer une journée, encourageant ses bonnes paroissiennes de la parole et de l’exemple et leur donnant avant le départ la Bénédiction du Saint Sacrement. Le second jour Monsieur le Curé de Saint Joachim a été remplacé par M. l’abbé Patron, son digne vicaire, qui a mis au travail toute son activité et son cœur.
N° 8 Mai 1905
Travaux du Calvaire
Paroisse de Saint-Malo-de-Guersac
La distance de Saint-Malo-de-Guersac au Calvaire est de douze bons kilomètres bien comptés. Ce n’est pas pour effrayer les intrépides chrétiennes de cette paroisse. Ayant à cœur de fournir une sérieuse somme de travail, plusieurs jours à l’avance, elles réquisitionnent les véhicules de la localité. Mais pour plusieurs, les moyens de transport font défaut ; celles-ci partent à pied, et trouvent le moyen d’arriver les premières. Elles se sont mises en route, il est vrai, peu après cinq heures. Dès leur arrivée, vite à l’ouvrage. Bientôt nous arrive avec les premières voitures, M. l’abbé Gallais, vicaire de la paroisse. Une fatigue passagère a retenu, à son grand regret, le dévoué et vénéré Pasteur, qui jusqu’à ce jour n’avait jamais manqué une journée de travail.
Connaissant les travailleuses de Saint-Malo, quelle belle et bonne journée en perspective ! Mais à peine étions-nous au travail qu’une pluie torrentielle nous oblige à chercher un abri. Nous récitons un chapelet dans la chapelle du Calvaire. On est impatient de se remettre à l’ouvrage, mais impossible : la malencontreuse giboulée s’est changée en pluie continue. Que faire? Peut-être aurons-nous du beau temps un peu plus tard ! Pour n’en pas perdre un instant, nous avançons le déjeuner. Pendant le déjeuner, la pluie cesse en effet, et nos intrépides travailleuses de courir à toute jambe au chantier. C’est un plaisir de les voir remplir les paniers et les transporter au pas de course. Mais, nouvelle épreuve, la pluie reprend avec force et il faut rentrer de nouveau à la chapelle. On veut espérer une nouvelle éclaircie ; en l’attendant, nous donnons le salut, faisons le mois de saint Joseph et chantons des cantiques. L’éclaircie ne venant pas, nous chantons un chapelet pour hâter sa venue. Nous sommes enfin exaucés et nous reprenons joyeux le chemin du chantier. Mais quel chantier! Pauvres bottines ! vous disparaissez dans la boue. Et les toilettes ! Quelle épreuve ! Je me trompe, jamais les robes n’avaient été aussi splendidement ornées. C’est l’effet de belles broderies et garnitures d’orque produit sur elles la terre orange du Calvaire, et ces riches ornements y sont jetés à profusion. Aussi quelle joie ! Comme on chante avec enthousiasme : « Chers amis, tressaillons d’allégresse », — « Dieu le veut», et « Montfort est l’écho de sa voix », etc. On est électrisé : la pluie revient, mais désormais on lui tient tête. On n’en travaille qu’avec plus d’activité. On s’arrête seulement quand la tâche est terminée.
De cette journée, on s’en souviendra. Toutes nos félicitations à ces intrépides. Elles avaient, il est vrai, un stimulant puissant dans la vue du dévoué M. l’abbé Gallais qui, sous la pluie, la pioche à la main, les aurait entraînées par son exemple, s’il en eut été besoin. A lui aussi tous nos remercîments et toutes nos félicitations. Nous n’avons pas manqué de prier le Bienheureux de Montfort de rendre au vénéré Pasteur de Saint-Malo sa vigueur d’autrefois.
Sainte-Reine
Le jour que fixa pour sa paroisse, le dévoué M. l’abbé Lévêque, curé de Ste-Reine, fut le mercredi, 13 mars. M. l’abbé Gauthier, son zélé et sympathique vicaire, fit au nom de son Pasteur, un chaleureux appel. On ne pouvait manquer d’y répondre en masse ; aussi tout Ste-Reine comptait se trouver, le 13 mars, au Calvaire. Mais le matin, tempête effrayante et pluie continue. — Nous en avons pour la journée, nous disions-nous, et notre désir, nous l’avouons, était de voir la journée remise. Nous étions à notre bureau, comptant bien n’être pas dérangé, quand on vint nous annoncer des travailleuses. Quitter la plume pour la pioche nous coûta quelque peu dans la circonstance, mais les travailleuses ne s’en sont pas doutées. Comme il convenait, nous leur avons fait bonne figure.
Il ne fait vraiment pas beau, il pleut, il vente surtout, et c’est au sommet de la montagne qu’il nous faut travailler. Une affreuse giboulée nous oblige bientôt à déguerpir au plus vite. Nous nous réfugions à la chapelle où nous récitons un chapelet, puis nous retournons au travail. Dieu récompensa tant de foi et de générosité chrétienne : la soirée fut superbe. Le travail se poursuivit avec une activité, un courage, un entrain étonnant. Que de pierres, que de paniers de terre furent montés au sommet du Calvaire ! Combien de fois fut fait, une lourde charge au bras, l’ascension de la montagne ? Le Bienheureux de Montfort le sait et il saura donner à chacune sa récompense.
N° 4 Janvier1907
Chronique
Pèlerinage des hommes de Saint-Joachim Dimanche 25 Novembre
Le R. P. Ménard fut vraiment bien inspiré, en clôturant la mission de Saint Joachim par un pèlerinage au Calvaire de Pontchâteau. Rien assurément ne pouvait être plus agréable au Pasteur et aux paroissiens, rien n’était plus capable de confirmer les enseignements et les résolutions de la Mission.
Le dimanche 23 novembre, est le jour choisi pour les hommes. L’élan est irrésistible. Plus de 1.000 hommes, le Christ sur la poitrine s’avancent en ordre de procession. Qu’ils sont admirables d’entrain ! on dirait un régiment qui passe. Aussi après avoir franchi prestement près de 10 kilomètres en moins de 2 heures, ils arrivaient à la chapelle du pèlerinage, précédés de la croix et de la bannière et au son des tambours et des clairons.
M. le Directeur de la Mission et M. l’abbé Barré adressent un mot aimable qui va droit au cœur et le chemin de la croix commence. La parole chaude et vibrante de M. l’abbé Ménard fait courir bien des frissons… et pour peu on eût vu des larmes mouiller les paupières de ces braves ! Car ces hommes recèlent une âme généreuse et ils sentent dans leur poitrine un cœur qui bat bien fort au récit des souffrances de Jésus. 0 qu’ils saisissent parfaitement le sens de ces paroles jetées par l’orateur. « Si Dieu traite ainsi le bois vert, son divin Fils, comment traitera-t-il le bois sec, nous autres pécheurs, criminels ? » L’émotion les étreint, ils n’en peuvent mais, et, spectacle touchant, ces milles poitrines acclament la croix, la religion, l’église ! Quel contraste avec ce qui se passe de nos jours ! Pendant que des sectaires s’acharnent avec tant de rage contre Dieu, ses ministres, ses temples et ses Calvaires, vous, habitants de Saint-Joachim, avez voulu dans un élan magnanime de foi non moins que d’indignation pour ces suppôts de Satan, montrer, vous, que vous êtes chrétiens, attachés à Jésus et prêts, s’il le faut, à le venger, à mourir pour Lui. Vous, pour la plupart, ouvriers des usines de Penhoët, de Trignac et de Saint-Nazaire, vous avez tenu à dire à nos impies que l’ouvrier n’est pas tel qu’on veut bien le dépeindre : un homme sans foi. Non, mais vous avez voulu comme leur jeter un défi et percer à jour l’inanité de leurs assertions, de leurs mensonges. Oui, oui, habitants de Saint-Joachim, montrez-vous encore plus vaillants que jamais ; soyez crânes, on vous l’a dit, et à qui se permettrait en face de sourire de vos convictions, sachez lui imposer silence, sachez-vous faire respecter. Et quand la tristesse viendra s’abattre sur vous, sur les vôtres, tournez vos regards vers le Calvaire de Pontchâteau, et Jésus, soleil de justice, fera briller dans votre âme un rayon de sa gloire, telle par une bruine épaisse, une échancrure du firmament suffit à faire jaillir d’en haut un rayon de lumière et à illuminer ce qui est en bas.
Il est temps de retourner à l’Eglise de la paroisse où les pèlerins doivent recevoir la bénédiction de Notre Seigneur et les adieux des Missionnaires. La procession se forme et se met en marche. Plus rien, sinon le souvenir d’une belle journée. Au revoir donc et merci. Habitants de Saint-Joachim, on vous connaît à l’œuvre, car déjà vous avez fait vos preuves. Néanmoins voulez-vous savoir l’impression de qui vous a vus une première fois ? Je vous la confie : les braves !
Pèlerinage des femmes de Saint-Joachim, lundi 26 Novembre
Pour la bonne cause les femmes, dit-on, ne le cèdent en rien aux hommes. C’est ce que nous avons vu lundi, 26 novembre. 1.500 femmes de Saint-Joachim franchissaient à leur tour, la croix sur la poitrine et par un léger brouillard, la route qui mène au Calvaire de Pontchâteau. Les événements de la veille les ont-elles électrisées ? peut-être, mais ce qui est vrai c’est que les cantiques chantés avec entrain et mesure leur donnent des jambes, car à peine mettent-elles un quart d’heure de plus que les hommes à venir à la chapelle du calvaire. Leur première visite est pour N.-S. Chrétiennes, en effet, elles veulent épancher leurs âmes dans celle de Jésus, lui demander ce dont elles ont besoin et surtout le dédommager des outrages qu’il reçoit de nos jours. Monsieur l’abbé Barré les remercie vivement de les voir si nombreuses, puis en termes éloquents, où perce l’émotion, leur rappelle les faits et gestes des femmes de Saint-Joachim dans les travaux du Calvaire. Il fait allusion entre autres à cette journée mémorable où après avoir rompu par trois fois les chaînes, 600 d’entre-elles avaient enfin eu raison d’un énorme bloc de pierre que 200 hommes, quelque temps auparavant, avaient dû abandonner. Honneur à vous, s’écrie-t-il ! oui, honneur à vous, à vous qui êtes venues encore si nombreuses redire votre amour au P. de Montfort, à ce saint missionnaire qui durant 15 jours évangélisa votre paroisse,
Le long de la voie douloureuse M. l’abbé Maindron, dans un langage pur et vivement senti, leur retrace en quelques mots les souffrances de Notre-Seigneur. On l’écoute avidement. El plus d’une, nous en avons la certitude, serait quelque peu surprise si on venait à leur parler d’une automobile qui, lancée à toute vitesse, vint par hasard à passer durant la cérémonie. Les autres, si elles l’entendent, ne daignent même pas lui risquer un simple regard de curiosité ! Ah ! ces âmes franchement chrétiennes sont tout entières à leur dévotion et elles veulent offrir à Jésus tous les sacrifices, les petits comme les grands. C’est ce que leur vénérable Pasteur leur demandera pendant le salut du Très Saint Sacrement : « Chères paroissiennes, leur dira-t-il, vous venez de chanter : à Jésus sans partage. Eh bien ! oui, donnez-vous absolument à lui « car Dieu veut tout ou rien. » Puis ce saint prêtre, après avoir remercié Monsieur le Directeur du pèlerinage et les missionnaires, donna la bénédiction de Notre-Seigneur à la foule agenouillée.
A notre tour, nous vous disons : merci, Monsieur le Curé de Saint-Joachim. Votre paroisse vous honore, soyez-en fier; merci à vous, Missionnaires de l’Immaculée-Conception, d’être venus ici retremper les âmes. Merci à vous, vaillantes chrétiennes. On vous a parlé des héroïnes de 93. Et bien ! je suis heureux de le redire, vous n’avez pas dégénérées, et si (Dieu nous en préserve) un nouveau 93 allait éclater sur notre malheureuse Patrie, la France trouverait en vous des femmes courageuses, fortement trempées, des héroïnes.
Les Travailleurs de Crossac au Calvaire, 5 Décembre
Depuis quelque temps déjà les événements qui se déroulent en France nous ont contraints à suspendre les travaux du Calvaire. Restait néanmoins un travail qui s’imposait. Il s’agissait d’une plantation d’arbres qui fit le pendant de celle qui court à gauche de la voie douloureuse, de la route à la neuvième station : car cette partie du pèlerinage trop négligée jusqu’ici à raison de l’espoir toujours gardé de reprendre les travaux de la montagne voulait à l’instar des autres une avenue complète. En cet endroit, où le roc abonde, il faut creuser et apporter de la terre : ce qui demande des bras vigoureux. Monsieur le Curé de Crossac convoque ses hommes et le mercredi, 5 Décembre, 70 de ses paroissiens, Monsieur le Maire en tête, nous arrivent, les uns munis d’une pelle, d’une pioche, les autres, conduisant une quinzaine de charrettes. Sur un signal donné par le Directeur du pèlerinage, voilà nos cambrioleurs qui s’attaquent fiévreusement non pas à une porte d’église, mais qui a un fossé, qui a un sol rocailleux. Nous regrettons l’absence de Monsieur le Curé, retenu ailleurs par les devoirs de sa charge. Monsieur l’abbé Beaufils, son dévoué vicaire, est là, surveillant les travaux. Nous lui disons merci ; qu’il veuille bien transmettre nos remerciements à son vénéré Pasteur. Merci à vous, vaillants travailleurs du 5 Décembre. Cette journée a été dure pour vous avec la pluie torrentielle qui est venue vous arrêter quelques instants, mais combien précieuse et méritoire pour le Ciel. Que le Père de Montfort vous paye au centuple. Allons! vous êtes des courageux et une fois de plus vous avez montré qu’on peut compter sur vous. A nouveau, merci.
N° 5 Février 1907
Une journée de travail au Calvaire
Les travailleurs de Bergon qui, le 11 Décembre, quittaient, par un temps affreux, leurs foyers, ne se doutaient point que dans la France, cardinaux et évêques recevaient l’ordre d’abandonner leur résidence, mais pour ne plus y revenir. Cette navrante nouvelle connue dans la journée est pour eux un coup de foudre ; loin de leur faire tomber les bras, elle leur donne au contraire du courage. C’était vraiment plaisir de les voir manier pioches et pelles. Pour être juste, il faut dire que les Bergonniers ont la réputation » de rudes travailleurs » et ils le méritent en vérité, certes. La tranchée va se terminer… reste encore un rocher qui dans son arrogance semble défier les forces de ces braves. » Pauvre petit, dit une voix, un quart d’heure après, il gisait dans le ravin, brisé en deux. Ainsi, disaient-ils gaiement, les gars de Bretagne ont raison du « bloc. »
Dans la soirée, nos bons voisins de la Madeleine, de Beaulieu et de la Salmonaie, de Pie, s’empressent de nous amener leurs charrettes pour transporter la terre destinée à combler la tranchée.
A 4 heures, 23 petits arbustes sont là, courant sur une ligne des plus régulières, la ligne droite géométrique. Comme ils sont fiers ! Balançant leur frêle tige aux bourrasques d’un vent de l’Ouest, ils semblent dire aux Benjamins de la journée (plusieurs comptent 3 lustres à peine) : merci et au revoir, oui, au revoir, et quand, un jour, grandis par les années, vous reviendrez vous abriter sous notre ombrage, vous vous direz à part vous « nous les avons plantés. »
Après la bénédiction de Jésus Hostie, monsieur le Directeur du pèlerinage leur adresse un mot aimable et tout de circonstance… et joyeux ils reprennent le chemin de leurs demeures. Avec nos remerciements, nous les prions d’offrir notre merci à leur vénérable Pasteur qui les a convoqués pour cette journée de travail…
N° 11Août 1908
Un nouveau Groupe au Prétoire
Le faible Pilate, croyant pouvoir fléchir la colère haineuse des Juifs, venait de faire flageller Jésus. « Ensuite les soldats le conduisirent dans la cour du prétoire et réunirent autour de lui toute la cohorte. Ils le dépouillèrent de ses vêtements et le revêtirent d’un manteau couleur de pourpre. Et tressant une couronne avec des épines, ils l’enfoncèrent sur sa tête, et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, fléchissant le genou devant lui, ils le raillaient en disant : Salut ! Roi des Juifs, et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et lui frappaient sur la tête. Et, fléchissant le genou, ils l’adoraient et lui donnaient des soufflets ».
C’est la traduction fidèle de ces paroles de l’Evangile que nous donne M. J. Vallet, l’éminent et sympathique artiste nantais, dans son nouveau haut-relief qui sera placé au Prétoire de Pontchâteau comme pendant au groupe de la Flagellation, et qui sera béni solennellement le 6 septembre prochain, par Sa Grandeur Mgr Rouard, évêque de Nantes.
A cette œuvre si belle — que j’ai eu le bonheur de voir dans son atelier — M. Vallet apporte toute sa foi de chrétien et tout son talent d’artiste. Je ne dis pas que c’est le chant du cygne, mais c’est un beau chant de cygne, car j’espère que M. Vallet, à coup de chefs-d’œuvre mènera à bonne fin l’œuvre qu’il a entreprise et qu’il a prise à cœur.
Depuis de longs mois, de 5 heures du malin à 8 heures du soir, il est là debout méditant et cherchant à fixer dans cette glaise inerte l’idéal vivant et sublime que son œil a entrevu dans l’Evangile. S’il n’a pas réalisé son idéal sacré — qui ne l’aura jamais ici-bas ? — avec courage, avec ardeur, il s’en est, du moins, très approché.
C’est, sans doute, comme les artistes chrétiens du XIIIe siècle, l’âme au ciel, la prière sur les lèvres, qu’il travaille ; c’est l’Evangile et l’histoire à la main.
Pour reproduire les traits bénis de l’Homme-Dieu, il a dû vivre de longues heures en tête à tête avec lui, se figurer et revivre cette scène atroce et inoubliable du couronnement d’épines qui suivit la Flagellation.
« On abandonne Jésus aux valets et aux soldats, dit Bossuet, et il s’abandonne encore plus lui-même : cette face autrefois si majestueuse, qui ravissait en admiration le ciel et la terre, il la présente droite et immobile aux crachats de cette canaille : on lui arrache les cheveux et la barbe ; il ne dit mot, il ne souffle pas ; c’est une pauvre brebis qui se laisse tondre. Venez, venez, camarades, dit cette soldatesque insolente; voilà ce fou dans le corps de garde, qui s’imagine être le roi des Juifs; il faut lui mettre une couronne d’épines : il la reçoit. Eh ! elle ne tient pas assez, il faut l’enfoncer à coups de bâton ; frappez, voilà la tête ! »
« Pour diadème, dit aussi Bourdaloue, on prend une couronne d’épines qu’on lui enfonce sur la tête… Les épines appliquées avec force le percent de toutes parts ; autant de pointes, autant de plaies ; le sang coule de nouveau ; et depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête, il n’y a plus rien en cet homme de douleur qui n’ait eu son tourment et son supplice ».
Voilà l’Homme tel que M. Vallet s’est efforcé de le réaliser dans son œuvre. Le Christ, bien au milieu, ressort parfaitement dans le calme et la résignation, dans l’acceptation d’une douleur divine et immense.
Nous lisons dans l’Express de l’Ouest, sous la signature de M. Jos. Angot : « Dans ce premier haut-relief (la Flagellation), le Christ avec une douleur encore inquiète, avec des soubresauts humains, est regardé par l’aristocratie judaïque : le sanhédrite orgueilleux, le publicain rapace, le pharisien dilettante, la main dans la ceinture, désintéressé, cherchant une sensation nouvelle pour son cœur blasé dans la torture du condamné, et le jouisseur banal dont les yeux rampent, sans flamme et sans ardeur.
Le Couronnement d’épines nous montre un Christ plus résigné, moins torturé — et plus souffrant ; la douleur s’est réfugiée dans les cachettes profondes des yeux. Ses traits ont déjà quelque chose de la sérénité de la mort. Ses tortionnaires ont changé de sang : ce sont des « Apaches » de la Judée, la tourbe de Jérusalem : figures bestiales, glabres, vicieuses, fronts fuyants, lèvres lippues ou roulées en dedans, membres déformés. L’un crache, l’autre persifle ; tous ces yeux luisants guettent avidement une nouvelle souffrance avec des rictus de bête de proie. Deux Romains regardent, dédaigneux et hautains, vaguement écœurés, le menton bref et le nez impérieux, qui est le signe de leur race. Dans un coin, une figure plus ouverte, des yeux plus francs, une bouche plus parlante, dénote un gaulois légionnaire; Longin, peut-être?… En tout cas, ses traits trahissent la révolte de son être, c’est plus que du mépris pour les mercenaires, c’est du dégoût, c’est cet écœurement qu’à vingt siècles de distance nous avons pu voir, à certains jours tragiques, sous le képi ou le casque d’uniforme ! »
On remarquera, en effet, que ces tortionnaires ne sont pas des soldats romains, mais des auxiliaires, de ces barbares tirés de toutes les provinces conquises. L’un d’eux presse à l’aide d’un bâton, sur la couronne d’épines pour l’enfoncer sur la tête du divin Supplicié. On y voit un arabe au front fuyant, tenant entre ses mains une sorte de bonnet et saluant ironiquement. Les Romains, les maîtres, n’ont, là, que la haute surveillance.
Qu’est-ce donc que cette couronne épineuse que la barbarie delà valetaille et de la soldatesque imposa au front de Jésus? Une tradition latine de Jérusalem nous apprend qu’elle fut prise sur l’arbre épineux lycium spinosum. Cependant le savant botaniste Hasselguist croit qu’on se servit pour la faire du nabka des Arabes. « Il y a toute apparence, dit-il, que le nabka fournit la couronne que l’on mit sur la tête de Notre-Seigneur : il est commun dans l’Orient. On ne pouvait choisir une plante plus propre à cet usage ; car elle est armée de piquants, ses branches sont souples et pliantes, et sa feuille est d’un vert foncé comme celle du lierre. Peut-être les ennemis de Jésus choisirent-ils, pour ajouter l’insulte au châtiment, une plante approchant de celle dont on se servait pour couronner les empereurs et les généraux d’armée ».
En tout cas, ce couronnement dérisoire d’épines acerbes constitua pour Jésus un des plus douloureux supplices de sa Passion.
Mais M. Vallet n’a pas voulu nous laisser sur cette impression de douleur, d’ignominie et de défaite. Au-dessus du groupe, il nous montrera dans une apothéose le Christ couronné de gloire, environné des légions de ses Anges. « Nous y verrons Jésus, à cause de la souffrance de sa mort, couronné de gloire et d’honneur ». Hébr. 2. 9.
En contemplant la superbe maquette de M. Vallet, je me disais : je regrette que le moulage en plâtre ne rende pas le fini, l’impression de force, la puissance de vie que donne la maquette en glaise, couleur de chair. Le plâtre est trop blanc, trop factice. II lui faudra attendre la patine du temps. Voilà, précisément, ce qui fait le désespoir des artistes, qui, comme M. J. Vallet, constatent leur impuissance à fixer dans la matière l’idéal adoré. Oui, certes, il y a toujours loin, un intervalle infini entre la réalisation et le rêve, et les plus .belles œuvres humaines ne seront toujours que de pâles reflets de la beauté suprême entrevue un instant, mais irréalisable.
N’empêche que l’éminent artiste nantais a conçu et effectué une belle œuvre d’art, que, à partir du 6 septembre prochain, tous les pèlerins du Calvaire auront désormais le plaisir d’admirer au Prétoire.
Sa Grandeur Mgr Rouard, évêque de Nantes, qui a bien voulu accepter l’invitation de M. J. Vallet d’aller visiter son œuvre dans son atelier, a bien voulu aussi accepter l’invitation d’en venir faire la bénédiction et de présider la fête du 6 septembre 1908. Que le nouveau groupe et la présence de Monseigneur soient donc les deux attraits, comme deux aimants, qui attirent en ce jour au Calvaire une foule de pèlerins plus nombreuse que jamais.
François PILET.
N° 1 Octobre 1908
Bénédiction du Couronnement d’épines 6 Septembre 1908
La fête est passée ; mais, comme un parfum exquis, son souvenir fructueux restera longtemps gravé dans le cœur de tous les pèlerins. Nous la voulions belle, calme, pieuse, consolante : elle a été tout cela. Monseigneur l’évêque de Nantes voulait que cette fête, que cette manifestation, à l’occasion de la bénédiction du groupe du Couronnement d’épines fut un acte solennel d’expiation et de réparation: elle a été tout cela au-delà même de nos espérances. Un peuple nombreux et fidèle est venu consoler Jésus des outrages que lui prodigue un autre peuple rebelle et dévoyé. Le peuple pervers s’écrie : « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Mais le peuple chrétien a crié ici : « Il faut que Jésus règne. » Oui, il faut qu’il règne, et sur lui et par lui Jésus régnera.
Depuis une huitaine de jours, des nuages noirs, lourds et menaçants traînaient au ras de la terre et assombrissaient le ciel, jetant du même coup une ombre de tristesse dans notre esprit. Parfois, souvent, ils crevaient comme des ballons, et une pluie impertinente criblait de ses averses diluviennes le sol par trop désaltéré. M. le Directeur du pèlerinage relevait notre confiance, en nous disant: «Je ne me souviens pas d’avoir eu du mauvais temps pour une seule de nos fêtes.» Nous nous reprenions à espérer, et nous avons eu raison. Dès le vendredi soir, il s’éleva dans le nord un vent qui balaya le ciel et raffermit l’atmosphère. Le samedi le beau s’accentua. Les derniers nuages comme les derniers fuyards dans une bataille perdue, bien loin s’évanouirent à l’horizon.
Et dès lors, commença de régner autour du calvaire une activité quasi fiévreuse, d’une part pour la décoration du Pèlerinage, d’autre part pour l’installation des boutiquiers. Et pour ceux-ci, c’était vraiment une course… aux places, pour trouver une situation avantageuse, plus achalandée. Car, disons-le en passant, le pèlerinage du Calvaire est d’un apport considérable au commerce de Pontchâteau en particulier.
En même temps donc que les boutiques s’installent, les mâts s’élèvent portant joyeusement leur oriflamme de fête ; la chapelle se pare de ses ornements des grands jours; le Prétoire revêt son front d’une guirlande légère de drapeaux en festons.
Et l’œuvre de M. Vallet? Elle était à sa place depuis déjà 8 jours, toute blanche de jeunesse et de beauté, toute resplendissante de la foi de l’artiste qui l’a fait jaillir de son âme de chrétien.
Tout est prêt au Calvaire, et l’on sent que tout est prêt aussi ou se prépare autour de nous. Des lettres nombreuses et sympathiques sont venues nous assurer que notre appel avait été compris et qu’on y répondrait d’un élan unanime. Les Compagnies de chemin de fer de l’Etat, de l’Ouest, d’Orléans, la petite Compagnie morbihannaise, que nous tenons à remercier toutes dès maintenant, ont été d’une complaisance très large en faisant des réductions considérables et en mettant un nombreux matériel au service des pèlerins.
… Dès 7 heures et demie, nous arrive notre plus cher et vénéré pèlerin, sa Grandeur Mgr Rouard, évêque de Nantes. Il vient, accompagné de M. le Chanoine Leroux, vicaire général, notre très cordial ami de toujours, de M. Simon, économe du Grand Séminaire, de M. Dupas.
C’est la calèche de M. le comte de la Villeboisnet, si cordialement offerte comme de coutume, qui amène jusqu’à notre seuil notre auguste pèlerin et M. le Vicaire général. Monseigneur avait tenu à dire la Sainte Messe dans la chapelle du pèlerinage, à laquelle assiste un groupe déjà compact. Disons tout de suite que, toute la journée, la chapelle ne désemplit pas, pour les messes, les confessions, les communions, la vénération des reliques du Bienheureux de Montfort et la bénédiction des objets de piété. Il faut en dire autant de la chapelle du Calvaire et de tous les autres sanctuaires.
Mais déjà l’heure s’avance. Il est 9 heures et demie. Tels des fleuves aux larges rives et au lit profond portant leurs eaux à l’Océan, les 3 routes de Pontchâteau, d’Herbignac et de Crossac, comme 3 immenses artères, déversent des flots de peuple sur la lande de la Madeleine. Des paroisses entières s’avancent en rangs serrés, au chant des cantiques, qui monte par-dessus les têtes et couvre les rumeurs de la foule, et toutes vont se masser successivement au pied du Prétoire, dans l’ordre de leur arrivée. Un très grand nombre de paroisses sont venues croix et bannières en tête, conduites par Messieurs les Curés ou vicaires, plusieurs par les deux à la fois.
Voici d’abord le canton de Pontchâteau : il donne en masse. La paroisse de Pontchâteau, sur le territoire de laquelle est érigé le Calvaire, a le droit d’être fière et d’être à l’honneur. Elle est là au grand complet, amenée par M. Lebert, curé-doyen, et ses deux vicaires, M. Rochet et M. Derennes. Voici Saint-Guillaume avec M. Verger; Saint-Roch avec M. Labigne; Besné avec M. Laure et M. Boya ; Crossac avec M. Guibert et M. Beauflls ; Saint-Joachim avec les deux vicaires, M. Bourmaud et M. Blois; Sainte-Reine avec M. Corbineau et M. Bizeul.
Voici le canton d’Herbignac qui nous dirige ses gros contingents. Herbignac arrive, au nombre de 1000 à 1200, sous la conduite de M. le chanoine Pellerin, curé-doyen, avec l’un de ses vicaires. C’est ce vénérable ami qui, à 10 heures et demie, dira la Sainte Messe au Prétoire. — Assérac détient la palme de l’arrivée. La première, gravissant allègrement la côte sous les ordres de M. Ménard, son curé dévoué, la paroisse d’Assérac passe devant la chapelle, bannière au vent, précédée de son suisse tout chamarré d’or et de rouge et armé de sa hallebarde. C’était le seul suisse, aussi fût-il distingué par Sa Grandeur. C’est une bonne idée à suivre. — La Chapelle-des-Marais défile bravement et très nombreuse, sous le commandement de M. de Kergos, son vicaire. — Saint-Lyphard presse ses rangs ayant à sa tête son vicaire, M. Nerrière.
Voici le canton de Saini-Gildas-des-Bois. M. Marchand amène les paroissiens du chef-lieu. M. Patron, ceux de Drefféac. — Missillac, guidé par son vénérable curé, M. Gaudin, par M. Leroux, et quelques autres ecclésiastiques, que rejoignit dans la soirée le second vicaire, M. Jouy, jette sur la lande, au dire de M. le curé, plus de 2000 pèlerins. — M. Hoiron, vicaire à Sévérac, nous fournit un détachement très nombreux de cette paroisse.
Le canton de Saint-Nazaire nous dépêche des délégations très nourries de Montoir avec M. Jamoneau — de Saint-Malo de Guersac avec M. Gallais — de Saint-Nazaire, de Donges, de l’Immaculée, de Méan…
Du canton de Blain, voici 300 pèlerins du Gâvre, des bataillons serrés de Bouvron, de Saint-Omer.
Venant par la ligne de Chateaubriand, voici des groupes très fournis de Fay, Marsac, Nozay, Héric, Fercé avec M. le curé Landeau, etc.
Du canton de Guérande, voici Mesquer, avec M. le curé Fouchard, Saint-Molf, avec M. le curé Cottineau, Trescallan, avec ses 350 amenés par M. Leduc, vicaire. De même Saille, Escoublac et Saint-André-des-Eaux, nous envoient plusieurs centaines de pèlerins.
Du canton du Croisic, nous voyons une délégation très nombreuse du bourg de Balz et du Pouliguen.
Du canton de Saint-Etienne de Montluc, voici Cordemais, avec M. le curé Chuniaud ; Couéron, avec M. le vicaire Pichon ; Le Temple, avec M. le curé Barbier.
Du canton de Saint-Nicolas-de-Redon, voici des groupes très drus du chef-lieu lui-même ; Fégréac, avec M. le doyen Dautais ; Saint-Joseph-du-Dresny, avec M. le curé Macé.
Du canton de Savenay, voici la vieille cité elle-même qui fournil un gros appoint amené par son vénérable doyen qui, malgré ses 84 ans, a tenu à faire à pied la route de Pontchâteau au Calvaire. N’oublions pas Malville et son curé M. Warron. non plus que Prinquiau avec de même M. le curé Leduc, qui l’un et l’autre sont heureux de leurs groupes compacts.
Puis, de plus loin, regardez ce petit bataillon qui vient d’arriver le premier de ce côté : c’est le Clion avec M. le curé Lucas. Ecoulez ces chants vigoureux; c’est le groupe ardent de la Bernerie qui les fait entendre, sous la direction de son enthousiaste et chrétien président, M. Fillaudeau. Voici Donges, Paimbœuf, etc.
Enfin, voici Nantes. Combien sont-ils ? L’on demande : combien sont-ils ? Qui nous le dira? Ils viennent, nos chers Nantais, très nombreux, plus de 2.000, faire escorte à leur évêque, sous la présidence de M. le chanoine Renaud, Supérieur de l’Immaculée Conception, de M. Fourage et de M. Luzeau. Et tout le long du parcours, depuis Nantes jusqu’à Pontchâteau, comme un torrent soudain grossi par les pluies, le fleuve des pèlerins s’accroit et monte. Chaque station présente des phalanges de pèlerins aux nombres insoupçonnés. Les troisièmes, deuxièmes et premières classes sont littéralement bondés, on s’étouffe. Le matériel devient insuffisant, et, alors, dans cet embarras imprévu, le train de l’Etat, l’express de Bordeaux-Nantes, eut l’extrême obligeance de prendre tout le reste des pèlerins, d’en emplir ses wagons et de venir les déposer jusque sur les quais de la gare de Pontchâteau. Que ces dévouées compagnies reçoivent encore ici nos plus sincères remerciements !
Si nous sortons du diocèse pour entrer dans le Morbihan, c’est le même courant. Voici Férel, très nombreux, amené par M, le chanoine Gergaud ; la Roche-Bernard, par M. le vicaire ; etc.
On comprendra qu’il m’est impossible de mentionner toutes les paroisses représentées ici. Mais Dieu vous a vus, il vous a comptés, il saura donc bénir et récompenser votre foi et votre piété.
Quand cette foule énorme se fut massée sur l’esplanade du Prétoire, du perron de la Scala Sancta, ce fut un spectacle magnifique, qu’il faut avoir vu, digne de Lourdes et de Sainte Anne ; un spectacle admirable et consolant qui dut réjouir le cœur en même temps que les yeux de notre évêque vénéré, qui se disait avec bonheur et vérité que cette famille de chrétiens convaincus était la sienne.
A 10 h. 1/2, commence la sainte messe, dite par M. le chanoine Pellerin, curé-doyen d’Herbignac, cependant que la foule entière, sous la direction entendue de M. l’abbé Pineau, chante dans un superbe unisson, nos vieux cantiques de foi catholique et française toujours. En même temps sous le voile des cantiques, d’humbles quêteurs entament la masse profonde, pénètrent dans les rangs serrés et généreux, accueillent avec reconnaissance l’obole des petits sous, parmi lesquels perce parfois le scintillement du blanc ou du jaune. Et cela, il le faut bien pour achever l’œuvre géante du Pèlerinage. Les petites gouttes d’eau font les mers immenses… Les petits sous, que Dieu multiplie au gré de la baguette d’une fée merveilleuse — qui se nomme la Charité — font les trésors que le génie apostolique transforme en œuvres admirables pour l’unique gloire de l’Auteur de tout don.
Mais voici que la Messe s’achève sur un dernier refrain puissamment enlevé. La multitude se fait plus silencieuse et plus attentive. Elle attend qu’on lui parle, qu’on lui dise quelque chose. Cette tâche, c’est M. l’abbé Lebert, le sympathique curé-doyen de Pontchâteau, qui nous a fait l’insigne honneur et le vif plaisir de l’accepter et de la remplir.
« Le Couronnement d’épines de Notre-Seigneur », tel est le thème naturellement indiqué de ce magnifique discours, d’une sévère élévation de pensée et d’une belle facture littéraire. M. le Curé est servi par un organe puissant, sans l’être trop, par un temps calme, par un emplacement sonore, par un auditoire incomparable et surtout par un sujet d’une haute inspiration. Me promenant à dessein aux confins de la foule, je constatai que le jet de la voix du prédicateur parvenait clairement jusqu’à mes oreilles, et je distinguai chaque parole. L’esplanade, en effet, qui s’étend devant le Prétoire est un lieu unique, merveilleusement propice au développement des masses et aux envolées de l’éloquence.
M. le curé débute par une vue d’ensemble de l’œuvré du Calvaire. Qu’est-ce que nous représente ce pèlerinage? Il nous représente les différentes scènes de la Passion. Et c’est alors que M. le curé nous en fait un récit émouvant : scènes atroces de la Trahison, des Jugements, de la Flagellation, du Couronnement d’épines, de l’Ecce Homo, du Crucifiement. Ces outrages faits à Notre-Seigneur autrefois et aujourd’hui exigent une réparation. Nous devons réparer, mais particulièrement la France. Et comment le ferons-nous? Nous le ferons par un renouvellement de la foi dans la société, la famille et l’individu… C’est fini, et l’on écoute encore.
Monseigneur se lève. Le spectacle qui s’offre à ses regards touche son cœur d’évêque. Son cœur déborde d’émotion et d’enthousiasme. Il en laisse s’épancher le trop plein sur la foule, sur ses enfants en des paroles de félicitations, d’encouragement, d’espoir et de prière. Il félicite le nouvel apôtre du Calvaire, dont chaque pierre, chaque motte de terre, chaque arbre, chaque sanctuaire redit le nom, en même temps que ses frères en Dieu qui travaillent à l’extension du règne de Notre-Seigneur et qui ont réalisé, avec tous les travailleurs, une œuvre colossale. Il félicite l’artiste chrétien d’avoir tiré de son âme une si belle manifestation de l’idéal divin. Il félicite tous ces Messieurs de leur attachement au Calvaire et les prie d’unir leurs efforts communs pour le relèvement et le maintien indéfini de la foi dans les âmes. Il félicite aussi toutes ces chrétiennes populations qui ont afflué si nombreuses en ce jour, ces légions de bienfaiteurs, de travailleurs et de travailleuses de tout rang et de toute condition qui ont contribué à l’édification de ce Pèlerinage ; il les adjure de rester toujours inébranlablement fidèles aux enseignements du Bienheureux Père de Montfort et de tous ses successeurs.
Puis, Sa Grandeur procède à la bénédiction solennelle du groupe du Couronnement d’épines. C’était tout à l’heure une œuvre belle, c’est maintenant une œuvre sainte. La bénédiction du pontife l’a sanctifiée et consacrée. Soyez, M. Vallet, félicité et béni, comme votre chef-d’œuvre et que la bénédiction qui vient de descendre sur votre travail pour le sanctifier, descende aussi sur vous pour vous permettre de réaliser les projets qui germent déjà dans votre âme et qui, sous la chaleur inspiratrice et fécondante du grand soleil de la foi, s’épanouiront au grand jour, à leur temps, en délicieux fruits mûrs.
Et d’un geste paternel, Monseigneur répand sa bénédiction sur la foule. Et pendant qu’une messe tardive se dit pour les derniers arrivés, la foule s’écoule pour la réfection.
De leur côté, Monseigneur et sa suite se rendent à la salle du banquet. Le banquet, il fut modeste, car Sa Grandeur avait instamment tenu à ce qu’il fut un vrai dîner de pèlerins. Il en fut ainsi à la satisfaction générale.
Outre messieurs les ecclésiastiques mentionnés plus haut qui, comme tous les autres, aussi nombreux, disséminés dans la foule, avaient été invités, on voyait autour de Monseigneur, M. le comte de la Villeboisnet et son fils, M. le conseiller général Arthur de la Villesboisnet, M. le marquis de Montaigu, député de la circonscription, M. le comte de Beaudinière, M. le comte de la Monneraye, M. de Monti, M. de Marcé, conseiller d’arrondissement, M. de Kersabié, M. le baron Gaétan de Wismes, M. Vallet, l’artiste, héros de la journée, M. de la Morandais, conseiller général, M. Lanoë, M. Gerbaud, ancien directeur des travaux du Calvaire, M. Lévêque.
Au dessert, M. l’abbé Barré, directeur du pèlerinage se lève et, d’une voix émue, prononce le toast suivant.
Monseigneur,
C’est à Votre Grandeur que nous devons cette belle fête. A vous d’abord mes remerciements.
Vous avez pu le lire sur tous les visages, Monseigneur, votre présence est la cause d’une grande joie pour toutes nos chrétiennes populations. Elles voient Jésus-Christ dans votre auguste personne; et, comme vos prêtres, sont heureuses de vous témoigner leur inviolable attachement surtout au jour de l’épreuve.
Cette fête me rappelle, Monseigneur, les nombreux gages de sympathie et de dévouement que vous avez donnés à l’œuvre du Calvaire, et je saisis avec empressement l’occasion de vous en témoigner de nouveau ma vive gratitude.
Je l’ai fait par lettre, mais je tiens à le renouveler publiquement; je vous remercie sincèrement, Monseigneur, de nous avoir donné pour curé le bon et dévoué M. Lebert. On a dit, le jour de son installation, que le Bienheureux de Montfort vous avait inspiré sa nomination. Je l’ai cru sans peine, et votre zèle et votre dévouement, Monsieur le Curé, ainsi que l’émouvant discours que vous venez de nous donner, ne sont pas de nature à m’en dissuader. A vous aussi toute ma reconnaissance.
Ce qui distingue l’œuvre du Calvaire, c’est qu’elle est l’œuvre de tous. Oui, vous avez tous, Messieurs, votre bonne part dans cette œuvre, à commencer par vous, Monsieur le Vicaire général1.
Je ne citerai qu’un fait. Un jour, c’était sous l’épiscopat de Mgr Laroche et au presbytère de Pontchâteau, vous avez exercé une influence décisive sur l’avenir de l’œuvre du Calvaire.
Comme toutes les œuvres religieuses, celle du Calvaire se trouvait récemment menacée de la ruine, votre admirable dévouement l’en a préservée, Monsieur le comte de la Villeboisnet.
1M. l’abbé Leroux.
Comme Monseigneur, vous avez, dans notre chemin de croix, votre station à vous, Monsieur le Député1.
N’est-ce pas votre zèle, Messieurs les Curés, qui a produit ce magnifique élan de nos populations vers les travaux du Calvaire ?
Combien je suis heureux de voir, assis à cette table avec M. Gerbaud, le directeur de nos travaux, plusieurs de nos travailleurs d’élite. Vous êtes de ce nombre, Monsieur notre Conseiller général2, et vous aussi, M. le comte de Beaudinière, M. le comte de la Monneraye, M. le baron Gaétan de Wismes, M. de Monti de Rezé, M. de Marcé. M. Lévêque. Plusieurs autres, parmi lesquels M. le Maire de Pontchâteau; le Général du Guiny et M. de la Chevasnerie n’ont pu, à raison de leur santé, venir à cette fête, mais ils sont avec nous d’esprit et de cœur. En m’exprimant leurs sincères regrets, ils m’ont prié de vous offrir leurs hommages, Monseigneur.
En vous abaissant, Messieurs, au rang de nos travailleurs volontaires, vous avez encore grandi dans l’estime et l’affection de nos populations de foi qui, à rencontre de ce qui a lieu en nombre d’autres cantons, vous demeurent sincèrement attachées.
Ce n’est pas assez, cher monsieur Vallet, de vous donner la première place parmi les travailleurs du Calvaire. Vous, vous appartenez à un ordre supérieur dans lequel, à l’unanimité, nous vous décernons le premier prix.
Votre Flagellation est une touchante prédication. Mais plus merveilleux encore est l’effet de votre couronnement d’épines.
C’est l’idéal de ce que peut réaliser l’artiste voulant représenter l’Homme-Dieu dans l’humiliation et la souffrance. Recevez mes plus chaleureuses félicitations.
Je le reconnais, c’est à votre zèle, Messieurs les Curés el Messieurs les Vicaires, que nous devons l’immense concours de pèlerins venus prendre part à cette fête.
Vous y avez aussi votre bonne part, Messieurs les membres du Comité des pèlerinages, et vous tout particulièrement, Monsieur Lanoë.
A vous tous, Messieurs, mes sincères remerciements.
Je lève maintenant mon verre à la santé de Monseigneur.
A son tour, Monseigneur se lève et répond tout aussitôt avec un à-propos parfait, d’une façon très avertie et avec une délicatesse très entendue. Il remercie M. le Directeur du pèlerinage de son zèle apostolique et de son dévouement à toute épreuve. Il a un mot pour chacun. Il remercie et félicite tous ces Messieurs qui se sont faits manœuvres au Calvaire, rehaussant ainsi le prestige de leur nom et de leur influence aux yeux des populations qui les entourent et ont les yeux fixés sur eux, en rayonnant aussi leur glorieux blason de nouveaux motifs de splendeur. Il conjure ses prêtres de rester toujours groupés autour du Calvaire, parce que l’œuvre du Calvaire est l’un des plus grands auxiliaires de la piété, l’un des plus grands leviers de la religion dans ces contrées, et, au point de vue de la foi, l’un des plus beaux joyaux du diocèse de Nantes.
…Mais déjà les abords du prétoire sont absolument envahis comme par de véritables vagues humaines. Et, comme un flot qui monte et se pousse toujours, le peuple pieux gravit sans cesse à genoux les degrés indulgenciés de la Scala Sancta. Avec eux, plus haut qu’eux, c’est la prière qui monte au ciel, aux pieds du Roi Jésus qui triomphe en ce jour. Les bannières elles-mêmes sont montées, comme un acte de foi, jusque sous les voûtes du monument.
Sa Grandeur arrive, et de suite, la procession géante s’organise. Les bannières défilent, abritant les bataillons serrés des hommes. Il y eut d’abord — c’était presque inévitable, avec un tel nombre — un peu d’hésitation et de flottement dans l’ébranlement et l’évolution de ces masses profondes. Monseigneur vient après les hommes, d’où il préside cet immense chemin de croix. Les femmes veulent bien, du moins en grand nombre, suivre docilement. C’est M. l’abbé Barré, directeur du Pèlerinage, qui s’est réservé, pour ce jour, le soin de prêcher le Chemin de la Croix.
Et le vaste courant s’avance dans les trois allées parallèles, débordant parfois sur ses rives. Et toute la foule écoute, prie et chante. Mais voici que déjà les premières lignes escaladent la montée du Calvaire. Et les vastes ondes vont toujours. Bientôt la butte est noire de monde, absolument inondée par les hommes. C’est de là que M. le Directeur prêche les cinq dernières stations du Chemin de la Croix.
…Et ce fut une chose belle, une vue unique, un spectacle inoubliable, que celui de cette multitude répandue partout dans la lande, et vue du haut de la sainte Montagne. En bas, l’on aperçoit les houles paisibles de celte masse énorme qui repose un instant. Combien sont-ils? D’après l’appréciation que j’ai pu établir par le détail, par paroisses, par groupes venus, d’après les renseignements exacts obtenus de divers côtés, je crois pouvoir affirmer que le chiffre de trente mille est loin d’être exagéré, peut être au-dessous de la vérité. Et cette foule était là, priant, chantant, acclamant. Puis, élevant les regards, on jouit de ce magnifique panorama que l’on n’admire qu’ici, on voit surgir des brumes d’un horizon indéfini, toute une couronne de clochers, mâts de vaisseaux de pierre ancrés en terre, pointant vers le ciel, droits comme la prière, symboles de foi et d’espérance, centres de vie surnaturelle, foyers de familles chrétiennes, d’où nous sont venus tous ces pèlerins que l’on contemple ici.
Au milieu de cette foule aux couleurs multiples, Sa Grandeur met sa note violette, comme une note significative, de pénitence, il est vrai, et de réparation, — puisqu’aussi bien c’en est le jour — mais, aussi comme un symbole d’invincible espérance ; car, comment ne pas espérer à voir ce que l’on voit, à entendre ce que l’on entend ?
Voici, en effet, que l’on parle de Jésus mis sur la Croix. C’est la douzième station, la station de la mort, la station du triomphe. La Croix, c’est le pavois d’honneur de Jésus, c’est l’autel où il faut l’adorer, c’est le trône d’où il doit régner : car il est Dieu, car il est Roi. Mais ce Roi, couronné d’épines et crucifié, il faut l’acclamer. Et voici qu’on l’acclame. Et quand j’ai vu trente mille bras se lever vers le ciel dans un geste d’attestation solennelle, trente mille poitrines respirer ensemble, trente mille bouches s’écrier ensemble : Vive Jésus-Christ ! Vive la Croix ! Vive la Religion ! j’ai senti un frisson de vie immortelle courir dans cette masse chrétienne, j’ai compris que Jésus régnait en eux, que l’Eglise ne peut mourir, que la Religion est encore bien vivante. El je me suis dit que notre évêque bien-aimé doit être fier et heureux d’avoir de si vaillants chrétiens pour enfants ; que tous ces chrétiens et chrétiennes qui prient les bras en croix, sans respect humain, se feraient hacher plutôt que de reculer d’un pas devant le grand ennemi ; que, du haut du ciel, les phalanges des anges et des élus devaient se pencher pour nous regarder, que Montfort devait sourire, que Marie devait, bénir, et que Dieu devait être content.
… Et la marée humaine, lentement, sans désordre, quitte le faite du Mont béni et revient envahir les alentours du Prétoire. M. le vicaire général Leroux donne la bénédiction du Très Saint-Sacrement. Comme, en effet, Notre-Seigneur dût se plaire à bénir avec effusion tous ces fronts inclinés et à exaucer toutes ces prières montant vers Lui.
Puis Sa Grandeur fait réciter une dizaine de chapelet à l’intention du Souverain Pontife Pie X, pour tous les évoques français, pour la France pour tous ses diocésains et tous les pèlerins. C’était la fin, quand M. l’abbé Barré paraît au sommet de la scala Sancta, et à la foule émue et bénie par notre évêque il propose d’acclamer sa Grandeur, et, par trois fois, un cri formidable monte de la lande : Vive Monseigneur ! Vivez, en effet, Monseigneur, vivez longtemps encore pour le bien de vos fidèles et la prospérité de votre beau diocèse.
Et comme une marée qui redescend – pour remonter quelque jour, nous l’espérons — la foule se relire et regagne les foyers. Je ne dirai pas les sentiments de chacun, les prières faites, les sacrifices offerts, les mérites acquis, les grâces obtenues, les résolutions prises :
Dieu a tout vu, tout compté, tout pesé ; lui seul saura exaucer et récompenser. Mais je puis dire que cette belle fête laissera dans toutes les familles, sous tous les toits, dans toutes les âmes, un souvenir profond, ineffaçable et salutaire ; qu’elle a été une splendide manifestation de foi chrétienne, de piété exemplaire et de vitalité catholique ; qu’un pays qui compte de tels enfants ne peut périr. C’est pourquoi gardons toujours allumée et vivante dans notre âme la flamme sacrée et inviolable de l’espérance. Mettons donc dans la pratique de notre vie ces paroles qu’un Ange nous présente à lire sur une banderole, au-dessus du groupe béni aujourd’hui, paroles que Monseigneur nous a fait remarquer : Oportet illum regnare ! Il faut que Jésus règne. Oui, que Jésus règne donc sur vous tous, chers pèlerins du Calvaire, qu’il règne sur vous, sur vos enfants, sur vos familles, sur votre Patrie ! qu’il règne ici-bas par sa grâce dans chacune de nos âmes, en attendant son règne sans fin dans la gloire de la céleste Jérusalem.
François PILET.
1M. le marquis de Montaigu.
2M. Arthur de la Villeboisnet, Conseiller général du canton de Pontchâteau.
N° 3 Décembre 1908
Ecce Homo, voilà l’Homme
Les pèlerins qui sont venus au Calvaire le 6 septembre dernier garderont du spectacle grandiose qu’ils ont eu sous les yeux un souvenir inoubliable et délicieux. Ils ont pu et ils peuvent encore admirer l’œuvre admirable de M. Vallet, que sa foi plus encore que son talent a fait éclore.
Cette œuvre si belle va avoir une voisine, une sœur plutôt. Ce sera la troisième en attendant la quatrième pour 1910. Ce nouveau bas-relief est déjà sur le chantier, et M. Vallet y travaille avec son ardeur habituelle et sa science consommée doublée de l’intuition artistique. C’est l’Ecce Homo. Nous en reparlerons quand le moment sera venu. Je voulais simplement vous en donner une première antienne ; nous chanterons le psaume. Réjouissons-nous, chers pèlerins, nous verrons encore de beaux jours.
Une transformation au Prétoire
Durant cet hiver, une transformation va se faire au Prétoire, et tous ceux qui verront ce travail achevé, jugeront, comme nous, qu’il était nécessaire. Voici en quoi il consiste et les raisons qui l’ont motivé :
Il s’agit de supprimer l’escalier latéral du Prétoire et de faire devant toute la façade un escalier monumental qui prendra toute la longueur. Il va sans dire que la Scala Sancta demeure intacte avec ses rampes et ses marches spéciales. En ce qui la concerne, rien ne sera modifié, et les pèlerins pourront continuer de la gravir à genoux en priant, comme par le passé.
Voici pourquoi nous opérons ce changement d’escalier. Nous avons constaté maintes fois, dans les grandes affluences de pèlerins, que la circulation devenait, sinon impossible, du moins très difficile. L’autel étant placé au milieu, au sommet de la Scala Sancta, les pèlerins qui gravissaient l’escalier béni à genoux, arrivés au dernier degré, n’avaient plus de débouché. Ainsi, le 6 septembre dernier, tous voulant aller voir et admirer le nouveau groupe du couronnement d’épines, il se produisait des encombrements puisqu’il n’existe aucune sortie de ce côté et que le passage vers l’autre côté est très difficile à cause de l’emplacement obligatoire de l’autel au milieu.
De plus, le vent et la pluie qui viennent souvent du nord-est endommagent promptement les statues, ils les désagrègent peu à peu. Or, la disparition de l’escalier latéral nous permettra de placer à ce bout un vitrail qui protégera les différents groupes.
Enfin, il y aura plus de commodité pour les foules d’assister à la messe et de voir et entendre le prédicateur. Sous ce rapport l’escalier du bout était gênant et défectueux. Beaucoup s’y installaient — empêchant ainsi toute circulation — et se plaçaient derrière, à l’abri du soleil, et assistaient ainsi que difficilement aux offices. Tandis que le grand escalier de façade permettra à un grand nombre de s’y installer et à tout le monde de suivre parfaitement les différents exercices.
Je ne parle pas ici d’un autre avantage qui, pour être secondaire à un point de vue, n’en est pas moins très appréciable. C’est l’effet grandiose, admirable et saisissant que produira cet escalier monumental. L’esthétique comme la commodité y ont tout à gagner.
Cette transformation a été jugée, non seulement nécessaire, mais urgente. Voilà pourquoi les travaux sont déjà commencés.
Une manifestation grandiose se projette pour l’année prochaine et l’on nous a prié d’y prêter notre concours. Nous voulons le faire avec un grand empressement. Et c’est pour mieux le prêter, pour permettre à la cérémonie future de se déployer dans toute sa grandeur et sa majesté que nous entreprenons immédiatement ce travail.
Mais cette œuvre ne va pas sans de grandes dépenses. Or, cette œuvre est l’œuvre de tous. C’est pourquoi nous avons, je ne dis pas l’espérance, mais la certitude que les ressources ne nous manqueront pas. Le ruisseau qui a coulé coulera encore. Aussi comptons-nous sur la générosité ordinaire et admirable des amis du B. P. de Montfort. Nous prierons comme d’habitude pour nos insignes bienfaiteurs. Mais c’est Montfort surtout que nous chargeons et qui se chargera de les récompenser, c’est Notre-Seigneur Jésus-Christ pour qui nous travaillerons qui se fera un devoir et un bonheur de les payer au centuple en ce monde et dans l’autre. La foi n’est pas morte dans cette contrée, grâce à Dieu ; la charité non plus. Or, la charité enfante des merveilles : la vôtre en fera aussi.
Les travaux au Prétoire
Quel est donc celui auquel il suffirait de frapper du pied la terre pour en faire surgir des guerriers? Il a suffi d’un simple appel au nom du Père de Montfort, pour réveiller le vieil enthousiasme des jours glorieux des travaux du Calvaire. La foi n’est jamais morte; elle est, au contraire, plus forte et plus vivante que jamais dans l’âme de nos chers amis et travailleurs d’antan. Il a suffi d’y faire appel pour raviver le feu sacré de l’élan, comme le souffle réveille le feu qui dort sous la cendre.
Pour commencer les travaux, il nous fallait les éléments nécessaires : du sable, de la pierre, de la chaux et les marches. Nous avons demandé et nous avons été entendus.
Il nous fallait du sable. C’est chez M. le Maire de Crossac, à Quémené, que nous le prenons, chez M. le Maire, le modèle des maires, chrétien et brave cultivateur. Lui-même, malgré les travaux pressants de la campagne, s’est chargé de faire une convocation et de nous faire amener dix charretées de sable le premier jour. Honneur donc et merci à ces braves habitants des villages de Quémené, La Monderais, La Brionnière et de Rion.
Il nous fallait des pierres. Une petite tournée à travers les villages a suffi pour atteler les bœufs aux charrettes. Les pierres sont extraites de deux carrières situées, l’une à Travers, l’autre aux Métairies. Tout aussitôt elles nous sont amenées par ces chrétiens à la volonté droite, au franc parler, à la foi robuste.
Les pierres de la carrière de Travers sont charroyées par les braves habitants des villages de Travers, de Lanoë, de la Buronnerie, et de la Tasnière en Sainte-Reine, de la Cossonnais et de Coismeux en Crossac.
Les pierres prises aux Métairies sont amenées par les hommes des villages des Métairies, de la Viauderie, de la Berneraie, de la Pintaie, de la Plaie, du Buisson-Rond, de Callac.
A tous nous disons merci.
Il nous fallait de la chaux et les marches. Et tout cela vient comme par enchantement. Chacun rivalise d’entrain et de bonne volonté pour rendre service à l’œuvre du P. de Montfort. C’est ici Pontchâteau qui donne avec les vaillants habitants du Calvaire, de la Madeleine, de Sabot-d’Or, de Malabrit, de la Salmonnaie-de-Pie.
A vous aussi toute notre reconnaissance !
Soyez, en effet, tous remerciés, vous qui n’hésitez pas à interrompre vos labours et vos semailles pour donner un coup de main au Calvaire. Mais vous avez confiance en votre bon Père de Montfort. Soyez, en son nom et au nôtre, remerciés a. nouveau. Dieu qui ne laisse pas un verre d’eau froide donnée au pauvre, sans récompense, vous rendra cent pour un ce que vous faites pour l’extension de son règne et de sa gloire.
N° 4 Janvier 1909
Nos Travaux
Ils se poursuivent activement. C’est un vrai plaisir de voir les matériaux se transformer entre les mains de nos braves maçons. Depuis longtemps, ils auraient fait défaut, si le zèle des amis du Bienheureux de Montfort pouvait se refroidir. Il nous fallait encore du sable. Notre bon ami M. le Curé de Crossac, se charge de nous en fournir. Il fait appel à ses paroissiens et dès le lendemain matin le sable nous arrive. Honneur aux braves habitants de la Guène, de la Haie, de Cunta, de Boslas et de l’Hôtel-Guérif ! Dès ce jour, nous aurions eu ample provision, pour tout notre travail, si le sable n’avait pas fait défaut à la carrière. De nombreuses charrettes, nous a-t-on dit, n’ont pu trouver leur chargement. Le Bon Père de Montfort saura récompenser cet admirable zèle.
Nous devons mentionner aussi les villages de la Basinais de Crossac, du Hinguet et de la Porcheraie de Si-Guillaume, qui nous ont amené des pierres. Les premiers envois de marches sont transportés par les habitants du Calvaire, de Beaulieu, de la Richardais, de Malabrit, de la Salmonaie de Pie, villages de Pontchâteau ; et par ceux de Montmara et de Travers, de la paroisse de Sainte-Reine. A eux aussi tous nos remerciements.
N° 5 Février 1909
Nos Travaux
On se plaint, en beaucoup de contrées, de la rigueur de la saison. La neige couvre la terre, le verglas interrompt la circulation, la gelée arrête les travaux. Ici, jamais hiver n’a été plus clément. Jusqu’à présent, le froid n’a fait perdre à nos braves maçons qu’une seule journée. Aussi, le travail s’avance. Les marches se posent au fur et à mesure qu’elles arrivent. Nous avons déjà reçu quatre wagons et les deux derniers ne tarderont pas. Nous n’avons qu’à nous louer de nos ouvriers : carriers, tailleurs de pierres, maçons et manœuvres, tous rivalisent d’activité pour l’avancement du travail. Pas une heure n’est perdue, même après la paie.
Aussi, pouvons-nous jouir dès maintenant de l’heureux effet de notre travail. L’escalier de droite est achevé; la rampe posée. Cet escalier, parallèle à la Scala Sancta, dont il est séparé par la rampe, a huit mètres de large. Il donne directement accès au magnifique groupe du couronnement d’épines et à l’arcade où nous admirerons, en quelques mois, le groupe plus empoignant encore, de l’Ecce Homo, avec son magnifique contraste, la Transfiguration.
Le dévouement des amis du Père de Montfort est toujours le même. C’est avec un joyeux empressement que les habitants de la Moriçais, du Sabot-d’Or, de la Madeleine, des Caves, d’Epars, de la Jouberaie, du Haut-Bodio, de Terre-Neuve, de la Chasselandière, des Coterels, villages de la paroisse de Pontchâteau, nous ont transporté les marches et les paliers. Nos amis du Calvaire se sont aussi fait un plaisir de retourner au sable. Le Bienheureux Père de Montfort saura les récompenser dignement.
N° 6 Mars 1909
Une nouvelle Œuvre du sculpteur Vallet, pour le Calvaire de Pontchâteau
Au cours de sa vie publique, le Messie fut déclaré deux fois Fils de Dieu. Après son baptême dans le Jourdain, il sort du fleuve ; pendant qu’il prie, l’Esprit-Saint se pose sur Lui sous la forme d’une colombe et du Ciel tombent ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en Lui j’ai mis toutes mes complaisances ». Six mois environ avant le sacrifice suprême, Jésus gravit une montagne élevée, probablement le Thabor, en compagnie de Pierre, de Jacques et de Jean ; la nuit descend, on prie et le sommeil s’empare des trois apôtres. A leur réveil, un spectacle merveilleux les éblouit : le Christ rayonne de gloire, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements ont l’éclat de la neige ; Moïse et Elie s’entretiennent avec Lui ; alors Pierre dit au Maître : « Il nous est bon d’être ici ; si Tu le veux, dressons trois tentes, une pour Toi, une pour Moïse, une pour Elie. » Comme il parle, une nuée lumineuse enveloppe les trois personnages et les dérobe aux regards des Apôtres effrayés ; au même instant, une voix céleste crie : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toutes mes complaisances ; écoutez-Le. » Pierre, Jacques et Jean tombent la face contre terre, mais Jésus s’approche d’eux, les touche et leur dit : « Levez-vous ; ne craignez pas. » Ils ouvrent les yeux, le Christ est seul ; le miracle est terminé.
Notons en passant que les témoins privilégiés de la Transfiguration furent ceux de l’Agonie et que, si le sommeil du Thabor fut suivi d’une vision radieuse, au sommeil de Gethsémani succédèrent la trahison et la fuite.
Possédant la nature divine et la nature humaine, le Sauveur devait se faire reconnaître comme Dieu et comme homme. On vient de constater qu’il fut reconnu comme Dieu sur les rives du Jourdain et à la cime du Thabor ; on va voir à présent où il fut reconnu comme homme.
Transportons-nous au Vendredi-Saint. Le Rédempteur vient d’être flagellé ; la soldatesque s’amuse à ses dépens ; Il se dit Roi ; son caprice sera satisfait: un manteau rouge est jeté sur ses épaules sanglantes, une couronne d’épines est enfoncée sur sa tête, on lui place dans la main un roseau, sceptre dérisoire. Alors Pilate le fait amener en présence de la plèbe hurlante et, Le désignant d’un geste dédaigneux, prononce ces simples paroles : « Voilà l’homme ! » c’est-à-dire, voilà ce pauvre misérable, ce passant vulgaire après qui vous vous acharnez sans savoir pourquoi ; comment voulez-vous que je condamne un être aussi innocent ? Je vais le relâcher, et n’en parlons plus.
N’est-ce pas là le dernier degré de l’humiliation ? N’est-ce pas la réalisation tragique de la prophétie de David, au psaume XXI, verset 7 : « Je suis un ver de terre, et non pas un homme ; je suis l’opprobre des hommes et le mépris du peuple. »
Après l’apothéose fulgurante du Thabor vient l’exposition ignominieuse du Prétoire ; Dieu l’a déclaré son Fils, le fonctionnaire de César le déclare le plus vulgaire des hommes ; Jéhovah dit : « Hic est Filius meus dilectus » ; Pilate répond : « Ecce homo ».
Obéissant au pieux désir de l’intrépide directeur du calvaire de Pontchâteau, M. Vallet consacre son inspiration chrétienne et son admirable talent à présenter ces deux pages évangéliques aux foules qui accourent de plus en plus nombreuses sur la lande de la Madeleine.
Déjà, la Transfiguration s’achève ; je viens de l’étudier avec joie dans l’atelier si hospitalier de la rue de Rennes, et je veux la décrire brièvement.
Au centre, plane le Sauveur, en des vêtements presque immatériels ; les bras sont étendus horizontalement, et de sa personne sacrée partent des rayons en forme de croix ; l’idée de l’artiste est ingénieuse ; ne lit-on pas, en effet, dans saint Luc (IX, 31) : « ils parlaient de la manière dont il devait finir ses jours dans Jérusalem. » A droite et à gauche du Messie et planant au-dessus du sol, mais vêtus de robes aux plis lourds, Moïse et Elie écoulent le Sauveur avec une respectueuse attention. Au-dessus du Fils apparaît, dans un nuage, le Père Eternel ; il est entouré de fines têtes de chérubins. Le haut de la composition est encerclé de la plus heureuse manière par une banderole trilobée.
Ce nouveau travail honore grandement M. Vallet qui, sans la moindre servilité, s’est inspiré de Raphaël ; avec une ardeur juvénile, il va sous peu commencer à pétrir la scène de l’Ecce Homo qui servira de base à la Transfiguration. Lorsque ces nobles œuvres seront placées à la Scala, les pèlerins de Pontchâteau contempleront d’un seul regard les deux pages si instructives que je viens de rappeler : glorifié par Dieu, méprisé par les hommes, voilà toute la vie du Rédempteur ; l’épreuve de l’humiliation est nécessaire pour mériter l’apothéose ; il faut passer par le Prétoire pour monter au Thabor.
Baron Gaétan de Wismes.
N° 7 Avril 1909
Nos Travaux
Notre escalier du Prétoire est entièrement terminé. Tous les pèlerins en admirent l’effet grandiose. Le monument a gagné cent pour cent. Ils voient en même temps combien cette amélioration facilitera les cérémonies et la circulation des foules. Ceux qui graviront à genoux les degrés de la Scala Sancta ne seront pas troublés dans leur pieux exercice par les visiteurs qui monteront par l’un des escaliers latéraux et descendront par l’autre.
Nos remerciements à tous ceux qui nous ont aidés dans cette œuvre. Aux villages déjà signalés nous devons ajouter ceux des Caves, de Beaumare, du Haut-Bodio, de la Jouberaie, du Sabot d’Or, de la Madeleine, de la Petite-Madeleine, d’Epars, de la Moriçais, de Terre-Neuve, de la Cacognais, de la Herviais, des Cottrais, etc., villages de Pontchâteau qui nous ont transporté de la gare au Calvaire les derniers wagons de marches.
Il nous fallait relier le Prétoire à l’avenue des tilleuls, faire des plantations à la place de l’ancien escalier et restaurer le sommet de la montagne du Calvaire. Notre cher et vénéré Curé de Pontchâteau a fait appel aux hommes de sa paroisse et le mercredi des cendres nous est arrivé une nombreuse et vaillante équipe de travailleurs. M. le Curé a bien voulu se charger de diriger lui-même les travaux du Calvaire. Messieurs les Vicaires et M. l’abbé Cousin se sont occupés des plantations et des nouvelles avenues. Le travail s’est poursuivi avec un joyeux entrain et au chant des cantiques. La journée s’est terminée par le Salut du Très-Saint Sacrement donné par M. le Curé. C’était un devoir pour nous de féliciter et remercier chaudement notre bon et dévoué M. Lebert, ainsi que ses chers et braves paroissiens. Nous l’avons rempli avec une grande joie.
Dès le temps de la construction du Prétoire et de la Scala Sancta, on nous avait souvent exprimé le désir de voir une grande avenue relier ce monument au Calvaire.
Ce désir nous a été renouvelé de nombreuses fois depuis par les chers et regrettés Pères Grolleau et Sarré, par le dévoué directeur de nos travaux, M. le Chevalier Gerbaud et, par bon nombre de nos amis. — « Voyez, nous disaient-ils, comme cette avenue serait d’un magnifique effet! Du Prétoire, comme le Calvaire serait beau vu entre deux belles et longues rangées d’arbres ! Et du Calvaire comme le Prétoire serait magnifique à l’extrémité de cette avenue avec les arbres pour cadres.
— Ce désir était aussi le nôtre. Mais de nombreux obstacles, des obstacles pour lors insurmontables, nous empêchaient de penser à le réaliser. Le Bienheureux de Montfort nous est venu en aide, tous les obstacles se sont successivement évanouis. Ce qui alors eût été traité de folie, va se réaliser grâce au généreux dévouement de M. le comte de la Villeboisnet qui veut bien nous autoriser à faire cette avenue sur sa propriété.
Nous avons déjà commencé notre plantation et elle sera prochainement terminée.
Nous jouirons pleinement de sa beauté seulement dans dix ans.
Mais dès cette année, notre nouvelle avenue quoique inachevée va nous être très utile dans la grande manifestation eucharistique du 24 juin. C’est l’avenue que suivra la procession du Très-Saint Sacrement en retournant du Calvaire au Prétoire.
N° 8 Mai 1909
Les Centenaires (1709-1710)
Il y a deux cents ans, à pareille date, il se passait dans les contrées que nous habitons des choses absolument extraordinaires, dont il est bon de se rappeler l’intéressant souvenir. Le récit détaillé de ces faits se trouve longuement raconté dans les très nombreuses vies de Montfort.
Le diocèse de Nantes était à cette époque entièrement infestée de la lèpre jansénienne, et la terre où nous sommes, n’en était nullement épargnée. Les populations d’alors étaient loin de valoir celles d’aujourd’hui malgré le malheur des temps. Il fallait une audace inouïe pour oser attaquer en face l’hydre aux cents tètes toujours renaissantes ; un courage indomptable pour résister à ses coups et parfois à son poison. Montfort eut cette audace et ce courage apostolique. La foi qu’il sema à pleines mains porta des fruits merveilleux. La révolution passa sans l’entamer.
*
Un fait domine tous les autres dans la campagne évangélique que fit Montfort au nord du diocèse de Nantes, de janvier 1709 à septembre 1710 : c’est l’érection d’un Calvaire. Il avait toujours rêvé d’élever quelque part à la Croix un piédestal grandiose. Les anciens de Campbon rapportent que Montfort avait d’abord songé à l’élever sur une petite montagne située en Quilly, alors de la paroisse de Campbon. Mais l’hostilité jansénienne le fit échouer. Il songea ensuite à Ste Reine, durant la mission de Pontchâteau. Mais, là encore, une intervention providentielle vint modifier son plan en le dirigeant ailleurs, cette fois avec certitude. Peu à peu, en effet, on le voit, comme poussé par une force mystérieuse, se diriger vers les Cieux prédestinés où son rêve va prendre corps et devenir une réalité splendide.
*
La fixation de la date des différentes missions que donne Montfort dans cette contrée a été traitée longuement et soigneusement autrefois, par M. l’abbé Barré. Voici ce que nous lisons dans une note du numéro de mai 1903 :
« Induits en erreur par M. Olivier, tous les historiens du Père de Montfort placent la mission de Pontchâteau au mois de juillet et après celle de Crossac. Mais nous avons la preuve que la mission de Pontchâteau suivit immédiatement celle de Campbon, et se termina au commencement de mai, tandis que celle de Crossac n’eut lieu que dans le mois d’août. Nous avons entre les mains un contrat d’alliance avec Dieu signé de la main du Bienheureux et donné par lui à la fin de la mission de Pontchâteau. Nous y lisons ces mots : « Fait en face de l’église de Pontchâteau, le 4 mai 1709. L. de Montfort, prêtre.
Non seulement la signature, mais aussi les mois Pontchâteau, 4 mai, sont de la propre main du missionnaire. La mission de Pontchâteau, qui s’est terminée au commencement de mai, a donc eu lieu aussitôt après Pâques, immédiatement après celle de Campbon, que le Bienheureux avait fait durant le Carême. La mission de Crossac n’a donc pu avoir lieu avant celle de Pontchâteau. »
Il nous semble probable qu’après la mission de Pontchâteau, le Bienheureux retourna dans l’est du diocèse de Nantes où il avait évangélisé plusieurs paroisses l’année précédente. Il y donna des missions jusqu’au mois de juillet et revint à Pontchâteau. C’est alors seulement que commencèrent les travaux du Calvaire. Les engagements pris dans l’autre partie du diocèse avaient empêché Montfort de les commencer sitôt après la mission de Pontchâteau.
Revenons à la note de M. l’abbé Barré : « La mission de Crossac a dû avoir lieu dans les mois d’août. La preuve nous en est fournie par le registre des sépultures. Durant la mission, le Père de Montfort fit signer aux notables de Crossac l’engagement de ne plus se faire enterrer dans l’église. Or, la dernière sépulture faite dans la nef de l’église eut lieu le 24 juillet. C’est donc après cette date qu’il faut placer la mission de cette paroisse. La première sépulture faite dans le cimetière est inscrite au 25 août. La mission était donc alors au moins commencée. Une autre preuve que cette mission n’a pas eu lieu avant cette époque, c’est que les habitants de Camérun, très assidus à suivre les exercices de la mission, traversaient les marais à pied avant le jour pour assister à l’instruction du matin.
Or, l’on ne peut pas traverser le marais à pied avant le mois de juillet, et le voyage avant le jour suppose le mois d’août.
Quand le Père de Montfort arriva à Crossac, la paroisse était administrée par un Vice-Gérent, M. Jacques Chotard ; le recteur, M. Gilles Halgan, était mort le 12 mars 1709. Son successeur, M. Jean Cuvin, fut installé probablement pendant la mission. Il l’était certainement le 25 août, puisqu’il présidait ce jour-là la première sépulture dans le cimetière ».
La mission de Crossac fut suivie de celle de Besné. Celle-ci « commença dans les premiers jours de septembre 1709. Les habitants de Besné comme ceux de Crossac avaient le droit de faire inhumer leurs défunts dans l’église. Durant la mission, vivement sollicités par le saint missionnaire, les notables s’engagèrent par acte notarié à ne plus permettre les inhumations dans l’église. Cet engagement fut pris le 22 septembre 1709 et signé par un bon nombre d’habitants et par le saint Missionnaire. Nous en avons vu la copie dans les Archives de la paroisse. La dernière sépulture faite dans l’église, celle de Jean Tassé, avait eu lieu le 27 juin précédent1. »
Comme M. des Bastières l’avait quitté après la mission de Crossac, le Père de Montfort dut se trouver surchargé à Besné. Aussi fallut-il se procurer un aide avant de commencer la mission de Missillac. Ce fut le but d’un voyage à Nantes, d’où il amena M. Olivier.
Commencée en octobre, la mission de Missillac se termina le 1er décembre, premier dimanche de l’Avent. En voici la preuve, extraite textuellement des Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures de Missillac:
« Le premier jour de décembre 1709, le nouveau cimetière acheté de François Périon, par les paroissiens, a été béni par M. de Montfort, Missionnaire apostolique, faisant actuellement la mission en cette paroisse, qui finit ce jour, premier dimanche des Avents.
L.-M. de MONTFORT.
THIBOUT, recteur ».
La mission de Missillac fut immédiatement suivie de celle d’Herbignac. Celle de Camoël, que M. Olivier place en 1709, n’a pu avoir lieu qu’au commencement de 1710.
*
PONTCHATEAU. — La mission de Pontchâteau est sans contredit une des plus célèbres et des plus importantes qu’ait donné Montfort, à cause des conséquences et du retentissement qu’elle a eue à l’époque contemporaine et dans les âges futurs. L’ancienne paroisse de Pontchâteau embrassait une immense étendue. Elle comprenait les paroisses actuelles de Pontchâteau, St-Roch, St-Guillaume et Sainte-Reine.
La mission de Pontchâteau fut menée de la première partie avril au milieu de mai, et dura un grand mois. Elle eut le succès de toutes les autres. Montfort fit notamment paver, blanchir et décorer l’église. Mais le fait le plus marquant de cette mission fut l’inauguration des travaux de son Calvaire. Il choisit son heure, son temps et son lieu pour en parler. Tous, prêtres et peuple acceptèrent sa proposition avec enthousiasme. Comme on le sait, il avait d’abord proposé d’édifier son Calvaire à Sainte-Reine, où l’on en voit encore l’emplacement choisi, marqué par un plus modeste, mais pittoresque Calvaire. Le miracle des gentilles colombes le fait changer de lieu, et c’est alors qu’il jette les yeux sur la lande de la Madeleine et où les petites porteuses de terre s’étaient arrêtées.
Alors, sous l’ardeur embrassante de Montfort, naît ce magnifique et unique mouvement qui se poursuit sans interruption, sans ralentissement, sans murmures, durant quinze mois. Il ne rentre pas dans mon cadre de relater les éphémérides de ce long travail. L’histoire en est dans toutes les mains et dans toutes les mémoires. Les familles conservent pieusement le legs sacré des traditions et des souvenirs transmis par leurs ancêtres. Tous savent par les détails les péripéties de ce gigantesque ébranlement des peuples, que couronna le plus grandiose des monuments élevés à la Croix et que couronna la plus sanglante des humiliations. Le disciple ressembla au Maître. Mais n’anticipons pas.
En ce moment nous sommes tout à la joie. Arrêtons-nous un instant pour contempler ce spectacle émouvant de foi et d’enthousiasme.
« La vaste lande que traverse aujourd’hui la route île Nantes à Vannes, avait alors, dit M. Olivier, environ une lieue et demie de tour… Elle est faite en forme de surface de champignon… M. Grignion forma le dessein de construire un Calvaire au lieu le plus élevé de cette lande. C’était en 1709, vers la fin du mois de juillet et le commencement d’août. »
Montfort donne l’élan, et tout le monde part. Il donne le premier coup de bêche, et durant lu mois, le travail ne discontinue pas. Toute la Bretagne et la Vendée accourent. On y vient d’Espagne et des Flandres. Les enfants du peuple rivalisent avec leurs seigneurs et leurs châtelains. On bêche la terre, on transporte des pierres, on chante, on prie. Hommes, femmes, garçons et filles, s’y pressent au nombre de 300 par jour On y voit parfois jusqu’à 5 ou 600, avec une centaine de bœufs. Et ce mouvement admirable dura 15 mois Montfort n’était pas toujours là, mais il y venait souvent et animait tous de sa foi et de son ardeur. On y vit des merveilles et la réalisation de visions et de paroles prophétiques.
« Un vieillard de quatre-vingts ans et ses deux enfants, âgés d’environ soixante ans, qui sont venus à confesse à moi, raconte M. Olivier, le compagnon des travaux de Montfort, m’ont dit avoir vu, où était le Calvaire, il y avait en ce temps-là environ cinquante ans, sur l’heure de midi, le temps était fort clair, des croix environnées d’étendards qui descendaient du ciel dans le même endroit ; et ils ajoutaient qu’il se fit dans le moment un si grand bruit en l’air que les bêtes qui paissaient dans la lande s’enfuirent dans les villages voisins, et que cela se termina par un nombre infini de voix qui formaient une agréable harmonie ; que le tout dura bien environ une heure, et que plusieurs autres personnes avaient vu et entendu la même chose. »
Oh ! ces croix, ces étendards, ce nombre infini de voix qui chantent harmonieusement, ce n’est pas seulement pendant une heure, depuis une heure qu’on les entend et qu’on les voit, que voient et entendent des milliers et des milliers de pèlerins et de pèlerines, témoins à la fois et acteurs. Voilà deux cents ans que l’on voit se réaliser cette vision et ces paroles prophétiques du grand thaumaturge:
Oh ! qu’en ces lieux l’on verra de merveilles !
Que de conversions,
De guérisons, de grâces sans pareilles.
De merveilles, de conversions, de guérisons, de grâces, cette contrée en est inondée, et nos belles annales en sont pleines. Les merveilles, elles se sont déroulées régulièrement ici presque chaque jour depuis deux cents ans. Les merveilles, l’année dernière encore, nous en avons eu d’étonnantes, et cette année, et l’année prochaine, nous en verrons de belles aussi et de consolantes. C’est pourquoi Montfort entraînait les foules par ces paroles :
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Et le Calvaire fut fait.
*
Je n’ai pas voulu faire de l’histoire, mais vous rappeler un souvenir de famille, un geste héroïque de vos aïeux, une page immortelle, la première dans l’histoire du Calvaire de Pontchâteau.
La deuxième fut écrite en 1747-1748, par vos aïeux encore, sous la direction des PP. Mulot et Audubon.
La troisième, sous l’impulsion de M. Gouray, curé de Pontchâteau, de 1821 à 1825.
La quatrième s’écrit encore et n’est pas la moins belle pour la gloire de la croix et de Montfort.
En ces années anniversaires, répétons ce refrain que chantaient nos aïeux :
Allons au Calvaire, allons,
Allons au Calvaire.
A ce Calvaire béni, abattu et relevé tant de fois, ne serait-il pas opportun, en ces années de souvenirs, d’y mettre la dernière main, de le parachever enfin pour la grandiose manifestation du 14 septembre 1910, deuxième centenaire de la grande humiliation de Montfort, le 14 septembre 1710? Assurément, les descendants de ceux qu’évangélisa Montfort ne voudront pas se montrer au-dessous de leurs aïeux, et peut-être n’attendent-ils qu’un appel ? Confiance ! cet appel viendra et renaîtra aussi l’enthousiasme des anciens jours, et vous pourrez chanter encore les cantiques de votre Père : Travaillons tous à ce divin ouvrage, Dieu nous bénira tous ; Grands et petits, de tout sexe et tout âge : Faisons un Calvaire à Dieu, Faisons un Calvaire.
François PILET.
1Mémoire de l’abbé Bertho.
N° 9 Juin 1909
Fête du 24 Juin
Pèlerinage eucharistique.
Bénédiction des deux groupes de l’Ecce Homo et de la Transfiguration.
La fête sera présidée par Monseigneur l’Evêque de Nantes.
Cérémonies du matin
A 10 heures, Messe au Prétoire.
Discours de Monsieur le Chanoine Ménard, Directeur des œuvres diocésaines.
Bénédiction du nouveau groupe, par Monseigneur l’Evêque de Nantes.
Cérémonies du soir
A 1 h. 3/4, Allocution par Monsieur l’Abbé Deval.
Procession du Très Saint-Sacrement.
Nota. — 1° Toutes les paroisses du diocèse sont invitées à cette fête. Nous serons très heureux d’y voir aussi prendre part, selon l’usage traditionnel, les paroisses des diocèses voisins, celles du diocèse de Vannes en particulier qui ont contribué pour une si grande part aux travaux du Calvaire.
2° Messieurs les Curés sont priés d’apporter leurs croix et bannières.
3° Le matin, les paroisses se placeront devant le Prétoire dans l’ordre de leur arrivée. Avant la cérémonie du soir, au son de la cloche, à 1 h. 1/2, les pèlerins se grouperont autour de leurs bannières paroissiales. Des poteaux indicateurs feront connaître la place de chaque bannière.
4° Messieurs les Curés qui voudront bien venir avec leurs bannières sont priés de le l’aire savoir à M. l’Abbé Barré, directeur du Pèlerinage, afin qu’il puisse leur assigner une place.
5° M. le Directeur du Pèlerinage est heureux d’offrir à déjeuner aux prêtres. Il prie seulement ceux qui voudront lui faire l’honneur et le plaisir d’accepter son invitation de lui envoyer leurs cartes, au moins 8 jours avant la fête.
Ainsi que l’a annoncé la Semaine religieuse de Nantes, l’organe officiel du diocèse, le pèlerinage eucharistique au Calvaire de Pontchâteau aura lieu le jeudi 24 Juin. Il sera présidé par Monseigneur l’Evêque.
Le matin, Sa Grandeur bénira les deux groupes de l’Ecce homo et de la Transfiguration sculptés par M. Vallet.
Dans l’après-midi, aura lieu dans le vaste enclos du pèlerinage la procession en l’honneur du Très Saint-Sacrement.
Deux sermons seront donnés, l’un le matin par M. le chanoine Ménard, l’autre le soir par M. l’abbé Deval.
Comme vous le voyez, cette fête a un double but qui n’en fait qu’un parce qu’il se résout à un seul objet et se concentre sur une seule personne : c’est la glorification de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans sa Passion et son Eucharistie.
Disons donc un mot de chacun d’eux.
Un mot a été dit de la Transfiguration, la partie haute de l’œuvre. Il me reste à dire un autre mot de l’Ecce homo, la partie basse et principale. Je vous ai déjà entretenu ici de la scène historique du Prétoire. Présentement, je veux vous parler de l’œuvre qui réalisera cette scène et qui s’achève à cette heure dans les ateliers de M. Vallet.
Le nouveau groupe comprend douze personnages. Il est à double plan.
Au milieu du cadre des personnages se détache l’Homme-Dieu, Jésus grand et beau, divinement douloureux, rayonnant sous la pourpre de son sang que l’on devine couler de ses plaies comme de sources silencieuses. Il est tel qu’il fut mis sur la colonne de la Flagellation par les lanières acerbes des bourreaux. Il est tout rouge, comme un homme qui vient de fouler le raisin dans le pressoir. Comme un roi qu’il est, il a la couronne en tête, mais c’est une couronne faite d’épines, et, comme pour mieux marquer à Jésus son caractère de roi, elle a laissé autour de son front une empreinte sanglante, elle a enfoncé ses pointes aiguës dans la chair vive. Et des mille petites ouvertures ont jailli des rubis de sang qui projettent comme un flamboiement d’auréole autour du front de Jésus. On a jeté sur ses épaules le Sagum ou manteau court des soldats. Et sous la chlamyde rouge, le corps de Jésus apparaît tout labouré par les coups de fouet de la flagellation, littéralement zébré de cicatrices, de plaies dont les lèvres entr’ouvertes laissent encore filtrer de minces filets de sang. C’est vraiment l’homme des douleurs et la parole de Jérémie se réalise avec une minutieuse exactitude. Depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête, il n’y a pas une partie saine en lui.
Et sous le voile sanglant de la souffrance, Jésus, apparaît plus beau, parce que cette souffrance est toute imprégnée, toute palpitante d’amour. Sur le front de Jésus on lit le calme, la résignation, l’acceptation delà douleur. Dans les yeux de Jésus on voit passer des flots de tendresse, d’amour et de commisération. Sur les lèvres de Jésus, il semble qu’on entend passer un murmure de pitié, de prière et de pardon. Sur tous ses traits rayonne une majesté surhumaine, divine.
Voilà l’homme, tel que l’a réalisé M. Vallet, avec son érudition de savant, doublée de l’intuition de l’artiste, éclairée par sa foi de chrétien.
*
A la droite de Jésus se tient Pilate. Il est drapé dans-un ample manteau aux plis savants, naturels et harmonieux. Il est digne, mais son front est inquiet. Car, derrière le masque romain de sa figure de proconsul, on devine une complexité très subtile de sentiments divers, presque opposés. Il paraît chef, mais chef responsable. On lit sur ses traits du froissement pour les avances de sa politique qui a chaque fois fait faillite devant l’obstination haineuse des Juifs. On sent que l’irritation monte, que la colère n’est pas loin. Mais on pressent aussi que la lâcheté guette par derrière. Car, Pilate a encore dans les oreilles l’écho dominateur des terribles paroles : Si tu délivres cet homme, tu n’es pas l’ami de César. Et Pilate veut à tout prix demeurer l’ami de César. Mais on sait aussi que Pilate voudrait — presque à tout prix — délivrer Jésus. Sa femme Claudia l’en presse, l’en abjure, car la nuit précédente, elle a été effrayée par des songes au sujet de Jésus. Lui-même, Pilate, croit à l’innocence de Jésus, il voudrait le délivrer, mais il ne le peut pas — politiquement — car il tient plus à sa place, à l’amitié de César qu’à l’innocence d’un homme. Voilà pourquoi il a tergiversé. Mais sa politique tortueuse commence à exaspérer la populace.
Il avait fait flageller Jésus, l’avait comparé à Barabbas. Rien n’avait réussi. Il veut risquer un coup de théâtre et sa dernière chance. Aussi, sur la face glabre du gouverneur, est-ce l’ennui qui prédomine, et c’est dans un geste de découragement qui sort de toute sa personne qu’il montre la douce victime, et on croit entendre sortir de sa bouche les paroles à jamais mémorables : Voilà l’Homme.
*
Au côté gauche de Jésus se tient un Juif salarié. D’une main il soulève, avec une joie cruelle, un pan du manteau de Jésus, pour bien montrer à tous les Juifs, ses frères en férocité, qui ricanent en bas, cet homme dont le corps est criblé de blessures. A côté de Pilate, mais par derrière, apparaît un autre salarié Juif, brossé de main de maître, dont les lèvres, le nez, les yeux ont un superbe retroussis de race haineuse. Il tient à la main une corde, prêt à ligoter Jésus, dès que la lâche capitulation de Pilate le leur aura livré pour être crucifié.
*
Au second plan s’aligne une rangée de soldats romains et gaulois avec leurs officiers, surveillant la manœuvre odieuse. Les maîtres du monde sont là, et ils le paraissent, et ils le montrent. Ils sont témoins impassibles, irresponsables, mais non indifférents. Ils surveillent une corvée faite par ces juifs qu’ils dédaignent, exécutée par ces salariés de toutes nations. On sent passer sur leur belle, intelligente et expressive figure, de la sympathie pour Jésus, de la pitié pour Pilate, et une pointe très accusée de profond mépris pour ces Juifs vaincus dont le caractère se manifeste d’une façon brutale et révoltante dans l’ignoble besogne où ils se complaisent.
*
Dans un coin se campe fièrement un soldat vieilli dans les camps, un vétéran des armées romaines. Il porte sur sa face énergique, comme une signature, la morsure de tous les climats qu’il a traversés, de toutes les saisons qu’il a subies. C’est le porteur des insignes proconsulaires que l’on voit, ainsi que les lances des soldats, apposées sur le fond.
*
Dans le bas, on aperçoit comme un fouillis de jambes et de pieds, mais ce n’est pas un fouillis désordonné, et il faut admirer avec quel art consommé et quel rare bonheur M. Vallet a su donner à chaque personnage sa pose naturelle. Car, ce qui frappe, chez lui, ce n’est pas une fantaisie artistique, un caprice imaginaire, une conception vaporeuse. Non, c’est le scrupule de la vraisemblance, de la couleur locale, de la perfection du beau et du vrai ; c’est l’exactitude rigoureuse, je dirais, minutieuse, dans les personnages, dans leurs physionomies si variées et si expressives, dans leur costume particulier, dont la pose correspond à leur état d’âme, dans le milieu où ils se sont agités, dans l’expression de leurs sentiments intimes; c’est l’habileté qu’il a fallu pour placer ces nombreux acteurs dans un cadre restreint, et leur donner pourtant une aisance parfaite, une personnalité respective et une puissance de vie étonnante. Voilà ce qui rend cette œuvre vraiment artistique. La majesté souveraine répandue sur le visage de l’auguste Martyr, le souci profond peint sur les traits de Pilate, le groupe impassible des soldats, donnent à toute la scène un cachet spécial de calme, de gravité, de fermeté, en même temps qu’une impression de vie puissante mais contenue, intime, plutôt dans l’âme. Il y a dans cette œuvre une psychologie très étudiée qui fait le plus grand honneur à l’artiste distingué que se montre de plus en plus notre cher ami, M. Vallet.
2° Le Pèlerinage eucharistique
Après la cérémonie du matin qui sera plutôt une fête particulière du pèlerinage, il y aura, le soir, une fête générale en l’honneur de l’Eucharistie. Toutes les paroisses du diocèse de Nantes y sont particulièrement convoquées. Mais il est de tradition oculaire que les paroisses des diocèses voisins se joignent à celles du diocèse de Nantes dans les manifestations du Calvaire; c’est pourquoi elles sont spécialement invitées, particulièrement celles du diocèse de Vannes.
Nous convions tout le monde à ce pèlerinage eucharistique, car plus il y aura de chrétiens ici, plus Jésus sera loué, honoré, adoré. Que Saint-Nazaire et Nantes, entre autres, dont les processions eucharistiques du passé ont laissé un souvenir inoubliable, viennent ici en retracer les splendeurs. La campagne de la Madeleine s’y prête admirablement. Venez donc de partout faire à Jésus-Hostie un triomphal cortège et une merveilleuse apothéose.
*
Celui qui se cache sous les voiles eucharistiques, celui que nous recevons sous les frêles apparences du pain et du vin, c’est un homme et c’est un Dieu. Or cet Homme-Dieu participe à tous les droits de la divinité. Cet Homme-Dieu, Jésus, au Saint-Sacrement de l’autel, a droit à tous nos hommages. Or, le premier de tous les devoirs que nous devons rendre à Dieu — donc à Jésus dans l’Eucharistie — c’est l’adoration. Venez donc, et tous ensemble adorons Dieu dans l’Hostie. Dieu n’est pas seulement au ciel, il ne descend pas seulement une fois par an dans nos églises, comme autrefois à Jérusalem dans le Saint des Saints. Il habite et réside personnellement et perpétuellement au milieu de nous, au Tabernacle. Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu.
Or, ce Verbe, Fils de Dieu, qui, dans le ciel, avant les temps, fut salué et adoré par la troupe des Anges fidèles qui se soumirent par avance à sa royauté humaine ; ce Jésus qui naquit dans une crèche et dont la naissance fut saluée et annoncée par les anges dans le ciel et par une étoile en Orient; ce Jésus qui, durant tout le cours de sa vie mortelle, fut entouré d’hommages et de respect, à cause des prodiges et des bienfaits qu’il semait autour de lui; ce Jésus qui fut trahi et condamné à mourir sur une croix parce qu’il s’était dit Fils de Dieu et dont toute la nature atteste la divinité ; ce Jésus qui sortit triomphant du tombeau, en brisant le dard de la mort; ce Jésus, c’est le même que le Dieu de l’Eucharistie. L’Eucharistie, c’est lui-même.
Notre-Seigneur est remonté au ciel, dans la gloire, mais il demeure en même temps parmi nous, ayant fait cette invention étonnante de demeurer personnellement et dans le ciel et sur la terre. Et depuis lois, tout genou doit fléchir devant Jésus-Hostie au ciel, sur la terre et jusque dans les enfers. Dans l’Hostie trois fois sainte, Jésus est tout entier, Dieu et Homme, avec tout son amour et tous ses bienfaits. Il a donc droit à tous nos hommages, à toutes nos révérences, à toutes nos adorations. Son trône céleste est environné d’anges qui le chantent et l’adorent; les Vierges et les Martyrs le célèbrent; les vingt-quatre vieillards se prosternent jour et nuit devant le trône de l’agneau immolé mais glorieux et lui offrent leurs couronnes ; l’encens brûle et monte devant sa face. Soyons donc, nous aussi, chrétiens, les anges adorateurs de Jésus sur l’autel. Environnons son trône, et offrons-lui nos devoirs de prière, de respect et d’adoration.
C’est dans l’Eucharistie, en effet, que nous devons surtout adorer Jésus. L’Eucharistie est l’extension de l’Incarnation, Or, dans le mystère de l’Incarnation Dieu s’est caché sous les voiles de l’humanité. Il s’est anéanti, dit saint Paul, en prenant la forme d’un esclave. Mais dans l’Eucharistie l’anéantissement continué est encore plus complet et poussé jusqu’aux dernières limites. Ce n’est plus sous les traits d’un être, du reste raisonnable, libre, et encore noble et beau que Dieu se cache, mais sous les apparences de la matière inerte du pain et du vin. Dans l’Eucharistie, ni l’homme ni le Dieu n’apparaissent. L’humanité comme la divinité se sont dissimulées sous les voiles sacramentels du pain et du vin. Mais sous cet abaissement profond, l’œil de notre foi découvre le môme Dieu qui s’est fait homme; et l’amour qu’il nous témoigne nous presse de lui rendre par la ferveur de notre foi et de nos adorations, la gloire extérieure dont il se prive. Devant cet abaissement, jetons ce cri de foi de saint Pierre : Je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant ; jetons aussi son cri d’amour: Seigneur, vous qui connaissez tout, vous savez que je vous aime.
Mais cette Eucharistie, autour de laquelle l’amour et la reconnaissance devraient monter une garde éternelle, ce sacrement de la tendresse infinie, il est méconnu par les ingrats, oublié par les indifférents, outragé par les impies, trahi et vendu par les Judas. Nous qui savons combien Jésus souffre de ces ingratitudes, de ces mépris, de ces oublis, de ces insultes, de ces trahisons, venons presser nos rangs pieux autour de lui ; venons monter autour de l’ostensoir une garde d’honneur et d’amour; venons réparer les outrages des méchants, les tiédeurs des indifférents; venons lui prodiguer nos hommages d’adoration, venons lui protester que, s’il venait à être chassé du reste de la terre, il trouverait du moins chez nous, dans nos cœurs, un asile inviolablement Adèle.
François PILET.
N° 11 Août 1909
La Fête du 24 Juin 1909
A 10 heures du matin, quand la sainte Messe commença au Prétoire, une foule énorme était déjà massée sur l’esplanade et dans l’avenue. La marée, dont je parlais lors de la fête du 6 septembre 1908, était revenue battre de ses flots aussi abondants les abords du Prétoire et du Calvaire, ou plutôt, de 7 à 10 heures, la foule avait, pour ainsi dire, surgi de terre comme une mystérieuse moisson de chrétiens. On était venu nombreux de tous les points du diocèse de Nantes, des diocèses aussi de Vannes et de Rennes. Ne sont-ce pas des diocèses frères ? Et il serait plus facile de dire d’où l’on ne venait pas que d’où l’on était venu. Au moins cinquante-huit paroisses avaient annoncé qu’elles viendraient avec leur bannière, et le mauvais temps seul les a empêchées de le faire. Les connaisseurs ont évalué la foule, le matin, au chiffre d’au moins trente mille. Ce nombre grossit encore pour la cérémonie du soir. Et peut-être que, sans les menaces de pluie, nous en aurions compté un bon quart de plus. Chaque paroisse vient se ranger au pied du monument à son tour d’arrivée. Mais voici qu’on entend l’éclat triomphal d’une harmonie. C’est la musique des Touches et les clairons de Missillac qui jettent aux échos de la lande leurs notes stridentes. J’aime la musique dans une solennité. Cela donne un cachet plus joyeux, plus festival.
Il est vrai que si le pèlerinage est si nombreux, si le courant est si abondant, si la moisson a pris, germé et mûri avec tant de vigueur et d’exubérance, c’est que tout a été admirablement et soigneusement préparé. M. le Directeur du pèlerinage y a déployé, depuis de longues semaines, une énergie qui ne se dément pas, une entente qui s’affine et se perfectionne, une activité qui n’accuse aucune fatigue, aucune défaillance plutôt, et que ne trahit point encore l’implacable débilité de l’inéluctable vieillesse. Il est vrai de dire aussi qu’il a été puissamment secondé par des auxiliaires tout remplis de dévouement, de jeunesse et d’entrain. Il est vrai de dire encore que nous avons trouvé dans M. Lanoë et dans tous ces Messieurs du comité des pèlerinages diocésains un concours précieux dont nous les remercions cordialement. Il est vrai d’ajouter enfin que nous ne pouvons que nous féliciter de la courtoisie et de l’amabilité de toutes les Compagnies et de l’Administration des Chemins de fer, et c’est un devoir pour nous de les remercier de leur dévouement empressé.
C’est donc devant cette foule de trente mille chrétiens, se mouvant à l’aise dans la magnifique avenue de trente mètres de large qui relie maintenant le Prétoire au Calvaire, dans un merveilleux décor de verdure et drapeaux de fêle qui claquent au vent et qui semblent, eux aussi, à leur manière, applaudir gaiement et appeler le peuple à la joie de ce jour, que commence la sainte Messe, à 11 heures précises. Elle est dite par Mgr Pichon, archevêque de Cabaza, coadjuteur de Mgr Conan, archevêque de Port-au-Prince, à Haïti. C’est un enfant du Calvaire et un ami de Montfort.
Vous allez peut-être croire à l’absence de sa Grandeur Monseigneur l’Evêque de Nantes? Non, ne le croyez pas, et rassurez-vous. A cette fête, née sous son inspiration, organisée sous son patronage, encouragée par ses bénédictions, Sa Grandeur ne pouvait pas et n’a pas voulu se dérober. Elle voulait voir une fois de plus de ses yeux, savourer avec délices dans son cœur de père et d’évêque ce magnifique épanouissement de la foi dans son beau diocèse. Aussi, sur son trône, sous le dôme du Prétoire, à la vue de tout son peuple, il est là, Monseigneur l’Evêque de Nantes, que la voiture de M. le comte de la Villeboisnet est allée prendre chez M. le Curé de Pontchâteau, chez lequel, dès la veille, il était descendu.
Pendant la sainte Messe, les chants, sous l’habile direction de M. le vicaire de Prinquiau, s’élèvent de la lande. C’est toute la foule qui chante : Nous voulons Dieu, le Credo, O l’auguste Sacrement, etc. : chants de vie, de force et de courage, dont le rythme séculaire a bercé nos aïeux et en a fait des héros. Pareils à la mélodie irrésistible, à la mélopée captivante de la grande voix des vagues aux airs de laquelle grandissent et se façonnent les cœurs de nos vaillants marins des côtes bretonnes, la mélodie de ces cantiques populaires, de ces chansons religieuses a façonné l’âme de vos pères et façonnera encore l’âme de vos enfants. Elle vous donnera, comme à ceux qui s’en allaient au martyre en chantant, la vaillance des grands cœurs, l’amour des saintes causes et la nostalgie des lointains horizons de la patrie future. Oh ! qu’il est beau, doux et consolant de voir et d’entendre et de comprendre toute cette multitude de chrétiens, de frères, d’héritiers du même royaume chanter à l’unisson, à pleine voix, à la face du ciel et de la terre, ses mêmes croyances, ses mêmes amours et ses mêmes espoirs !
Dès que la Messe est terminée, M. le chanoine Ménard paraît au sommet des degrés de la Scala pour nous parler de ce qui fait le premier objet de cette fête : la bénédiction du bas-relief de l’Ecce homo et de la Transfiguration.
Quand, dit-il en substance, après la Transfiguration de Notre-Seigneur sur la montagne du Thabor, les apôtres levèrent la tête, ils ne virent personne, dit l’Evangile, sinon Jésus seul : levantes capita sua, neminem viderunt nisi solum Jesum. C’est aussi l’impression que j’éprouve et le spectacle que je contemple quand je viens au Calvaire et que je considère les différents sanctuaires et monuments qui peuplent la lande de la Madeleine. Partout, sous différentes formes, à la chapelle, au Prétoire, au Calvaire, dans les stations du Chemin de la Croix, dans les grottes, c’est le même et unique Jésus que l’on aime à voir et à vénérer : Solum Jesum.
Et ce Jésus, c’est précisément celui que Pilate, avec une âme inquiète et dans un geste découragé, présente à la plèbe juive, quand il dit ces mémorables paroles : Voilà l’Homme ! Et quand à cette oblation douloureuse et attristée la haine de la populace répond par des cris de rage : Qu’il soit crucifié ! Pilate, avec une intention et sur un ton évidemment ironiques, leur dit ces autres paroles : Je crucifierai votre Roi?
Telles sont les deux pensées que l’orateur, d’une voix vibrante et d’un cœur enflammé, développe devant nous : Voilà l’Homme, voilà votre Roi. Ecce Homo, ecce Rex vester.
Fuis il termine, en tirant des conclusions opportunes et pratiques et en faisant pousser à la foule d’énergiques acclamations à la Croix et à Jésus-Christ.
Sa Grandeur Mgr Rouard se lève en ce moment pour rappeler aux pèlerins le double but de cette manifestation religieuse : la Passion de Jésus dans Ecce Homo et son don d’amour dans l’Eucharistie. Et il profite de cette circonstance unique, où il peut parlera un si grand nombre de ses fidèles diocésains réunis, pour leur recommander instamment la dévotion au Dieu d’amour dans l’Eucharistie, particulièrement par la sainte Communion et la Communion fréquente.
C’est alors que Monseigneur de Nantes procède à la bénédiction du nouveau groupe. Nous en avons déjà parlé longuement dans ces pages : c’est pourquoi je n’en dirai rien présentement, sinon que c’est une œuvre qui fait honneur à celui qui l’a conçue et exécutée. J’aime à la voir à sa place à côté de ses sœurs plus vieilles, la Flagellation et le Couronnement d’épines, qui se patinent déjà sous la main du temps, toute rayonnante dans la blancheur de sa robe immaculée. Elle est belle, elle est sainte. La bénédiction de l’Eglise n’est-elle pas, en effet, comme un baptême qui donne aux œuvres d’art la naissance à la vie des œuvres sanctifiées ?
*
Il est près de midi. La foule se disloque et s’éparpille sur la lande pour manger son pain de chaque jour. C’est aussi ce que nous allons faire de notre côté. M. le Directeur du pèlerinage invitait gracieusement Messieurs les curés et vicaires à venir se restaurer dans les vastes locaux des anciens établissements, aujourd’hui déserts, et pendant que Messieurs les vicaires remplissent les réfectoires de l’ancien grand séminaire d’Haïti, Messieurs les curés et autres invités accompagnent Nosseigneurs les Evêques dans le vaste réfectoire des religieuses.
Sur la fin du repas, M. l’abbé Barré se lève et prononce un toast dans lequel il adresse ses remerciements à Mgr l’Evêque de Nantes, à Mgr Pichon, à M. le comte de la Villeboisnet et son fils, M. le Conseiller général, à M. le marquis de Montaigu, député, à M. Le Cour, sénateur, à MM. les chanoines Ménard et Deval, à M. le curé de Pontchâteau, à M. Sarzaud, maire de Pontchâteau et à M. Vallet, tous deux retenus par la maladie, à M. Lanoë et tous ceux du comité des pèlerinages, enfin à Messieurs les curés et vicaires, et cela avec un mot particulier à chacun, et l’on voit sur ses lèvres s’épanouir un sourire heureux, comme un ruban fleurissant la garde d’une épée.
Mgr l’Evêque de Nantes répond à chaque point de la manière délicate dont il est coutumier. Il m’est impossible de noter les détails, les nuances de cette gracieuse réponse. Ces notes ne seront qu’un écho affaibli de ses paroles ; elles seront au moins la reproduction fidèle de sa pensée :
« Je remercie M. l’abbé Barré, continuateur de l’œuvre de Montfort, du magnifique pèlerinage auquel il nous a convié et fait assister. Si j’en ai eu l’idée et donné l’inspiration, vous en avez été l’âme et l’instrument.
Je remercie Mgr Pichon, l’archevêque de Cabaza d’avoir accepté mon invitation qui lui a permis de revoir des lieux qui lui sont chers. Car, Monseigneur, vous êtes un enfant du Calvaire par votre éducation, et par le cœur un ami de Montfort.
« Je remercie M. le comte de la Villeboisnet, et son fils M. le conseiller général. Votre dévouement est acquis à toutes les bonnes œuvres, et vous êtes, M. le comte, un sauveur, le sauveur de cette maison et de cette œuvre.
« Je remercie Messieurs les représentants du peuple aux chambres françaises, de donner cet exemple de foi aux populations que vous représentez.
« Vous avez dit que vous ne pouviez rien sans Messieurs les curés. Je puis bien en dire autant. L’évêque ne peut rien sans ses curés, et cela est très facile à comprendre. Je tiens à rendre hommage à leur dévouement laborieux, et je les félicite de leur attachement sympathique au Calvaire du B. P. de Montfort dont la protection puissante rayonne toujours sur les chrétiennes populations de cette contrée.
« Je suis heureux de saluer ici M. le chanoine Deval, dont l’éloquence est connue et dont la présence me rappelle le cher souvenir de celui qui fut mon maître, mon père, mon conseiller, mon vénérable ami, de Mgr Frérot, que vous avez assisté à ses derniers moments.
« Je suis heureux de rendre hommage avec vous au zèle et au dévouement intelligent de ces Messieurs qui font partie du comité du pèlerinage.
« Monsieur le Directeur du Pèlerinage, il est dit dans l’Ecriture que le patriarche Jacob, à la vue de son fils Joseph qui croissait en âge, en force et en beauté, disait: Mon fils Joseph est toujours en croissance : filius accrescens, Joseph, filius, accrescens. » Ce sont aussi les paroles que je vous applique. Vous êtes toujours en croissance. Vous trouvez toujours un aliment à votre activité. Et quand tout serait fini, vous trouveriez bien encore quelque chose à faire. »
Les toasts étaient achevés et le repas près de finir, quand nous voyons entrer Mgr Debout, dont l’académie française a couronné la grande vie de Jeanne d’Arc et auquel sa sainteté Pie X a accordé le titre de Protonotaire apostolique ; c’est en ces termes que sa Grandeur le fait connaître à l’assemblée: « Je vous présente Mgr Debout, l’historien de Jeanne d’Arc. Regardez-le bien. Il porte sur son front l’auréole de la Bienheureuse. » Mgr Debout est, en effet, un descendant de la famille de Jeanne d’Arc.
*
Mais voici qu’approche l’heure de la cérémonie du soir. En attendant, du haut des escaliers du Prétoire, jetons un coup d’œil sur la physionomie de la foule et du pèlerinage. Cette multitude, aux houles paisibles, c’est vraiment une mer dont les flots se meuvent au souffle d’un vent inconnu. Dans cette masse on voit représentés les costumes les plus originaux comme les parlers les plus caractéristiques, depuis Sainte-Pazanne et Pornic jusqu’à Chateaubriand et Redon, de la Vendée à l’Ille-et-Vilaine, — et depuis la Boissière du Doré et la Renaudière jusqu’à Musillac et au-delà, — de la chaude terre angevine au rude sol morbihanais. — Les uns achèvent de se restaurer ; les autres gravissent religieusement les marches indulgenciées de la Scala Sancta ; d’autres, par grandes tranches, qu’on devine être des paroisses, se rangent autour des poteaux indicateurs qui sont assignés à chacune. Partout l’on voit flotter gaiement les drapeaux et les oriflammes. Ils sont là, sur tout le long parcours que suivra la procession, mariant leurs couleurs gaies et chantantes à la verdure des allées et des arbres. Je dis que le parcours est long, 1400 mètres. Il va du Prétoire à Gethsémani, de Gethsémani au Calvaire, du Calvaire au Prétoire. C’est beau, grandiose, triomphal. Nous avons pris cette belle nature, nous avons essayé de la parer un peu pour en faire un cadre digne de la marche de Dieu, notre Roi, au milieu de nous, ses sujets et ses enfants. Ces mâts, que vous voyez de tous côtés porter joyeusement leur flamme de fête, nous ont été prêtés gracieusement et plantés par les braves paroissiens de Crossac, de Besné, de Saint-Guillaume et de Pontchâteau. Honneur et merci !
Mais il est temps de descendre, car voici Nosseigneurs les évêques qui arrivent et fendent, en bénissant, les flots pressés de la foule et gravissent les degrés du Prétoire. A la suite de quelques couplets d’un cantique en l’honneur du Saint-Sacrement, le prédicateur se dresse sous les arceaux de la Scala Sancta. C’est M. le chanoine Deval. Voici tout de suite le squelette de son brillant fervorino.
Quand Pilate montrait aux Juifs Jésus sur le Prétoire, il disait : Ecce homo, voilà l’homme. Quel est cet homme ? C’est celui que Saint Jean-Baptiste, dont nous célébrons aujourd’hui la fête, vit venir à lui, mêlé à la foule pour qu’il le baptisât dans les ondes du Jourdain, c’est celui qu’il désigna à ses disciples par ces belles et symboliques paroles : Ecce agnus Dei, voilà l’Agneau de Dieu. Or, cet Agneau de Dieu qui fut immolé sur l’autel de la Croix, il continue toujours à verser son sang sur l’autel de nos sacrifices. L’Eucharistie, voilà l’Agneau de Dieu, qui a poussé son amour pour nous, jusqu’à se donner en nourriture à notre âme.
Dieu nous a aimés particulièrement dans quatre circonstances : dans la Création, — dans l’Incarnation, — dans la Rédemption, — dans l’Eucharistie. Dieu voulait nous aimer et nous le montrer jusqu’à n’en pouvoir plus davantage ici-bas. Jusqu’alors Dieu nous aimait, pour ainsi dire, en dehors de nous. Mais à la fin, Dieu nous aime jusqu’à se donner à nous en nourriture. L’Eucharistie c’est l’apogée de l’amour divin ici-bas. Il n’en peut plus sur cette terre, en cette vie.
C’est, approximativement, à ce squelette informe que M. le prédicateur donna un corps et une âme, de la vie, des nerfs, de la chaleur, du mouvement, du cœur. Ce fut un vrai régal pour l’esprit des auditeurs qui trouvèrent dans ces fortes paroles une nourriture substantielle. Puissions-nous profiter de ces enseignements et rendre à notre Dieu amour pour amour et demeurer toujours, en face de l’impiété menaçante, les dignes descendants de nos vaillants ancêtres !
Puis, tout aussitôt, après quelques avis donnés par M. l’abbé Barré, la procession s’organise et s’ébranle, le défilé commence. Nulle erreur, nulle hésitation, nul encombrement. Près de soixante paroisses avaient promis de venir avec croix et bannières. Nous comprenons facilement que le mauvais temps les ait empêchées de réaliser leur pieux dessein. Cependant la plupart des Croix ont été apportées, et il y avait bien encore une douzaine de bannières que les mains vigoureuses des robustes gars de nos landes maintenaient droites et fières malgré le vent. Chaque paroisse vient à son tour. C’est vraiment un fleuve qui coule dans le lit des vastes allées. La paroisse de Crossac ouvre la marche, celle de Pontchâteau la ferme, précédant le dais. Et l’on chante et l’on prie. Le S. Sacrement est porté par Monseigneur Pichon. Monseigneur de Nantes préside la procession et accompagne le dais, entouré et suivi d’un groupe compact d’hommes aux voix mâles qui chantent à plein cœur leur Dieu et leur Roi qui s’avance en triomphateur. Le service des cérémonies est assuré par les petits choristes de la paroisse de Pontchâteau, évoluant avec grâce et ensemble sous la sympathique direction de M. l’Abbé Derennes.
Mais le S. Sacrement n’a pas encore quitté le Prétoire que déjà, à l’autre bout de l’avenue, apparaît la tête de la procession. Mais en débouchant dans l’immense allée, en passant devant le Calvaire, le cortège se dédouble, afin de laisser au milieu un espace libre pour la marche du S. Sacrement. Et voici qu’à son tour, Jésus s’avance triomphalement, porté entre les mains de l’évêque missionnaire, escorté d’une imposante et royale garde d’honneur, accompagné de l’Ange du diocèse qui est bien là à sa place, veillant, la houlette du pasteur à la main, sur ses brebis fidèles et sur le Dépôt sacré, sur l’Hostie trois fois sainte et adorable, dont Dieu veut paître le pasteur et ses agneaux. Et c’est ainsi que, Père et Pasteur des âmes, il les conduit dans les plantureux pâturages de la vérité et les nourrit du Pain qui donne la vie éternelle.
… Et quand toute la masse des pèlerins s’est groupée dans l’immense avenue, elle se retourne et fait face à Jésus-Hostie qui vient lui-même de gravir la montagne du Calvaire et repose sur l’autel érigé sur sa cime. Et Jésus bénit la foule agenouillée à ses pieds sur la lande. Et pendant que là-haut, Jésus rayonne, regarde et bénit, M. l’abbé Lehuédé, — précédemment vicaire à Saint-Similien de Nantes et envoyé par la confiance de son évêque comme curé de Saint-Aubin des-Châteaux, — fait pousser à la foule d’une voix empoignante, ces acclamations triomphales, ces invocations suppliantes, qui font jaillir les larmes du cœur aux yeux: Jésus, nous croyons en vous ! Jésus, nous espérons en vous ! Jésus, nous vous aimons ! Jésus, convertissez-nous ! Jésus, sauvez-nous ! Jésus, sauvez la France !
Et pendant que Jésus bénissait de là-haut la foule qui l’acclamait en bas, mêlant ma faible voix à ce chœur grandiose de la foule, je me disais silencieusement: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonæ voluntatis ! Gloire à Dieu dans les hauteurs, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! Oui, gloire à ce Dieu beau, grand et puissant, couronné de splendeur dans la vie de son éternité, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Oui. Gloire à ce Dieu qui a quitté son vêlement divin pour prendre le vêtement de notre humanité, pour se cacher sous le voile des langes eucharistiques, pour devenir notre breuvage et notre nourriture. Oui, gloire à ce Dieu, notre Frère, notre Ami, notre Récompense. Oui, gloire à ce Christ qui aime toujours son peuple de France, parce que, par son dévouement à sa cause, il demeure toujours le premier peuple du monde. Oui, paix à ces hommes, à ces laboureurs, à ces ouvriers, à ces marins, à tous ces artisans de la matière ou de l’idée ; paix à ces hommes au cœur droit et fort, qui se souviennent qu’ils sont baptisés, enfants de Dieu, héritiers du royaume de Jésus-Christ, qui ne veulent et ne cherchent, la paix, le repos et le bonheur que dans le service de Dieu, dans le bon exemple et l’accomplissement intégral de tous leurs devoirs catholiques. Oui, paix à ces hommes, à ces chrétiens de race robuste qui ne reculeraient, pas plus que leurs pères, j’en suis sûr, devant la mort pour défendre leur Dieu, leurs autels et leurs enfants.
Et quand Jésus descendit de la montagne et traversa les rangs pressés de la foule agenouillée sur son passage, il me semblait voir Jésus descendant de la montagne du Thabor où il s’était transfiguré devant ses apôtres privilégiés et revenant parmi son peuple pour le bénir et le sauver. Mais ici, c’est à tout son peuple qu’il s’est montré dans la splendeur de son Eucharistie, et c’est tout son peuple qu’il bénit en passant et qu’il veut emmener avec lui au triomphe, au bonheur, au repos.
C’est ce que, tous ensembles, nous lui demandions quand, une dernière fois, du haut de la Scala Sancta, Jésus bénit encore la foule des pèlerins. Oui, ô Jésus bénissez ce peuple, il est vôtre. Gardez-lui toujours sa foi, naïve et simple peut-être, mais vraie et profonde, cette foi, qui fait sa gloire, sa force et sa sauvegarde ; et que la bénédiction céleste, que nos évêques font descendre sur lui, soit le gage assuré de celles que vous répandez vous-même, en ce jour, du haut de votre tabernacle et du haut de votre ciel.
Quand la bénédiction simultanée de nos évêques est donnée aux pèlerins, sa Grandeur Monseigneur de Nantes, prend la parole, car il sent le besoin d’épancher la joie qui déborde de son cœur. Il remercie ses fidèles pèlerins d’être venus si nombreux. Il les félicite de leur piété, de leur ferveur et de leur inviolable attachement à la foi de leurs pères et à leur Calvaire de Pontchâteau. Il félicite aussi l’infatigable gardien du Calvaire de Montfort, de l’inlassable énergie qu’il déploie, avec ses dévoués auxiliaires, pour conserver, développer et embellir le précieux héritage que lui a légué le B. de Montfort.
Puis Monseigneur fait réciter une prière à toutes les intentions qu’il recommande et à celles de tous les pèlerins.
Et quand ce fut fini, on entendit monter de la lande, en fusée formidable, un cri spontané : Vive Monseigneur! Et l’écho redisait sur la lande : Vive Monseigneur! Et cet écho comme un oiseau rapide s’en allait, en bonds joyeux, de clochers en clochers, jusque sur les tours de la Cathédrale de votre bonne ville de Nantes, et je l’entendis, sur les grandes tours et sur les sveltes clochers, qui répétait, au loin: Vive Monseigneur ! Oui, Vive Monseigneur et Merci !
*
Nous tenons à remercier aussi, à notre tour, tous les pèlerins de leur nombre et de leur piété. Nous remercions de même les Compagnies de chemin de fer, Messieurs les organisateurs du pèlerinage, Messieurs les Curés et Vicaires, et tous ceux, en un mot, qui ont contribué, dans la mesure de leur pouvoir et de leurs moyens, au succès de cette fête. Dieu seul connaît leur nom et ce qu’ils ont fait. Nous le prions de les en récompenser.
*
Tout est fini pour cette année. Mais cette fête demeure comme un témoignage irrécusable de la persistance, de la vivacité, de l’efflorescence vigoureuse et splendide de la foi dans ce pays. Le soir, dès 6 h., la lande avait repris son calme accoutumé, ce calme mystérieux, où l’on parle encore à mi-voix de peur de le rompre et qui suit les grandes affluences et les grands bruits. Et là-haut, sur son piédestal gigantesque, la Croix triomphait et semblait auréolée de rayons nouveaux. A cette heure, nul n’eut imaginé que, quelques instants auparavant, plus de trente mille chrétiens eussent prié et chanté ici, eussent tressailli d’intimes et suaves émotions, eussent puisé ici dans la prière des réserves d’énergie surnaturelle pour les luttes quotidiennes de la vie. Et cela était pourtant. Ces voix, sortant de toutes ces poitrines de baptisés, qui avaient prié, chanté, acclamé, me rappellent ces voix mystérieuses dont parlent les anciens de cette contrée, ces voix qu’ils racontent avoir entendu maintes fois retentir harmonieusement dans les airs ou comme sortir Je terre, précisément sur le parcours qu’a suivi aujourd’hui la procession, ces voix chantant des cantiques el des hymnes en l’honneur de la Croix et de l’Eucharistie. Mais n’est-ce pas ce que nous avons vu réalisé aujourd’hui?
Oh! à voir ce que nous avons vu, il ne faut pas désespérer de l’avenir. L’avenir est à nous, puisqu’il est à Dieu et que Dieu est avec nous.
Elle n’est pas vraie cette parole blasphématrice qu’a écrite la plume impie d’un homme mort il y a quelques années : « Le catholicisme est la crétinisation de l’individu ». Non, cela n’est pas vrai, et cet imposteur, au nom d’une science vaine et fausse, en a menti en face de la réalité des faits historiques et de l’expérience individuelle. Ce n’est pas le catholicisme qui rabaisse, qui ravale, qui crétinise l’homme, l’individu pas plus que la famille et la société, c’est le mal, l’impiété, l’athéisme, l’orgueil et tous les vices. Le catholicisme, au contraire, est la plus grande école d’éducation intellectuelle et morale, le véritable et unique laboratoire du perfectionnement des individus, de la santé des familles et du progrès de la civilisation des peuples.
C’est lui qui élève et surnaturalise l’homme, parce qu’il lui apprend ses origines, ses devoirs et ses destinées, d’où il vient, ce qu’il est, où il va. Oh ! chrétiens, amis du Calvaire, ce n’est pas vrai, n’est-ce pas, que sa fréquentation vous crétinise, mais, au contraire, qu’elle vous divinise. Soyez fiers de votre Baptême, de votre foi, du catholicisme auquel vous appartenez, de cette famille chrétienne dont vous êtes les enfants choisis, de ce corps du Christ dont vous êtes les membres visibles et vivants, de cette communauté d’âmes que vous êtes appelés à réformer un jour au sein du Père commun que nous avons dans les cieux. Soyez fiers aussi de votre Calvaire, du Calvaire du B. Père de Montfort. C’est lui et vos ancêtres qui l’ont élevé et qui vous l’ont légué comme un incomparable héritage de foi. C’est vous qui l’avez rétabli. Il est votre œuvre, et votre trésor. Gardez-le fidèlement, grandissez, fortifiez-vous à son ombre et au contact de sa vertu. Il a fait la gloire, la force et le bonheur de vos aïeux. Qu’il soit aussi votre honneur, votre sauvegarde et le rempart inexpugnable de vos croyances, de vos espoirs et de vos droits.
François PILET.
N° 1 Octobre 1909
En vue de la prochaine fête
Les Restaurateurs
Nous célébrerons l’année prochaine le second centenaire de l’Erection du Calvaire. Cette fête sera tout à la fois le triomphe de Jésus crucifié et du Bienheureux de Montfort. Monseigneur l’Evêque de Nantes la veut digne de Jésus-Christ et de son Apôtre inconfusible. Nous désirons que cette fête surpasse en éclat toutes celles qui ont eu lieu jusqu’à ce jour au Calvaire. Elle durera plusieurs jours. Nous comptons sur Monseigneur l’Archevêque de Rennes, et avec Monseigneur l’Evêque de Nantes, sur Nosseigneurs les Evêques de Luçon, d’Angers, de Vannes, de Quimper, etc. L’affluence des fidèles sera immense. Des orateurs éminents dispenseront avec magnificence la nourriture spirituelle.
Mais il nous faut aussi songer à la nourriture corporelle. Nous pouvons heureusement compter sur le dévouement des restaurateurs de Pontchâteau. Tous sont prêts à se transporter sur la lande du Calvaire afin d’offrir leurs services aux pèlerins.
Mais comment pourront-ils s’y installer? — A notre dernière fête, beaucoup sont venus me demander des places ; je n’ai pu à mon grand regret n’en procurer qu’à un petit nombre. Mais j’ai donné l’assurance à tous que je prendrais des mesures pour la prochaine fête. Ce n’est pourtant pas chose facile. Mon désir est de favoriser tout le monde. Je voudrais que tous soient contents de leur place. D’un autre côté, ils devraient être placés de façon à ne pas nuire à la fête. Il ne devrait y avoir aucun restaurant dans l’intérieur du pèlerinage, pas même sur les routes et les chemins. Pour cela, je peux compter, je le sais, sur le dévouement de M. le Maire de Pontchâteau. Il faut que les restaurateurs soient à proximité du lieu de la fête, mais en dehors de l’enceinte du pèlerinage.
Voici les mesures que j’ai prises ou compte prendre à cet effet. J’ai loué à M. le Comte de La Villeboisnet le terrain qui se trouve au sommet de la butte, en dehors de l’enceinte du pèlerinage. Cela me permettra de donner sur ce terrain et sur le landier du moulin des places à tous les restaurateurs de Pontchâteau.
Je serai aussi à même d’en offrir en nombre assez limité, dans la partie basse du pèlerinage. Un mur va clôturer cette partie où ont lieu nos grandes cérémonies, une parcelle de terre va être laissée entre ce mur et la route. Je pourrai la mettre aussi à la disposition des restaurateurs et des pèlerins.
J. BARRÉ.
N° 11 Août 1910
Bénédiction de la fontaine
Le Dimanche 10 juillet avait lieu au Calvaire la bénédiction d’un nouveau monument placé auprès de la Scala Sancta et qui attire les regards des pieux pèlerins qui viennent implorer les faveurs du Bienheureux Père de Montfort. C’est une fontaine aux eaux abondantes et limpides et dont la fraîcheur est particulièrement appréciée par ces temps de canicule que nous traversons. Surmontée d’un dôme en pierres de taille que supportent quatre colonnes du même granit bleu, elle se dégage avec majesté, et, au milieu des peupliers qui l’abritent, produit le meilleur effet. Mais ce qui lui donne son véritable cachet, et l’embellit encore, c’est une statue de grandeur naturelle du Bienheureux de Montfort couronnant le monument et invitant ses pèlerins d’aujourd’hui, comme autrefois ses bons travailleurs, à venir se désaltérer à cette source.
Nous avons profité de la présence au Calvaire de M. l’abbé Deval, chanoine du diocèse d’Angoulême pour faire la bénédiction de cette fontaine et de la statue du Bienheureux Père de Montfort. A une heure, le clergé et les nombreux pèlerins se dirigent vers la Scala Sancta au chant des cantiques. Avant de procéder à la bénédiction, M. le chanoine Deval, dans des paroles pleines de cœur et merveilleuses d’à-propos, indique aux fidèles le sens de la cérémonie qui va s’accomplir. Leur rappelant le séjour du bon Père de Montfort sur la lande de la Madeleine, il leur dit sa sollicitude, son amour paternel pour ceux qui, il y a deux siècles, travaillaient à édifier son Calvaire. Pour les nourrir, il multipliait les pains d’une façon miraculeuse et pour les désaltérer il les conduisait à la source voisine. « Vous aussi, ajoute-t-il, venez boire à cette source ; mais n’oubliez pas qu’en désaltérant vos corps, il faut, comme vos pères, aller puiser, pour vos âmes, aux fontaines du Sauveur, cette eau vive qui jaillit jusqu’à la vie éternelle ».
La cérémonie achevée, chacun s’empresse de goûter à cette eau qui a reçu les bénédictions de l’Eglise ; et aussitôt commence le chemin de la Croix qui se poursuit au milieu du recueillement qui règne chaque dimanche dans tous nos exercices.
N° 4 Janvier 1911
Nos travaux du Calvaire. — La montagne de l’Ascension. — Paroisse du Crossac
En se rendant de Bethléem à Gethsémani, le pèlerin aperçoit sur le sommet de la colline, à gauche, une chaîne de beaux rochers. Point culminant, ce lieu semble prédestiné à devenir la montagne de l’Ascension. Dès le début de nos travaux, il a été arrêté dans notre esprit que cette parcelle serait achetée à cette fin le plus tôt possible. Au printemps de l’année 1898, nous faisions part à l’un de nos amis, de nos désirs et de nos insuccès. Quelques jours après, ce digne prêtre nous apporta douze cents francs pour l’achat du terrain de l’Ascension, mettant pour condition que la donatrice et son intermédiaire demeureraient inconnus. C’était la valeur du sol. Mais sur la lande se trouvait un moulin et le meunier ne voulait consentir qu’à la condition qu’il fut remplacé. Souvent je réitérai ma demande et fis des instances parfois bien pénibles. Pendant ce temps mes douze cents francs ne demeurèrent pas improductifs ; après dix ans, la somme avait presque doublée. Cependant elle était encore loin de suffire. L’affaire fut conclue néanmoins, et nous sommes libres désormais de travailler à la montagne de l’Ascension.
Le travail à faire est relativement considérable. Devant et derrière notre chaîne de rochers, se trouvent d’énormes excavations. Ce sont d’anciennes carrières à combler. Nous devrons nous occuper ensuite de certains mouvements de terrain pour faire ressortir les rochers où sera placé le groupe de l’Ascension.
Le travail est maintenant en chantier. Le dimanche 27 novembre, M. l’abbé Guibert, curé de Crossac, à chaudement invité les hommes de sa paroisse à venir travailler à la montagne de l’Ascension. Le jour fixé fut le mardi, 29 novembre, ou le jeudi 1er décembre, s’il pleuvait le mardi. Le temps fut affreux le premier jour, il n’arrêta pas quelques braves du village de la Monderais qui travaillèrent sous la pluie toute la matinée, mais durent quitter l’après-midi. Il fit assez beau le jeudi. Aussi le Vénéré Pasteur accompagné de M. l’abbé Lizé, son vicaire et du Révérend Père Mahé, missionnaire à Ceylan, pouvait-il être justement fier de ses paroissiens. Ils étaient nombreux et travaillaient avec l’ardeur que donne une foi vive stimulée par l’exemple de leur vénéré Pasteur, de son dévoué vicaire et du R. Père Oblat.
Pour la première journée, c’est une journée excellente ; nous en aurons d’aussi bonnes, mais pas de meilleures. Aussi est-ce, avec des accents convaincus, qu’après la bénédiction du très Saint Sacrement nous leur avons adressé nos sincères remercîments et nos chaleureuses félicitations. Cette belle journée de travail, la première à laquelle il a pris part, a produit la plus heureuse impression sur M. l’abbé Chabot, appelé à rappeler à nos chers travailleurs l’activité et le dévouement du regretté R. P. Sarré.
J. BARRE
N° 5 Février 1911
Nos travaux. —Paroisse de Drefféac
Le dimanche, 11 décembre, le dévoué Pasteur de Drefféac invitait ses hommes à venir travailler au Calvaire. La chaude parole de M. l’abbé Patron ne pouvait manquer de trouver écho chez ses braves paroissiens. Car nulle part le culte du Bienheureux de Montfort et de son Calvaire n’est plus ardent qu’à Dreffréac. Sans borne est leur confiance dans le bon Père de, Montfort, et leur confiance est justifiée. Dans la maladie ou l’épreuve, leurs regards se tournent vers le Calvaire, ils y accourent, et ce n’est jamais en vain.
Aussi quel n’est pas leur dévouement à l’œuvre du Calvaire ! A l’époque de nos grands travaux, quand une épaisse couche de neige, couvrant la terre, nous enlevait l’espoir de voir arriver les paroisses convoquées de loin, notre pensée se tournait vers Drefféac ou Crossac. Plus d’une fois, en plein hiver, il nous est arrivé de partir du Calvaire à six heures du matin. Peu de temps après, nous frappions à la première porte où nous apercevions de la lumière : « Venez au Calvaire, mes amis, venez remplacer telle paroisse qui va nous faire défaut. » — « Comment pourrons-nous travailler, la terre est couverte de neige et gelée très dur ? » — « Nous n’en travaillerons que mieux, venez toujours. D’ailleurs il fait beau au Calvaire. Allez éveiller tous les hommes du village et dites-leur que je les attends dans une heure au Calvaire. » — Une heure après, m’arrivait en chantant une vaillante équipe d’intrépides travailleurs.
Les hommes de Drefféac n’ont pas dégénéré. Aucun d’eux n’est piqué du ver moderniste. Chez ces braves chrétiens, la foi est plus vivace que jamais. Aussi quel magnifique spectacle ils nous ont encore donné cette fois !
M. le Curé les avait convoqués pour le jeudi 15, ou, s’il faisait mauvais temps, pour le lendemain vendredi. Le Pasteur devait être à leur tête. Le matin du jeudi, le temps était affreux. Dix-huit braves, des villages écartés, se mirent quand même en route. Le matin, ils travaillèrent sous la pluie. Dieu récompensa leur courage, et nous donna une belle soirée.
Le lendemain, vendredi, malgré le mauvais temps du matin, quinze autres braves nous arrivaient. Le travail fut actif toute la journée.
Mais, avec le vénéré Pasteur, le grand nombre avait attendu un jour plus favorable. Ils choisirent le mardi 20. Ce jour-là fut une belle et bonne journée dont nous pouvons dire, comme de la journée de Crossac, impossible d’avoir mieux.
Etablir quatre voies ferrées, fut l’affaire d’un instant : et les wagons se chargèrent et circulèrent toute la journée, comme par enchantement.
Aussi déjà la lande de l’Ascension a-t-elle changé d’aspect ! Beaucoup d’excavations sont comblées et la chaîne des rochers ressort plus belle. Mais que personne ne soit jaloux ! Il reste à faire pour que notre montagne de l’Ascension soit un digne pendant du Calvaire.
Inutile de dire qu’au travail chacun rivalisait d’ardeur, stimulé encore par l’exemple de l’intrépide Pasteur. M. le Comte de Beaudinière, maire de Drefféac, empêché, a tenu à nous faire remettre le prix de sa journée.
On chante bien aux offices de Drefféac. Si nous n’en n’avions pas été témoins, la journée du mardi 20 décembre, avec le salut du Très Saint-Sacrement qui l’a couronnée, nous l’aurait appris.
Aussi est-ce de tout cœur, qu’avant leur départ, nous avons adressé à M. le Curé de Drefféac et à ses chers Paroissiens, avec nos sincères remerciements, nos plus chaudes félicitations.
L’Ascension, c’est le ciel. Que Dieu le leur accorde à tous ! En attendant, et pour être plus sûrs d’y parvenir, que leur esprit soit toujours fixé sur la glorieuse Ascension de Jésus ! Ceci est bon toujours, mais plus important à l’heure actuelle.
J. BARRÉ.
N° 6 Mars 1911
Nos travaux
C’est M. l’abbé Bourmaud, l’un de ses dévoués vicaires, que le bon M. l’abbé Guillard, curé de Saint-Joachim, avait chargé de nous amener ses paroissiens, le mardi, 10 janvier. M. Bourmaud avait droit d’être fier de se voir à la tête d’une centaine de travailleurs d’élite. Car ce sont des habiles et intrépides les hommes de la Brière. Aussi comme ils sont appréciés dans les chantiers ! Nous savons les apprécier nous-mêmes et depuis longtemps. Il y a quelque vingt ans qu’ils sont venus sous la conduite du zélé M. Plessis, alors vicaire à Saint-Joachim, mort curé de Frossay, creuser les fondations du Prétoire. Ils étaient à peu près le même nombre. Que nous avons été heureux de serrer la main de plusieurs de ces braves de la première journée ! Nombreux sont déjà les disparus ; mais il a été consolant pour nous de les voir remplacés par des jeunes animés de la même ardeur, de la même affection pour le Calvaire du Bienheureux de Montfort. C’était alors le regretté M. Berthelon qui était curé de Saint-Joachim. Il vint l’année suivante à la tête de six cents briéronnes empierrer le devant du Prétoire. Puis sous le dévoué M. l’abbé Gaillard, et depuis, les hommes et les femmes de Saint-Joachim nous ont donné maintes preuves de leur inlassable dévouement à l’œuvre du Bienheureux de Montfort, en répondant toujours avec le même empressement à notre appel.
Avec de tels ouvriers, la voie fut bientôt mise en parfait état, et durant toute la journée, le travail se poursuivit avec un ordre et un entrain merveilleux. Notre matériel roulant laisse à désirer ; certaines pièces font défaut, d’autres devraient être remplacées. Les hommes de Saint-Joachim nous étonnent par leur habileté et leur promptitude à tout réparer, à tirer parti de tout.
Nous avons signalé les chants de Crossac et de Drefféac, nous ne pouvons pas moins faire pour Saint-Joachim. Les cantiques, en se rendant au travail et en revenant ont été splendidement enlevés ainsi que les chants du salut sous la direction de M. l’abbé Bourmaud. Il nous a semblé que sur ce point aussi les hommes de Saint-Joachim méritaient de particulières félicitations que nous avons été heureux de leur adresser avant leur départ. Nous nous souviendrons de cette belle et bonne journée, et ce qui vaut mieux pour Saint-Joachim, elle restera fidèlement gravée dans le souvenir du Bienheureux de Montfort et le disposera plus favorablement encore à l’égard des habitants de la Brière.
Le mercredi, 18 janvier, une vaillante équipe de travailleurs nous était fournie par l’excellente paroisse de Besné. Ils avaient la joie d’avoir à leur tête M. l’abbé Lorre, leur sympathique curé, accompagné de son dévoué vicaire. C’est la première fois que M. l’abbé Lebastard vient prendre part à nos travaux. Mais il n’en est pas ainsi de M. l’abbé Lorre ; nous aimons à nous rappeler la splendide journée d’hommes qu’il a présidée alors qu’il était à Savenay, vicaire du regretté chanoine Maucler.
Nous aimons à saluer de vieilles connaissances parmi les hommes de Besné. Car Besné nous a donné de nombreuses et bonnes journées de travail, depuis la belle journée d’hommes de Gethsémani, en 1892, présidée par le bon M. l’abbé Tandé, alors curé de cette paroisse, et mort curé de Gétigné. Puis nous avons eu le paroxisme de l’entrain avec l’intrépide M. l’abbé Niel. Départ de l’église, à cinq heures du matin, en plein hiver. En passant à Pontchâteau, il se plaisait à réveiller les habitants par des acclamations et le chant des cantiques. Avant le jour, il était au Calvaire. Et quelle prodigieuse activité ! Un jour, une heure après son arrivée, on vient le chercher pour un malade, il part à l’instant. Trois heures après, il est de retour au Calvaire. Il était revenu par la traverse, en mangeant son dîner en chemin, afin d’être ici pour le commencement de la soirée. S’il y avait un poste rude et pénible, on était sûr de l’y voir. Son exemple entraînait plus encore que ses paroles. C’est ainsi, qu’usé avant l’âge, malgré sa robuste constitution, il devait bientôt être pleuré par ses chers paroissiens.
La journée du 18 ne pouvait manquer d’être excellente. Jeunes et vieux rivalisaient d’entrain et d’activité au travail, stimulés encore par l’exemple de leurs prêtres. Remplis dans un clin d’œil, les vagonnets étaient conduits à toute vitesse par les plus jeunes. Les cantiques ne furent pas chantés avec moins d’entrain. Aussi après le salut, donné par Monsieur le Curé, avons-nous été très heureux d’adresser au cher et vénéré pasteur, à son dévoué collaborateur, et à ses chers paroissiens de chaleureuses félicitations et de sincères remercîments.
Paroisse de Saint-Roch en Pontchâteau
Non moins bonne fut la journée de Saint-Roch, 24 janvier. Qu’il était beau de voir ces 65 hommes, pelle ou pioche sur l’épaule, marchant sur quatre rangs, sous la direction de leur curé en franchissant ainsi les dix kilomètres qui séparent leur clocher du calvaire. La chrétienne population de Pontchâteau les saluait avec émotion en les voyant traverser la ville au chant des cantiques. A leur arrivée au Calvaire, ils chantaient Ave, Ave Maria. Après une courte visite à la Chapelle et quelques paroles de bienvenue, nous nous rendons aussitôt à la montagne de l’Ascension. Là nous admirons l’adresse et l’activité des hommes de Saint-Roch ; à la grande voie qui contourne la colline, on en ajoute deux autres plus courtes, puis une quatrième qui, passant entre deux rochers, à travers une sorte de gorge, monte droit sur la colline, pour aller combler les excavations du côté opposé. Leur habileté a bientôt trouvé le moyen de suppléer aux traverses brisées de nos rails et désormais plus de déraillements à craindre ; tout fonctionne comme si notre matériel était dans un état parfait.
Et quels braves chrétiens que nos hommes de Saint-Roch. On le voit, c’est la foi qui les anime. Chez eux, pas de respect humain. Je leur parle de la grande affection de leur curé pour eux. — «Nous l’aimons bien nous aussi, me répondent-ils. » Ils le lui prouvent par leur parfaite docilité à suivre ses avis en tout. Comme nous félicitons l’heureux Monsieur l’abbé Adron de son ascendant sur ses paroissiens, l’humble curé nous répondit: « C’est à mes prédécesseurs, Messieurs Labigne et Yviquel, mais à Monsieur Yviquel surtout que ma paroisse doit d’être ce qu’elle est. »
Les chants du salut ont été un peu plus long qu’à l’ordinaire, car, suivant le désir exprimé par le bon Pasteur, nous avons laissé les hommes chanter seuls. Nous sommes loin de le regretter. Là encore nous avons de sincères félicitations à leur adresser. Que notre Bienheureux de Montfort continue à protéger d’une manière toute spéciale toutes les familles de Saint-Roch. Qu’il les conserve surtout dans les admirables sentiments de foi qui les animent, et qu’il donne, au cher Monsieur l’abbé Adron la santé dont il a besoin pour continuer de nombreuses années, selon le vœu de son cher troupeau et le sien, son fécond ministère dans l’excellente paroisse de Saint-Roch.
Paroisse d’Herbignac (25 Janvier)
Herbignac est l’une des paroisses qui, dès le début, a mis le plus de zèle à venir prendre part à nos travaux. Nombreuses sont les splendides journées consacrées par cette paroisse à l’œuvre du Calvaire. Le clergé, la noblesse, la bourgeoisie, la classe ouvrière et la campagne ont toujours rivalisé de zèle. Herbignac est l’une des rares paroisses où nous avons la joie de voir encore à sa tête un zélateur de nos travaux des premiers jours. Que Dieu nous conserve de nombreuses années encore le dévoué Monsieur le Chanoine Pellerin, Curé d’Herbignac ! Messieurs les Vicaires, dont nous avons admiré le zèle sont maintenant curés. M. Paquelet est à Treillières ; M. Ménard, à Vay ; M. Lecerf, à St-Michel-Chef-Chef ; M. Épervrie, à la Chevallerais ; M. Rousseau est Vicaire à Saint-Nazaire. Avec leurs fonctions, ils ont transmis leur zèle à leurs successeurs.
Quant à nos autres travailleurs des premiers jours, un certain nombre ont rejoint le Bienheureux de Montfort : ainsi l’ardent M. Corbun de Kérobert, Conseiller Général, et Maire d’Herbignac ; le bon et dévoué M. Quesnoy ; son gendre, le regretté M. Derouet, et tant d’autres non moins chrétiens et non moins dévoués. Au ciel où ils jouissent maintenant des fruits de leurs travaux, ils ne cessent pas d’être pour nous des aides précieux.
Nous sommes heureux de voir des jeunes, non moins vaillants et non moins intrépides, venir prendre leur place. Mais nous sommes non moins heureux de posséder encore beaucoup de nos anciens, et de ce nombre, l’intrépide M. Charles de la Chevasnerie, le bon M. de la Monneraie, le dévoué M. Bourbousson, maire actuel d’Herbignac, et le fidèle M. Morice, père du P. Morice, Missionnaire en Chine. Beaucoup d’autres méritent une mention particulière, mais il faut me limiter ; leurs noms ne seront pas oubliés du Bienheureux de Montfort, c’est l’important.
Le mercredi, 25 Janvier, c’est M. l’abbé Retière qui est à la tête des travailleurs d’Herbignac. C’est la première fois qu’il vient prendre part aux travaux du Calvaire. C’est la première fois aussi que nous voyons des automobiles nous amener des travailleurs. La journée a été excellente. Nos hommes ont été prompts à se mettre à l’ouvrage. Ils y étaient de tout cœur. Pendant que les uns transportaient la terre avec les wagons, les autres faisaient manœuvrer les crics. Malheureusement nos blocs étaient d’un poids démesuré, ou nos instruments affaiblis par un trop long état de service n’avaient plus la résistance d’autrefois. Il fallut se résoudre à renoncer pour l’heure au travail entrepris pourtant avec un grand courage et conduit avec une grande habileté. Dans la soirée, nous nous sommes attaqués à d’autres blocs à l’aide de la chaîne. Là encore les hommes d’Herbignac se sont montrés énergiques, mais le succès n’a pas entièrement répondu à leurs généreux efforts. Ce n’est pas leur faute. Une autre fois je tâcherai de ne pas mériter le reproche qu’ils seraient en droit de m’adresser dans la circonstance, en proportionnant mieux les effets à obtenir aux forces à ma disposition. Ces petits contre-temps n’ont rien enlevé à la franche gaieté de ces braves travailleurs. Le cantique « Vive Jésus, Vive sa Croix», ainsi que les acclamations, avaient été enlevés au Calvaire, avec un brio remarquable ; il en fut ainsi des cantiques chantés en retournant à la chapelle et du salut du Saint Sacrement. Aussi leur avons-nous adressé des félicitations et des remerciements bien mérités. Nous prions le Bienheureux de Montfort de continuer à protéger d’une manière toute spéciale tous les habitants de la paroisse d’Herbignac. Nous lui demandons en particulier d’arrêter la fièvre typhoïde qui règne en ce moment dans le bourg.
Paroisse de Campbon (1er février 1911)
Comme à Herbignac, grande est à Campbon la dévotion envers le « Bon Père Montfort. » Les deux paroisses ont eu l’inappréciable faveur d’avoir été évangélisées par l’homme apostolique. Elles ont toujours rivalisé de zèle pour les travaux du Calvaire. Les Campbonnais montrent avec une légitime fierté l’énorme bloc que l’on voit à droite, en entrant dans la grotte de Gethsémani. C’est un témoignage perpétuel de la splendide journée fournie alors par les hommes de Campbon. Ils avaient à leur tête ce jour-là le dévoué M. l’abbé Halgan, qui ne cessait de faire l’éloge de ses chers Campbonnais. Comme il se plaisait à nous parler des 40 zouaves fournis par Campbon à l’armée pontificale ! — « Leur dévouement, leur fidélité à toutes les nobles et saintes causes, nous disait-il, est sans pareil. Quand vous travaillerez à restaurer le Calvaire, demandez Campbon. Mes Campbonnais répondront toujours à votre appel avec empressement. » — Nous avons fait de nombreux appels, pendant dix ans, à la paroisse de Campbon. Elle a toujours répondu d’une façon admirable. Que de fois les Campbonnais nous sont venus de deux à trois cents, sous la conduite du vénéré M. le chanoine Halgan ou de ses vicaires ! Nous aimons à nous rappeler entre autres les dévoués Messieurs les Abbés Apert, aujourd’hui curé du Cellier; Waron, curé de Malville ; Martin, vicaire à Châteaubriant.
Quand notre chantier n’était pas assez vaste, la paroisse était divisée en quatre sections qui venaient successivement.
Pour le 1er février dernier, l’appel fut adressé à toute la paroisse. M. l’abbé Épiard tient à la réputation de ses Campbonnais et il veut une manifestation digne d’eux. Il doit être satisfait. Le froid est rigoureux ; malgré cela, plus de deux cents braves arrivent de bonne heure au Calvaire avec l’intrépide abbé Roué, leur vicaire, à leur tête. La difficulté est de mettre cette armée de travailleurs en ouvrage. Bien vite nos wagonnets roulent sur les voies existantes. On se hâte de préparer deux autres voies. Cela ne suffit pas encore. Soixante à quatre-vingts prennent la grosse chaîne. C’est un jeu de rouler et mettre en place les blocs dont jusque-là on n’avait pu venir à bout. Ils s’attaquent ensuite à un énorme ; ils s’en rendent bientôt maîtres comme des autres. Ils sont forts, les Campbonnais et ils en ont conscience. Ils entreprennent de transporter le bloc géant sur lequel s’était brisé le gros cric. Dans un instant la chaîne est placée ; « Hisse ! Hisse ! Hisse ! » — Le bloc ne bouge pas. On appelle du renfort, on fait manœuvrer les crics, les leviers et les barres de fer. — « Hisse ! Hisse ! Hisse ! » Le bloc remue. On fait appel à tous les hommes. Il n’est pas possible que toute la force de Campbon ne triomphe pas du bloc. M. le vicaire va aux crics et commande la manœuvre. — « Hisse ! Hisse ! Hisse ! » Le bloc remue, se soulève, on redouble de courage. Mais Dieu le veut là, il y fait bien, tel que les Campbonnais l’ont soulevé. Il y restera le mémorial de la journée du 1er février.
Les chants des cantiques et du salut ont été enlevés comme il devait. Aussi avons-nous adressé nos plus chaudes félicitations et nos plus sincères remerciements au zélé M. l’abbé Epiard, à son dévoué vicaire, et à nos braves Campbonnais.
Nous nous souviendrons, et ce qui est mieux pour eux, Jésus et Marie, le Bienheureux de Montfort se souviendront de cette belle journée.
J. BARRÉ.
N° 7 Avril 1911
Chronique du Calvaire
Mars 1911
Il m’est arrivé, bon nombre de fois, dans mes conférences aux populations françaises du Nord de l’Amérique, soit au Canada, soit aux Etats-Unis, de parler, en termes, au surplus, très discrets, du Calvaire de Pontchâteau ; de ces légions de travailleurs et de travailleuses, qui, depuis plus de vingt ans, sous la direction de leurs prêtres, les chefs toujours aimés et vénérés, répondaient, chaque année, à l’appel d’un homme suscité de Dieu, pour achever, après deux siècles, l’Œuvre commencée par un autre homme, par un saint, et réalisaient ces merveilles, dont nous sommes les témoins attendris et reconnaissants. Ils écoutaient, plein de respect, ainsi qu’ils le font, quand il s’agit de la parole de Dieu ; mais ils avaient un sourire malin et un air de vous dire : « Vous nous prenez pour des naïfs et vous prétendez nous en conter ».
Il n’y a pas que les braves gens d’Outre-mer, qui peuvent croire à une épopée romanesque, quand il s’agit du Calvaire de Montfort. Ils ont tout vu des splendeurs et des richesses artistiques des pays les plus reculés du monde ; de leur ville natale, ils connaissent toutes les antiquités, voire même la dernière plaque de marbre, indiquant le lieu de naissance du dernier citoyen plus ou moins illustre ; et, là, tout auprès d’eux, à quelques lieues à peine, il y a des beautés à voir, des prodiges, qui s’accomplissent presque sous leurs yeux… En vérité, ils semblent avoir des yeux, pour ne point voir, des oreilles, pour ne point entendre… Et, quand, un jour, égarés dans une partie de chasse aux canards, dans la Grande Brière, ou emportés par l’automobile légère, ils se sont rencontrés sur la colline sainte, pour eux, c’est toute une révélation. Ils croient rêver; ils se frottent les yeux, se demandant s’ils ne sont point encore endormis… « Qu’est-ce que c’est que toutes ces choses ?» disent-ils. « Où sommes-nous ? » Au Calvaire du Bienheureux Père de Montfort. — Mais nous avions cru que le Calvaire du Bienheureux Père de Montfort, c’était un Calvaire, un beau Calvaire, d’après tout ce qu’on en disait, mais, enfin, un simple Calvaire… tandis que, ici, il y a tout autre chose. »
Eh ! oui, ils avaient cru, quand les journaux religieux et même profanes, racontaient les solennités inoubliables, qui se déroulaient chaque année, de temps à autre, sur cette lande de Pontchâteau, qu’il s’agissait de l’un de ces Calvaires, comme on en voit, grâce à Dieu, dans chacune de nos paroisses, à l’entrée de nos bourgs, témoignage de la foi et de la générosité des peuples, qui les ont élevés, et, aux pieds desquels, aux clôtures des Jubilés et des missions, ils se rendent pour y renouveler leurs serments de fidélité. Ah ! oui, certes, ils sont beaux, nos pieux Calvaires de Bretagne ; et, le jour où il faudrait les défendre, nos chrétiennes populations seraient là, prêtes à mourir pour la croix sainte, comme elles sont prêtes, en tout temps, à vivre pour Jésus-Christ.
Ils avaient cru… et ils s’étaient trompés. Ce n’est plus simplement le Calvaire de granit, avec sa grandiose et austère beauté, c’est la terre sainte ; c’est Bethléem, Hébron, Nazareth. Puis, c’est surtout Jérusalem ! Pas un des coins douloureux, où Jésus a souffert et versé son sang n’a été oublié ; ils marchent pensifs, recueillis, une heure durant, à travers la cité, et arrivent, après avoir gravi le Calvaire, à la XIVe station.
C’est alors que, émerveillés et ravis, ils s’en vont à regret, promettant de revenir pour visiter jusque dans les moindres détails et les plus petits rochers, dont chacun a son histoire. Et ils se redisent entre eux : « Comment, au XX° siècle, après que nos grands hommes ont prétendu avoir éteint les lumières au ciel, et brisé la harpe d’or, sur laquelle se chantait la cantilène croyante de nos Pères, on voit des choses si étonnantes ! Il y a donc encore une race, qui n’a point courbé les genoux devant Baal ! Ils ont mené, à eux seuls, une entreprise, qui eût coûté plusieurs millions de francs ! » Ah ! sans doute, ils ont donné largement toujours, quand il le fallait, pour le prétoire, pour les statues, et ils sont prêts à donner encore, à de nouveaux appels ; mais, ils se sont donnés surtout ; ils ont versé leur sueur, leur sang parfois, au milieu de toutes ces magnificences : Jeunes et vieux, riches et pauvres, maîtres et serviteurs, patrons et ouvriers, tous fondus ensemble, en une sainte union, ont transporté les montagnes ; la foi seule a fait ces prodiges.
Vous qui prêchez au peuple la fraternité universelle et prétendez détruire les sociétés contemporaines, trop encore imprégnées de la foi des vieux siècles, et les remplacer par une nouvelle, où l’on pourra se passer de Dieu et de son Eglise, dans un bonheur toujours rêvé jusque-là, et toujours introuvable, de grâce, cessez vos utopies. Venez sur la lande bretonne, qui a fleuri à la voix de Montfort ; considérez ces foules ; pendant quinze mois, du vivant de notre apôtre, elles ont élevé la sainte Montagne du Calvaire. Elles sont venues de Bretagne, d’Anjou, de Vendée, du Midi, du Nord ; la catholique Belgique elle-même y a fourni son contingent. Chacun a travaillé et n’a reçu pour tout salaire que l’audition de la parole de Dieu, la prière, le chant des cantiques, la vénération des reliques saintes ; il n’a pas même reçu sa nourriture, qu’il a dû apporter avec soi et il trouvera même de quoi donner aux pauvres de sa surabondance généreuse.
Deux cents ans après, à l’heure où l’Eglise le place sur les autels, Montfort souffle, de nouveau, son zèle apostolique au Calvaire de la Madeleine, et les petits-fils des anciens travailleurs se lèvent et accourent en foule. L’instrument de travail, d’une main, le panier aux provisions de l’autre, ils traversent les paroisses qu’ils rencontrent, en chantant. Ici, on les salue et on leur crie : « demain, bientôt, se sera notre tour ! » Là : « Nous y étions la semaine dernière. » Leur nom, celui de leur paroisse, vous ne le verrez nulle part, écrit sur les pierres des différents monuments ; seul, un registre d’or, en gardera mémoire. Eux, de leur côté, ils se rappelleront les arbres qu’ils ont plantés, les rochers cyclopéens, qu’ils ont tirés de leurs assises et montés sur le sommet de la colline, et, quand ils feront pieusement leur pèlerinage, il leur sera bien permis j’avoir une distraction à tant d’endroits, témoins de leur sublime et inlassable énergie.
N’est-il rien de plus consolant pour les Pasteurs des paroisses, que cette chevauchée matinale, à pied, à bicyclette ou en carriole, à la tête de leur régiment d’hommes et de jeunes gens, tous superbes d’entrain, de gaîté, de vaillance ? Quel beau jour aussi que celui-là ! Un jour, où ils n’auront pas blasphémé; où, de leurs lèvres de chrétiens, ne seront sorties que des paroles honnêtes et de bon aloi ! Un jour, où ils auront bu à la si gracieuse fontaine du bienheureux plus qu’à la dive bouteille, gardant avec leur raison, leur esprit naturel, vif, primesautier, et leur piété fervente et facile à enthousiasmer ! Le soir, ils rentrent à la nuit tombante, au bourg, où chacun les attend, pour les saluer au passage. Ils sont harassés de fatigue : ils ont si bien travaillé ! ils ont tant et si bien chanté ! ils ont si bien prié ! La belle et bonne journée, toute pour Dieu, toute, par conséquent, pour eux, de bénéfices. Dieu leur rend au centuple ce qu’ils lui ont donné.
Ils tiennent tellement à cette journée de travail, que ceux qui sont empêchés d’y venir, paient le prix d’une journée d’homme et en font offrande au Calvaire. On se raconte ensuite, le soir, à la veillée, tous les incidents du voyage. Rien n’est oublié : ni les bons mots de celui-ci ou de celui-là ; ni les sages et prudents conseils de Monsieur le Curé ou de Monsieur le Vicaire; ni les encouragements et félicitations sur toute la ligne du bon Père Barré.
Les femmes et les jeunes filles, ont, elles aussi, leurs journées de travail. Elles ne sont, ni les moins ardentes, ni les moins rudes à la besogne. En bien des circonstances, elles ont fait des travaux, devant lesquels, les hommes auraient peut-être hésité. C’est que : « Ce que femme veut, Dieu le veut ! » On le verra encore au Calvaire.
Victor de Saint-Cybard.
Nos Travaux
Paroisse de Sainte-Reine (7 février 1911)
Que de souvenirs rattachent la paroisse de Sainte-Reine au Calvaire ! A l’époque du Bienheureux de Montfort, Sainte-Reine faisait partie de la paroisse de Pontchâteau. C’est même sur son territoire que le Missionnaire songea d’abord à placer son calvaire. Le calvaire paroissial en est un mémorial permanent. Puis, n’est-ce pas la paroisse de Sainte-Reine qui a eu l’insigne honneur de donner le jour à l’illustre M. Gouray, curé de Pontchâteau, deuxième restaurateur du Calvaire ? Monseigneur Jacquemet n’a-t-il pas trouvé dans la personne du pieux et zélé M. l’abbé Verger, curé de Sainte-Reine, un précieux et dévoué concours pour l’établissement des Fils de Montfort au pied de son Calvaire ? A Sainte-Reine, le dévouement au Calvaire est dans le sang. Aussi comme on s’est toujours empressé de répondre aux invitations adressées par l’ancien Curé, le regretté M. Lévêque. L’appel chaleureux du bon M. l’abbé Corbineau ne devait pas trouver moins d’écho dans les cœurs de ses paroissiens. Il eut la joie de les voir, dès son arrivée, nombreuse et enthousiaste. Après une courte visite et quelques mots de bienvenue à la chapelle, on se rend au travail au chant des cantiques. Puis, donnant l’exemple, M. le Curé saisit une pioche ; son vicaire, une pelle ; et le travail commence et se poursuit toute la journée avec un joyeux entrain. Il n’est interrompu que par la récitation de l’Angélus faite à haute voix par M. le Curé, auquel tous ses paroissiens répondent pieusement et avec un ensemble parfait.
La soirée n’est pas moins bonne que la matinée. Nombreux sont les jeunes gens qui n’avaient pas encore pris part à nos travaux. Aussi les wagons ne chôment pas quand ils ont reçu leur charge. Mais il y a aussi des anciens, qui travaillent avec non moins de courage. Nous adressons des félicitations particulières à un brave octogénaire qui porte vaillamment ses 80 ans.
Excellente journée, très agréable à Jésus et à Marie, très méritoire pour chacun de ses courageux travailleurs. Elle leur vaudra une part au bien qui sera fait par notre mystère de l’Ascension et sera un nouveau titre à la protection particulière du Bienheureux Montfort. Il nous a été très agréable de leur en donner l’assurance, en les remerciant avant leur départ, et en remerciant tout spécialement le bon et zélé M. l’abbé Corbineau, curé de la paroisse, l’âme de cette belle et touchante manifestation de foi, ainsi que M. l’abbé Bizeul, son dévoué vicaire.
Paroisse de Férel (8 février 1911)
Le lendemain, c’étaient les hommes de Férel. Mais Férel n’est-il pas à près de vingt kilomètres du Calvaire ? Pourquoi les hommes de Férel avant tant d’autres plus rapprochés du Calvaire, qui aspirent à prendre part à nos travaux de l’Ascension ? C’est que M. le chanoine Gergaud, recteur de Férel, dans son zèle ardent pour la gloire de Jésus-Christ et sa grande dévotion envers le Bienheureux de Montfort, a pris l’initiative de nous demander à nous amener ses paroissiens. Il nous écrivit, le 25 janvier : « J’ai appris qu’aujourd’hui vous aviez convoqué la paroisse d’Herbignac à élever la montagne de l’Ascension. Vous n’oublierez pas certainement Férel. » Puis le dévoué Recteur nous presse d’aller nous-même faire appel à ses chers paroissiens. « Religion et reconnaissance, voilà des motifs qui pourraient entraîner ma population. Essayons, cher Père, et que votre présence, rappelle les si beaux souvenirs de la mission !!! »
Le dimanche 5 février, M. l’abbé Chabot était à Férel ; et, le mercredi 8, Férel nous donnait une splendide journée de travail. Avant huit heures du matin, une vaillante équipe de jeunes gens décidés nous arrive à pieds. Ils sont partis à 4 heures. C’est l’habitude des travailleurs de Férel. Que de fois l’intrépide M. le chanoine Gergaud est parti ainsi à pieds, dès 4 heures du matin, à la tête de ses travailleurs ! Cette fois, il s’est fait remplacer par son digne vicaire, M. l’abbé Delaune. Il y a bientôt 80 travailleurs sur la lande de l’Ascension, et tous, à l’exemple du vaillant abbé Delaune, rivalisent d’activité. On ouvre l’avenue qui doit conduire au rocher de l’Ascension. Les sapins, les bouleaux et les acacias sont vite abattus. Sur toute la ligne le travail se poursuit avec une étonnante activité. Après l’Angélus, le cantique Par l’Ave Maria est chanté sur l’air Morbihannais. Dans la soirée, un beau bloc est roulé à la base du rocher de l’Ascension ; un autre plus énorme est placé sur le chariot, malheureusement il glisse et porte sur les roues qui s’enfoncent jusqu’à l’essieu. Nos hommes veulent à tout prix transporter ce bloc, tous se mettent à la chaîne. Mais le malheureux chariot s’obstine à demeurer en place. Il est cinq heures. C’est à regret, mais il faut partir.
A la chapelle, nous remercions avec effusion nos vaillants travailleurs de Férel. Nous leur disons quel suave souvenir nous gardons de l’édification qu’ils nous ont donnée pendant la mission d’octobre dernier, et combien il nous a été agréable d’entendre leur cher et vénéré Recteur nous parler de leur fidélité à garder leurs résolutions. Nous prions le Bienheureux de Montfort de les conserver dans les sentiments de foi et de générosité chrétienne qui les animent, de continuer à protéger d’une manière toute particulière, l’excellente paroisse de Férel, de lui conserver de nombreuses années son cher et vénéré Recteur, de bénir le dévoué abbé Delaune, chacune des familles et chacun des membres des familles de Férel. Cette belle journée, après tant d’autres qui demeurent gravées dans la mémoire de Montfort, leur vaudra, nous n’en doutons pas, cette insigne faveur.
Chapelle-Launay (9 Février 1911)
Hier nos travailleurs venaient des rives de la Vilaine, ils nous arrivent aujourd’hui des bords de la Loire. Nous comptons aussi sur une excellente journée. Car nous les connaissons, les habitants de la Chapelle-Launay. Ce sont des hommes de foi. Souvent nous avons admiré leur tenue à l’église, quand nous leur y avons adressé la parole. Le dimanche à la messe, on se croirait dans une communauté religieuse.
A la Chapelle-Launay, on aime le Bienheureux de Montfort et son Calvaire, et l’on est aimé de lui. Dans toutes les épreuves, on recourt à son intercession, et ce n’est jamais en vain. Que de journées de travail consacrées au Calvaire. Elles sont gravées dans la mémoire du Bienheureux, et nous aimons à nous les rappeler nous-même ces belles journées où ils venaient toujours nombreux, toujours intrépides, sous la conduite du bon et dévoué M. l’abbé Allain et ses dignes vicaires, Messieurs Dubois et Mosset.
A la Chapelle-Launay, l’ivrognerie, l’alcoolisme sont inconnus : les hommes sont robustes et ingénieux. Ce qui pour d’autres sera impossible, ne sera rien pour eux. Tels nous les avons connus sous le bon M. Allain, tels nous les retrouvons sous le pieux M. Maugé. Ce n’est pas chez eux que le niveau religieux a baissé ; au contraire, ils marchent toujours dans le vrai progrès.
Ils arrivent de bon matin, sous la conduite de M. l’abbé Combeau, leur dévoué vicaire.
Retenu par les catéchismes, M. le Curé les rejoindra vers la fin de la matinée. Le travail est bientôt distribué et tous rivalisent d’activité. Nos wagonnets se remplissent et roulent comme par enchantement. Plusieurs énormes blocs sont bientôt mis en place. Puis l’on s’attaque au chariot enfoncé jusqu’à l’essieu. Le bloc est d’abord soulevé avec les crics ; de grosses pierres habilement placées les maintiennent au-dessus des roues. — « Tout le monde à la chaîne !» — « Hisse ! » — Le chariot s’ébranle lentement. Trois hommes vigoureux s’efforcent de maintenir le limon entouré de la chaîne. Mais à chaque coup, ils sont projetés en l’air comme des plumes. Ils doivent se coucher à plat ventre sur le timon pour n’avoir pas les membres brisés en retombant. Enfin le bloc est à destination.
Deux braves ont reçu pour tâche, dès le matin, d’en dégarnir un autre. C’est fait, il n’y a plus qu’à le sortir de son trou. — « Vite, la chaîne. » — « Hisse ! » Le bloc essaie de résister, mais bientôt il doit céder à la force.
Le voilà debout, on va crier : « il est à nous », quand la chaîne glisse. Il retombe lourdement sur son séant.
C’est à recommencer, mais cette fois on se munit des calles et des leviers pour le maintenir à mesure qu’il s’élève et replacer la chaîne à temps. Ainsi nous pouvons bientôt chanter victoire. Plus que dix minutes ! Qu’il faut se hâter pour la rendre à l’Ascension ! On veut pourtant en venir à bout. Une première culbute est l’affaire d’un instant ; mais la forme de notre bloc rend la seconde difficile, et nous oblige, faute de temps, à le laisser en chemin.
Belle et bonne journée ! Comme les précédentes, bien agréables au Bienheureux Montfort. Journée bien consolante pour nous, mais rude, trop rude même pour des forces que je voudrais ne pas sentir décliner. A la fin, j’étais aphone, et pour commander la manœuvre j’avais dû faire appel au dévouement du bon M. Chabot. Grâce à M. le vicaire de la Chapelle-Launay, le chant des cantiques et du salut n’a fait qu’y gagner. Nous avons pourtant tâché de trouver assez de voix pour adresser, après le salut donné par M. le Curé, nos plus chaudes félicitations au bon Pasteur de la Chapelle-Launay, à son dévoué vicaire, ainsi qu’à ses chers et intrépides paroissiens.
Paroisse de Prinquiau (14 Février 1911)
La paroisse de Prinquiau s’est aussi toujours distinguée par sa dévotion au Bienheureux Montfort et son dévouement à sa chère œuvre du Calvaire.
La première journée mentionnée par l’Ami de la Croix est celle du 28 mars 1894, consacrée par les hommes de Prinquiau, aux derniers travaux du jardin de Gethsémani. Ils étaient nombreux, ayant à leur tête le vénéré M. l’abbé Poisson, curé de la Paroisse. On a signalé dans la circonstance le transport d’un énorme bloc qui fut placé au midi du jardin et reçut le nom de « pierre de Prinquiau. » Depuis lors, que de journées consacrées par cette chrétienne paroisse à nos travaux du Calvaire. Rappelons seulement celle où les hommes de Prinquiau se trouvaient en même temps que ceux de Quilly et où fut transporté le bloc géant qu’on voit debout à droite, faisant façade, à l’entrée de la grotte d’Adam. Signalons cette autre journée où le général du Guiny, qui venait de quitter son commandement de corps d’armée, faisait partie de nos travailleurs. Nous aimerions à citer d’autres noms si les limites de notre compte-rendu nous le permettait. Un certain nombre de ces braves sont allés prendre possession du bonheur du ciel. Avec quel empressement ils ont été accueillis et présentés à Marie et à Jésus par le bon Père Montfort. Mais il existe encore, et un bon nombre, de nos braves travailleurs de Gethsémani et du Calvaire. Que nous avons regretté d’avoir été obligé de nous absenter le 14 ! Que nous aurions été heureux de leur serrer la main, d’adresser nos félicitations en particulier à M. Datin, maire de la commune et faire connaissance avec la nouvelle génération, qui, on nous l’a dit, s’est montrée digne de ses ancêtres.
C’est à son dévoué vicaire, M. l’abbé Allais, que le bon M. Leduc, curé de Prinquiau, avait confié ses hommes. M. l’abbé Allais pouvait être justement fier d’une telle armée de braves. Nous n’avons pas été étonnés des éloges que M. l’abbé Chabot nous a fait des hommes de Prinquiau. Il a été frappé de leur force, entre les mains de l’un d’eux, notre grosse barre de fer que certains ont peine à soulever semblait être une plume. Aussi le bloc laissé en chemin, faute de temps, par la Chapelle-Launay a-t-il été bientôt en place. La somme d’ouvrage de la journée a été considérable. Deux légers accidents n’ont pas diminué l’ardeur au travail. Trop de promptitude à tirer sur la chaîne a pressé malencontreusement le doigt d’un travailleur contre le bloc et lui a enlevé l’ongle. En poussant un wagonnet chargé, un autre s’est frappé violemment les lèvres contre la fonte. La douleur a été vive. Mais ces sacrifices ont été offerts joyeusement à Jésus. « Il en a souffert de plus rudes pour nous ouvrir le ciel. »
Cette fois, notre bon général n’était pas, à son grand regret, au nombre de nos travailleurs. Mais il a tenu à nous faire remettre le prix de sa journée.
Remarquable a été le chant des cantiques et du Salut. Il en a été ainsi d’ailleurs de toutes les paroisses qui jusqu’à ce jour sont venues prendre part à nos travaux. Nous avons le plaisir de constater que, depuis leur début, en 1890, le chant religieux a fait de réels progrès parmi les hommes dans toute notre région.
Belle et bonne journée ! durant laquelle le Bienheureux de Montfort a dû encore abaisser des regards satisfaits sur la lande de la Madeleine. Après le salut, M. l’abbé Boutillier, laissant parler son cœur, a adressé, en termes chaleureux, des félicitations et des remerciements bien mérités à M. le Curé de Prinquiau, à son digne vicaire et à ses dévoués paroissiens.
Paroisse de Notre-Dame-de-Grâces (15 janvier 1911)
Nous lisons dans « l’Ami de la Croix », à la date du 13 mai 1898 : « Félicitations très particulières à ce groupe de travailleurs de Notre-Dame-de-Grâces qui, sans convocation spéciale, sans avoir entendu comme tant d’autres, du haut de la chaire, prêcher la sainte croisade, mais en ayant seulement recueilli quelques échos, sont venus d’eux-mêmes offrir leurs bras au Calvaire. Ils ont fait preuve, dans la journée, de la plus grande bonne volonté, d’un vrai dévouement et aussi d’une habileté spéciale dans les travaux qui leur ont été demandés. »
Le 13 mai 1898; les travailleurs de Notre-Dame-de-Grâces n’avaient pas le bonheur d’être amenés par leurs prêtres. L’organisateur était M. Chevalier.
Mais cette année, c’est leur dévoué pasteur, M. l’abbé Renaud, qui les a convoqués et est venu à leur tête accompagné de son zélé vicaire, M. l’abbé Clavié. M. le Curé comptait sur une quarantaine ; ses prévisions ont été dépassées. Malgré la distance, (5 à 6 lieues), la petite paroisse de Notre-Dame-de-Grâces nous a fourni une soixantaine de travailleurs. Il y avait un véritable enthousiasme, un merveilleux entrain, une étonnante activité. Ils ont tenu à avoir leur bloc. Ce sera un souvenir qu’ils montreront à leurs enfants et petits-enfants, quand ils viendront en pèlerinage. Ils ont bien mérité les félicitations qui leur ont été adressées par M. l’abbé Boutillier : «Vous venez, leur a-t-il dit, de Notre-Dame-de-Grâces : on le voit bien. Dame de grâce veut dire : toute belle et toute bonne. Comme une mère ici-bas donne de sa ressemblance à ses enfants, ainsi la Très Sainte Vierge vous a donné de sa toute beauté et de sa toute bonté.
De sa toute beauté, non pas celle qu’on reconnaît en vous dans la pureté des linéaments du visage, mais dans cette foi, cette vertu, cette liberté, qui rayonnent dans tout votre être.
De sa toute bonté, qui vous rend aimables, gracieux, prêts à tout faire, pour faire plaisir, comme nous en avons une preuve encore aujourd’hui dans votre pèlerinage de travailleurs, où ni l’entrain, ni l’endurance, ni la belle humeur n’ont fait un seul instant défaut. Puisse, Notre-Dame-de-Grâces, par l’intercession du Bienheureux Père de Montfort, pour lequel vous avez si bien travaillé, vous garder beauté et bonté, pour le bonheur de vos familles et la joie de votre Pasteur ! »
Nous n’avons pas eu le bonheur d’être témoins des travaux de cette belle journée. Mais nous avons eu du moins la douce consolation d’arriver à temps pour remercier le bon Curé de Notre-Dame-de-Grâces et son vicaire, et donner une cordiale poignée de main à chacun de ses braves travailleurs.
Paroisse de Pontchâteau (1er mars 1911)
Monsieur l’abbé Lebert, curé doyen de Pontchâteau, adressa, le dimanche de la Quinquagésime, un chaleureux appel à ses dévoués paroissiens, les invitant à se rendre nombreux travailler au Calvaire, le mercredi des Cendres. L’appel du zélé Pasteur fut entendu. Le mercredi des Cendres, la paroisse de Pontchâteau nous a donné une bonne, une splendide journée de travail. Quand, vers le milieu de la matinée. M. le Curé arriva sur la lande, il eut la joie d’y trouver toute une armée de travailleurs. Les wagonnets roulaient sur quatre voies : 4 équipes de rouleurs, 4 nombreuses de piocheurs et de chargeurs, 4 de déchargeurs. Sur différents points, d’autres équipes travaillaient activement à extraire des blocs en vue de l’Ascension et de la Résurrection ; une autre préparait une nouvelle voie. Enfin une vingtième était occupée du bloc géant. Après un salut cordial au Directeur des travaux, le bon Curé va de groupes en groupes, heureux de féliciter ses chers paroissiens, il a pour chacun un mot aimable et particulier. Tous sont enchantés, ravis. Parmi nos travailleurs, nous sommes heureux de signaler M. Joseph de Marcé, notre sympathique et dévoué Conseiller d’Arrondissement. Il nous est bien agréable aussi d’avoir M. l’abbé Cousin et, dans la soirée, M. l’abbé Bouchaud. Nous comptons des hommes de tout âge, mais les jeunes gens surtout sont nombreux. Aussi les wagonnets ne chôment pas, et c’est toujours la grande vitesse. Une force étonnante et une adresse remarquable sont déployées pour retirer du fond des carrières des blocs énormes. Rien n’est capable d’arrêter les hommes de Pontchâteau. Aussi, après plusieurs résultats vraiment merveilleux, nous entreprenons de remettre la chaîne sur le bloc géant qu’a dû laisser Campbon. Il ferait mieux un peu plus loin, puis il est pleinement dégagé et les crics l’ont beaucoup relevé. Le succès couronne les premiers efforts : le bloc géant est debout. Il n’y a plus maintenant qu’à l’avancer. Il fait d’abord la sourde oreille, nous oblige à recourir encore aux crics. Mais à la fin de la journée, il cède aux instances réunies de nos inlassables Pontchâtelains. A Pontchâteau donc la gloire d’avoir mis en place le bloc géant.
L’Ascension ne nous fait pas oublier la Résurrection. C’est au Calvaire, au-dessus du saint Sépulcre que le mystère de la Résurrection doit être représenté. Mais la représentation de ce mystère exigera de grands travaux : la montagne devra être élargie du côté du saint Sépulcre et il faudra pour cela de nombreux blocs. Nous songeons à les préparer, tout en travaillant à l’Ascension. Nos hommes de Pontchâteau en ont extrait plusieurs qui sont très beaux. Les jeunes gens ont réclamé l’honneur de transporter les premiers. Mais quand nous avons voulu recourir à notre chariot, il nous refusa ses services. L’essieu avait plié sous de trop lourdes charges et une boucle du limon faisait serre-frein. Parmi les travailleurs se trouvait heureusement un forgeron. Se procurer des outils et enlever la boucle fut l’affaire d’un quart d’heure, et, malgré son essieu faussé, le chariot reçut les blocs que nos agiles jeunes gens transportèrent au pas de course au Calvaire.
Retenus par leurs devoirs d’état, plusieurs de ces Messieurs de la ville ont tenu à nous faire parvenir le prix de leur journée. Nous les en remercions sincèrement. Cette offrande nous aidera à couvrir les frais de réparation de notre matériel, auquel trop souvent une jeunesse, avide d’innocents amusements, cause, sans s’en douter, des dégâts dispendieux : c’est un wagonnet lâché à la descente ; il en résulte un choc violent qui brise les boîtes des essieux, parfois même les montants destinés à soutenir les caisses ; d’autres fois, c’est la traverse d’un rail brisée, ou le rail lui-même faussé ou cassé. Les avis ne manquent pas, mais tout entière au travail et à la joie, la jeunesse oublie facilement. Il faudrait avoir l’œil partout, mais impossible.
Le travail de la matinée s’est terminé par le chant de l’Angélus entonné par M. le Curé de Pontchâteau et continué par les travailleurs avec un brio remarquable. Ils ont chanté de même, en se rendant déjeuner, le cantique Par l’Ave Maria. Avant la reprise du travail, nous sommes montés au Calvaire. Après le chant du cantique « Vive Jésus ! Vive sa Croix ! » et les acclamations ordinaires, ils ont enlevé avec enthousiasme :
« Chers Amis, tressaillons d’allégresse,
Nous avons le Calvaire chez nous. »
C’est que ce cantique, composé ici même par le Bienheureux, a pour les habitants de la paroisse de Pontchâteau une signification particulière. C’est chez eux que se trouve le Calvaire du Père Montfort ; c’est à eux qu’il a confié ce précieux dépôt et ils se sont toujours montrés dépositaires fidèles. En retour, le Bienheureux les a toujours protégés et bénis d’une manière toute particulière. Loin de s’affaiblir, leur foi et leur piété, comme leur amour et leur zèle pour le Calvaire vont grandissant.
Nous avons été témoin, il y a quarante ans, d’une journée de travail de la paroisse de Pontchâteau au Calvaire. M. l’abbé Noël était alors Curé, on restaurait l’avenue qui arrive en face du Calvaire et on plantait les cèdres qui en sont l’ornement sous la direction de Messieurs les abbés Nicol et Brény. C’était une belle manifestation. Nous avons eu de bien belles journées depuis lors, sous M. l’abbé Richard. Mais nous ne craignons pas d’être contredit en affirmant que la journée du mercredi des Cendres 1911, l’emporte sur tout ce que nous avons vu jusqu’à ce jour. Cette splendide manifestation a été inspirée par la foi et elle en indique le niveau ; elle montre qu’à Pontchâteau la foi va s’accroissant. Le zélé M. Lebert, heureux de recueillir les fruits de son zèle, nous le disait dans la journée. A Pontchâteau, la fréquentation des Sacrements augmente chaque année d’une façon admirable, le prêtre y est vénéré, et toutes les œuvres religieuses y sont prospères.
Nous avons admiré avec quel entrain et quelle perfection le Salut et le cantique Je suis Chrétien ont été chantés par la masse des travailleurs.
Aussi, est-ce avec une grande joie, qu’avant le départ, nous avons adressé de chaudes félicitations et de sincères remerciements au dévoué M. l’abbé Lebert, qui a passé la journée au milieu de ses paroissiens, les encourageant et prenant part à leurs travaux. Nous avons félicité et remercié de même nos intrépides travailleurs. Nous garderons fidèlement le souvenir de cette excellente journée. Et, ce qui sera plus précieux pour nos chers travailleurs, c’est le souvenir qu’en gardera le Bienheureux de Montfort. Il l’a favorisée, en nous obtenant un beau temps exceptionnel. Il en a été satisfait. Du haut du ciel, il a abaissé, durant toute cette journée, des regards de complaisance sur ses chers et dévoués Pontchâtelains. Cette journée lui demeurera présente, et il saisira avec empressement, je n’en doute pas, toutes les occasions de prouver au zélé Pasteur de Pontchâteau et à son cher troupeau, qu’il en conserve un fidèle souvenir.
J. BARRÉ.
N° 8 Mai 1911
Chronique de Mai 1911
L’un des chasseurs de la Brière a cru que je l’avais pris à partie, dans ma dernière Chronique et il m’a reproché d’avoir un tantinet exagéré l’ignorance, dans laquelle il se trouvait, à l’égard de notre Cher Calvaire et de ses œuvres. Il savait bien qu’il y avait ici, autre chose qu’un Calvaire semblable à ceux qu’on voit à l’entrée de nos villages… mais, en fin finale, il ignorait ce qu’il y avait. Je dois à la vérité de dire que son enthousiasme délirant de mars dernier ne diminue pas et que déjà il s’apprête à s’égarer de nouveau, par ici, en auto, par un beau jour de mai, avec quelques amis, plus ou moins sceptiques, pour leur montrer et leur narrer, à son tour, ce que je lui ai, de si bon cœur, appris. Et je lui ai appris encore du nouveau, qui l’a mené de surprise en surprise ; si bien qu’il m’a dit : « Sans comparaison, c’est comme chez Nicollet, ça va toujours de mieux en mieux. »
Vous l’avez dit, mon très-cher, toujours de mieux en mieux. C’est la devise du vieux Prêtre, couronné de cheveux blancs, qui dirige l’Œuvre. Je voudrais bien que, l’un de ces quatre matins, alors qu’il voudra ou plutôt qu’il pourra se reposer et laisser travailler son monde, il vous narre par le menu, tous les incidents joyeux et tristes, qui, depuis vingt-trois ans, se sont déroulés sous ses yeux. Tristes… certes, il y en eût… de quoi déconcerter les hommes les plus forts, d’autant qu’ils venaient presque toujours du côté où l’on devait le moins les attendre ; mais, il était l’homme choisi par Montfort : il devait vaincre par la croix et par les contradictions. Il voyait en elles, le gage le plus certain de la victoire, et toujours, il regardait du côté consolant ; il voyait ce qu’il avait déjà, il en bénissait le Ciel, et, s’il ne dédaignait point de regarder plus loin, ni plus haut, il savait attendre l’heure ; et l’heure sonnait : et ses contradicteurs, qui n’en étaient pas moins souvent de ses meilleurs amis, disaient en riant et en l’applaudissant ; « C’est arrivé, comme il l’avait prédit. »
Il s’agissait de tracer sur la lande, une place, qui répondit à son ardent désir de représenter Jérusalem, la ville sainte. Rien ne lui eût été plus facile d’obtenir un passage sur le bateau, qui, chaque année, emmène des centaines de Pèlerins en Judée et d’y voir, lui-même, de ses yeux, ces augustes sanctuaires, où, dans chaque siècle est venue se retremper la foi de la chrétienté. Et, cependant, que deviendra son œuvre, là-bas, au Calvaire de la Madeleine ? Il se réjouira du bonheur de ceux qui iront ; lui, il restera. En combien d’autres circonstances, sollicité par des amis intimes, anciens élèves devenus prêtres, curés, vicaires, directeurs d’Oeuvres magnifiques, il n’hésitera pas à mécontenter les plus chaudes amitiés et à sacrifier les plus beaux voyages : son Calvaire le retient. A peine s’échappe-t-il, quelquefois, par année, pour aller saluer sa vénérable mère, et il revient, toujours avec des projets, qui semblent nouveaux pour le vulgaire mais qui sont, en somme, la suite normale de ce vaste plan, qu’il a conçu et pour lequel la divine Providence lui aménagé deux hommes, dont l’un, en deux ou trois voyages, le R. P. Jérôme, vicaire de la Custodie de Terre-Sainte tracera les lignes et jalonnera les différentes étapes de la voie douloureuse, tandis que l’autre, ouvrier infatigable, plusieurs fois Pèlerin de Jérusalem, ancien officier des Zouaves Pontificaux, M. Gerbaud, pendant une douzaine d’années, emploiera tout son dévouement et toute son activité, à les faire exécuter le plus parfaitement possible.
En moins de quelques mois, au surplus, on commence à s’y reconnaître ; les distances des stations sont indiquées, mais, parce que, pour la population, on ne marche pas assez vite, saint Lyphard. conduit par son Pasteur, de sainte et douce mémoire, M. Bertrand, vient planter un chemin de croix en bois, tout en travaillant, ce jour-là, à la noble et grande entreprise, à laquelle, si souvent, on les reverra, toujours alertes, adroits et dociles, ardents au travail, toujours les mêmes sous leurs différents curés ou vicaires.
Et, c’est à cette époque, que l’on voit apparaître les premières théories de femmes et de jeunes filles, qui, la bêche sur l’épaule, ont traversé, le plus souvent à pieds, la Brière, à peine desséchée et sont venues par centaine. Il me faudrait nommer, l’une après l’autre, toutes les paroisses, depuis Saint-Nazaire jusqu’à Saint-Guillaume et Sainte-Reine ; et pourquoi non ? Honneur, en effet, aux femmes de Saint-Joachim ! « Elles travaillent comme des hommes, ces femmes-là ! » disait un personnage, qui les avait vues à l’œuvre. Il aurait dit la même chose de vous, femmes et filles chrétiennes de Missillac, de Crossac, de Campbon, de Guenrouët, de la Chapelle des Marais. Bravo ! également à celles d’Herbignac, de Férel, de Saint-Dolais, Marzan… Mais, je n’en finirais pas. Leurs noms sont plus nombreux que les noms des litanies des Saints. Honneur donc aux femmes et aux hommes des 120 paroisses au moins, qui sont venues depuis Nantes jusqu’à Vannes ; depuis Nozay jusqu’à l’Océan !
Sans doute, les gros, et durs et cyclopéens travaux ont été fait par les hommes ; mais, il y avait place pour les femmes. Comme leurs devancières du temps du B. Montfort, pour exhausser le Calvaire, elles portaient de la terre, dans des paniers, dans des hottes, et, faute de mieux, dans leur tablier. Elles ne dédaignaient pas, à l’occasion, de s’attacher à la chaîne, pour rouler sur la sainte Montagne, telle ou telle pierre, que les hommes avaient abandonné la veille ; entraîner les wagonnets jusqu’à la grotte d’Adam, au risque, comme il advint un jour, de voir le char et les traîneuses, dégringoler jusque dans la douve profonde, sans trop d’égratignures, un peu rafraîchies, néanmoins, mais pas découragées, prêtes tout au contraire, à recommencer, avec plus de précaution, toutefois, du moins pour le quart d’heure.
La voie douloureuse, toute pavée de pierres aiguës, est, en grande partie, l’œuvre des femmes. C’est un vrai supplice de suivre Notre-Seigneur sur ce rude chemin du Calvaire. Les ronces, les ajoncs et autres plantes, l’ont envahie de toute part. Travail méticuleux, ennuyeux : les femmes en viendront à bout ; l’herbe n’y poussera plus que comme un gazon. Elles sauront en effet plus tard, à la suite de justes et intelligentes observations, rendre la voie moins rocailleuse ; elles feront, elles déferont, plusieurs fois la même chose, selon que des circonstances nouvelles obligent à certaines modifications de détail, et cela avec la même joie, qu’elles ont mises en tout, dans leur travail, du commencement à la fin. Elles planteront les arbres, ratisseront les allées, désherberont les plates-bandes, arroseront les plantes, qui vont se dessécher et périr, et elles trouveront encore le temps pour la prière et le chant des Cantiques. Elles sont venues faire un pèlerinage. Combien d’entr’elles et de très éloignées du Calvaire, sont parties de chez elles, de 3 à 4 heures du matin, à jeun, pour faire la sainte communion, et accomplir ainsi un vœu ?
Car, n’allons pas nous imaginer que le B. Père de Montfort va se laisser, par eux, vaincre en générosité. Interrogeons-les tous ; et il est bien rare que nous en rencontrions un seul, qui n’ait quelque vieille dette à solder envers le saint Missionnaire. Ils sont si assurés qu’il va les exaucer, qu’ils lui demandent des choses qui feraient sourire, si on ne s’émerveillait pas plutôt de leur naïve confiance. « Dieu aime son saint serviteur, disent-ils, et il lui donne tout pouvoir sur son cœur ; or, son saint serviteur nous aime ; donc demandons-lui ce que nous voudrons : il nous donnera d’autant plus, que nous l’aimerons et le prierons davantage. » Besoins temporels : pour soi, pour les siens ; on n’oubliera personne, pas même les plus humbles animaux de l’étable. Besoins spirituels : pour une conversion, pour une guérison, la conservation de la foi, l’augmentation de la piété, etc. Et les messes d’actions de grâces qu’ils font dire, aux différents sanctuaires, et les lampes, et les cierges, qui brûlent nuit et jour, et les merci, dont par une trop grande discrétion, la revue de l’Ami de la Croix ne fait connaître que le petit nombre; tout cela témoigne hautement du puissant crédit dont le B. Père de Montfort jouit toujours en leur faveur, auprès de Jésus et de Marie.
Victor de St-CYBARD
Nos Travaux
Paroisse de Saint-Guillaume (7 mars 1911)
L’Ami de la Croix a mentionné les journées de travail consacrées à l’œuvre du Calvaire par la bonne paroisse de Saint-Guillaume : elles sont nombreuses. C’est même cette paroisse qui est venu travailler la première, sous la conduite de son curé, le regretté M. Nicol. Combien de fois depuis lors, cet ami dévoué du Calvaire et son successeur, le bon M. l’abbé Péreau, ne nous ont-ils pas amené les hommes, puis les femmes de Saint-Guillaume, travailler à Gethsémani, à la voie douloureuse et au Calvaire !
Le zèle des habitants de cette paroisse ne saurait diminuer sous la direction de M. l’abbé Verger, dont le dévouement au Bienheureux de Montfort et à son Calvaire est un héritage de famille. Le père Verger, missionnaire de la Compagnie de Marie, qui fut martyrisé à La Rochelle, pendant la Révolution était son grand-oncle. Les ennemis de notre foi, lui arrachèrent la langue, cette langue, disaient-ils, qui avait fanatisé tant de personnes : fin digne d’envie pour un prédicateur de l’Evangile !
Nous n’avons pas oublié le saint abbé Verger, curé de Sainte-Reine, dont la mémoire est en vénération dans son ancienne paroisse. Personne n’a mis plus de zèle et de dévouement à seconder Monseigneur Jacquemet dans l’établissement des Fils du Bienheureux de Montfort au pied de son Calvaire. M. l’abbé Verger, ancien curé de Sainte-Reine, était aussi l’oncle de M. l’abbé Verger, curé actuel de Saint-Guillaume.
Dès son arrivée dans la région, comme vicaire du bon Monsieur Gaudin, M. l’abbé Verger nous témoigna son dévouement à l’œuvre du Calvaire, en s’empressant de venir à la tête des travailleurs et des travailleuses de Missillac. Curé de Saint-Guillaume, ses sentiments sont les mêmes. Ses paroissiens ont répondu avec empressement au chaleureux appel de leur bien aimé Pasteur. Au son de la cloche ils se rendent à l’église paroissiale et se mettent en marche vers le Calvaire au chant des cantiques. Ils nous arrivent ainsi le visage épanoui et rayonnant de joie. Nous leur serrons cordialement la main et ils entrent à la Chapelle. Après une prière et deux mots de bienvenue au Pasteur et à ses paroissiens, nous nous rendons à la montagne de l’Ascension, toujours au chant des cantiques. Puis, vite à l’ouvrage.
Le principal travail de la journée a été de placer de chaque côté du bloc de Pontchâteau d’autres blocs qui l’encadrent. Un énorme bloc, extrait par les Campbonnais, est amené ensuite et mis de façon à donner plus d’ampleur au bloc géant. Ce travail rude et difficile est fait avec adresse et courage.
Honneur aux hommes de Saint-Guillaume ! Ils ont à cœur d’avancer l’ouvrage et de bien faire.
Aussi avons-nous adressé à ces braves, avant leur départ, des félicitations et des remerciements bien mérités. Cette belle et bonne journée sera pour eux un nouveau titre à la protection particulière du Bienheureux Père de Montfort, qui ne manquera pas de saisir avec empressement les occasions de donner au dévoué Pasteur de Saint-Guillaume et à ses chers paroissiens des témoignages effectifs de sa grande bienveillance.
Frairies de Bergon et de Sainte-Luce (9 mars 1911)
Missillac est une grande paroisse ; et une paroisse dévouée au Bienheureux de Montfort et au Calvaire. C’est la raison pour laquelle nous avons prié M. le Curé de la diviser en deux sections.
Nous savons que chaque section nous donnera de nombreux et vaillants travailleurs.
Ce sont les deux frairies de Bergon et de Sainte-Luce qui ont été convoquées pour le 9 mars. La frairie de Sainte-Luce nous rappelle le souvenir du regretté Monsieur Dézanneau, ancien membre de l’Assemblée nationale, qui fut pour Monseigneur Jacquemet un auxiliaire dévoué dans l’acquisition des terrains nécessaires à l’établissement des Fils de Montfort au Calvaire. Il habitait la Haie-Eder, était propriétaire de la Chapelle de Sainte Luce, y faisait célébrer la messe et était l’âme de cette région. Par reconnaissance, nous sommes allés longtemps dire la messe le dimanche dans cette chapelle, maintenant régulièrement desservie par le clergé paroissial.
La frairie de Sainte-Luce est toute dévouée au Calvaire. Celle de Bergon ne l’est pas moins.
Que de fois, à l’époque de nos grands travaux, apprenant qu’une paroisse attendue allait nous faire défaut, nous sommes allés faire appel à nos braves Bergonniers. Nous frappions à la première porte ; et transmise de maisons en maisons, notre invitation nous valait le lendemain quarante intrépides travailleurs Aussi le bon Père de Montfort a-t-il pour Bergon une affection toute spéciale. Les habitants de Bergon le savent, et ils ont une grande confiance en le Bienheureux. Dès qu’ils se voient menacés de quelque épreuve, ils accourent au Calvaire et ce n’est jamais en vain. Personne n’entre d’une manière plus parfaite dans l’esprit du pèlerinage : ils se confessent et communient avec une grande ferveur, puis font pieusement tous les exercices, visitant, le chapelet à la main, chacun des sanctuaires, méditant les mystères du Rosaire, et faisant avec une foi vive l’exercice du Chemin de la Croix.
Ceci explique l’empressement des bons habitants de Sainte-Luce et de Bergon à venir travailler au Calvaire. Le 24 février 1892, ils sont 80, à travailler à Gethsémani, sous la conduite de l’intrépide abbé Landeau, curé actuel de Fercé. Nous les avons revus aussi nombreux et aussi zélés sous la direction des dévoués Messieurs Laiteux, curé de Brains ; Warron, curé de Malville et Verger, curé de Saint-Guillaume. L’invitation était toujours faite, il est vrai, à la messe paroissiale de la façon la plus chaleureuse par le Pasteur, le bon Monsieur l’abbé Gaudin qui ne manqua jamais, à moins de graves empêchements, de venir lui-même encourager ses chers paroissiens.
Nous n’avons donc pas été étonnés, le 9 mars, de nous voir arriver 80 hommes vigoureux, le visage épanoui, heureux comme s’ils allaient à une fête. Ils ont été convoqués, le dimanche précédent, à l’église paroissiale par leur bien-aimé Pasteur et à Sainte-Luce, par le bon abbé Jouy, qui viendra passer aimablement la journée avec eux et prendre part à leurs travaux. Avec de tels hommes, nous pouvions nous attaquer aux plus gros blocs. L’un est bientôt sorti de terre et conduit en place. Un énorme, extrait par Pontchâteau, est au fond de la carrière. Placé derrière le bloc géant, il sera d’un bel effet. Entre lui et nos premiers blocs va se trouver un sentier d’accès au rocher destiné à recevoir Jésus montant au ciel. C’est entendu, le bloc va être amené et mis en place. Quatre hommes ont bientôt adouci la pente trop raide de la carrière et vingt autres apportent la grosse chaîne. Hisse : voici une première culbute, puis une seconde, mais la troisième n’est pas aussi facile. A l’une de ses faces, le bloc s’allonge et une pointe fait levier de résistance. Mais l’énergie et l’endurance de nos braves en a bientôt triomphé. Le bloc rendu, le difficile est de le mettre en place. Il ne s’agit plus de le rouler : le passage est trop étroit. Il faut le culbuter dans sa longueur. On fait appel aux crics, le bloc se lève lentement et bientôt d’un coup de chaîne nos hommes achèvent de le culbuter. « Vive Missillac ! »
Entre temps, les wagons transportent la terre ; un autre beau bloc est extrait. Il est après cinq heures ; le travail se poursuit avec la même activité. Nos hommes ne songent pas à la distance qui les séparent de leurs villages. Le bon abbé Jouy veut bien y penser pour eux et nous donnons le signal du Salut du très saint Sacrement.
Avant le départ, nous leur adressons des félicitations et des remercîments bien mérités : Belle, excellente journée dont nous garderons le meilleur souvenir. Le Bienheureux de Montfort ne l’oubliera pas. Elle sera un nouveau titre à sa particulière protection. Elle vaudra un jour au ciel à chacun de nos chers travailleurs une part à la gloire des apôtres. « Fulgebunt quasi stellœ in perpétuas œternitates. » Pour avoir contribué à exciter l’énergie chrétienne, en nous aidant à représenter aux yeux des peuples le mystère de l’Ascension, éternellement ils brilleront comme des astres au firmament des élus.
Paroisse de Guenrouët (29 mars)
Aujourd’hui, ce sont les hommes de Guenrouët qui viennent travailler à la montagne de l’Ascension. La journée ne peut manquer d’être aussi excellente, car nous les connaissons depuis longtemps, les hommes de Guenrouët. Que de gages de dévouement ne nous ont-ils pas donnés ? Nous n’oublierons jamais les belles journées qu’ils ont consacrées au Calvaire, dès le temps où ils avaient pour curé le bon et regretté M. Guiaumé, et pour vicaire, l’intrépide abbé Avenard. Avide de sacrifice, sans compter avec ses forces, l’abbé Avenard partait de Guenrouët à pieds pour venir travailler au Calvaire, entraînant à sa suite une vaillante et nombreuse équipe de jeunes gens auxquels il avait communiqué son zèle enthousiaste. Ce fut le même dévouement, le même entrain sous M. Liaumet. Les femmes comme les hommes de Guenrouët continuèrent à rivaliser de zèle. Fidèle au vœu qu’elle avait fait, une femme de Guenrouët fit neuf fois, pieds nus, les vingt kilomètres qui séparaient sa demeure du Calvaire, pour venir prendre part à nos travaux.
Sous le dévoué M. l’abbé Hervé, le zèle des habitants de Guenrouët pour toutes les bonnes causes pourrait-il se refroidir ? Le vénéré pasteur eut la consolation de voir ses chers paroissiens répondre magnifiquement à son chaleureux appel. Ils étaient déjà nombreux à son arrivée et ses prévisions furent bientôt dépassées. Durant toute la journée le travail fut très actif. Nous avions tracé d’une manière définitive l’avenue de droite qui fait suite à celle montant du Prétoire à Gethsémani pour arriver à l’Ascension. Cette avenue, déjà commencée d’ailleurs, fut presque achevée. Nous avions aussi posé les jalons d’un bosquet qui se trouvera à gauche de celte avenue au pied de la montagne des oliviers. Ce travail fut avancé. Plusieurs équipes sont employées sur divers points de la lande à extraire d’énormes blocs destinés aux rochers de l’Ascension pendant que d’autres s’appliquent à donner la dernière main à l’ouvrage de la journée précédente.
Bientôt on vient nous dire qu’un magnifique bloc est prêt. Il convient justement pour être mis au-dessus de l’un des acolytes du bloc géant. La chaîne est vite placée et, par les efforts réitérés de cent cinquante bras vigoureux, l’énorme bloc, semblant quitter à regret le lieu où le Créateur l’avait placé, roule lentement vers l’endroit qui lui est destiné. Le voici enfin à pied d’œuvre. Mais le plus difficile n’est pas fait. Il s’agit de l’élever à un mètre cinquante du sol et pour tout instrument nous n’avons que nos crics, une chaîne et quelques leviers. C’est le moment de faire usage des sapins abattus par Férel. Trois sont coupés d’égale longueur et disposés de façon qu’on puisse y faire glisser le bloc. Les crics le montent sur ces madriers improvisés, et, grâce à la chaîne et aux leviers, nos efforts vont bientôt être couronnés de succès : le voilà à mi-chemin. Malheureusement sur nos primitifs madriers de sapins non équarris qui ont oublié de pousser droits et d’égale épaisseur, il tend toujours à faire de fâcheux écarts. Pour en finir, nous entreprenons de le culbuter. — « Ah ! Hisse ! » Le bloc se soulève ; c’est une vraie jouissance pour nos braves qui le voient en place, mais en retombant, il brise comme une paille, le plus fort de nos sapins, et le voici de nouveau à terre. Il n’y a heureusement aucun accident de personne, si ce n’est une chute sans conséquence de l’un de nos braves qui fuyant précipitamment à reculons heurte un rocher et tombe à la renverse.
L’heure était trop avancée pour entreprendre de tenter un nouvel essai. Sans cela nous eussions recommencé, et dès lors le succès eut couronné nos efforts. Il reste encore un quart d’heure, il est mis à profit. Un autre beau rocher avait été dégagé le matin. Il est sorti de son trou et rapproché de l’Ascension.
Honneur donc à nos braves travailleurs de Guenrouët ! Ils ont de nouveau donné à l’œuvre du Calvaire une bonne, une excellente journée dont notre Bienheureux de Montfort saura se souvenir et qui leur vaudra au ciel une récompense spéciale. Après le salut, nous les en avons chaudement félicités et remerciés. Nous avons remercié tout particulièrement le bon et dévoué M. l’abbé Hervé, curé delà paroisse de Guenrouët. C’est à son zèle et à son dévouement que nous sommes redevables de cette belle manifestation de foi et de générosité chrétienne. Il en a été l’âme par ses chaleureux encouragements et son exemple. Avec son digne vicaire, M. l’abbé Vince, il a tenu à passer la journée au milieu de ses chers paroissiens et à prendre part lui-même à nos travaux.
Paroisse de Sainte-Anne-de-Campbon (31 mars 1911)
Les hommes de Sainte-Anne-de-Campbon ont dignement clôturé nos travaux du mois de Mars. A l’époque du Bienheureux de Montfort, la paroisse de Sainte-Anne faisait partie de celle de Campbon. Les habitants de Sainte-Anne comme ceux de Campbon ont eu les prémisses de l’apostolat du Grand Missionnaire dans la contrée. Aussi ont-ils les mêmes sentiments de dévotion à l’égard de celui auquel ils sont si redevables, la même confiance en sa protection, le même zèle pour son cher Calvaire. L’homme de Dieu les entretient lui-même dans ces sentiments en leur accordant les faveurs qu’ils viennent solliciter de sa bienveillance.
Il y a longtemps que nous avons vu les hommes de Sainte-Anne venir travailler au Calvaire pour la première fois. C’était à la grotte de Gethsémani, en 1892. Ils avaient alors pour curé le bon M. Peigné, décédé à la maison du Bon-Pasteur de Nantes. Nous les avons eus depuis lors, soit au Calvaire, soit à Bethléem, sous la conduite du regretté M. l’abbé Maindon, alors curé de Sainte-Anne, mort curé de Saint-Vincent-des-Landes. Mais jamais les hommes de Sainte-Anne ne sont venus plus nombreux, n’ont déployé plus d’activité, n’ont montré plus de courage et d’adresse que le 31 mars dernier. Nous félicitons M. l’abbé Jahan, curé actuel de Sainte-Anne, d’avoir inspiré de tels sentiments à ses paroissiens. Le grand nombre ont fait à pieds les douze kilomètres qui les séparent du Calvaire et sont arrivés néanmoins de bonne heure.
Nous avons entrepris aussitôt de monter le bloc qu’avaient dû laisser les hommes de Guenrouët. Les sapins furent remplacés par une accumulation de rochers. Le bloc fut solidement enchaîné par d’habiles ingénieurs et dans un clin d’œil fut culbuté et mis en place. Comment aurait-il pu résister à la force de trois cents bras ? Amener les autres blocs, épars sur la lande, et les mettre en place était un amusement pour les hommes de Sainte-Anne. Ils ne les roulaient pas comme nous faisons d’ordinaire ; ils les enchaînaient et traînaient à leur suite. Ce ne fut pas le seul travail de la journée : l’avenue fut entièrement ouverte, le mouvement de terrain pour la formation du bosquet très avancé, d’autres blocs tirés de terre. Merveilleux fut le résultat obtenu.
Aussi, après le Salut chanté avec enthousiasme par tous les travailleurs, remplissant la chapelle, avons-nous adressé les plus chaudes félicitations aux vaillants hommes de Sainte-Anne. Que le Bienheureux de Montfort continue, et il ne manquera pas de le faire, à leur témoigner sa paternelle affection ! Qu’il leur conserve cette foi vive qui fait leur honneur, et ce zèle pour l’instruction religieuse de leurs enfants, qui est l’assurance de l’avenir.
Retenu par son ministère, le bon Pasteur de Sainte-Anne n’avait pu, à son grand regret, accompagner ses chers paroissiens. Il s’était fait remplacer par son dévoué vicaire qu’une sépulture obligea lui-même de retarder son départ. Ce fut une grande joie pour nos travailleurs de le voir arriver au milieu d’eux. Tous nos remerciements au bon Curé de Sainte-Anne et à son digne vicaire, M. l’abbé Erraud.
J. BARRÉ.
Une visite aux ateliers de M. Vallet
L’artiste nantais nous produit en ce moment pour le Prétoire un nouveau chef-d’œuvre qui l’emporte, au témoignage de tous les hommes compétents, sur tout ce qui, jusqu’à ce jour, est sorti de ses ateliers. C’est la scène de Jésus devant Pilate, qui a pour pendant le jugement dernier.
C’est avec plaisir que nous communiquons à nos lecteurs la lettre qu’un de nos amis vient de nous écrire à ce sujet :
Nantes, 28 mars 1911.
Cher Monsieur le Directeur,
Je sors de chez maître Vallet, véritablement ravi de ce que je viens de voir. Son tableau du jugement dernier, qui se compose de trois scènes absolument distinctes est tout simplement splendide. Tous ceux qui ont été, comme nous, à même de le voir, en ont été émerveillés : les artistes les plus huppés, aussi bien que des prêtres des plus distingués de Nantes et d’ailleurs, ont trouvé en cet œuvre si important, une perfection qui surpasse tout ce que l’auteur a donné jusque-là.
La première scène se passe sur la terre, au Prétoire de Pilate : celle-ci n’est encore qu’en maquette et laisse deviner, par la situation qu’y occupent les différents personnages, la grandeur de l’acte qui s’y déroule : l’Homme-Dieu est condamné par le juge inique, et prophétise le grand jugement de la fin des temps : « Il viendra sur les nuées, juger les vivants et les morts ».
Au-dessus de ce tribunal, où Jésus ne voit autour de soi que des accusateurs, se déroule, en seconde scène, dans un plan des plus harmonieux, le groupe des anges, avec leurs trompettes d’argent, appelant les quatre coins du monde à venir au jugement.
Mais le clou du tableau, c’est bien le troisième acte, où chaque personnage semble emprunter au doux Sauveur, quelque reflet de sa majesté suprême. Aucune des figures ne se ressemble, et toutes ont un air véritablement angélique et qui fait rêver du ciel. Pour Notre-Seigneur, il semble prendre à regret le chemin de la justice ; il a des larmes pleins les yeux, mais on sent qu’il a les bras chargés des foudres de sa colère qui ne désarmeront pas.
Nul doute que ce nouveau chef-d’œuvre inspiré par la foi et la piété n’impressionne vivement tous ceux qui le verront et n’amène bien du monde en pèlerinage.
V. de S.-G.
N° 9 Juin 1911
Nos travaux
Paroisse de Saint-Gildas-des-Bois (5 avril 1911)
La paroisse de Saint-Gildas-des-Bois est connue de tous nos lecteurs. Il y a plus de trente ans qu’elle accomplit fidèlement son pèlerinage paroissial annuel au Calvaire. Elle l’accomplissait sous le prédécesseur du vénéré Monsieur le Chanoine Cesbron, mort curé de Châteaubriant. Malgré son état de fatigue, M. Cesbron n’a pas manqué une seule année de faire son pèlerinage paroissial au Calvaire. Il venait à la tête de ses paroissiens, faisant à pied, en surplis, les 12 kilomètres qui séparent Saint-Gildas du Calvaire, priant ou chantant des cantiques tout le long du chemin. M. l’abbé Prodhomme, le zélé doyen actuel, ne saurait laisser tomber en désuétude une aussi pieuse coutume. Aussi loin de diminuer, l’élan et la ferveur des bons habitants de Saint-Gildas pour ce pèlerinage vont toujours grandissant.
On le comprend, leur zèle pour les travaux du Calvaire ne doit pas être moindre. Nous aimons à nous rappeler les nombreuses et belles journées de travail des hommes et de femmes de Saint-Gildas. C’est le 3 février 1892 que les hommes de Saint-Gildas vinrent travailler pour la première fois. Nous lisons à ce sujet dans l’Ami de la Croix : Ce jour-là, les travaux d’aplanissement autour du Prétoire avancent considérablement, des beaux blocs de pierre sont amenés à pied d’œuvre, au jardin des Oliviers. » L’un d’eux me rappelait qu’ils avaient à leur tête, ce premier jour, l’intrépide abbé Fonteneau, alors leur vicaire, aujourd’hui Directeur de l’Orphelinat de la Ducheraie. C’était « un entraîneur», me disait-il. Depuis lors que de belles et bonnes journées !
La journée du 5 avril n’a pas été moins bonne.
Les travailleurs eussent été pourtant moitié plus nombreux sans la sépulture, qui eut lieu le jour même, du bon et sympathique M. Raquet, maire de la commune. C’est l’un de nos anciens et dévoués travailleurs, nous le recommandons aux prières de tous les amis du Calvaire. Cette sépulture nous a privés aussi de la présence de Monsieur le Doyen de Saint-Gildas qui avait eu l’amabilité de nous annoncer sa venue.
Malgré ces fâcheux contre-temps, nous avons eu une belle et bonne équipe de travailleurs. Le train de six heures nous amena les premiers, les autres, à pied ou en voiture, ne tardèrent pas à nous arriver. Malgré un froid intense et de fortes giboulées de neige, le travail se poursuivit activement. Ils me rappelèrent que je leur avais parlé plus d’une fois, et il y a longtemps, de notre dessein de représenter en ce lieu le mystère de l’Ascension, et me dirent combien ils étaient heureux de travailler à réaliser ce beau projet.
Le travail accompli durant cette journée fut considérable : un certain nombre de blocs furent mis en place, d’autres conduits à pied d’œuvre, l’avenue fut entièrement dégagée et nivelée, le mouvement de terrain pour le bosquet presque entièrement terminé. Nos plus chaudes félicitations et tous nos remercîments à nos excellents travailleurs de Saint-Gildas !
Le Bienheureux de Montfort n’a pas dû cesser d’abaisser sur eux durant tout le jour des regards satisfaits et il saura leur témoigner dignement sa satisfaction, en continuant sa particulière protection à chacun d’eux et à toute la chrétienne paroisse de Saint-Gildas.
N° 10 Juillet 1911
Nos Travaux
Paroisse de Missillac – Le Bourg et la Frairie de Saint-Dié (Mardi 16 mai 1911)
L’Ascension ne nous fait pas oublier le Calvaire. Depuis six semaines, nous travaillons à restaurer la chapelle construite, en 1820, par M. Gouray, curé de Pontchâteau. Nous ne pouvons non plus négliger la montagne. Jusqu’à ce que ses sentiers et ses avenues soient entièrement pavés de cailloux, il faudra réparer de temps en temps les dégâts causés par les pluies. Ce genre de travail se trouvant plus à la portée des femmes, nous leur faisons l’honneur et le plaisir de le leur réserver.
A la Confirmation de Missillac, nous avons prié M. le Curé de vouloir bien inviter une partie de ses paroissiennes à nous consacrer le mardi suivant.
Comme les hommes de Bergon et de Sainte-Luce étaient venus peu de temps auparavant, nous avons demandé pour cette fois l’autre partie de la paroisse.
La journée a été fort intéressante. Le travail d’ailleurs n’était pas banal, surtout pour des femmes. Il s’agissait de paver avec des cailloux une partie de l’avenue qui monte au sommet du Calvaire.
Pour ce travail, que nous avons fait nous même plus d’une fois, nous avions ce jour-là deux maçons. Mais les travailleuses devaient transporter les matériaux. Pour les pierres les plus lourdes, destinées à servir de marches, elles firent usage des brouettes que six d’entre elles tiraient avec des cordes pendant qu’une septième, chose qui n’était pas toujours facile, maintenait les brancards. Les cailloux plus maniables étaient passés de mains en mains, les moindres, étaient comme le gravier dans les paniers mayennais. En suivant les sentiers de la montagne, la distance était longue ; on l’abrégea, en grimpant en droite ligne à travers les rochers.
Le travail fut agrémenté par des chants continuels et variés. Jamais on a plus chanté en travaillant au Calvaire. Nous connaissions la réputation des chanteuses de Missillac, mais, ce que nous ignorions, c’est leur aptitude à improviser des strophes, pleines d’à-propos. On le comprend, la gaîté n’a pas fait défaut un instant ; mais elle s’est manifestée d’une façon plus expressive à l’arrivée de M. l’abbé Leroux, le dévoué vicaire de Missillac.
Paroisse de Saint-Guillaume (Mercredi, 17 mai)
Le lendemain, 17 mai, le travail est continué par les femmes de Saint-Guillaume.
M. le Curé arrive le premier et ses paroissiennes ne tardent pas à suivre leur Pasteur.
Malgré le sarclage des blés qui presse, elles sont nombreuses. Elles n’ont pas oublié les promesses du Bienheureux de Montfort :
« Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous,
Grands et petits, de tout sexe et de tout âge.
Faisons un Calvaire à Dieu
Faisons un Calvaire. »
On conserve fidèlement à Saint-Guillaume le souvenir d’un fait merveilleux qui, du temps du Bienheureux de Montfort, se renouvela durant un mois, chez une sainte veuve du village de la Lande. Il eut lieu à la même époque de l’année. On sarclait alors les blés, et il y avait beaucoup à faire. Confiante dans la parole du Missionnaire, la pieuse veuve envoyait chaque jour tous ses enfants travailler au Calvaire. Elle restait seule à sarcler. Or le soir, l’ouvrage était plus avancé que si elle avait eu tous ses enfants avec elle.
Nos travailleuses de Saint-Guillaume mirent une telle activité au travail que nos maçons ne purent suffire à placer les cailloux. Plusieurs n’hésitèrent pas à se mettre elles-mêmes à paver la voie, et il faut le reconnaître, elles s’en tirèrent à merveille. L’ouvrage avança ainsi doublement.
Le gravier manquant dans l’enceinte des douves, il fallut aller en chercher au bout de notre ancienne carrière. Il était trop tard pour installer notre voie ferrée. La distance était longue, la montée rude, la fatigue se faisait sentir en approchant de la fin de la journée ; mais le courage ne manqua à personne, toutes tinrent bon jusqu’au bout.
Parmi les travailleuses de cette journée, se trouvait Modeste Thébaud de la Herviais qui fut guérie, il y a un an, durant la procession, à notre fête du centenaire. Que notre Bienheureux de Montfort continue à protéger le dévoué curé de Saint-Guillaume et ses chers paroissiens !
N° 11 Août 1911
Fête de la Bénédiction du double groupe de Jésus jugé par Pilate et de Jésus venant juger les hommes à la fin du monde.
Monseigneur l’Evêque de Nantes a fixé au dimanche 3 septembre, la bénédiction du double groupe de Jésus jugé par Pilate et de Jésus venant juger les hommes à la fin du monde. Nous invitons tous les amis de notre Bienheureux Père de Montfort et de son cher Calvaire à prendre part à cette belle et touchante cérémonie.
Elle sera présidée par Monseigneur l’Evêque de Nantes assisté de Monseigneur Leroy, Vicaire Apostolique.
De divers côtés, nous parviennent les plus grands éloges du nouveau groupe de M. Vallet : « C’est, nous écrit M. l’abbé Lebert, curé de Pontchâteau, ce que l’artiste nantais a produit de plus beau, de plus émouvant. » — Quel magnifique chef-d’œuvre, nous écrit-on de Nantes ! C’est empoignant. Il vaudra l’immortalité au nom de M. Vallet. »
Nous sommes heureux de mettre sous les yeux de nos lecteurs l’article suivant que « l’Espérance du Peuple » vient de publier sur ce magnifique travail.
Le Christ devant Pilate
Poursuivant la série de ses travaux pour le Calvaire de Pontchâteau, notre habile sculpteur, M. Vallet, nous donne aujourd’hui le Christ devant Pilate. L’éminent artiste s’est surpassé ; son groupe, qui contient vingt-quatre personnages, réalise des tours de force comme composition et comme facture.
Le tableau n’a que trois mètres de longueur et 47 centimètres de profondeur, mais la perspective est si savante qu’il en paraît beaucoup plus.
Tout chrétien connaît le sujet du tableau : Notre-Seigneur Jésus-Christ comparaît devant Pilate, et les Juifs se font ses accusateurs.
A droite, le proconsul romain est assis sur un siège très simple, dont le socle est orné d’une aigle romaine aux ailes étendues débordant la couronne qui enserre l’oiseau symbolique.
Le Christ se détache absolument du fond du tableau. Sa taille mesure 1 mètre 78 ; Pilate n’a que 1 mètre 72 et les autres, en moyenne, 1 mètre 60. Son beau visage réalise le type oriental le plus pur, le plus élevé. C’est bien là « le plus beau des enfants des hommes. »
Sa pose, d’une simplicité majestueuse, respire la dignité de la divine victime qui s’offre elle-même au sacrifice. Debout, les mains liées, devant son juge, Jésus écoute en silence les accusations que des Juifs haineux portent contre lui : « Jesus autem tacebat ». Il regarde avec loyauté et douceur le proconsul, qui a peine à soutenir ce regard pénétrant.
Les yeux de Pilate semblent clignoter, le magistrat est visiblement gêné, il sent qu’il n’a point devant lui un accusé ordinaire; les récriminations passionnées des Juifs l’impressionnent. Son œil embarrassé cherche, non pas la voie droite de la justice, mais le faux fuyant qui lui permettra de se débarrasser de cette corvée ennuyeuse, sans se compromettre.
Les Juifs forment deux groupes, reliés ensemble par une gradation savante : à droite, les intellectuels, comme nous dirions aujourd’hui, les Pharisiens, les Docteurs de la loi, les Scribes qui accusent ; puis, à gauche, le peuple avec ses nuances diverses qui s’abaissent, jusqu’au pâle voyou prompt à l’insulte. Avec quel air le soldat romain contient de sa lance cette tourbe hurlante, et quel regard de mépris le rude soldat lance sur le misérable insulteur.
Les personnages ont le type juif merveilleusement exprimé ; tous se ressemblent sans être pareils, et l’on pourrait dire avec une légère variante : « Non omni bus una, Nec diversa tamen, qualis decet esse sororum. »
Les chefs du Sanhédrin sont bien ces personnages bibliques dont les barbes majestueuses s’étalent sut leur poitrine comme celle d’Aaron, parfumées de l’huile orientale ; leurs yeux rapprochés, leurs nez crochus, indiquent des fils d’Israël : leurs bouches contractées expriment la haine qui leur remplit le cœur, et s’il était permis, en un si grave sujet, d’employer l’argot moderne, le spectateur s’écrierait volontiers. « Quelle bande de youpins ! »
Cependant l’artiste n’a point franchi les limites que lui prescrivait le sérieux de la scène : les figures sont expressives au suprême degré, mais aucune ne tombe dans la charge ; les personnages sont bien tels qu’on se figure les accusateurs du Christ. La scène est saisissante de vigueur et de réalisme : en le contemplant, le peuple chrétien revit ces moments tragiques où se joua le sort de l’humanité. Il apprend avec émotion l’histoire sainte, exposée par un artiste qui a mis là toute son âme servie par un admirable talent.
L’Espérance du Peuple.
N° 12 Septembre 1911
Pèlerinage au Calvaire de Pontchâteau
Bénédiction du double groupe de Jésus devant Pilate et du Jugement dernier
Monseigneur l’Evêque de Nantes, assisté de Monseigneur Leray, vicaire apostolique des Iles Gilbert, bénira, le dimanche 3 septembre, le double groupe de Jésus devant Pilate et du Jugement dernier.
A cette occasion, aura lieu un pèlerinage au Calvaire du Bienheureux de Montfort à Pontchâteau.
Messieurs les Curés qui voudront bien venir paroissialement prendre part à la fête sont priés de faire apporter leurs croix et bannières.
La paroisse de Pontchâteau se placera immédiatement devant le Prétoire. Les autres paroisses se rangeront à sa suite selon l’ordre d’arrivée.
Cérémonie du matin.
10 h. 15, départ de Nosseigneurs les Evêques de l’ancien Séminaire.
10 h. 30, messe. — Allocution suivie de la bénédiction des nouveaux groupes.
Nosseigneurs les Evêques sont reconduits processionnellement. — Une seconde messe sera alors célébrée à la Scala en faveur des fidèles qui n’auraient pas entendu la première. M. l’abbé Barré prie Messieurs les Ecclésiastiques de venir déjeuner à l’ancien Séminaire. Il demande seulement que ceux qui voudront bien lui faire l’honneur d’accepter son invitation l’en prévienne par l’envoie de leur carte afin que le déjeuner soit préparé en conséquence.
A 1 h. 45, les paroisses devront se trouver avec leurs croix et bannières devant la Scala.
Départ de Nosseigneurs les Evêques. — A 2 heures, chemin de Croix solennel, prêché. Tous les pèlerins prendront part à cet exercice avec une grande piété, gardant un parfait silence. Ils réciteront les prières à haute voix, les bras en croix.
Salut du Très-Saint Sacrement.
Le Vendredi, 8 septembre, à 10 heures, visite des sanctuaires du Rosaire, suivie de la messe à la Scala Sancta. — Allocution.
A 1 h. 30, chemin de Croix suivi du Salut.
Le 8 septembre, la messe célébrée au Prétoire sera dite pour les Abonnés à l’Ami de la Croix et les bienfaiteurs de l’œuvre du Calvaire.
N° 1 Octobre 1911
La fête du dimanche 3 Septembre 1911 au Calvaire de Pontchâteau
Beaucoup avaient prophétisé que ce serait une fête manquée ou considérablement diminuée du moins, que la fête du 3 septembre au Calvaire de Pontchâteau : il y avait des courses de chevaux, d’un côté ; une fête de reconnaissance d’un pont, d’un autre, sans parler de ces attractions multiples, que nos villes et nos campagnes offrent désormais à satiété, sinon, chaque dimanche, du moins plusieurs fois, pendant l’été, et cela, sans aucun profit, ni matériel, ni spirituel, mais au contraire, avec un détriment toujours certain pour la fortune et l’honneur de la religion.
Oui, ils s’étaient trompés; et, dès la veille dans l’après-midi, il était facile de prévoir ce qui aurait lieu le lendemain. Des avalanches de pèlerins arrivaient par tous les trains, débouchaient par toutes les voies qui aboutissent au Calvaire, et se munissaient prudemment d’un gîte pour la nuit. D’où venaient-ils ? seuls les connaisseurs le pourraient dire, et il faudrait citer les noms de presque toutes ces paroisses des cantons à 30 lieues à la ronde. Beaucoup, profitant de la fraîcheur, arrivaient vers 2 ou 3 heures du matin ; n’avaient-ils pas aussi la bonne idée de se confesser dès l’aube, en arrivant, comme l’avaient fait un bon nombre de ceux de la veille, de remplir ainsi toutes les conditions d’un vrai pèlerinage et de gagner toutes les indulgences qui y sont attachées ? Le fait est que les communions furent bien nombreuses dans la chapelle de l’ancien Séminaire, qui est toujours la vraie chapelle du Pèlerinage, par laquelle commencent et finissent toutes les cérémonies, enrichie, au surplus, d’indulgences très précieuses, comme en font foi les plaques de marbre que chacun peut y lire.
Le mouvement ininterrompu de la nuit, s’accentue vers 7 heures. Alors, des carrioles bondées de monde, des voitures, des omnibus, des automobiles, des bicyclettes se croisent, s’entrecroisent sans aucun choc, sans aucun heurt, surtout sans grosse parole, ni blasphème. Il y a donc ici quelques escadrons de gendarmerie pour maintenir le bon ordre et empêcher les accidents, les contestations, les abus dans les auberges? Non, on n’en a pas vu le chapeau d’un seul, et plus d’une des contrées voisines préférerait être ici qu’à toute autre fête. Le bon ordre, il consiste tout à l’heure, pour chacun, à aller s’établir pour manger à l’aise, puis de faire ses dévotions particulières, qui ne nuiront en rien à la dévotion générale. On va se munir d’objets de piété ; grâce à Dieu les boutiques ne manquent pas, ni les spécialités, qui sont vraiment fraîches, précieuses et de la dernière mode; le tout est à des prix abordables, et pas plus aux boutiques qu’aux hôtelleries, nul ne trouve à se plaindre d’ordinaire.
Ce n’est plus qu’un flot humain depuis Pontchâteau jusqu’à la lande de la Madeleine ; Monsieur le Doyen, toujours des premiers, quand il y a fête au Calvaire, et qui, du reste, y occupe de droit la première place, arrive, amenant avec lui, son hôte, Mgr Leray, qui, malgré deux sermons donnés par lui dans l’église de Pontchâteau et la quête faite pour ses œuvres, a bien voulu accepter de présider la fête, au nom de Monseigneur l’Evêque de Nantes. De Missillac, drapeaux déployés, musique en tête, s’avance également la paroisse tout entière, prêtres, enfants, parents, vieillards, tous sont là formant le groupe le plus compact, et leur musique habile et expérimentée reçoit le cortège épiscopal et lui ouvre la marche à travers les milliers de Pèlerins qui attendent 10 h. 1/4, l’heure du départ pour le Prétoire, où la Sainte Messe sera dite par l’infatigable Curé de Pontchâteau, visiblement heureux de cette si belle manifestation. On remarque, outre les bannières de Pontchâteau et de Missillac, celles de Saint-Guillaume, de Drefféac et de Donges bannière paroissiale et des Enfants ; le drapeau du Comité des pèlerinages de Nantes et les trois drapeaux du personnel des chemins de fer de Nantes, Chantenay et Savenay. Les Prêtres de nos paroisses n’ont pas pu venir aussi nombreux qu’ils seraient venus, retenus chez eux par les travaux du dimanche ; ils sont bien là, malgré tout, une centaine, formant couronne d’honneur à l’autel du Prétoire, autour de Mgr Leray, cependant qu’aux sièges réservés, se tiennent les représentants des différentes œuvres catholiques de la légion. M. le Comte de la Villeboisnet, M. de Marcé, Maire de Pontchâteau, M. le Comte de Beaudinière, M. de Posses, M. de la Chevasnerie et les autres.
La messe est dite et l’attitude des pèlerins (combien sont-ils ? de quinze à dix-huit mille, a-t-on dit), est superbe. Ils enlèvent d’assaut les cantiques, entonnés par le bon Père, directeur du Pèlerinage, toujours intrépide, toujours en avant :
Vive Montfort, l’apôtre du Rosaire, Oh ! l’auguste Sacrement, Par l’Ave Maria !
C’est maintenant l’heure du sermon, prêché par celui qui écrit ces lignes et se trouve dispensé d’en donner l’appréciation, sinon que pendant 40 minutes, il se trouva en face de l’auditoire le plus attentif, écoutant dans un religieux et encourageant silence, sa parole, qui grâce à Dieu, ne se ressentait pas d’une série de retraites qu’il prêchait en ce moment-là à Orléans.
« Ventre affamé n’a pas d’oreilles. »
Ce proverbe ne fut pas vrai, ce jour-là ; toutefois, le sermon fini, chacun s’en fut se restaurer pour la sainte corvée du soir.
Dans l’ancien Séminaire, M. l’abbé Barré, directeur toujours aimable du Pèlerinage, reçut à sa table, avec Mgr Leray, ces Messieurs dont j’ai parlé plus haut, ainsi qu’une soixantaine de prêtres, parmi lesquels, outre Monsieur le Curé-doyen de Pontchâteau, je suis heureux de nommer le R. P. Supérieur et le Directeur de l’Immaculée-Conception, Monsieur le Doyen d’Herbignac, etc., etc.
A la fin du repas, le Directeur du Pèlerinage eut un mot gracieux de remerciement pour tous ; nul n’y fut oublié. L’Evêque y répondit avec beaucoup d’à-propos ; avec non moins d’à-propos le R. P. Supérieur de l’Immaculée-Conception, proposa une quête autour de la table, faite pour Monseigneur, pour lui « monter un bateau », aux îles Gilbert: un applaudissement bien nourri, une quête généreuse, lui ont prouvé qu’il avait bien parlé.
Et la foule de je ne sais combien de milliers de Pèlerins, qui accompagna à 2 h. 1/2, de la Scala au Calvaire, par chacune des stations de la Voie Douloureuse, le bon Père Masson, lui ont prouvé combien sa parole ardente, claire, sympathique, avait su toucher leurs cœurs, et couronner une journée si belle de chants et de prières, par ces accents de piété et de foi, qui donnent à Pontchâteau son vrai cachet : on en part toujours meilleur et disposé à vivre en plus parfait chrétien.
Du haut du Prétoire, Monseigneur donna ensuite, à la foule immense, massée par groupes, dans tout le Pèlerinage, mais surtout au pied de ce superbe monument, la bénédiction du T. S. Sacrement.
Puis d’une voix émue, il nous adresse ces paroles : « Dans notre Mission des îles Gilbert, au fond de l’Océanie, nous recevons bien rarement des nouvelles de la France. Ce sont les journaux protestants d’Angleterre qui nous les apportent, et qui s’efforcent de nous faire croire que la France est finie comme nation catholique, parce qu’elle a perdu la foi. Mais nous, enfants de France, nous refusions d’y croire, car nous savons que c’est encore notre pays qui fait vivre les Missions et fournit le plus grand nombre des missionnaires.
Depuis mon arrivée, j’ai constaté que la foi n’est pas morte en France ; et vous m’en fournissez une preuve vivante aujourd’hui sur cette lande de la Madeleine, au pied du Calvaire du B. P. de Montfort. Vos pères, autrefois, sont venus travailler avec ce grand Apôtre de la Croix et ont su conserver ses précieux enseignements. Vous-mêmes avez hérité de leur vaillance et de leur foi, puisqu’au premier appel du R. P. Barré, vous êtes venus en foule pour édifier le Calvaire que je salue là-bas. Gardez, mes frères, gardez les enseignements que vous donne la Croix : et c’est ainsi que vous conserverez la foi dans vos familles bretonnes et que vous travaillerez efficacement au salut de la France. »
Victor Boutillier.
N° 2 Novembre 1911
Nos projets
Très rares sont les jours, même durant l’hiver, où l’on ne voit aucun pèlerin au Calvaire du Bienheureux de Montfort en Pontchâteau. Mais dans aucune saison, ils ne viennent plus nombreux que dans le mois de septembre. L’affluence va grandissant. Cette année, elle a été extraordinaire. Dans le mois de Juillet et d’Août, nous avons vu journellement de nombreux autos ; tous les jours 6 ou 7 à la fois, et souvent un plus grand nombre. Il faut pourtant le reconnaître, ce n’est pas d’ordinaire le monde de la vraie piété. Beaucoup visitent le pèlerinage à la hâte et n’en retirent pas beaucoup de fruits. Il ne serait pas juste néanmoins de trop généraliser. Nous en avons vu un certain nombre faire les exercices du pèlerinage avec une foi vive. Les Anglais nous ont particulièrement édifiés durant le mois d’Août. Nous avons admiré aussi plusieurs groupes de Parisiens. L’un d’eux me parla un jour de notre pèlerinage avec un véritable enthousiasme.
Il avait avec lui ses filles ; il donna à chacune d’elles un pieux souvenir. J’ai été non moins édifié par une bonne parisienne. Elle nous arriva de la Baule un samedi et suivit le dimanche tous les exercices du pèlerinage. — « C’est plus fervent, plus édifiant qu’à Lourdes, nous dit-elle, le dimanche soir. Je vais vous envoyer ma famille. » — En même temps, elle nous remit une offrande pour le groupe de l’Ascension. Nous pouvons citer encore une famille de Bordeaux qui nous manifesta son admiration pour la beauté de notre œuvre.
Nous avons vu de même dans ces derniers temps des pèlerins des autres parties de la France. Tous nous ont beaucoup édifiés. Le plus grand nombre nous est venu naturellement des diocèses de Nantes, de Vannes, d’Angers et de Luçon. L’Archidiocèse de Rennes nous a envoyé aussi de nombreux, de très nombreux pèlerins. Nous avons eu la consolation de voir, tous les jours, durant le mois de septembre, un vrai concours de fidèles faisant les exercices du pèlerinage avec la piété la plus touchante. Mais les dimanches surtout, nos nombreux pèlerins ont suivi tous les exercices d’une façon admirable.
D’ordinaire, nous voyions leur nombre diminuer en avançant vers la fin de septembre. Cette année, nous avons vu le contraire. Nous avons été même très surpris de l’affluence du premier dimanche d’octobre. Notre chapelle était insuffisante pour contenir la foule. Le chemin de croix a été splendide.
*
N’est-ce pas l’expression de la volonté de Dieu sur l’œuvre du Bienheureux de Montfort à son cher Calvaire de Pontchâteau. N’est-ce pas la preuve manifeste que Dieu veut l’achèvement de cette œuvre.
Jamais nous n’avons reçu autant d’honoraires de messes d’action de grâce que durant le mois qui vient de s’écouler. Je n’exagère pas en affirmant que leur nombre, durant le mois de septembre, dépasse la centaine. Il ne m’appartient pas de me prononcer sur la nature des faveurs dont les familles sont venues en aussi grand nombre, témoigner leur reconnaissance au Bienheureux de Montfort, mais je peux dire qu’humainement c’est inexplicable. Je ne peux m’empêcher d’y voir la réalisation de cette strophe prophétique :
« Oh ! Qu’en ce lieu, l’on verra de merveilles !
Que de Conversions !
De guérisons, de grâces sans pareilles !
Faites mon Calvaire ici,
Faites mon Calvaire. »
Oui ! le Bienheureux nous manifeste sa volonté de nous voir poursuivre sa chère œuvre du Calvaire qui a été pour lui la source de tant d’épreuves et de si pénibles contradictions.
Y eut-il jamais temps où nous ayons eu plus grand besoin de ranimer notre foi, d’exciter notre énergie, en ayant les yeux fixés sur Jésus montant au ciel, sous les regards de sa très sainte Mère et de ses chers disciples ? Voilà pourquoi nous allons représenter l’Ascension. La vue de Jésus montant au ciel et nous invitant à l’y suivre, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus puissant pour détacher nos cœurs des misérables jouissances terrestres et nous faire marcher vaillamment à sa suite?
C’est ce qui a déterminé, l’hiver dernier, les vingt paroisses qui, sous la conduite de leurs prêtres, sont accourues avec un si admirable empressement travailler à la montagne de l’Ascension. Ces dignes Pasteurs, ces vaillants chrétiens, nous ont donné une nouvelle preuve qu’ils comprenaient l’excellence et les admirables avantages de l’œuvre de leur bon Père de Montfort. Nous avons admiré comme par le passé leur foi et leur générosité chrétienne. Nous le savons, ils ne nous feront pas défaut. D’autres viendront avec le même empressement achever leur belle œuvre et dans quelques mois tout sera prêt pour recevoir le splendide groupe de l’Ascension.
Maintenant nous faisons appel à tous les amis du Bienheureux de Montfort el de son cher Calvaire, à tous ceux qui ont vraiment à cœur le relèvement de la foi dans notre chère France et nous les supplions de nous venir en aide. Le Calvaire de Montfort exerce, c’est incontestable, une heureuse influence sur nos contrées. Dieu le veut, et nous en avons mille preuves, cette heureuse influence doit grandir, doit s’étendre au loin. Aussi, malgré la difficulté des temps, nous faisons appel à la générosité de tous les amis de notre sainte Religion. Nous comptons sur la générosité des riches, sans dédaigner les offrandes de ceux qui sont moins favorisés des biens de la fortune.
« Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous,
Grands et petits, de tout sexe et tout âge. »
J. BARRE.
N° 4 Janvier 1912
Travaux du Calvaire
A l’époque du Bienheureux de Montfort, la Chapelle-des-Marais faisait partie de la paroisse de Missillac. Cette paroisse s’étendait alors des rives de la Vilaine à la Grande-Brière. La paroisse de Théhillac, aujourd’hui du diocèse de Vannes, faisait partie de Missillac. Toute celle de la Chapelle-des-Marais, ainsi que le village de Cusiac, en Sainte-Rennes, appartenaient aussi à Missillac. Les communications entre certains grands villages et l’église paroissiale étaient alors très difficiles, impossibles même, certains dimanches d’hiver. Camérun, Gamer, et même Québitre, étaient entourés d’eau, et pendant la plus grande partie de l’année, ne pouvaient en sortir qu’en bateau. Les habitants de ces villages étaient pourtant avides d’entendre le Père de Montfort. Ceux de Camer et Camérun furent assidus à suivre la mission de Crossac. Crossac est moins éloigné de leur île que Missillac. Puis la mission de Crossac avait lieu dans le mois d’août, époque de l’année où d’ordinaire le marais de la Boulaie est guéable.
Leur assiduité, malgré les difficultés qu’ils avaient à Surmonter, leur valut de la part du bon Père de Montfort, une affection particulière. Un soir, plusieurs se promirent de s’éveiller de bon matin, pour aller entendre le sermon. Il fut convenu que le premier levé avertirait les autres. Or, voici qu’une femme entend frapper à la porte. Elle se lève aussitôt et presse le pas pour rejoindre ceux qui l’ont éveillée. Elle croit les entendre causer à peu de distance. Mais elle a beau se presser, elle ne peut y parvenir. Quand le jour commence à poindre, elle s’aperçoit qu’elle a été égarée. Elle est près d’un village de Saint-Malo-de-Guersac. A ce moment, le Missionnaire récite le chapelet. Il l’interrompt et dit à l’assistance : « Le malin esprit a égaré une femme dans le marais, prions la Sainte Vierge de le contraindre à la laisser en liberté. » La messe et l’instruction furent retardées. Le Père de Montfort fit continuer la récitation du chapelet jusqu’à ce que la pauvre égarée entrât dans l’Eglise. L’on montre encore au village de Camérun la maison de cette femme.
Nos lecteurs n’ont pas perdu le souvenir de l’enfant perdue, et retrouvée comme miraculeusement, après deux jours de recherche, pendant que sa famille était en prière au Calvaire. Elle est du même village.
Il est à croire que, malgré la distance et les difficultés du voyage, les bons habitants de Camer et de Camérun ne mirent pas moins de zèle à suivre les exercices de la mission de Missillac, leur paroisse, mission qui eut lieu durant le mois de novembre de la même année. Il fallait absolument alors recourir à des bateaux pour sortir de leur île et les jours étaient courts. Mais rien n’était capable d’arrêter les braves habitants de la Chapelle-des-Marais.
Aussi le Père de Montfort savait qu’il pouvait compter sur leur dévouement. C’est aux habitants de la Chapelle-des-Marais qu’il s’adressa pour préparer au moins deux des croix du Calvaire. Le premier à qui il fit appel, fut Pierre Legoff, de Québitre. Il mourut dans l’année, selon la prédiction de l’homme de Dieu. Le second fut Jean Broussard, plus connu par le surnom de Père Gauchet. Il était originaire de l’Hôté Zalluin en Camer. Après avoir marié deux de ses filles à la Surbinais, il construisit une maison dans ce village où il vint se fixer. « Il était riche pour un habitant de la campagne, dit M. Bertho. C’était un habile menuisier, qui faisait de belles armoires comme on n’en fait point aujourd’hui. » Cet homme paraît avoir été le principal menuisier du Père de Montfort au Calvaire. Pour voir où en était l’ouvrage et pour donner ses ordres au Père Gauchet, le Bienheureux allait souvent à la Surbinais, et en particulier pendant la mission d’Assérac. On compte 12 kilomètres d’Assérac à la Surbinais. Comme le confessionnal du Missionnaire était toujours assiégé par la foule, il ne pouvait s’échapper que le soir ; il prenait un cheval pour aller à la hâte à la Surbinais, où il n’arrivait que fort tard et parfois au milieu de la nuit.
Quand les croix furent prêtes, on les mit sur des charrettes attelées de nombreuses paires de bœufs. On les transporta au Calvaire, en passant par les villages de Painly et de Cusiac. C’était l’époque des grandes chaleurs. Les mouches piquaient les bœufs jusqu’au sang, les rendaient furieux et difficiles à conduire. Dans un moment d’impatience, un paysan laissa échapper un juron. Le Père de Montfort qui accompagnait ses croix, lui fit une réprimande ; puis passa la main sur le dos d’un bœuf. Les mouches disparurent à l’instant pour ne plus revenir.
Comme du temps du bon Père de Montfort, inlassable est le dévouement des habitants de la Chapelle-des-Marais pour l’œuvre du Calvaire. Ils ont toujours répondu avec un admirable empressement aux nombreux appels que nous leur avons adressés.
Aussi le Bienheureux se plaît-il à les protéger d’une façon toute particulière. Ce n’est jamais en vain que dans leurs peines et leurs maladies, ils ont recours à sa bienveillance. L’Ami de la Croix mentionne souvent, et c’est toujours pour lui un vrai bonheur, les nombreuses faveurs particulières accordées aux bons habitants de la Chapelle-des-Marais.
Ce qui n’est pas moins consolant, c’est l’esprit de foi et de piété de celte chrétienne population, malgré les dangers auxquels une partie est exposée par la fréquentation des chantiers de Saint-Nazaire. Dieu l’a confiée à un prêtre selon son cœur, à un prêtre qui déploie un zèle admirable pour la sanctification de ses chers Paroissiens. Dans cette paroisse, les sacrements sont très fréquentés. Ils le sont par la presque unanimité des femmes. Un bon nombre d’hommes se confessent et communient au moins tous les mois, suivant les engagements signés par leurs ancêtres, et contresignés par le Bienheureux de Montfort dans le contrat d’alliance avec Dieu. Ce nombre s’augmentera selon les désirs du Pasteur. La plupart entreront dans la Confrérie du Très Saint-Sacrement rétabli par M. l’abbé Rondeau. Car le Père de Montfort avait fait à Missillac, ce qu’il faisait partout, il avait fait prendre à tous les hommes l’engagement de se confesser et de communier au moins tous les mois, le jour où ils avaient le bonheur de prendre part à la procession du Très Saint-Sacrement.
Le dimanche, 19 novembre, sur l’invitation du dévoué Pasteur, nous avons passé la journée au milieu de cette chrétienne population. Nous avons été heureux de voir le matin les fidèles se diriger nombreux vers la sainte Table. Nous avons joui, en portant après les Vêpres, le Très Saint-Sacrement ; nous avons joui de le voir précédé d’un grand nombre d’hommes, un cierge à la main. C’était autour de l’église une magnifique couronne vivante et lumineuse. Nous n’avions pas encore quitté le sanctuaire, que la tête de la procession était de retour à l’entrée et que les hommes devaient se serrer pour laisser passer le Très Saint-Sacrement, vers lequel tous les fidèles s’inclinaient profondément. C’était la seconde procession mensuelle depuis le rétablissement de la Confrérie du Très Saint-Sacrement. Ceci promet pour l’avenir, car sous l’active impulsion du zélé Pasteur, le nombre et la ferveur des confrères ne peuvent manquer d’aller grandissants.
Aussi le mardi, 28 novembre, jour fixé pour le travail des hommes de la Chapelle-des-Marais au Calvaire, n’avons-nous pas été surpris de nous voir arriver deux cents braves, Pasteur en tête, bien décidés à imiter leurs ancêtres et à nous donner une excellente journée en vue du mystère de l’Ascension ? Ils auraient encore été notablement plus nombreux sans les engagements vis-à-vis des Chantiers de Saint-Nazaire.
La journée a été ce que devait être une journée de travail d’hommes de foi, travaillant pour Dieu et sous le regard de Dieu, n’attendant de salaire que de Dieu et du bon Père de Montfort. Après une courte prière à la chapelle, on se rend à l’ouvrage au chant des cantiques. Au chantier, c’est à qui déploiera le plus de courage, d’activité et d’énergie. II y a de tout jeunes gens, encore imberbes, ils s’emparent naturellement des wagons, chargent et transportent les cailloux avec un merveilleux entrain. Nous sommes heureux de trouver des hommes d’une adresse remarquable qui ont bientôt fait de transporter et de mettre en place les plus énormes blocs. Toute la colline est couverte de travailleurs qui, sous les regards du Bienheureux de Montfort, rivalisent d’activité. Nous avions confié, le matin, à une équipe d’hommes, entendus dans la partie, le soin de faire une avenue, allant de la route de Crossac à la Scala. Ce travail est bientôt fait et mérite des félicitations que nous sommes heureux d’adresser à ses auteurs. Un certain nombre travaillent activement à combler les excavations des anciennes carrières de cailloux, tandis que d’autres dégagent les rochers proches de celui de l’Ascension, de la terre dont les corroyeurs les ont couverts, il y a une soixantaine d’années, en fouillant pour extraire l’empierrement de la route de Pontchâteau à Guérande. La journée est admirable d’entrain et d’activité.
Aussi après le salut du Très Saint-Sacrement, nous sommes-nous empressés d’adresser à ces braves nos plus chaudes félicitations. Nous avons été heureux de leur rappeler ce que la Chapelle-des-Marais a fait pour le Calvaire. Nous leur avions déjà parlé des Croix faites et transportées par leurs ancêtres. Nous leur avons rappelé que c’est à des prêtres originaires de la Chapelle-des-Marais que nous devons l’histoire du Calvaire. La première notice écrite sur le Calvaire est due à la plume de M. l’abbé Lemaistre, originaire de la Chapelle-des-Marais, et alors curé de Besné. Un second travail intéressant sur le Calvaire, est le fruit des recherches de M. l’abbé Bertho, lui aussi originaire de la Chapelle-des-Marais et curé de Besné. Ce travail dont nous possédons le manuscrit, contenant des détails pleins d’intérêts, nous a été remis à nous-mêmes par M. l’abbé Audiger, alors curé de Besné. Lui aussi est originaire de la Chapelle-des-Marais.
Aussi je ne doute pas que le Bienheureux de Montfort, qui a la mémoire du cœur, n’affectionne et ne protège tout particulièrement la Chapelle-des-Marais. Je ne peux m’empêcher de lui attribuer une bonne part dans cette magnifique efflorescence de vocations sacerdotales et religieuses qui font de la Chapelle-des-Marais une paroisse unique dans le diocèse de Nantes. Actuellement elle peut se glorifier d’avoir donné le jour à deux de nos Vicaires Généraux1. J’ignore le nombre e ses prêtres, mais je sais qu’ils sont nombreux et que, dans peu d’années, ils seront plus nombreux encore. C’est par centaines que se comptent ses religieuses. Et nul-part le souvenir et le culte du Bienheureux de Montfort ne sont plus vivants qu’à la Chapelle-des-Marais. Et ce n’est pas sous M. l’abbé Rondeau, que nous verrons diminuer le nombre des vocations sacerdotales et religieuses à la Chapelle-des-Marais.
J. BARRE.
N° 5 Février 1912
Nos travaux
Nous lisons dans la Vie de M. de Montfort, publiée par M. Grandet, en 1724.
« Après la Mission de Cambon, il en fit une dans la paroisse de Crossac, au même diocèse ; outre les fruits spirituels qu’elle produisit, il y fit une action très mémorable, qui causa de l’étonnement a tout le monde. Cette paroisse, dit M. des Bastières, était sans Pasteur, lorsque nous y allâmes. L’église en était très mal propre, et n’était pavée que dans le sanctuaire ; presque toute la nef était labourée comme un champ, par sillons, et elle servait de cimetière à tous les paroissiens, nobles et roturiers, grands et petits, pauvres et riches, qui prétendaient avoir droit de teins immémorial de s’y faire enterrer. Mgr l’Evêque de Nantes et Messieurs ses grands Vicaires avaient eu beau s’opposer à un si grand abus, contraire aux Canons et à la pratique de l’Eglise, ils n’en purent jamais venir à bout; et après avoir inutilement usé des censures contre les habitants de Crossac, on procéda contr’eux en justice; l’affaire fut portée au Parlement, et jugée par arrêt contradictoire en faveur des paroissiens de Crossac, sur la possession où ils étaient de se faire enterrer de tous tems dans leur église, et ils gagnèrent leur procès avec dépens. »
« M. de Montfort ayant été informé de ce fait, prêchait de toutes ses forces contre cet abus, et leur fit voir que dans toute l’Eglise primitive on enterrait les Papes, les Evêques, les Empereurs et les Rois que dans les cimetières, ou tout au plus dans les-vestibules, que les églises ne devaient être destinées qu’à renfermer le corps de Jésus-Christ et ceux des Saints ; et qu’autrefois la Canonisation ne s’en faisait que par la translation de leurs sacrés ossements, des cimetières où ils étaient enterrés, dans les églises où on les exposait à la vénération publique ; que la coutume qu’ils avaient de se faire enterrer dans le lieu saint, était purement abusive, et une espèce de profanation. Dieu donna tant de bénédictions à ses paroles, que tous ses auditeurs pleurèrent amèrement l’aveuglement où ils avaient été Jusqu’alors : et M. de Montfort profitant de leur bonne disposition, les obligea de lui promettre qu’ils ne se feraient désormais plus enterrer dans leur église; et près le sermon, les principaux d’entr’eux s’assemblèrent avec lui dans la sacristie. On y fit venir un notaire, qui fit un acte, par lequel ils renonçaient de se servir de l’Arrêt qu’ils avaient obtenu au Parlement de Bretagne, et promettaient tous de choisir le lieu de propre sépulture dans le cymetière. Aussitôt après que cet acte fut signifié, Monsieur de Montfort fit travailler à paver l’église, à la blanchir et à y faire toutes les autres réparations nécessaires2. » A quelle date eut lieu la mission de Crossac? — Induit en erreur par M. Olivier, M. Grandet la place immédiatement après celle de Campbon. Or c’est la mission de Pontchâteau qui suivit celle de Campbon. Après la mission de Pontchâteau, le Bienheureux retourna sur la rive gauche de la Loire, donna les missions de Vertou et de Saint-Fiacre et revint à Pontchâteau pour s’occuper des travaux du Calvaire. C’est alors, dans la seconde partie de juillet et dans le mois d’août, qu’il fit la mission de Crossac, suivie, dans le mois de septembre et la première partie d’octobre, de la mission de Besné, puis de celle de Missillac. Cette dernière se termina le premier dimanche de l’Avent. Le Bienheureux ouvrit le même jour la mission d’Herbignac.
Cet ordre, qui est le vrai, nous est donné d’abord par M. Grandet lui-même à la page 124. Il avait alors sous les yeux les Mémoires de M. Desbastières qu’il eut le tort d’abandonner ensuite pour s’en rapporter à M. Olivier, esprit plus brillant, mais superficiel. Les autres historiens ont simplement copié M. Grandet, citant M. Olivier. Or, il est certain que dans le récit qui précéda la mission de Missillac, M. Grandet eut dû préférer les témoignages de M. Desbastières, témoin oculaire intègre, à celui de M. Olivier, qui n’était pas encore collaborateur du Bienheureux et qui n’écrivit son mémoire que dix ans après les événements, en 1721. D’ailleurs nous allons donner des preuves irrécusables de ce que nous affirmons.
Ni la mission de Besné, ni celle de Crossac n’eurent lieu avant la mission de Pontchâteau. La mission de Pontchâteau commença immédiatement après celle de Campbon, qui avait eu lieu pendant le Carême de 1709.
Elle se termina dans les premiers jours de mai. Le contrat d’Alliance avec Dieu, signé par le Bienheureux lui-même, le 4 mai 1709, en est une preuve certaine. Ce contrat d’Alliance est possédé par la famille Pabœuf, du village de Travers en Sainte-Reine, qui faisait alors partie de la paroisse de Pontchâteau. Le Bienheureux donnait ce souvenir de mission, à la fin des exercices, à ceux qui y avaient été assidus. Nous y lisons ces mots : « Fait en face de l’église de Pontchâteau, ce 4 mai 1709. L. de Montfort, prêtre, » Pontchâteau, 4 mai 1709 et la signature sont de la main du Bienheureux. Nous devons en conclure avec certitude que la mission de Pontchâteau se termina dans les premiers jours de mai.
Un autre contrat d’Alliance, signé et daté de la main du Bienheureux, nous fait connaître d’une manière certaine l’époque de la mission de Crossac. Il est ainsi daté : « Crossac, ce 17 aoust 1709. » Crossac, 17 aoust sont de la main du Bienheureux, ainsi que la signature : « L. Marie de Montfort. » Dans le contrat d’Alliance de Pontchâteau : le mot Marie est exprimé seulement par M. « L. M. de Montfort. » Nous devons conclure de là que, le 17 août 1709, la mission, donnée par le Bienheureux à Crossac, touchait à sa fin.
Avec la signature du Bienheureux, le contrat d’Alliance de Crossac porte celle de celui à qui il avait été donné : Guillaume Guigan. — La personne du village de Travers ne savait pas signer.
A tous ceux qui avaient fait leur mission, Montfort faisait signer l’engagement de renouveler tous les ans au jour assigné par lui, leurs résolutions de mission. Il organisait les choses de façon que, dans la paroisse, il y eût, tous les jours un nombre à peu près égal de fidèles à faire cet acte de piété, ainsi chaque paroisse renouvelait journellement son contrat d’Alliance, dans la personne de plusieurs de ses membres.
Le jour de la rénovation était un jour férié pour ceux qui la faisaient. Ils s’y préparaient par la confession et la communion, et demeuraient une partie de la journée en adoration devant le Très Saint-Sacrement.
C’est ainsi que l’Apôtre de l’Eucharistie, Montfort mérite ce titre, assurait, dans chaque paroisse, des communiants tous les jours, et des adorateurs perpétuels du Très Saint-Sacrement.
C’est le 28 octobre qui était assigné à Guillaume Guigan de Crossac, et le deux février, au possesseur de celui de Sainte-Reine.
La personne qui possède actuellement l’exemplaire de Crossac habite le village de la Guêne. Elle nous a affirmé avoir entendu dire à sa grand’mère qu’autrefois, tous les jours de l’année, on voyait des hommes et des femmes se confesser, communier, renouveler le contrat d’Alliance et passer une bonne partie de la journée en adoration devant le Très Saint-Sacrement a jour qui leur avait été assigné par le Père de Montfort.
*
« A la fin de la mission de Crossac, je partis, dit M. Desbastières, pour aller à Nantes, sans en avoir donné connaissance à M. de Montfort. Ayant su mon départ, il crut que je l’avais abandonné pour toujours, et dans le même temps, un des frères laïcs se révolta contre lui, et le chargea d’injures très atroces : il fit sur ce sujet cette strophe de cantique, qu’il inséra depuis au milieu de ceux qu’il avait sur la conformité à la volonté de Dieu.
« Un ami m’est infidèle,
Dieu soit béni, Dieu soit béni,
Un serviteur m’est rebelle,
Dieu soit béni, Dieu soit béni,
Dieu fait tout ou le permet,
C’est pourquoi tout me satisfait3. »
Quand le bienheureux de Montfort donna la mission le Crossac, la paroisse était sans Pasteur. M. Giles Halgan était mort le 12 mars précédent. La paroisse était administrée par Jacques Chotard, originaire de Crossac. Il prenait le titre de vice-gérent. Le nouveau recteur, Jean Cuven, prit possession de la paroisse, après la mission, peut-être même avant la fin. Il est certain qu’il s’y trouvait le 25 août 1709. Mais la mission était alors terminée, puisque le contrat d’Alliance avec Dieu est daté du 17 août.
*
**
Aucune paroisse ne fut plus fidèle que celle de Crossac à conserver et à mettre en pratique les enseignements du bienheureux de Montfort. Nous avons dit comment se sont conservées pendant très longtemps les pratiques prescrites par le contrat d’Alliance avec Dieu. Maintenant encore, il y a peu de paroisses où l’on s’approche plus fréquemment, les hommes surtout, de la sainte Communion. Aussi cette paroisse est-elle demeurée un modèle d’esprit de foi et de piété. Nous y avons connu plusieurs curés. Nous sommes sûr de n’être pas démenti par le dévoué M. l’abbé Ménager, que son état de santé a obligé de se retirer du saint ministère. Il garde, je le sais, le meilleur souvenir de son ancienne paroisse.
Aucune paroisse n’a montré plus de zèle à l’occasion des fêtes de la béatification. Elle n’a jamais manqué depuis lors ses pèlerinages paroissiaux annuels au Calvaire. Et ils ont toujours été admirables d’entrain, d’esprit de foi et de piété. Nous aimons à nous rappeler aussi les magnifiques arcs de triomphe de M. l’abbé Ménager à nos premières grandes fêtes au Prétoire.
Sous M. l’abbé Guibert, c’est le même zèle, le même entrain, la même piété. Jamais le pèlerinage paroissial annuel n’est omis, et ce jour est une fête chômée pour toute la paroisse. Il est vrai que si les habitants de Crossac n’oublient pas le bienheureux de Montfort, le bienheureux de Montfort ne les oublie pas non plus. A l’époque des fêtes de la Béatification, aucune paroisse n’a été aussi comblée de ses faveurs. Combien de guérisons extraordinaires et durables ont été accordée par son intercession? Certains villages en comptent plusieurs et de vraiment prodigieuses. A Lornay, c’est la guérison instantanée de plaies variqueuses qui jusque-là avaient résisté à tous les traitements; c’est la guérison instantanée de Fany Corbillé qui se trouvait alors dans un état très grave et peu de jours après entrait à la Sagesse.
1M. le Chanoine Loyer et M. le Chanoine Bodet, Supérieur du Collège d’Ancenis.
2La Vie de M. de Montfort, par m. Grandet, pages 143-148.
3Grandet, p. 305, 306.
A Quémené, c’est la guérison de Joséphine Mahé qui depuis longtemps était clouée sur le lit et se voit un jour rendue une santé parfaite dont elle jouit depuis lors. Nous ne pouvons citer ici les autres guérisons opérées alors et depuis, dans les divers villages de Crossac.
Nous comprenons après cela le zèle des habitants de Crossac pour les travaux du Calvaire. Beaucoup d’autres paroisses ont été admirables de dévouement et nous ont fourni des journées très nombreuses. Mais Crossac a certainement le premier rang. Je ne compterai pas le nombre de journées consacrées à l’œuvre du Calvaire par cette chrétienne paroisse, au Prétoire, à Gethsémani, à la Voie douloureuse, à Nazareth, à Bethléem, et surtout au Calvaire, et non seulement par les hommes et parfois avec de nombreux attelages de bœufs et de chevaux, mais aussi par les femmes. Les hommes de Crossac étaient venus nombreux encore sous la conduite du dévoué vicaire, M. l’abbé Lizé, le jeudi 28 décembre. La dernière tempête nous avait causé de nombreux dégâts ; beaucoup de nos arbres, même parmi les grands, étaient courbés complètement à terre, ou même déracinés. La plus grande partie de la journée a été consacrée à les remettre sur pied et à les fixer à l’aide de forts tuteurs. Dieu veuille que tant de travail ne soit pas rendu inutile par une nouvelle tempête. Ce travail terminé, il nous restait peu de temps à consacrer à l’Ascension. Nous l’avons utilisé en mettant un bloc à sa place définitive. Ils pourront le montrer avec fierté à leurs enfants et petits-enfants ; mais ce que ceux-ci auront peine à comprendre, c’est le travail que nous a demandé le transport de cette pierre.
L’un de nos braves travailleurs, et non l’un des moins forts et des moins ardents, avait pris ses habits de noces, pour venir travailler ce jour-là au Calvaire. C’est le père d’une nombreuse et intéressante famille. Il doit avoir plus de trente ans de mariage, car il y a longtemps que l’aîné de ses jeunes gens est venu pour la première fois prendre part à nos travaux.
Le salut du Très Saint-Sacrement a été donné avant leur départ par M. le Vicaire de la paroisse, le dévoué M. l’abbé Lizé. Après les avoir félicités et remerciés, nous avons récité un Pater et un Ave pour la prompte et entière guérison de M. l’abbé Guibert, le digne curé de Crossac. Sous la conduite de leurs vicaires, les hommes et les femmes de Crossac sont déjà venus, plusieurs fois et nombreux, solliciter cette insigne faveur du bienheureux de Montfort C’est de tout cœur que nous nous unissons à eux pour le supplier de nous exaucer.
J. BARRÉ.
Chronique de Janvier 1912
Nous voilà de retour au pied de notre cher Calvaire et ce n’est pas sans une émotion nouvelle, que, à peine après quelques semaines d’absence causée par nos prédications apostoliques, nous revoyions cette montagne sainte, toujours pour nous la montagne dont parle le Prophète, riche, regorgeant de toutes sortes de biens, et sur laquelle se multiplient les bienfaits du Seigneur. Cette fois-ci, nous avions hâte de parcourir à nouveau, notre ville sainte: nous avions su que l’ouragan d’avant Noël, avait soufflé dur sur la lande de la Madeleine et qu’il y avait fait des dégâts. Nos arbres, nos beaux arbres verts, qui donnent tant de charmes à notre solitude, en tout temps, et si douce fraîcheur, en été, avaient été, en grand nombre, tordus, brisés, renversés par la tempête, comme si Satan avait voulu encore jouer un tour à son plus redoutable ennemi, en notre contrée. C’est ce que tout le monde nous racontait ; mais, nous avions beau écarquiller nos yeux, nous voyions au contraire, des arbres vigoureux, verdoyants, appuyés et solidement attachés sur des tuteurs profondément ancrés dans le sol : les arbres avaient été taillés et ne donnaient que plus d’espérance pour l’avenir. Il est sûr pourtant qu’il y avait eu là un vrai désastre ; mais, les travailleurs du Calvaire, ceux de Crossac en particulier, étaient là pour un coup. On leur fit signe : ils accoururent. Il s’agissait de sauver leurs arbres ; car ce sont leurs arbres : ils les ont plantés, arrosés, à l’occasion, bêchés en passant. Le bon P. Barré commande, donne le signal, le P. Chabot mène la troupe à la bataille, les arbres se rendent prisonniers, c’est parfait ; et si maintenant, le bon Dieu veut bien y donner l’accroissement, on en aura été quitte pour la peur.
Le mal était réparé1 ; il restera quelques centaines de francs à dépenser pour la réfection ou restauration de certaines toitures : la bonne Providence nous viendra en aide, comme d’ordinaire, espérons-le, et nous aurons lieu de la bénir encore. Puisse notre chère petite revue la faire bénir davantage, de près comme de loin ! Nous avions, quelques jours avant Noël, la joie d’entendre un saint Prélat, chef aimé et respecté dans son diocèse d’Angoulême, se rappelant con amore son pèlerinage à la grande fête de juin 1910, nous dire les sentiments qu’il avait éprouvés à la vue de toutes ces magnificences qui s’étaient déroulées sous ses yeux; puis il ajoutait : « je lis avec beaucoup d’intérêt, chaque début du mois, votre petit libretto des Amis de la Croix, qui rend un compte exact de la mentalité de l’œuvre du Calvaire et des faveurs constamment obtenues. » Sa Grandeur voulut bien souligner elle-même de ses bonnes paroles et de ses sourires, le bien que je dis alors du Calvaire, devant ses prêtres; j’eus soin d’ajouter, c’était l’opinion générale, que le Chemin de la Croix, le troisième jour du grand pèlerinage de juin 1910, avait été l’un des plus touchants qu’on ait entendus au Calvaire de Pontchâteau.
Ainsi donc, semblable au grain de sénevé, l’œuvre du bon Dieu se développe peu à peu partout, et devient un arbre vigoureux, et les oiseaux du ciel y viennent chercher ombrage et fraîcheur, pour mieux chanter les louanges d’en-haut.
Quelle sera cette année qui commence ? Le temps paraît sombre de tous côtés ; les éléments, les premiers, semblent donner le branle, comme si la nature inanimée elle-même voulait méconnaître son Créateur et faire chorus avec ses ennemis ; car, ils sont nombreux, et plus puissants que jamais les ennemis du Tout-Puissant. Dans les bas-fonds de la société, ce sont des grondements sinistres, qui présagent d’horribles tempêtes ; dans les sommets, même là, où il y a un reste de foi chrétienne, on danse, on rit, on s’amuse, on joue avec les plaisirs et les séductions infâmes, passant du sacré au profane, du devoir au dérèglement, avec une rapidité qui tient du vertige ; les mariages, fondements les vraies familles chrétiennes et qui se faisaient jadis entre personnes du même pays et de condition à peu près semblable, mais où, avant tout, on exigeait l’honneur, la religion et la vertu, ne sont plus que des contractes plus ou moins solennels, passés devant Monsieur Maire ; on va à l’église, en un certain monde, parce que c’est encore bien porté ; aujourd’hui, on brise ces liens sacrés avec un sans-gêne, une désinvolture, qui empêche pas le sacrilège et chassent plus loin toute pudeur, on en vient à contracter devant la loi des unions qu’on a appelées justement des concubinages légaux, et c’est alors la ruine complète des familles. Ne demandons plus de justice aux chefs des peuples ; ils se sont laissés enchaîner par la Franc-maçonnerie, qui les conduit, selon chaque pays, par des chemins divers, et avec des moyens plus ou moins rapides, selon leur tempérament, à saper par la base la religion, en anéantissant la foi catholique dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos armées, dans les lois.
Quels nouveaux projets les sectaires viendront-ils ajouter aux autres ? c’est là le secret de Dieu ; mais, ce qu’il y a de sûr; c’est que l’Eglise est immortelle, et, de toute part, se lèvent pour elle, des soldats jeunes et valeureux, et qui ne laissent pas plus longtemps outrager et vilipender leur mère ; ils sont venus de tous les camps, et souvent les plus braves et les plus courageux viennent d’où on les attendait le moins. Elevés par nos ennemis, formés par eux, pour les combats futurs, ils ont vu briller à leurs yeux, la lumière de la vérité, ils ont fini par connaître Dieu, tel qu’il est, bon, généreux, magnifique et libéral envers ceux qui se dévouent pour sa cause, et alors, ils ont aimé Celui qui avait tant aimé le monde, et ce n’est pas à demi qu’ils se sont donnés à lui. Nous pouvions le constater, dans une paroisse moins chrétienne, où nous venons de donner les saints exercices de la Mission ; une vingtaine de jeunes gens, à un simple appel des Missionnaires et du Curé, se sont enrôlés sous la bannière du Christ, jurant d’être ses défenseurs, en face de l’apostasie qui se dresse orgueilleuse et méprisante, et de l’hérésie qui se drape dans un manteau de vertu hypocrite et menteuse. Souvent, nous voyons ici, au Calvaire, se répéter cette même scène, non plus en public, mais, en particulier : des jeunes gens, étudiants, ouvriers, soldats, qui nous demandent s’ils ne peuvent pas faire partie désormais de la Jeunesse Catholique : l’œuvre commencée ici, s’achève au presbytère de l’une de nos paroisses de villes ou de campagnes; Montfort a gagné à Dieu et à la bonne cause un lutteur de plus.
Que de vocations apostoliques viennent se décider au pied du Calvaire de Pontchâteau ! Y a-t-il une congrégation de missionnaires, qui ne compte en un nombre respectable, quelque membre du Clergé Nantais, Breton ou Vendéen ? Ils sont sur toutes les plages du monde et sous des costumes et noms divers, ils font bénir le nom de Montfort. Ils sont venus à son Calvaire, nombreux chaque année. Ils étaient indécis, non pas sur la bannière qu’ils allaient suivre, c’était bien celle Ide Jésus-Christ, mais quel héritage serait le leur, à travers les confins du globe. Les jeunes filles, non plus, n’oublient pas que c’est un lieu de lumières, ou telles verront la route à suivre, pour devenir l’œil de l’aveugle, le pied du boiteux, la mère de l’orphelin, la consolation de ceux qui pleurent. Mais quoi ! vous pouvez voir autour de nous les monastères des vierges rendus déserts par la persécution et l’exil ; d’autres, où a fallu laisser les saintes livrées des épouses de Jésus-Christ, et briser les liens qui les unissaient à Lui et aux pauvres pour l’Eternité ; celles qui ont survécu vivent dans la pauvreté la plus extrême, sont en butte à la persécution ou aux plus mesquines exigences d’une loi tyrannique, qui va s’aggravant chaque jour. Quelques communautés à peine sont restées debout, incertaines pour aujourd’hui, tremblantes pour le lendemain, gardant encore sur la poitrine, l’image du divin Crucifié, et forcées de retenir sur leurs lèvres, près du mourant, le nom et l’espérance en Lui… Qu’allez-vous faire, filles de nos contrées, chez qui la vocation religieuse s’est ouverte au fond du cœur comme la fleur au premier rayon du soleil ? Vous partirez un beau matin d’hiver, du fond de votre village, le rosaire à la main, la paix dans l’âme : Montfort a toujours éclairé la famille. Quand la mère a voulu, elle aussi, connaître sa vocation, elle est venue au Calvaire, et il lui a paru que le saint Apôtre lui disait tout bas : « va, fonde un foyer chrétien ; élève tes enfants pour Dieu ; et, puisque tu n’as pas pu te donner à lui, ne crains rien, il prendra les prémices. » Et la prédiction continue à se réaliser. La brave enfant s’est relevée, elle est revenue à son église, à son prêtre ; et son Prêtre, hésitant jusque-là, dit la bonne parole : « va, mon enfant, puisque l’homme de Dieu a parlé. » Et si vous allez dans toutes nos paroisses, vous les trouvez ainsi nombreuses, les élues du bon Dieu, qui ont entendu sa voix tout près du Calvaire ou de Gethsémani.
Un jour, Mgr Bruchési, l’éminent et si gracieux Archevêque de Montréal, au Canada, était dans l’une de ces paroisses privilégiées, comme on rencontre beaucoup, grâce à Dieu, sur les bords du Saint-Laurent, et qui semblent autant de paroisses bretonnes ou vendéennes, égarées à travers les grands lacs et les forêts vierges, à Saint-Jacques-l’Achigan, et dans l’élan d’une joie débordante de son cœur plein de foi, il s’adresse tout à coup à son auditoire : « Voyons, Mes Frères, que ceux parmi vous qui n’ont ni un frère, ni une sœur, prêtre ou religieuse, se lèvent ! » Deux ou trois seulement se levèrent ; et maintenant, ajouta-t-il : « que ceux, parmi vous, qui n’ont aucun proche parent, prêtre ou religieuse se lèvent ! » tout le monde resta assis. Les lecteurs de l’Ami de la Croix se rappellent avoir lu, dans le numéro de juin, la visite que fit au Calvaire de Pontchâteau, en 1911, Mgr Dugas, un enfant des plus illustres de cette paroisse Canadienne.
A ce que le bon Archevêque de Montréal demandait, il n’est pas une paroisse, en nos parages, où la grande majorité ne pourrait répondre : « et nous aussi ; nous avons nos frères prêtres, religieux, missionnaires ; et nous aussi, nous avons nos sœurs, consacrées à Dieu dans tous les ordres et faisant bénir son nom sur toutes les plages du monde ! » Voyons-en cela, en grande partie, l’influence bénie du Bienheureux Père de Montfort, et réjouissons-nous, puisque Dieu donne encore des saints à notre chère terre de France.
Aussi bien, nous avons au Calvaire, le dimanche, 7 janvier, devant un bel auditoire, que la furieuse tempête de la veille était loin de nous faire espérer, célébré à la grand’messe le cinquième centenaire de la naissance de Jeanne d’Arc, dans un sermon dont nous donnons le résumé : Comme autrefois, l’étoile apparut aux Mages, pour les guider au berceau du divin enfant de Bethléem, ainsi apparut-elle, dès l’aurore du XVe siècle, à la France. Les Mages de l’Eglise hésitèrent d’abord à la reconnaître : pourtant, qu’elle était belle, limpide, lumineuse et pure ; ils se rappelèrent que dans le cours de l’histoire des peuples, Dieu s’est souvent plu à se servir des faibles, pour confondre les forts ; des insensés, pour abattre la sagesse des plus sages, et ils jugèrent que l’étoile venait de Dieu, et comme Lui, ils dirent à Jeanne : « va, fille de Dieu, va ! car, il est grand pitié au royaume de France. » Les Mages de l’Etat hésitèrent aussi ; mais, dans ce temps-là, la parole de l’Eglise dictait ou éclairait les lois… « Dieu avait pu parler… Il avait sans doute parlé. Va donc, fille de Dieu, va ; car, il est grand pitié au royaume de France. » Ne semble-t-il pas que Dieu ait voulu donner, sous la loi de grâce, à la France, la place que sous la loi de crainte, il avait donnée au peuple Juif ! Depuis le baptistère de Reims, il la relève, il l’abaisse ; il la comble de ses bénédictions, il la frappe de ses coups, toujours parce que, de concert avec elle et par elle, il veut accomplir ses actes de par le monde, gesta Dei per Francos. Et c’est cette petite Pastourelle, qu’il va prendre aux Marches de Lorraine, à la tête de son troupeau, sous le chêne des fées ; elle sera la petite étoile qui mènera le roi Charles VII, de victoire en victoire, et lui rendra son royaume de France, que les grands Seigneurs et les Princes s’étaient détaillé entre eux, pour arrondir leurs domaines, elle le conduira I l’autel, pour qu’il y reçoive l’onction royale du saint chrême et pourra chanter alors le Te Deum de reconnaissance et de fidélité. L’œuvre de la Pucelle semblera à tous incomplète parce qu’elle meure martyre sur le bûcher de Rouen, et qu’il y a encore des troupes Anglaises sur quelque point du territoire ; détrompons-nous, la petite étoile a rallumé au cœur des Français le flambeau de la foi et le feu de la charité ; c’en est assez : Dieu finira le reste, comme et quand il voudra.
L’heure actuelle nous montre la France, en proie à un ennemi bien plus terrible que les Anglais; homicide dès le commencement, Satan essaie de détruire le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Il n’oublie pas que la France est son peuple chéri et que la Vierge Immaculée l’a pris sous sa protection sainte : regnum Galliæ, regnum Mariæ. Le monstre infernal a lancé sa horde franc-maçonnique à travers le pays, et de ses serres cruelles, il étreint les œuvres de l’Eglise pour les anéantir à tout jamais, ou plutôt c’est la France elle-même qu’il enserre, qu’il étouffe, au point que les penseurs se demandent, comme ils se demandaient du temps de Charles VII : « la France, demain, sera-t-elle bien encore la France ? » Et Pie X, de son regard profond et inspiré a vu l’abîme ; mais, à travers les larmes par lui abondamment versées depuis dix ans, sur notre trop malheureuse Patrie, il l’a vue nécessaire, semble-t-il, dans le plan divin de la conduite du monde, et il a fait luire à ses regards la petite étoile des Marches de Lorraine, apparue au monde, le 6 janvier 1412, et les Mages ont reconnu cette étoile, et ils se sont réjouis, et ils l’ont suivie, et au cœur des peuples elle a rallumé la foi et la confiance en Dieu, et ils ont suivi l’étoile jusqu’à la maison, où ils ont enfin trouvé Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille de la terre et du ciel. Plus belle, nous n’en doutons pas, sera la définitive victoire, quand dans quelques mois, Pie X aura achevé par la canonisation de la Bienheureuse, de montrer tout entière la belle étoile de la France, resplendissante comme le soleil, sur la tête d’un peuple qui aura retrouvé son Dieu, sa gloire et sa grandeur.
Victor BOUTILLIER.
1La tempête du jour des Rois a été encore bien terrible pour certain nos plus beaux arbres : nous ne pourrons savoir qu’au printemps, les vrais dommages.
A Quémené, c’est la guérison de Joséphine Mahé qui depuis longtemps était clouée sur le lit et se voit un jour rendue une santé parfaite dont elle jouit depuis lors. Nous ne pouvons citer ici les autres guérisons opérées alors et depuis, dans les divers villages de Crossac.
Nous comprenons après cela le zèle des habitants de Crossac pour les travaux du Calvaire. Beaucoup d’autres paroisses ont été admirables de dévouement et nous ont fourni des journées très nombreuses. Mais Crossac a certainement le premier rang. Je ne compterai pas le nombre de journées consacrées à l’œuvre du Calvaire par cette chrétienne paroisse, au Prétoire, à Gethsémani, à la Voie douloureuse, à Nazareth, à Bethléem, et surtout au Calvaire, et non seulement par les hommes et parfois avec de nombreux attelages de bœufs et de chevaux, mais aussi par les femmes. Les hommes de Crossac étaient venus nombreux encore sous la conduite du dévoué vicaire, M. l’abbé Lizé, le jeudi 28 décembre. La dernière tempête nous avait causé de nombreux dégâts ; beaucoup de nos arbres, même parmi les grands, étaient courbés complètement à terre, ou même déracinés. La plus grande partie de la journée a été consacrée à les remettre sur pied et à les fixer à l’aide de forts tuteurs. Dieu veuille que tant de travail ne soit pas rendu inutile par une nouvelle tempête. Ce travail terminé, il nous restait peu de temps à consacrer à l’Ascension. Nous l’avons utilisé en mettant un bloc à sa place définitive. Ils pourront le montrer avec fierté à leurs enfants et petits-enfants ; mais ce que ceux-ci auront peine à comprendre, c’est le travail que nous a demandé le transport de cette pierre.
L’un de nos braves travailleurs, et non l’un des moins forts et des moins ardents, avait pris ses habits de noces, pour venir travailler ce jour-là au Calvaire. C’est le père d’une nombreuse et intéressante famille. Il doit avoir plus de trente ans de mariage, car il y a longtemps que l’aîné de ses jeunes gens est venu pour la première fois prendre part à nos travaux.
Le salut du Très Saint-Sacrement a été donné avant leur départ par M. le Vicaire de la paroisse, le dévoué M. l’abbé Lizé. Après les avoir félicités et remerciés, nous avons récité un Pater et un Ave pour la prompte et entière guérison de M. l’abbé Guibert, le digne curé de Crossac. Sous la conduite de leurs vicaires, les hommes et les femmes de Crossac sont déjà venus, plusieurs fois et nombreux, solliciter cette insigne faveur du bienheureux de Montfort C’est de tout cœur que nous nous unissons à eux pour le supplier de nous exaucer.
J. BARRÉ.
Chronique de Janvier 1912
Nous voilà de retour au pied de notre cher Calvaire et ce n’est pas sans une émotion nouvelle, que, à peine après quelques semaines d’absence causée par nos prédications apostoliques, nous revoyions cette montagne sainte, toujours pour nous la montagne dont parle le Prophète, riche, regorgeant de toutes sortes de biens, et sur laquelle se multiplient les bienfaits du Seigneur. Cette fois-ci, nous avions hâte de parcourir à nouveau, notre ville sainte: nous avions su que l’ouragan d’avant Noël, avait soufflé dur sur la lande de la Madeleine et qu’il y avait fait des dégâts. Nos arbres, nos beaux arbres verts, qui donnent tant de charmes à notre solitude, en tout temps, et si douce fraîcheur, en été, avaient été, en grand nombre, tordus, brisés, renversés par la tempête, comme si Satan avait voulu encore jouer un tour à son plus redoutable ennemi, en notre contrée. C’est ce que tout le monde nous racontait ; mais, nous avions beau écarquiller nos yeux, nous voyions au contraire, des arbres vigoureux, verdoyants, appuyés et solidement attachés sur des tuteurs profondément ancrés dans le sol : les arbres avaient été taillés et ne donnaient que plus d’espérance pour l’avenir. Il est sûr pourtant qu’il y avait eu là un vrai désastre ; mais, les travailleurs du Calvaire, ceux de Crossac en particulier, étaient là pour un coup. On leur fit signe : ils accoururent. Il s’agissait de sauver leurs arbres ; car ce sont leurs arbres : ils les ont plantés, arrosés, à l’occasion, bêchés en passant. Le bon P. Barré commande, donne le signal, le P. Chabot mène la troupe à la bataille, les arbres se rendent prisonniers, c’est parfait ; et si maintenant, le bon Dieu veut bien y donner l’accroissement, on en aura été quitte pour la peur.
Le mal était réparé1 ; il restera quelques centaines de francs à dépenser pour la réfection ou restauration de certaines toitures : la bonne Providence nous viendra en aide, comme d’ordinaire, espérons-le, et nous aurons lieu de la bénir encore. Puisse notre chère petite revue la faire bénir davantage, de près comme de loin ! Nous avions, quelques jours avant Noël, la joie d’entendre un saint Prélat, chef aimé et respecté dans son diocèse d’Angoulême, se rappelant con amore son pèlerinage à la grande fête de juin 1910, nous dire les sentiments qu’il avait éprouvés à la vue de toutes ces magnificences qui s’étaient déroulées sous ses yeux; puis il ajoutait : « je lis avec beaucoup d’intérêt, chaque début du mois, votre petit libretto des Amis de la Croix, qui rend un compte exact de la mentalité de l’œuvre du Calvaire et des faveurs constamment obtenues. » Sa Grandeur voulut bien souligner elle-même de ses bonnes paroles et de ses sourires, le bien que je dis alors du Calvaire, devant ses prêtres; j’eus soin d’ajouter, c’était l’opinion générale, que le Chemin de la Croix, le troisième jour du grand pèlerinage de juin 1910, avait été l’un des plus touchants qu’on ait entendus au Calvaire de Pontchâteau.
Ainsi donc, semblable au grain de sénevé, l’œuvre du bon Dieu se développe peu à peu partout, et devient un arbre vigoureux, et les oiseaux du ciel y viennent chercher ombrage et fraîcheur, pour mieux chanter les louanges d’en-haut.
Quelle sera cette année qui commence ? Le temps paraît sombre de tous côtés ; les éléments, les premiers, semblent donner le branle, comme si la nature inanimée elle-même voulait méconnaître son Créateur et faire chorus avec ses ennemis ; car, ils sont nombreux, et plus puissants que jamais les ennemis du Tout-Puissant. Dans les bas-fonds de la société, ce sont des grondements sinistres, qui présagent d’horribles tempêtes ; dans les sommets, même là, où il y a un reste de foi chrétienne, on danse, on rit, on s’amuse, on joue avec les plaisirs et les séductions infâmes, passant du sacré au profane, du devoir au dérèglement, avec une rapidité qui tient du vertige ; les mariages, fondements les vraies familles chrétiennes et qui se faisaient jadis entre personnes du même pays et de condition à peu près semblable, mais où, avant tout, on exigeait l’honneur, la religion et la vertu, ne sont plus que des contractes plus ou moins solennels, passés devant Monsieur Maire ; on va à l’église, en un certain monde, parce que c’est encore bien porté ; aujourd’hui, on brise ces liens sacrés avec un sans-gêne, une désinvolture, qui empêche pas le sacrilège et chassent plus loin toute pudeur, on en vient à contracter devant la loi des unions qu’on a appelées justement des concubinages légaux, et c’est alors la ruine complète des familles. Ne demandons plus de justice aux chefs des peuples ; ils se sont laissés enchaîner par la Franc-maçonnerie, qui les conduit, selon chaque pays, par des chemins divers, et avec des moyens plus ou moins rapides, selon leur tempérament, à saper par la base la religion, en anéantissant la foi catholique dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos armées, dans les lois.
Quels nouveaux projets les sectaires viendront-ils ajouter aux autres ? c’est là le secret de Dieu ; mais, ce qu’il y a de sûr; c’est que l’Eglise est immortelle, et, de toute part, se lèvent pour elle, des soldats jeunes et valeureux, et qui ne laissent pas plus longtemps outrager et vilipender leur mère ; ils sont venus de tous les camps, et souvent les plus braves et les plus courageux viennent d’où on les attendait le moins. Elevés par nos ennemis, formés par eux, pour les combats futurs, ils ont vu briller à leurs yeux, la lumière de la vérité, ils ont fini par connaître Dieu, tel qu’il est, bon, généreux, magnifique et libéral envers ceux qui se dévouent pour sa cause, et alors, ils ont aimé Celui qui avait tant aimé le monde, et ce n’est pas à demi qu’ils se sont donnés à lui. Nous pouvions le constater, dans une paroisse moins chrétienne, où nous venons de donner les saints exercices de la Mission ; une vingtaine de jeunes gens, à un simple appel des Missionnaires et du Curé, se sont enrôlés sous la bannière du Christ, jurant d’être ses défenseurs, en face de l’apostasie qui se dresse orgueilleuse et méprisante, et de l’hérésie qui se drape dans un manteau de vertu hypocrite et menteuse. Souvent, nous voyons ici, au Calvaire, se répéter cette même scène, non plus en public, mais, en particulier : des jeunes gens, étudiants, ouvriers, soldats, qui nous demandent s’ils ne peuvent pas faire partie désormais de la Jeunesse Catholique : l’œuvre commencée ici, s’achève au presbytère de l’une de nos paroisses de villes ou de campagnes; Montfort a gagné à Dieu et à la bonne cause un lutteur de plus.
Que de vocations apostoliques viennent se décider au pied du Calvaire de Pontchâteau ! Y a-t-il une congrégation de missionnaires, qui ne compte en un nombre respectable, quelque membre du Clergé Nantais, Breton ou Vendéen ? Ils sont sur toutes les plages du monde et sous des costumes et noms divers, ils font bénir le nom de Montfort. Ils sont venus à son Calvaire, nombreux chaque année. Ils étaient indécis, non pas sur la bannière qu’ils allaient suivre, c’était bien celle Ide Jésus-Christ, mais quel héritage serait le leur, à travers les confins du globe. Les jeunes filles, non plus, n’oublient pas que c’est un lieu de lumières, ou telles verront la route à suivre, pour devenir l’œil de l’aveugle, le pied du boiteux, la mère de l’orphelin, la consolation de ceux qui pleurent. Mais quoi ! vous pouvez voir autour de nous les monastères des vierges rendus déserts par la persécution et l’exil ; d’autres, où a fallu laisser les saintes livrées des épouses de Jésus-Christ, et briser les liens qui les unissaient à Lui et aux pauvres pour l’Eternité ; celles qui ont survécu vivent dans la pauvreté la plus extrême, sont en butte à la persécution ou aux plus mesquines exigences d’une loi tyrannique, qui va s’aggravant chaque jour. Quelques communautés à peine sont restées debout, incertaines pour aujourd’hui, tremblantes pour le lendemain, gardant encore sur la poitrine, l’image du divin Crucifié, et forcées de retenir sur leurs lèvres, près du mourant, le nom et l’espérance en Lui… Qu’allez-vous faire, filles de nos contrées, chez qui la vocation religieuse s’est ouverte au fond du cœur comme la fleur au premier rayon du soleil ? Vous partirez un beau matin d’hiver, du fond de votre village, le rosaire à la main, la paix dans l’âme : Montfort a toujours éclairé la famille. Quand la mère a voulu, elle aussi, connaître sa vocation, elle est venue au Calvaire, et il lui a paru que le saint Apôtre lui disait tout bas : « va, fonde un foyer chrétien ; élève tes enfants pour Dieu ; et, puisque tu n’as pas pu te donner à lui, ne crains rien, il prendra les prémices. » Et la prédiction continue à se réaliser. La brave enfant s’est relevée, elle est revenue à son église, à son prêtre ; et son Prêtre, hésitant jusque-là, dit la bonne parole : « va, mon enfant, puisque l’homme de Dieu a parlé. » Et si vous allez dans toutes nos paroisses, vous les trouvez ainsi nombreuses, les élues du bon Dieu, qui ont entendu sa voix tout près du Calvaire ou de Gethsémani.
Un jour, Mgr Bruchési, l’éminent et si gracieux Archevêque de Montréal, au Canada, était dans l’une de ces paroisses privilégiées, comme on rencontre beaucoup, grâce à Dieu, sur les bords du Saint-Laurent, et qui semblent autant de paroisses bretonnes ou vendéennes, égarées à travers les grands lacs et les forêts vierges, à Saint-Jacques-l’Achigan, et dans l’élan d’une joie débordante de son cœur plein de foi, il s’adresse tout à coup à son auditoire : « Voyons, Mes Frères, que ceux parmi vous qui n’ont ni un frère, ni une sœur, prêtre ou religieuse, se lèvent ! » Deux ou trois seulement se levèrent ; et maintenant, ajouta-t-il : « que ceux, parmi vous, qui n’ont aucun proche parent, prêtre ou religieuse se lèvent ! » tout le monde resta assis. Les lecteurs de l’Ami de la Croix se rappellent avoir lu, dans le numéro de juin, la visite que fit au Calvaire de Pontchâteau, en 1911, Mgr Dugas, un enfant des plus illustres de cette paroisse Canadienne.
A ce que le bon Archevêque de Montréal demandait, il n’est pas une paroisse, en nos parages, où la grande majorité ne pourrait répondre : « et nous aussi ; nous avons nos frères prêtres, religieux, missionnaires ; et nous aussi, nous avons nos sœurs, consacrées à Dieu dans tous les ordres et faisant bénir son nom sur toutes les plages du monde ! » Voyons-en cela, en grande partie, l’influence bénie du Bienheureux Père de Montfort, et réjouissons-nous, puisque Dieu donne encore des saints à notre chère terre de France.
Aussi bien, nous avons au Calvaire, le dimanche, 7 janvier, devant un bel auditoire, que la furieuse tempête de la veille était loin de nous faire espérer, célébré à la grand’messe le cinquième centenaire de la naissance de Jeanne d’Arc, dans un sermon dont nous donnons le résumé : Comme autrefois, l’étoile apparut aux Mages, pour les guider au berceau du divin enfant de Bethléem, ainsi apparut-elle, dès l’aurore du XVe siècle, à la France. Les Mages de l’Eglise hésitèrent d’abord à la reconnaître : pourtant, qu’elle était belle, limpide, lumineuse et pure ; ils se rappelèrent que dans le cours de l’histoire des peuples, Dieu s’est souvent plu à se servir des faibles, pour confondre les forts ; des insensés, pour abattre la sagesse des plus sages, et ils jugèrent que l’étoile venait de Dieu, et comme Lui, ils dirent à Jeanne : « va, fille de Dieu, va ! car, il est grand pitié au royaume de France. » Les Mages de l’Etat hésitèrent aussi ; mais, dans ce temps-là, la parole de l’Eglise dictait ou éclairait les lois… « Dieu avait pu parler… Il avait sans doute parlé. Va donc, fille de Dieu, va ; car, il est grand pitié au royaume de France. » Ne semble-t-il pas que Dieu ait voulu donner, sous la loi de grâce, à la France, la place que sous la loi de crainte, il avait donnée au peuple Juif ! Depuis le baptistère de Reims, il la relève, il l’abaisse ; il la comble de ses bénédictions, il la frappe de ses coups, toujours parce que, de concert avec elle et par elle, il veut accomplir ses actes de par le monde, gesta Dei per Francos. Et c’est cette petite Pastourelle, qu’il va prendre aux Marches de Lorraine, à la tête de son troupeau, sous le chêne des fées ; elle sera la petite étoile qui mènera le roi Charles VII, de victoire en victoire, et lui rendra son royaume de France, que les grands Seigneurs et les Princes s’étaient détaillé entre eux, pour arrondir leurs domaines, elle le conduira I l’autel, pour qu’il y reçoive l’onction royale du saint chrême et pourra chanter alors le Te Deum de reconnaissance et de fidélité. L’œuvre de la Pucelle semblera à tous incomplète parce qu’elle meure martyre sur le bûcher de Rouen, et qu’il y a encore des troupes Anglaises sur quelque point du territoire ; détrompons-nous, la petite étoile a rallumé au cœur des Français le flambeau de la foi et le feu de la charité ; c’en est assez : Dieu finira le reste, comme et quand il voudra.
L’heure actuelle nous montre la France, en proie à un ennemi bien plus terrible que les Anglais; homicide dès le commencement, Satan essaie de détruire le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Il n’oublie pas que la France est son peuple chéri et que la Vierge Immaculée l’a pris sous sa protection sainte : regnum Galliæ, regnum Mariæ. Le monstre infernal a lancé sa horde franc-maçonnique à travers le pays, et de ses serres cruelles, il étreint les œuvres de l’Eglise pour les anéantir à tout jamais, ou plutôt c’est la France elle-même qu’il enserre, qu’il étouffe, au point que les penseurs se demandent, comme ils se demandaient du temps de Charles VII : « la France, demain, sera-t-elle bien encore la France ? » Et Pie X, de son regard profond et inspiré a vu l’abîme ; mais, à travers les larmes par lui abondamment versées depuis dix ans, sur notre trop malheureuse Patrie, il l’a vue nécessaire, semble-t-il, dans le plan divin de la conduite du monde, et il a fait luire à ses regards la petite étoile des Marches de Lorraine, apparue au monde, le 6 janvier 1412, et les Mages ont reconnu cette étoile, et ils se sont réjouis, et ils l’ont suivie, et au cœur des peuples elle a rallumé la foi et la confiance en Dieu, et ils ont suivi l’étoile jusqu’à la maison, où ils ont enfin trouvé Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille de la terre et du ciel. Plus belle, nous n’en doutons pas, sera la définitive victoire, quand dans quelques mois, Pie X aura achevé par la canonisation de la Bienheureuse, de montrer tout entière la belle étoile de la France, resplendissante comme le soleil, sur la tête d’un peuple qui aura retrouvé son Dieu, sa gloire et sa grandeur.
Victor BOUTILLIER.
1La tempête du jour des Rois a été encore bien terrible pour certain nos plus beaux arbres : nous ne pourrons savoir qu’au printemps, les vrais dommages.
N° 6 Mars 1912
Les groupes de l’Ascension
L’artiste nantais est à l’œuvre. Inutile d’ajouter qu’il y met tous ses soins et son beau talent. Il a jugé devoir commencer par saint Jean, le disciple que Jésus aimait1, le disciple à qui, sur la croix, il avait confié sa mère bien-aimée2.
C’est Pierre sans doute que Jésus a établi le chef visible de son Eglise. Il lui en fit d’abord la promesse : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise… je te donnerai les clefs du royaume des cieux3. » Cette promesse, il l’a réalisée, le joui’ où il a chargé Pierre de paître ses agneaux et ses brebis, c’est-à-dire les fidèles et les pasteurs4.
Néanmoins, le jour de l’Ascension, nous le savons par les Actes des Apôtres, les disciples de Jésus étaient encore loin d’avoir une connaissance précise de leur mission. Nous les voyons en effet, immédiatement avant l’Ascension, poser cette question à leur divin Maître : « Domine, si in tempore hoc restitues reynum Israël ? » — « Seigneur, est-ce maintenant que vous allez rétablir le royaume d’Israël ? » Or, rétablir le royaume d’Israël était pour eux la délivrance de la domination romaine.
La sainte Vierge seule avait une idée nette et précise de la nature de la mission de son divin Fils, et de la vocation des Apôtres. Si Jésus, montant au ciel, ne l’emmène pas avec lui, ce n’est pas sans raison. Sa mission ici-bas n’est pas finie. Comme elle a engendré Jésus-Christ, elle doit engendrer son Eglise. C’est elle qui va préparer les Apôtres à recevoir l’Esprit-Saint. Les Actes ont soin de le noter : « Erant persévérantes unanimiter in oratione cum Maria matre Jesu. » Ils persévéraient dans la prière avec Marie, Mère de Jésus, ne formant avec Elle qu’un cœur et qu’une âme. Qui établissait cette communauté de sentiments, cette unité d’aspirations? C’était Marie. C’est elle qui instruisait les Apôtres, leur apprenait quelle était la vraie mission de son divin Fils, mission toute spirituelle, toute surnaturelle ; quelle était leur vocation, vocation de continuateurs de la mission de Jésus-Christ. Elle leur apprenait que ce n’était pas seulement la Judée et la Galilée qu’ils allaient lui soumettre, mais le monde entier. Elle leur faisait connaître quels seraient leurs moyens d’action : la prière, la prédication, le sacrifice, les épreuves de toutes sortes, les tourments et la mort, à l’exemple de leur divin chef. « Le Paraclet, ajoutait-elle, que Jésus va nous envoyer, vous donnera la pleine intelligence de ces choses avec la force de les accomplir.
De tous les Apôtres, saint Jean était, au moment de l’Ascension, le plus avancé dans la science de la vocation apostolique. C’est à Marie, c’est aux entretiens particuliers qu’il avait eus avec elle, depuis que Jésus mourant la lui avait confiée, qu’il devait cette science. Il n’appréciait alors plus qu’aucun autre, plus que Pierre lui-même, l’immense faveur que Jésus avait fait à son Eglise naissante, en lui laissant sa très sainte Mère. Aussi en le voyant monter au ciel, il lui en exprime sa vive gratitude d’un regard et d’un geste expressifs qui disent éloquemment : « Merci, ô bon Jésus, de nous laisser votre bien-aimée Mère, pour nous instruire et nous préparer à recevoir le Paraclet. »
Voilà ce que M. Vallet a su rendre admirablement par l’attitude qu’il a donnée à saint Jean dans le groupe de l’Ascension.
J. BARRÉ.
4 février. — Nous sortons des ateliers de M. Vallet. Il termine en ce moment Marie-Madeleine. C’est la statue qu’il a tenu à faire après celle du disciple bien aimé. Nous pouvons déjà juger ce que sera le groupe de l’Ascension. De tous les chefs-d’œuvre de l’artiste Nantais, l’Ascension occupera le premier rang. Sa Madeleine ne sera pas inférieure à son saint Jean. C’est une statue d’une beauté rare, très expressive. Il faut nous rappeler que Madeleine n’avait pas encore reçu l’Esprit-Saint avec ses dons d’intelligence et de force. Aussi son visage est-il empreint de tristesse à la vue de son bon Maître qui va bientôt disparaître à ses yeux.
L’artiste nous le disait justement. Tout autre sera l’expression du visage de la Mère de Jésus. Car elle jouissait de la pleine lumière. Ce sera la joie à la vue de l’entrée de son divin Fils dans la gloire du ciel.
Nos travaux
C’est le jeudi, 18 janvier, que les hommes de Drefféac poursuivaient au Calvaire nos travaux de l’Ascension. M. l’abbé Patron, leur digne Pasteur, était à leur tête.
Cette journée est au moins la 32e consacrée par cette excellente paroisse à notre œuvre du Calvaire.
1re journée. — C’est le 26 janvier 1892, que les hommes de Drefféac nous donnèrent leur première journée de travail. N’ayant pu venir le 7, à cause de la neige, ils nous font une agréable surprise, le 26. «Nous entendons dans le lointain, un chœur de voix bien nourri. C’est l’air de nos cantiques bien connu. L’excellent Curé s’était contenté de leur dire : « Au premier beau jour ! » Et les voilà, au nombre de plus d’une centaine, chiffre énorme relativement à la population.
Les uns achèvent les travaux préparatoires pour la construction de la grotte de Gethsémani, les autres travaillent au nivellement du terrain qui entoure le Prétoire.
Lorsque le vénérable Curé apparaît, accompagné de son vicaire, il y a une explosion de joie qui montre bien l’union qui existe entre le Pasteur et le troupeau.
Monsieur le Curé nous fait remarquer deux vieillards de 75 et 76 ans que n’ont point arrêté, ni la longueur de la route, ni les fatigues de la journée5. »
2e. — « Le mardi, 17 mai, Drefféac, si dévoué à l’Œuvre du Bienheureux P. de Montfort, a voulu revenir en aussi grand nombre que la première fois »
3e. — Le mardi, 29 novembre de la même année, ils reviennent les premiers après Crossac, reprendre les travaux interrompus durant les moissons et les semailles. A 8 heures, ils sont tous réunis au nombre de cent à la chapelle où ils entendent pieusement la sainte messe. Dans la journée, ils achèvent d’enclore le jardin des Oliviers. Ils préparent le terrain pour les plantations. Ils transportent aussi les premières pierres qui doivent servir d’assises au pont du Cédron.
4e. — Le 13 avril 1893, c’est le tour des pieuses chrétiennes de Drefféac. « A Drefféac, on aime tant et on invoque si souvent le bon P. de Montfort. Il n’y a pas de villages, presque pas de maison où l’Ami de la Croix ne soit reçu, lu en famille. Aussi chaque famille était-elle représentée, pour avoir sa part aux travaux de la voie douloureuse. Il y avait une bonne vieille de 84 ans, venue à pied au Calvaire. En 1821, elle avait déjà 12 ans. Elle avait accompagné ses parents et porté sa hottée de terre, pour aider à relever la sainte colline, vers laquelle se dirige la voie qu’on trace aujourd’hui6. »
5e. — Le jeudi, lendemain des Cendres, les travailleurs de Drefféac déblaient avec ardeur le terrain où doit s’élever notre Nazareth. De temps en temps, se fait entendre le chant : Ave Maria. C’est bien de circonstance, au milieu du travail qui a pour but l’édification de la maison même de l’Ave Maria7.
6e. — Lundi, 28 janvier 1895. — « La neige n’empêche pas un groupe de braves de Drefféac de venir nous donner une excellente journée de travail8. »
7e. — Lundi, 4 février 1895. — « Aujourd’hui, une escouade du bourg de la Vallée de Drefféac, bien que a température soit excessivement froide, continue bravement les travaux. »
8e. — Mercredi, 6 février 1895. — « Pour la troisième fois en bien peu de temps, honneur à la paroisse de Drefféac ! Ce sont les courageux chrétiens de Branduca, de Catiho qui n’ont pas voulu rester en arrière du bourg et de la Vallée, et que n’ont pu retenir, ni le verglas, ni le vent glacial du nord9. »
9e. — Vendredi, 29 mars 1895. — 9e journée de Drefféac au Calvaire : « On aime à lire sur le registre des travailleurs, la signature de M. le comte de Beaudinière, Maire de Drefféac10. »
10e. — Le jeudi, 16 mai 1895 : « Très nombreuse réunion de travailleurs, les unes de la paroisse de Drefféac ; les autres de la paroisse de Sainte-Anne de Campbon. Il va sans dire que tout en chantant de nombreux refrains, les unes et les autres rivalisaient d’ardeur au travail. Leurs noms remplissent sur le registre, 6 grandes pages in-folio11. »
11e. — Le jeudi, 14 novembre 1895. — Ce sont encore les femmes de Drefféac : « Elles sont au moins une centaine. Pendant la nuit, la pluie a détrempé le sol, elles n’en accomplissent qu’avec plus de courage, et plus de mérite aussi, une tâche considérable. »
12e. — Le vendredi, 22 novembre 1895. — «Ce sont les hommes de Drefféac qui ont tenu à ne pas retarder eux aussi la promesse faite à l’occasion de leur pèlerinage du mois dernier. Ils ont travaillé avec la bonne volonté et le courage ordinaires. »
13e. — Vendredi, 29 novembre 1895. — « C’est la 13e journée que donne au Calvaire, l’excellente paroisse de Drefféac. Le travail était d’autant plus méritoire ce jour-là, que le terrain était fort détrempé par la pluie. »
14e. — Mardi, 11 février 1896 — « Cette journée est donnée par les femmes de Drefféac. C’est toujours le même esprit de foi, la même activité, le même dévouement. »
15e. — « Le jeudi, 20 février 1896 : Journée pluvieuse. — Les bons habitants de Drefféac n’en ont que plus de mérite d’être venus, bien que le temps fut menaçant dès le matin. Ils se mettent à l’ouvrage et travaillent même sous la pluie. »
16e et 17e. — La paroisse de Drefféac, divisée en deux sections, celle du bourg et celle de la campagne, a donné les deux journées du 18 et 20 novembre. L’un de ces jours, le temps était pluvieux dans la matinée ; mais les braves travailleurs de Drefféac ne se sont pas découragés pour cela ; et ils ont eu une belle soirée. »
18e. — 18 février 1897. — « Drefféac nous envoie aujourd’hui sa centaine de bonnes travailleuses. Il en est de bien jeunes, jeunes comme des écolières. C’est jeudi, le jour du congé. Mais elles ne sont pas venues au Calvaire pour rester inactives. Et si elles veulent compter ce soir, le nombre de fois qu’elles ont gravi la colline, avec leur panier rempli de terre à la main, l’addition pourra être assez longue ».
19e. — Jeudi, 11 novembre 1897. — « On avait oublié de faire la convocation du haut de la chaire. Pour y suppléer, les enfants des écoles ont été chargés de la faire dans les différents villages. On voit que la commission a été bien faite. Mais de plus, il est évident que bon nombre de fillettes ont profité de l’occasion pour solliciter la faveur d’accompagner la Mère ou les grandes Sœurs. Grandes et petites travailleuses montrent égale activité et bonne volonté. »
20e. — Quatrième semaine de l’A vent, 22 décembre 1897. — Le mercredi, c’étaient des travailleurs anciens, émérites, qu’il nous était donné de revoir. Le froid rigoureux n’a pas empêché un certain nombre d’hommes de Drefféac, de venir donner un bon coup de main pour l’achèvement des travaux du Calvaire ».
21e. — 23 novembre 1898. « Les travailleuses de Drefféac arrivent de bonne heure au Calvaire. Elles se mettent avec ardeur au travail, montent ce qui est nécessaire à paver la plate-forme.
Malheureusement le ciel s’est couvert de nuages. Elles tiennent bon sous la pluie jusqu’à midi. Mais après leur légère réfection, il paraît évident que le travail ne pourra être continué dans la soirée. Elles se réunissent à la Chapelle pour le salut et partent avec le regret de n’avoir pu donner une journée entière ».
22e, 23e, 24e et 25e journées de Drefféac, les 29 et 30 novembre, et les 1ers et 2 décembre 1898.
« Dans notre chronique du mois de novembre, nous avons fait l’éloge des bons habitants de Crossac, qui ont ouvert la nouvelle campagne de travaux. Ceux qui leur ont succédé ne méritent pas moins d’être loués. C’est la paroisse de Drefféac qui, partagée en 4 sections, a fourni à elle seule, dans cette semaine, 4 bonnes journées. Tous les gros blocs de pierres amassés, la semaine précédente, sur les bords de la voie douloureuse, ont été relevés, mis en place, consolidés. Et déjà pour plusieurs groupes, les statues étant exhaussées, on peut constater que ce changement produit un excellent effet. » Ami de la Croix, année 1898. p. 78.
26e. — Elles reviennent prendre leur revanche le mercredi de la Passion, le 22 mars 1899. Favorisées par un beau temps, elles travaillent en même temps, au sommet du Calvaire, au jardin de Nazareth et dans diverses allées qui demandent un nettoyage complet pour les fêtes de Pâques qui approchent. Elles partent visiblement heureuses de cette journée donnée à Dieu et au bon Père de Montfort. 27e et 28e journées de travail de Drefféac, mai 1900. Voici la note que nous trouvons dans l’Ami de la Croix au sujet de ces deux journées :
« Rappelons que dans le courant de ce mois de mai, les vaillantes travailleuses de Drefféac, que nous avions vues à l’œuvre, déjà bien des fois, ont reparu, en deux groupes, à huit jours de distance.
Dans ces deux journées, elles ont accompli un travail fort utile pour l’embellissement du pèlerinage, en faisant une guerre acharnée au chiendent et autres plantes nuisibles qui menaçaient d’étouffer les nombreux jeunes plants d’arbres et arbustes qui doivent en décorer les [avenues. » Ami de la Croix, 1899-1900, p. 202. — Nous trouvons sur le livre d’or des travailleurs, 49 signatures de travailleuses de Drefféac, à la date du 1er mai. Celles de la seconde journée ont oublié d’écrire leurs noms.
29e et 30e journées. — « Pendant le mois de janvier 1901, les hommes de Drefféac, partagés en deux sections, viennent deux jours différents, réunir les blocs destinés à la Grotte de Bethléem. »12
32e. — 15, 16 et 20 décembre 1911. — Depuis les 10 ans qui nous séparent de nos premiers travaux, les hommes de Drefféac n’ont pas dégénéré. M. l’abbé Patron, leur digne curé, les avait convoqués pour le jeudi 15 décembre, ou, s’il faisait mauvais temps, pour le lendemain. Le matin du jeudi, le temps était affreux. Dix-huit braves, des villages écartés, se mirent quand même en route. Le matin, ils travaillèrent sous la pluie. Dieu récompensa leur courage, et nous donna une belle soirée.
Le lendemain, vendredi, malgré le mauvais temps, quinze autres braves nous arrivaient. Le travail fut actif toute la journée.
Mais avec le vénéré Pasteur, le grand nombre avait attendu un jour plus favorable. Ils choisirent le mardi 20. Ce jour-là fut une belle et bonne journée, dont nous pouvons dire : impossible d’avoir mieux.
Etablir 4 voies ferrées, fut l’affaire d’un instant; et les wagons se chargèrent et circulèrent toute la journée, comme par enchantement.
33e journée de la paroisse de Drefféac. — Jeudi, 18 janvier 1912. Nous avons compté pour une seule et même journée, celle de l’an dernier qui triple, en elle-même, était une intentionnellement. Cette année, nos braves de Drefféac, ont pu venir le même jour, avec leur cher Pasteur, continuer nos travaux de l’Ascension. Les jeunes étaient nombreux. Tous ont rivalisé de zèle et d’entrain. Sous la direction de l’intrépide Abbé Chabot, ils ont commencé l’avenue de l’Ascension. Elle part de la huitième station du Chemin de la Croix, arrive devant les rochers de l’Ascension pour aboutir à Gethsémani, en passant devant les rochers où seront représentés un jour le tombeau de la Sainte Vierge et le mystère de l’Assomption.
Une seconde équipe de jeunes gens vigoureux ont entrepris d’enlever, à l’aide de crics et de barres de fer, un énorme bloc, à l’autre extrémité de la nouvelle avenue, près de la Grotte de Gethsémani. Activement poursuivi, le travail a été couronné de succès. Soulevé par les crics, le bloc a été culbuté par les hommes réunis sur la chaîne. Malgré tous nos efforts, nous n’avons pu réussir pourtant à le mettre à sa place. L’heure était avancée, et, il faut bien l’avouer, nos forces n’étaient pas en rapport avec le poids du bloc. Pour une paroisse trois fois plus nombreuse, ce sera petite affaire.
Nous avons été heureux de donner, après le salut, des félicitations méritées aux hommes de Drefféac et à M. l’abbé Patron, leur digne Curé. Monsieur le Comte de Beaudinière, maire de la commune, empêché, nous avait fait parvenir le prix de sa journée. A lui aussi nos sincères remercîments.
La somme des journées de travail consacrées à l’œuvre du Calvaire, depuis le début de nos travaux, par la petite paroisse de Drefféac, est, on le voit considérable : 33 journées au moins ; nous en avons probablement omis quelques-unes, c’est plus d’un mois de travail ; avec une moyenne de cent travailleurs par jour, c’est plus de 3.000 journées volontairement offertes au Bienheureux. Quel bel acte de générosité! Il vaut une somme. Cet acte de générosité chrétienne recevra sa récompense non seulement au ciel, mais dès ici-bas. Aussi dès qu’un habitant de Drefféac se voit sous le coup de l’épreuve, il tourne ses regards vers le Calvaire, il accourt se jeter aux pieds du Bon Père de Montfort. Le Bienheureux pourrait-il être insensible à l’égard de ceux qui lui ont donné tant de témoignages d’attachement?
Nous parlerons une autre fois des nombreuses et inappréciables faveurs accordées à la paroisse de Drefféac. Mais, dès aujourd’hui, mentionnons-en une qui l’emporte sur toutes les autres, la foi vive de cette chrétienne population. A Drefféac, comme ailleurs, on a imposé des écoles sans Dieu. Mais elles sont vides. Les sectaires de la région s’étaient un jour donnés rendez-vous à Drefféac, mais ils s’abstinrent, prudemment, à la nouvelle qu’on était prêt à les recevoir avec des fourches.
Il est juste de rappeler ici le souvenir de M. l’abbé Lezin, curé de Drefféac pendant la première période de nos travaux du Calvaire, toujours si sympathique à notre œuvre. Avec quelle affection il a dû être accueilli par notre bienheureux de Montfort à son arrivée au ciel !
Nous n’oublierons jamais non plus Messieurs les abbés Trebéden et Lambert, anciens vicaires de M. Lezin, qui ont toujours été dévoués à notre chère œuvre du Calvaire. Mais ce qui est plus précieux pour eux, c’est le souvenir que le Bon Père de Montfort conserve de leur inlassable dévouement à son cher Calvaire.
J. BARRÉ.
1 S. Jean XIX, 26.
2 lbid, 27.
3 Math. XVI, 18, 19.
4 Joan. XXI, 15, 17.
5Ami de la Croix. Mars, 1892, p. 135.
6Ami de la Croix, 2ème année.
7Ibid., p. 712.
8N° de Mars 1895.
9P. 1001.
10P. 1051.
11Ami de la Croix, p. 1079, année 1895.
12Voir à la fin de ce numéro la 31e journée de Drefféac.
Paroisse de Nivillac
Le dévoué M. l’abbé Magnin, Recteur de Nivillac, avait convoqué les hommes de sa paroisse à venir prendre part à nos travaux, le lundi 22 janvier. Le zélé Recteur voulut être à la tête de ses paroissiens.
Rappelons le travail fourni par cette chrétienne paroisse depuis 1892.
1re journée de travail, de la paroisse de Nivillac, 5 avril 1892. — « C’est la grande paroisse morbihannaise de ce côté de la Vilaine. Aussi a-t-elle tenu à être bien représentée. Deux cents travailleurs ! Un bon nombre ont fait la route à pied, et même quelques-uns à jeun (six lieues). Et ils sont là, dès le matin à sept heures, entendant la messe dite par M. le Recteur. M. l’abbé Le Large est aussi venu apporter le précieux concours de sa voix pour le chant des cantiques, et en même temps le concours de ses bras pour le travail. Car on chante et on travaille, et avec une ardeur qui ne laisserait pas supposer la fatigue et la longue route faite le matin.
Nous ne saurions dire tout le travail accompli. Le cours du Cédron est prolongé, plusieurs énormes blocs de pierre mis en place.
Le soir, au salut solennel, on n’entend pas sans émotion ces 200 voix, d’hommes chanter ce refrain :
« Je n’ai qu’une âme
Qu’il faut sauver. »
Ami de la Croix, t. 1. p. 182.
2e journée. — Le lundi, 13 mai 1895. — M. le Recteur de Nivillac est venu à la tête d’une bonne escouade de travailleurs. Toutefois, il eut été suivi d’un bien plus grand nombre, sans une circonstance spéciale. Presque toute la jeunesse valide doit se présenter aujourd’hui au conseil de révision à la Roche-Bernard. La chaleur excessive n’empêche pas l’ardeur au travail. « Année 1895, p. 1078. Sur le livre d’Or des travailleurs, je lis cette note : C’est dès 3 heures du matin, que nos travailleurs, à pied, sont partis de Nivillac. Ils n’auront été de retour qu’à 10 heures du soir. »
3e journée, « le mercredi 29 mai. — Très belle réunion d’hommes, tous de la paroisse de Nivillac. Pendant cette chaude et si active journée, M. l’abbé Le Large et M. l’abbé Guégah, vicaires, n’ont pas cessé de payer de leur personne. » Ami de la Croix, Année 1095, p. 1103.
Je lis cette note sur le registre des travailleurs. « Excellente journée. Travailleurs nombreux, pleins de courage et d’énergie.
Un certain nombre ont quitté leur village dès trois heures du matin. Après avoir fait 5 à 6 lieues à pied, ils nous sont arrivés peu après 7 heures. Ils n’ont quitté le travail qu’à 6 heures du soir avec une longue marche en perspective. La fatigue est joyeusement supportée, et pour Dieu seul. »
4e journée de travail, le mardi 11 juin 1895. — « Après cette journée de travail, l’excellent Recteur de Nivillac a dû certainement éprouver quelque joie, en bénissant le soir cette réunion de femmes courageuses venues de si loin, pour accomplir un acte de foi et de reconnaissance envers le Bienheureux Montfort. » L’Ami de la Croix, 4e année, p. 1105. — Voici d’autre part la note que nous trouvons sur le registre des travailleurs : « Excellente journée. Travailleuses actives et pleines d’entrain. Résultat excellent. Commencé de bon matin, le travail a fini tard. Une douzaine seulement ont fait la route à pied, le matin. Il leur avait fallu être matinal pour être à 7 h. 1/2 au Calvaire. »
5e journée de travail, le vendredi 31 janvier 1896. Sur cette belle journée, l’Ami de la Croix nous donne cette seule note ; « Paroisse de Nivillac. Beau groupe d’hommes sous la conduite de M. le Recteur. » Ce n’est pas assez. Heureusement nous avons notre registre où nous lisons : « Vive Nivillac ! Le froid le plus rigoureux n’arrête pas le courageux Recteur, M. l’Abbé Kougeon, et ses paroissiens. Dès 7 heures du matin, ils sont au Calvaire. Courage et entrain. Excellente journée. Que notre Bienheureux Père, protège les braves travailleurs de Nivillac ! » I 6e journée, 12 mars 1897. — « C’est toujours un beau bataillon d’hommes qui nous vient quand cette grande paroisse s’ébranle. En tête de la liste nous voyons les noms des deux vicaires de la paroisse et des deux adjoints de la commune, représentant la double autorité. L’ordre et l’activité dans le travail ne laissent rien à désirer. » Ami de la Croix, Avril 1897, p. 155
7e journée, vendredi 4 juin 1897. — C’est, on peut le dire, la dernière grande journée de travail de cette saison. C’en est le digne couronnement.
Les travailleuses de Nivillac dépassent de beaucoup la centaine. Elles déploient au travail, selon leur habitude, une grande activité, et montrent partout leur grand esprit de foi, le vénérable Recteur est, à bon droit, heureux et fier de présider et de bénir cette belle réunion. »
8e journée, lundi 22 janvier 1912. — Les travailleurs du 22 janvier 1912 ont continué sur la lande de l’Ascension, l’avenue commencée par les hommes de Drefféac. Toutes nos félicitations et nos remerciements au dévoué Recteur et à ses braves paroissiens ! Impossible de déployer plus d’activité au travail.
Le dévoué Recteur a pourtant regretté de n’avoir pas pensé, en choisissant ce jour, qu’il y avait à Nivillac deux mariages, qui retiendraient nécessairement un certain nombre d’hommes.
Qu’il nous soit permis de commencer par rappeler le concours dévoué prêté à notre œuvre du Calvaire par cette excellente paroisse, depuis que nous en avons commencé la restauration. C’est le 26 février 1892 que M. l’abbé Le Méter, recteur de Saint-Dolay, nous envoya ses paroissiens prendre part à nos travaux de Gethsémani, sous la conduite de ses deux vicaires. Voici la note que nous lisons, dans l’Ami de la Croix, au sujet de cette journée : « C’est la seconde paroisse morbihannaise qui vient prendre part à nos travaux. Les paroissiens de Saint-Dolay, souvent évangélisés par les Fils de Montfort, connaissent bien et aiment son Calvaire. Aussi c’est au nombre de cent qu’ils nous viennent sous la conduite des deux vicaires. L’un d’eux dit, en arrivant, la sainte Messe, à laquelle tous assistent. L’autre fait chanter le beau cantique : Je suis chrétien. »
Nous ne dirons rien des travaux, sinon qu’ils se firent de manière à satisfaire pleinement celui qui les dirige, et c’est le meilleur éloge que nous en puissions faire. » Ami de la Croix. 1re année, p. 159.
2e journée de Saint-Dolay, 23 mai 1892.
Sous la direction de leurs deux vicaires, Messieurs les Abbés Burban et Le Garnec, les hommes de Saint-Dolay reviennent, le 23 mai suivant, nous aider à terminer les travaux de la grotte de Gethsémani.
Ils rivalisent d’ardeur avec les hommes de Saint-Lyphard qui sont ici le même jour. « Les deux paroisses ont déjà beaucoup fait pour notre œuvre. » Ami de la Croix, 1re année, p. 237.
3e journée de Saint-Dolay, village de Burin. Lundi, 14 janvier 1895.
Voici les quelques lignes consacrées à cette journée par l’Ami de la Croix : « Vaillante petite escouade du village de Burin, en Saint-Dolay. Elle eut été bien plus nombreuse sans des circonstances tout à fait indépendantes de la volonté de tous. Nous savons du reste que les braves paroissiens de Saint-Dolay ne nous ont pas dit leur dernier mot. »
Le livre des Travailleurs est plus explicite. Nous y lisons : Travailleurs peu nombreux, mais bons, très bons. Chacun a fait l’ouvrage de deux hommes.
Les foires d’Herbignac et de Redon ont empêché certains autres de venir. Puis il y avait le service d’une mère de famille du village. Plusieurs autres se trouvaient malades. Ils ne manqueront pas de venir une autre fois.
C’est à Burin et chez la famille Leroux, nous a-t-on assuré, que le Bienheureux a pris la principale croix du Calvaire.
N° 7 Avril 1912
Notre groupe de l’Ascension
Nous sortons des ateliers de M. Vallet. Le groupe de l’Ascension nous apparaît déjà comme le chef-d’œuvre de l’artiste nantais. Trois statues sont terminées : saint Jean, sainte Marie-Madeleine et sainte Marie-Cléophas. La statue de la sainte Vierge est commencée. Dès maintenant, on peut juger de l’effet de ce magnifique groupe : il sera empoignant, de nature à relever les courages défaillants et à susciter de puissantes énergies. Son effet sur les foules sera quelque chose de l’effet de l’Ascension sur les Apôtres.
Mais, on le conçoit, un tel groupe exige de grands frais. C’est pour l’artiste et ses aides, un long travail et tout travail doit être rémunéré. Ces hommes et leurs familles ne vivent pas que de l’air du temps. Viendra ensuite le travail du fondeur. On comprend que ces magnifiques statues, en fonte ciselée, de 2 mètres 10 de hauteur reviennent à un prix élevé.
C’est pourquoi je fais appel à la générosité de tous les amis du bienheureux de Montfort et de son cher Calvaire de Pontchâteau et les prie de nous venir en aide.
Déjà nous avons reçu beaucoup pour cette œuvre. Ce que nous avons reçu nous l’avons dépensé.
Nous avons un ardent désir de la mener à terme. Notre désir est inspiré par le désir même de Jésus et de sa sainte Mère, par le désir du bienheureux de Montfort et les aspirations de cette multitude innombrable de travailleurs qui, avec le Bienheureux et depuis le Bienheureux, ont arrosé tant de fois de leur sueur cette terre de prédilection. Le but que nous poursuivons est celui qu’avait en vue un grand évêque, Mgr Jacquemet, quand il entreprit lui-même de restaurer l’œuvre de Montfort. Sa Grandeur voulait non seulement restaurer le chemin de Croix, mais représenter dignement les 15 mystères du Rosaire.
C’est la raison de notre appel à tous les amis du Bienheureux et de son œuvre du Calvaire.
Montfort faisait chanter :
« Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous,
Grands et petits, de tout sexe et tout âge. »
Et encore :
« Oh ! qu’en ce lieu, l’on verra de merveilles !
Que de conversions,
De guérisons, de grâces sans pareilles ! »
Ces merveilles, nous en sommes journellement les heureux témoins. Il se passe peu de jours sans que la reconnaissance vienne nous faire part de quelques-unes de ces faveurs.
Naturellement, nous ferons d’abord appel à vous qui êtes si justement fiers d’être les petits-fils des privilégiés du Bienheureux, les heureux dépositaires de son Calvaire, à vous dont les ancêtres ont été les premiers à travailler à cette œuvre avec un inlassable dévouement.
Nous ferons appel ensuite à tous les amis du Bienheureux et de son cher Calvaire. J’en ai la douce confiance, notre appel sera entendu, et nous pourrons non seulement couvrir les frais du grand mystère de l’Ascension, mais ensuite poursuivre notre œuvre, l’achever promptement.
Déjà, malgré les difficultés des temps et même à cause de ces difficultés, nous avons non seulement l’espoir, mais la certitude du succès. Le zèle grandissant de nos populations pour les travaux du Calvaire en sont la preuve. Jamais les hommes n’ont répondu avec autant d’entrain à notre appel et ne sont venus aussi nombreux sous la conduite de leur digne clergé prendre part à nos travaux.
Le but de l’-œuvre de Montfort n’est-il pas de maintenir la foi, d’exciter l’énergie chrétienne? Les temps que nous traversons ne doivent-ils pas en hâter l’achèvement.
J. BARRÉ.
Nos travaux
Par mégarde, nous avons omis de mentionner dans notre dernier numéro, la deuxième journée de Nivillac à Gethsémani. L’Ami de la Croix, à la date du 8 février 1893, en rend compte en ces termes :
« Mercredi, 8 février 1893, Paroisse de Nivillac. — C’était un beau bataillon d’hommes qui avait suivi ce jour-là, M. le Recteur de Nivillac, accompagné d’un de ses vicaires, M. l’abbé Gourier. Malheureusement le temps a été peu favorable. La journée a dû être abrégée. Mais la grande paroisse de Nivillac n’en a pas moins montré sa bonne volonté et son attachement au Calvaire du B. Montfort. » Ami de la Croix, t. 2, p. 422.
La journée du 22 janvier 1912 est donc, non pas la 8e, mais au moins la 9e de cette chrétienne paroisse.
Paroisse de Saint-Dolay (suite)
4e journée, le mardi 14 mai 1895. — « Ce jour-là, on voit les courageuses chrétiennes des bords de la Vilaine et des bords de la Loire fraterniser ensemble au Calvaire. Elles rivalisent de zèle et d’ardeur pour la restauration de ce monument qu’élevèrent autrefois leurs aïeules à la voix de Montfort. Ce sont les paroissiennes de Saint-Dolay (Morbihan) et de Donges (Loire-Inférieure). Le Salut est donné par Monsieur le Curé de Donges, M. le Garnec, vicaire de Saint-Dolay, étant présent. » Ami de la Croix, année 1895, p. 1079.
5e journée de Saint-Dolay, 13 décembre 1895.
Voici la note que l’Ami de la Croix consacre à cette journée : « Une circonstance spéciale n’a pas permit aux bons habitants de Saint-Dolay de venir aussi nombreux qu’ils l’avaient pensé. Mais ce n’est que partis remise. Et ceux qui étaient présents ont suppléé au nombre par leur activité et leur courage. »
Quelle est cette circonstance spéciale? — Nous l’avons indiquée sur le Livre d’or des Travailleurs. C’est une foire de la Roche-Bernard. Le Salut fut donné par M. l’abbé Le Garnec, vicaire de la paroisse.
6e journée de Saint-Dolay, 19 mai 1896. « Avec l’intention très spéciale d’obtenir du ciel, par l’intercession du bienheureux de Montfort, la fin de la sécheresse, une centaine d’hommes de la paroisse de Saint-Dolay accomplissent aujourd’hui, ici, leur pèlerinage de travail. Tous, à leur arrivée, assistent dévotement à la messe dite par M. le Recteur. On prie encore à la visite des stations, au salut, ce qui n’empêche pas de travailler ferme tout le reste du jour. »
Le registre est signé par M. Le Méter, recteur de la paroisse et son second vicaire, M. l’abbé Le Garnec. : « Huit jours après que les hommes de Saint-Dolay, sous la conduite le leur excellent Recteur, ont donné au Calvaire une journée si bien remplie, ce sont les pieuses chrétiennes de la même paroisse que nous voyons, en ce moment I l’œuvre. Plus nombreuses que n’étaient les hommes, elles sont animées du même courage, de la même ardeur. La piété a eu son compte le matin, à la sainte Messe, à l’exercice pieux du milieu du jour, au salut du soir. » Années 1895-1896, p. 236.
Nous avons compté sur le registre, 233 signatures.
Il est bien probable qu’un certain nombre ont omis de signer.
8e journée de Saint-Dolay, 8 février 1897.
« Les travailleurs de Saint-Dolay, sous la conduite d M. l’abbé Burban, vicaire, font preuve aujourd’hui d’une bonne volonté, d’un courage digne de tout éloge Ils montrent aussi qu’ils ont bon souvenir. Il est édifiant de les entendre psalmodier en chantant une dizaine du Rosaire, comme ils ont appris à le faire, dans cette belle mission qui leur fut donnée par ceux-là même qui en ce moment dirigent et partagent leurs travaux. Ami de la Croix, année 1897, p. 130.
9e journée de Saint-Dolay. 17 mars 1897.
« Le R. P. Directeur du pèlerinage a noté lui-même sur le Livre d’or, cette journée dans laquelle les travailleuses étaient au nombre d’environ deux cents! Arrivée dès 7 heures du matin, au chant de l’Ave Maria. Messe dite par M. le Recteur. Travail sous la pluie et dans la boue. Courage admirable. » Ami de la Croix, année 1897, p. 156. — On travailla toute la journée à transporter de la terre pour combler les douves à côté du Saint-Sépulcre.
10e journée de Saint-Dolay, le mercredi 31 janvier 19I2.
C’est à 15 ans de distance que nous revoyons les hommes de Saint-Dolay travailler au Calvaire. Il y a longtemps que nous avons assisté à la sépulture du bon M. le Méter. Ses deux vicaires, M. Durban et M. Le Garnec sont maintenant à la tête de paroisses en d’autres parties du diocèse. M. l’abbé Gaillard, à qui nous sommes redevables de la belle journée du 31 janvier 1912 n’est pas le successeur immédiat de M. le Méter et il n’est même plus recteur de Saint-Dolay.
Habile appréciateur du mérite, Sa Grandeur, Monseigneur Gouraud, vient de le placer à la tête de l’important doyenné de Questembert. C’est la raison qui l’a empêché de venir, comme il nous l’avait écrit, à la tête de ses paroissiens. Il chargea le bon et dévoué M. l’abbé Huguet, de le remplacer.
Le succès a dépassé tout ce que nous pouvions espérer. De bonne heure, des voix mâles et nombreuses se faisaient entendre dans la direction de Missillac. C’était, nous ne pouvions en douter, nos travailleurs de Saint-Dolay qui venaient à pied. Ils étaient en effet tous à pied. Une demi-heure après, ils se trouvaient au Calvaire, dépassant 160. Un certain nombre, venant des bords de la Vilaine, avaient déjà plus de cinq lieues dans les jambes. Après une courte visite à la chapelle, ils se mirent immédiatement au travail. Organiser plusieurs chantiers était chose facile. Les uns, sous la direction de M. l’abbé Chabot, prennent l’avenue de l’Ascension où l’avaient laissée les hommes de Nivillac ; les autres vont à l’extrémité de la même avenue continuer le travail de Drefféac. Les blocs qui étaient sur la voie sont bientôt écartés. Celui qui se trouve devant le rocher de l’Ascension nous retient plus longtemps. Il nous oblige même à réunir toutes nos forces. Enfin nous en venons à bout. Toutes nos félicitations à nos braves travailleurs de Saint-Dolay ! Que Dieu leur donne un Recteur qui maintienne prospères toutes les œuvres de M. l’abbé Gaillard. Qu’il bénisse à Questembert, comme il a béni à Saint-Dolay, le ministère de ce prêtre vraiment selon son cœur !
Tous nos remerciements au bon et dévoué M. l’abbé Huguet.
Le dimanche 11 février, Monsieur l’Abbé Gaudin fit un chaleureux appel aux hommes de sa paroisse, les invitant le mercredi suivant à se rendre travailler au Calvaire du Bienheureux de Montfort. L’un de ses dévoués vicaires fit de même dans la chapelle de Sainte-Luce.
Ce double appel fut entendu, jamais Missillac ne nous avait envoyé un plus grand nombre de travailleurs et de travailleuses plus actifs.
Nous allons commencer par rappeler les principales journées consacrées à notre chère œuvre du Calvaire par cette chrétienne paroisse, depuis que M. l’Abbé Gaudin en est le Pasteur.
1re journée, 10 février 1892. —Grotte de Gethsémani. — « L’excellent Pasteur de Missillac, qui porte un si vif intérêt à notre Œuvre, a eu la bonne pensée de partager sa grande paroisse en plusieurs sections de manière à procurer plusieurs journées de travail. La seule section d’aujourd’hui fournit sa centaine de travailleurs. M. l’Abbé Landeau, vicaire, dirige la marche avec son entrain ordinaire.
Dès le commencement de la journée, il est décidé quel celui-ci s’occupera, avec une partie des travailleurs d’amener à Gethsémani une pierre remarquable par sa longueur et pour laquelle M. Gerbaud a une place désignée. A force de constance, la pierre s’ébranla, monta la pente, au milieu des hurrahs enthousiastes, et arriva enfin au lieu marqué.
Il fallut la voir debout, à la place qu’elle occupe, au milieu de la vaste ouverture de la grotte, qui aura ainsi sa porte d’entrée et de sortie.
Il était nuit, mais tous s’en allaient contents et joyeux. » Ami de la Croix, t. 1, p. 140.
2e journée, mercredi, 24 février 1892. — Fréries de Sainte-Luce et de Bergon. La convocation est faite chaleureusement, le dimanche précédent, le matin, à Sainte-Luce par M. l’Abbé Landeau, et est renouvelée par M. le Curé, à la grand’messe.
« Les voilà, au nombre de 80. Monsieur le Curé et Monsieur le Vicaire, qui ne les quittent pas de toute la journée, doivent être contents d’eux. Ils ont chanté avec entrain et travaillé de même.
Ce jour-là, nous avions la visite de M. Vallet, l’artiste nantais. Il était venu examiner notre grotte de Gethsémani, à un point de vue particulier que l’on devinera sans peine. Il ne pouvait se lasser d’exprimer sa satisfaction du spectacle qu’il avait sous les yeux. » Ami de la Croix, p. 157.
3e journée de Missillac, 11 avril 1892. — « C’est la 3e section de cette grande paroisse. Des travailleurs, nous dirons tout en affirmant qu’ils se sont montrés en tout, dignes de leurs devanciers des deux premières sections.
Personne n’ignore dans le centre quelle union existe à Missillac, pour le bien de tous, entre l’autorité religieuse et l’autorité civile.
Nous remercions M. le Marquis de Montaigu et M. le Curé, d’avoir bien voulu montrer, en venant ensemble prendre part à cette journée, qu’ils étaient aussi unis dans les mêmes sentiments de sympathie pour notre œuvre. » Ami de la Croix, p. 191.
4e journée, 18 mai 1892. — « Le mercredi, 18 mai, deux paroisses limitrophes fraternisaient ensemble. Théhillac avait à sa tête son excellent Recteur. Missillac, nommé pour la 4e fois, était conduit par M. l’abbé Landeau qui, d’après les habitudes que nous lui connaissons, se dépensa largement au milieu de ses braves travailleurs ». Ami de la Croix, p. 237.
5e journée, 13 décembre 1892, Bergon. — Les Bergonniers sont heureux d’avoir été convoqués les premiers et de marcher en avant pour cette nouvelle campagne.
Ils ont montré que non seulement ils étaient prompts et ardents au travail pour le bon Dieu, mais qu’ils tenaient à ne pas laisser sur le chantier une besogne commencée.
Il s’agissait d’amener au Cédron une énorme pierre, devant former à elle seule l’arche du pont. Cette pierre se trouvait à une assez grande distance. Il fallut du temps pour la placer sur le chariot. Il en fallut aussi pour mettre le chariot en mouvement. L’heure à laquelle finissent les travaux dans cette saison était passée. Vainement rappelait-on à ces courageux Bergonniers qu’ils avaient deux grandes lieues à faire. Les bras ne consentirent à se reposer que lorsque la pierre fut venue à l’endroit marqué.
Ils ne voulurent pas néanmoins partir sans avoir reçu la bénédiction du Très Saint-Sacrement qui leur fut donnée par M. l’abbé Laiteux, vicaire de la Paroisse.
6e journée, Frairie de Saint-Dié, 20 décembre 1892. — De cette journée, nous ne rappellerons qu’un fait qui montre avec quelle abnégation nos chers Bretons se dévouent, se dépensent pour l’œuvre de Montfort. Dans la matinée, la troupe presque entière était allée à une certaine distance, dans le but de dégager d’abord, puis de charger et d’amener ensuite un bloc de pierre qui semblait nécessaire pour l’achèvement du pont du Cédron. Le travail se prolongea et devint tellement animé, que personne ne songea que l’heure de dîner était venue. En vain la cloche de la chapelle avait tinté l’Angélus, elle ne fut pas entendue. Tous manœuvraient de plus belle aux leviers et à la chaîne. Ce fut seulement quand la pierre eut été déposée à l’endroit voulu, qu’en regardant les montres on s’aperçut qu’elles marquaient deux heures, de l’après-midi. Personne ne songea à se plaindre. Et ils étaient partis du village, le matin à cinq heures, n’ayant pris que très peu de chose. Après une légère réfection, tous reprenaient joyeusement le travail pour le reste de la soirée, pendant laquelle ils furent heureux de voir au milieu d’eux leur excellent curé et l’un ne leurs vicaires, M. l’abbé Landau. Ami de la Croix, III, p. 290.
7e journée, 1er février 1893. — « C’est la troisième section de cette excellente paroisse, composée en grande partie, croyons-nous, du bourg même de Missillac. M. l’abbé Landau est là, soufflant partout l’ardeur avec son entrain ordinaire.
Nous venions de recevoir de Nantes les wagonnets qui nous serviront à transporter la terre qui encaisse le lit du Cédron.
C’est un des jours où les déraillements sont plus fréquents, peut-être un peu à cause du trop d’empressement de ceux qui les dirigent. Mais, on ne se décourage pas pour si peu. Les wagons sont déchargés, remis sur la voie, puis rechargés et atteignent enfin le but marqué. » Ami de la Croix, t. II, p. 421.
8e journée, 22 mars 1893. — La voie douloureuse. — Frairie de Sainte-Luce et de Bergon.
Depuis longtemps déjà, les femmes nous faisaient un reproche de ne pas les admettre à nos travaux comme l’avait fait notre bienheureux de Montfort. Cédant leurs instances, nous leur avions réservé la Voie douloureuse, travail auquel elles avaient droit à plus d’u titre. Les femmes de la Frairie de Bergon et de Sainte Luce vinrent des premières.
« Evidemment, lisons-nous dans l’Ami de la Croix personne n’a voulu rester en arrière. On dirait une paroisse entière tant sont nombreuses les vaillante chrétiennes qui ont voulu faire leur part du travail d la Voie douloureuse. Elles occupent presque toutes les places disponibles dans notre chapelle, pour y entendre pieusement la sainte messe.
Nous n’avons pas à redire l’emploi de la journée qui 6e partage entre la piété et le travail, le chant des cantiques et le maniement de la bêche ou de la pelle. Tout cela forme un ensemble vraiment beau et édifiant. I Dès le matin, M. l’abbé Landau était là pour encourager et diriger le travail. Dans la soirée, la visite de le Curé est accueillie par tout le monde avec bonheur « Ami de la Croix, t. II, p. 465.
9e journée, jeudi 10 mai 1894. — Les hommes de Bergon à Nazareth.
« Ce jour-là, ce sont nos bons amis de Bergon qui viennent nous prêter main forte, avec leur bonne volonté ordinaire. Ils vont être dirigés par M. Gerbaud. Tandis qu’on lui amène de la crête de la lande les blocs de pierre, il les dispose avec son goût ordinaire ; et bientôt l’on voit se dessiner l’entrée de cette grotte qui faisait partie de l’habitation de la Sainte-Famille à Nazareth. La colline en même temps s’élève, et c’est avec une agréable surprise que tous peuvent constater le soir, les progrès accomplis dans la journée. Honneur aux braves travailleurs de Bergon ! » Ami de la Croix, t. 3, p. 787.
10e journée, 15 décembre 1894. — Ce sont les hommes de Bergon qui eurent la joie de donner la troisième journée de travail au Calvaire, après que sa restauration fut décidée. La quatrième page du registre ne suffit pas à contenir leurs noms et ils empiètent notablement sur la cinquième. — « Bien bonne journée de travail. Travailleurs entendus et infatigables. » Livre d’or des travailleurs.
11e journée, 19 décembre 1891. — C’est le tour des femmes de Bergon qui déploient pendant toute la journée une activité merveilleuse. Aussi le remblai avance-t-il à vue d’œil. Le soir la douve est entièrement comblée, et chacune des travailleuses tient à conduire au-delà sa brouettée de terre dans la première enceinte du Calvaire. Ami de la Croix, p. 937.
Elles ont tenu à travailler jusqu’à la nuit.
12e journée, Frairie de Saint-Dié, 11 janvier 1895. — Cette fois, c’est au Calvaire même que nous travaillons. Tous ces bons travailleurs sont heureux de voir au milieu d’eux, leur excellent pasteur, M. l’abbé Gaudin qui est venu pour les encourager et les féliciter.
J. BARRÉ.
Paroles de Monsieur l’abbé Gouray, curé de Pontchâteau
Le 11 août 1891, je fus demandé au parloir par une bonne ancienne, âgée de 78 ans, Mademoiselle Praud, tertiaire de Saint-François. Elle habitait alors la paroisse de Sainte-Anne de Campbon où elle avait été institutrice. Avant de faire la classe à Sainte-Anne, elle l’avait faite à Sainte-Reine, sa paroisse natale, puis à Saint-Guillaume qui était alors de la paroisse de Pontchâteau.
Elle m’exprima son regret de n’avoir pas suivi alors les conseils de M. Gouray, curé de Pontchâteau, qui lui avait dit : « Construisez une maison au Calvaire, et allez y habiter. Il va s’y établir deux communautés. J’y ferai bâtir une maison moi-même et j’irai y finir mes jours. »
M. Gouray lui avait dit ceci vers 1834, après un voyage à Saint-Laurent en vue de l’établissement ou fondation au Calvaire de la double famille spirituelle de Montfort. Dans une lettre qu’il lui avait adressée de Saint-Laurent, M. Gouray lui disait que l’une des communautés serait d’un côté de la montagne, et l’autre du côté opposé.
Comme il n’y avait alors aucune habitation au Calvaire, la bonne sœur Praud répondit qu’elle aurait peur dans ce désert. Elle est maintenant dans l’admiration en voyant réalisée la parole de M. Gouray.
Quelques années après, la bonne sœur Praud ne pouvant plus venir au Calvaire, à cause de son grand âge, me fit prier d’aller la voir. Elle voulait me remettre des honoraires de messes et trois cents francs pour les statues du Chemin de la Croix.
Poursuivant son projet de confier la desserte du Calvaire aux Fils de Montfort, M. Gouray fit un second voyage à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 1841. Les chroniques de la Compagnie de Marie, année 1841, ont noté les paroles suivantes prononcées à cette occasion par M. le curé de Pontchâteau.
« Si j’avais pris note des guérisons opérées au Calvaire du Père de Montfort, il s’en trouverait plusieurs centaines ; mais je me contente d’en bénir Dieu.
L’eau des douves de la circonférence est employée comme remède, tant est grande dans nos contrées la réputation d’éminente sainteté du vénérable Montfort. »13e journée, Vendredi, 18 janvier 1895. — Ce sont les habitants du bourg et des villages les plus rapprochés. M. l’abbé Landau est présent.
14e journée, Vendredi, 25 janvier 1895. — Brillante journée de la Frairie de Sainte-Luce.
15e journée, 6 février 1895. — Ce sont les habitant» de Bergon bien connus par leur dévouement.
16e journée, 15 février 1895. — Cette journée est donnée par la seconde moitié de la Frairie de Sainte-Luce. Le ciel ne peut que bénir la pieuse émulation qui semble exister entre les diverses paroisses.
17e journée, mardi de Pâques, 16 avril 1895. — Un groupe d’hommes de la paroisse de Missillac vient continuer les travaux. On voit aussi un certain nombre de bons cultivateurs de Crossac qui ont amené leurs charrettes pour transporter des blocs destinés à la voûte de la grotte d’Adam.
18e journée, 24 mai 1895. — « Les signatures prennent de nombreuses pages sur le livre d’Or. Ce sont les femmes de la grande et belle paroisse de Missillac. Tandis que les wagonnets déchargent la terre à portée, on la charge dans des paniers qui passent de main en main jusqu’au-dessus de la grotte d’Adam. De temps en temps les conversations s’arrêtent en même temps, et l’on entend retentir dans les airs un pieux refrain.
19e journée, le lundi 10 juin 1895. — «Travailleuses vraiment dignes d’éloges. » Quelques personnes de Quimperlé, en pèlerinage au Calvaire, ont aussi pris part aux travaux.
20e et 21e journée, le mercredi et le vendredi, 8 et 10 janvier 1896. — « Première journée excellente. La seconde, travailleurs peu nombreux. Le froid était ici très intense.
22e journée, le 12 février 1896. — Cette journée fut donnée par les femmes de Bergon. « C’est toujours le même esprit de foi, la même activité, le même dévouement. »
23e journée, le vendredi, 21 février 1896. — « Belle journée. Le soleil a reparu. Les bons habitants de Bergon toujours si actifs en profitent admirablement. » 24e journée de travail de Missillac, le jeudi, 23 avril 896 — « Bien que la convocation ne soit pas parvenue, nous assure-t-on, dans toutes les parties de la paroisse, très étendue, il est vrai, les travailleuses de Missillac sont aujourd’hui nombreuses, et montrent leur bonne volonté ordinaire. » Ami de la Croix, p. 192.
25e journée de travail, 27 novembre 1896. — « Ce sont les habitants de Bergon, toujours si pleins de bonne volonté, qui clôturent aujourd’hui 27, les travaux du mois de novembre. Ils le font dignement par une journée de travail bien remplie, très fructueuse. »
26e journée, 11 décembre 18915 — « Déjà nous avons fait ressortir le dévouement de Bergon pour le Calvaire, lorsque les hommes sont venus le mois dernier. Aujourd’hui les femmes continuent les traditions et font preuve d’une grande énergie, en continuant son travail qui devient de plus en plus pénible et difficile à mesure que l’on approche du sommet de la colline. Aucune tâche ne les effraie, aucun bloc de pierre ne les arrête. »
27e journée, 30 décembre 1896. – « Le temps est très mauvais, mais n’a pu cependant arrêter un groupe de travailleuses intrépides, qui suppléent au nombre par leur activité infatigable. » Il y a 22 signatures sur le Livre d’Or où nous lisons cette note : « Le temps a été très mauvais ; malgré cela, nous sont venues un certain nombre d’intrépides qui ont déployé une grande activité au travail. » Elles sont de la frairie de Sainte Luce.
28e journée, 22 janvier 1897. — « Peut-on se lasser de louer le courage et le dévouement au Calvaire des bons Bergonniers, lorsqu’ils ne se lassent pas d’en donner de nouvelles preuves ? Il n’y a qu’à les voir encore aujourd’hui à l’œuvre. »
29e journée, 25 février 1897. — « Les paroissiens de Missillac sont mis à contribution en ce moment pour l’achèvement de leur belle église. Cela n’empêche pas une centaine de bonnes travailleuses de cette paroisse de nous donner cette excellente journée, la dernière du mois de février. »
30e journée, 3 juin 1897. — « Quelques personnes venues du village de Bergon, continuent la tâche de la veille avec toute l’activité, le dévouement dont ce village nous a donné tant de fois la preuve depuis que les travaux du Calvaire sont commencés. »
31e journée, 28 décembre 1897. — « Les habitants de Missillac avaient, ces temps derniers, en construction, leur église. Leur concours devait d’abord aller là. Mais, maintenant cette magnifique église est achevée. Missillac, en donnant cette journée de l’année 1897 a montré qu’il n’oubliait point le Calvaire du Bienheureux Montfort. Les travailleurs, malgré le temps peu favorable, étaient nombreux, et se sont montrés plein de courage et d’ardeur. »
32e journée, 29 novembre 1898. — « Ce sont les Bergonniers qui paraissent en tête de cette nouvelle liste, et ils méritent bien cet honneur. Le village de Bergon, situé à l’extrémité de la grande paroisse de Missillac, forme comme un petit peuple à part dans son îlot de verdure. Et ce petit peuple s’est toujours montré très dévoué au Calvaire du Bienheureux Montfort. Ils sont là les travailleurs de Bergon, par une journée très froide. La terre est gelée, mais non au point de résister aux vigoureux coups de pelle et de pioche qui lui sont donnés. On se réchauffe vite à un semblable exercice. De temps en temps quelques refrains de cantique réchauffent ; aussi les cœurs. »
33e et 34e journée, 27 février et 3 mars 1899. — « Les travailleuses de ces deux belles journées ont été très nombreuses et se sont montrées très actives. Elles ont mis la dernière main au pavé de la voie douloureuse, et beaucoup travaillé pour certaines plantations, au pied même de la colline du Calvaire. Si, dans ces deux journées, on a bien travaillé, on a aussi bien chanté, sur le sommet du Calvaire, et à la chapelle du Pèlerinage. »
35e journée, 15 janvier 1901. — Cette journée a été donnée par les braves Bergonniers. Ils ont mis toute leur activité à recueillir les blocs qui ont servi à construire la grotte de Bethléem. 1901, p. 107.
36e journée, 20 février 1910, mercredi des Cendres. — « Ce sont les vaillantes chrétiennes du village de Bergon, qui sanctifient leur première journée de Carême, ici, d’une manière assurément bien méritoire. Elles sont nombreuses : entendent d’abord la sainte messe, puis se mettent avec ardeur au travail pour le continuer jusqu’au soir. Elles s’en retournent joyeuses, après avoir reçu la bénédiction du Bon Maître. » 1901, p. 131.
N° 8 Mai 1912
Notre groupe de l’Ascension
La statue de la sainte Vierge est terminée. Elle est ce que nous étions en droit d’attendre de l’Artiste nantais, admirablement conçue et d’une perfection achevée ; elle est ce qu’elle doit être dans le groupe de l’Ascension.
M. Vallet est l’artiste de foi. Sa foi lui montre dans la sainte Vierge, la femme forte par excellence, la femme capable des plus héroïques sacrifices. Elle en a fait un héroïque sur le Calvaire. Celui d’Abraham n’en était que la figure. Elle pouvait dire alors en toute vérité : « Vous tous qui passez, voyez s’il n’y a jamais eu douleur semblable à ma douleur. »
Au jour de l’Ascension, c’est la joie. Ce n’est plus la mort, l’humiliation, mais la glorification de l’adorable humanité de Jésus, de son âme très sainte, et « de son corps très pur né de la Vierge Marie. » C’est donc aussi la glorification de la Mère. Aussi grande est la joie et l’allégresse de la Très Sainte Vierge !
Pourtant sa joie et son allégresse ne sont pas complètes. Le Fils monte au ciel sans doute, mais la Mère demeure sur la terre. Marie sait d’une science certaine qu’elle ira rejoindre son Jésus, mais elle va être séparée de lui durant de longues années. C’est un sacrifice et un grand sacrifice qu’elle fait avec une entière générosité.
Marie doit encore demeurer sur la terre, parce que, Mère de Dieu, elle est en même temps Mère des hommes. Sa Maternité divine a été sans douleur, mais il en est autrement de sa Maternité humaine. Douloureuse a été pour Marie l’enfantement des élus sur le Calvaire, il continuera de l’être jusqu’à son entrée au ciel.
Marie le sait, c’est son office de Mère des hommes et d’épouse de l’Esprit-Saint qui la retient sur la terre. Elle doit d’abord préparer les Apôtres et les autres disciples à recevoir ce divin Esprit, les former parfaitement en Jésus-Christ et former Jésus-Christ en eux, leur faire connaître la vraie nature de leur vocation. C’est à sa prière surtout que l’Esprit-Saint descendra en eux, et leur communiquera ses dons de lumière et de force qui fera d’eux d’autres hommes. Marie restera ensuite sur la terre aussi longtemps que sa présence y sera nécessaire à l’Eglise naissante. Ce n’est qu’après y avoir accompli toute sa mission qu’elle montera au ciel rejoindre son divin Fils.
Nos travaux
37e journée. 5 mars 1901. — «Dans la seconde semaine de Carême, malgré la rigueur du temps le travail de Bethléem a été mené vigoureusement
Le mardi, un vaillant groupe d’hommes de Missillac a fourni au chantier un bon nombre de ces blocs de rocher qui se font de plus en plus rares sur la lande et qu’il faut amener de plus loin. » 1991, p. 150.
38e journée. — Le 11 décembre 1906, les hommes de Bergon viennent, par un temps affreux, planter la rangée d’arbres de Lambertianas, qui se trouva à droite de la voie douloureuse, en partant de la route au Calvaire. C’est là qu’ils apprirent que les Cardinaux, et les Evêques de France, avaient reçu l’ordre d’abandonner leur demeure. Cette navrante nouvelle fut pour eux un coup de foudre.
39e journée. — Frairies de Bergon et de Sainte-Luce, 9 mars 1911. — Connaissant le dévouement et l’attachement au Calvaire de ces généreux chrétiens, nous n’avons pas été étonnés de les voir arriver 80, le visage épanoui, heureux comme s’ils allaient à une fête. Ils ont été convoqués le dimanche précédent, à l’église paroissiale, par leur bien-aimé Pasteur, et à Sainte-Luce, par le bon abbé Jouy, qui viendra passer aimablement la journée avec eux et prendre part à leurs travaux. Avec de tels hommes ont peut s’attaquer aux plus gros blocs et en venir bientôt à bout. C’est ce qui a lieu. Ami de la Croix, 9 mars 1911, p. 272 et suivantes.
40e journée. — Le mardi 16 mai 1911, le bourg et la Frairie de Saint-Dié. — « La journée a été fort intéressante. Le travail d’ailleurs n’était pas banal, surtout pour des femmes. Il s’agissait de paver de cailloux une partie de l’avenue qui monte au Calvaire. Pour les pierres les plus lourdes, destinées à servir de marches, elles firent usage des brouettes que six d’entre elles tiraient avec des cordes pendant qu’une septième maintenait les brancards. Les cailloux plus maniables étaient passés de mains en mains : les moindres, dans les paniers mayennais. Le travail était agrémenté par des chants continuels et variés. » Ami de la Croix, année 1910-1911, p. 335, etc.
41e journée. — Le mercredi 14 février 1912. — De toutes les journées consacrées à l’œuvre du Calvaire, par la paroisse de Missillac, cette journée est peut-être la plus belle et la plus fructueuse. Il est sept heures du matin quand nous arrivent les premiers travailleurs. Ils viennent de l’extrémité nord de la paroisse. Dès lors sur toutes les routes qui aboutissent au Calvaire, depuis la route venant de la Roche-Bernard par Sainte-Reine jusqu’à celle venant de Séverac, par la Croix-de-Haut Versailles, arrivent de nombreux groupes d’hommes leurs instruments de travail sur l’épaule. Notre vaste chantier est bientôt couvert d’intrépides travailleurs qui rivalisent de courage et d’énergie. Les uns, sous la direction du dévoué M. l’abbé Chabot, poursuivent la voie qui relie l’Ascension à Gethsémani, ou achèvent l’autre partie se dirigeant vers le Calvaire, pendant que sous l’habile direction du bon M. Leroux, vicaire de la paroisse, un groupe de vaillants transforme le devant de l’Ascension, en disposant, d’une façon plus heureuse les énormes blocs qui s’y trouvent. Le résultat obtenu est prodigieux, encore deux ou trois journées et nous en aurons fini avec nos gros travaux de l’Ascension.
Nous avons omis de mentionner la première journée d’hommes de Missillac venus pour tracer notre voie de procession, en vue de la bénédiction du Prétoire. Nous avions ce jour-là, si nos souvenirs sont fidèles, 400 travailleurs. C’est donc au moins 42 journées de travaux qui ont été offertes au bienheureux de Montfort, par cette chrétienne paroisse, depuis que M. l’abbé Gaudin en est le Pasteur. Et, en parcourant rapidement nos 21 volumes de l’Ami de la Croix, nous avons dû en omettre. Nous n’exagérons pas, en portant à cent la moyenne des travailleurs de chaque journée. C’est donc 4.000 journées consacrées à l’œuvre du Calvaire. On comprend, après cela, la confiance de ce peuple en le bon Père de Montfort, confiance justifiée par les innombrables faveurs qui lui sont accordées à l’intercession du Bienheureux.
Omissions
En parcourant nos notes de 1891, nous avons constaté des oublis relativement à la paroisse de Missillac. Le 25 février 1891, les hommes des frairies de Bergon et de Sainte-Luce en Missillac sont venus travailler au Prétoire. Ils étaient environ 80. Avec eux, il s’en trouvait quelques-uns de Sainte-Reine, de la Chapelle-des-Marais et même d’Herbignac. La journée fut ravissante. Allocution à la Chapelle, récitation du chapelet en se rendant au travail. Ils sont partis heureux de leur journée en promettant de revenir. Quelques jours après, le 6 mars, plusieurs vinrent encore de Coulmant, village de Missillac, qui avait déjà envoyé des travailleurs le 25 février précédent. La journée que nous avons indiquée comme étant la 41e est donc la 43e.
J. BARRE.
Paroisse de Saint-Roch en Pontchâteau
C’est le 27 mars 1892 que la paroisse de Saint-Roch est venue pour la première fois prendre part à nos travaux de Gethsémani. Voici ce que nous lisons dans l’Ami de la Croix, au sujet de cette journée :
« Les habitants de Saint-Roch sont fidèles aux anciennes traditions. Ils aiment le Calvaire et sont pleins de confiance dans l’intercession du Bienheureux.
Aussi se sont-ils empressés de répondre à l’appel qui leur a été fait. Saint-Roch, qui est aujourd’hui une belle et bonne paroisse, faisait partie, il y a peu de temps encore, de celle de Pontchâteau. Il ne faut pas s’étonner si nos travailleurs fraternisent si bien, avec les habitants de quelques villages de la paroisse de Pontchâteau même, qui sont venus se joindre à eux. Ce sont les villages de la Moriçais, de Beaumare, de Beaulieu, des Caves, qui ont amené leurs attelages pour transporter le sable et la pierre. Le travail est actif partout, mais semble s’animer encore, quand apparaît dans l’après-midi, M. l’abbé Yviquel, curé de Saint-Roch, non seulement pour encourager ses paroissiens, mais pour mettre avec eux la main à l’œuvre.
Bonne journée pour nous sans doute, mais aussi, nous le savons, pour le Pasteur et pour le troupeau. » Ami de la Croix, t. I, p. 186.
2e journée, 31 janvier 1893. Torrent du Cédron. —
Journée d’averses presque continuelles surtout dans la matinée. Les plus éloignés, en particulier, ne peuvent songer à se mettre en chemin. Cependant une troupe de vaillants a bravé tous les obstacles, et tient à montrer pendant toute la soirée son courage et son dévouement. Dans cette troupe se trouve un vieillard disant bien haut qu’il serait venu tout seul, s’il l’eut fallu. Menacé l’an dernier, de perdre totalement la vue, il n’y voyait presque plus, quand il a invoqué le bon Père de Montfort et lui a promis un voyage au Calvaire. Ses yeux lui ont été rendus, et il croit qu’il n’en pourra jamais trop faire pour témoigner sa reconnaissance à notre Bienheureux. » Ami de la Croix, t. II, p. 120.
3e journée, jeudi 24 janvier 1895. — « Saint-Roch, petite mais bien bonne paroisse représentée tout entière et largement dans cette journée. Infatigables, les travailleurs sont parvenus à pousser les wagonnets presque jusqu’au sommet de la colline actuelle. M. l’abbé Yviquel, leur curé, heureux au milieu d’eux a pas quitté le chantier, et a donné le soir le salut du très Saint-Sacrement. » Ami de la Croix, 1895, 24 janvier.
4e journée, le jeudi 7 mars 1895. — « Ce jour a vraiment rappelé les plus beaux, les plus mouvementés entre ceux dont font mention les historiens du bienheureux de Montfort, lors de la construction de son Calvaire. C’est le chiffre de cinq cents qu’ils donnent alors pour le nombre des personnes qui prenaient part aux travaux. Elles étaient aussi environ cinq cents le 7 mars, les travailleuses venues de Saint-Roch et de Saint-Joachim. Les moyens employés étaient les mêmes qu’autrefois. Huit chaînes étaient formées du pied de la colline au sommet. Cinq de ces chaînes montaient les paniers remplis de terre et les trois autres redescendaient les paniers vides. Le reste des travailleuses avait à pourvoir au chargement des paniers. Spectacle aussi curieux qu’édifiant ! »
5e journée, 21 mai 1895. — « Peu nombreux sans doute, mais plein de bonne volonté et d’ardeur, ce petit groupe a contribué très utilement au travail important fait ce jour-là au-dessus de la voûte de la grotte pour la rendre imperméable. » Ami de la Croix, année 1895, p. 1080.
6e journée, le mardi 3 décembre 1895. — « Les hommes de Saint-Roch ont donné, ce jour-là, une nouvelle preuve de leur dévouement traditionnel au bon Père de Montfort. » Ami de la Croix, 1895-1896, p. 86.
7e journée, le mardi 11 février 1896. — Cette journée est donnée par les femmes. « C’est toujours le même esprit de foi, la même activité, le même dévouement. » Ami de la Croix, ibid., p. 139.
8e journée, le jeudi 30 avril 1896. — « On connaît le courage des braves chrétiennes de Saint-Roch. Elles sont ici de bonne heure et se mettent promptement à la besogne. Elles rivalisent d’ardeur au travail, qui n’est interrompu qu’une ou deux fois par la pluie trop abondante. » L’Ami de la Croix, p. 211-212.
9e journée, 18 décembre 1896. — « Honneur aux braves qui sont venus, ce jour-là, et qui sont reparti* bien décidés, malgré les fatigues de la journée et de la route, à tenir la promesse qu’ils avaient faite d’assister à l’exercice du Jubilé qui devait avoir lieu le soir même. Cette circonstance était ignorée lors de la convocation. » Ami de la Croix, 1896, p. 97.
10e journée, 20 février 1898. — « Ce sont des travailleurs prêts à tout faire que nos bons amis de la paroisse de Saint-Roch. Tandis que les uns achèvent le tracé des allées et le nivellement de la pelouse, les autres s’occupent des plantations. »
11e journée de travail, 18 février 1898. — « Nous avons vu naguère les hommes de Saint-Roch, aujourd’hui ce sont des travailleuses qui nous viennent de la même paroisse. La tâche qui leur est confiée demande un soin spécial et semble aussi particulièrement leur convenir. Pour rompre la monotonie rocheuse des flancs de la colline, il faut un peu de verdure, et par conséquent quelques plantations Des trous sont d’abord creusés, puis garnis d’une terre plus friable que les travailleuses apportent dans des paniers, et l’arbuste vient prendre la place qui lui est ainsi préparée. Tout cela se fait avec beaucoup d’ordre. Et il ne reste plus qu’à faire des vœux pour que les lauriers, les aucubas, les fusains, les youcas reçoivent assez de fraîcheur pour prendre racine et prospérer. » Ami de la Croix, année 1898, p. 138.
12e journée, le mardi 20 décembre 1898. —Les hommes de Saint-Roch ouvrent les travaux de la quatrième semaine de l’Avent. En entreprenant le nivellement des grandes allées latérales de la Voie douloureuse, on devait compter sur un travail de longue haleine, mais les pelles manœuvrent si bien qu’il suffira de quelques journées comme celle-ci. Et tout en travaillant on chante : « Priez pour nous, bienheureux Montfort. »
13e journée, 10 janvier 1899. — « Elles sont courageuses les travailleuses de Saint-Roch. Elles sont parties ce matin, sous la pluie, et elles ne pouvaient compter sur le beau temps ; le beau soleil qu’elles ont en arrivant ici. Elles en profitent pour continuer de paver la Voie douloureuse. »
14e journée, le 26 avril 1901. — Les femmes de Saint-Roch travaillent avec intrépidité à la grotte de Bethléem. La pluie n’a pu les arrêter. Elles ont montré un courage admirable. Livre d’or des travailleurs.
15e journée, 24 janvier 1911. — A la reprise de nos travaux, en vue du mystère de l’Ascension, les hommes de Saint-Roch, sous la conduite de leur intrépide curé, M. l’abbé Adron, ont été admirables d’activité et d’entrain. Ils ont fait preuve en même temps de beaucoup d’habileté pour mettre notre matériel détérioré en état convenable. Ils étaient 65 hommes, chiffre considérable pour cette petite paroisse. Voir l’Ami de la Croix, année 1911, p. 185.
16e journée, 27 février 1912. — Quelle belle et bonne journée ! C’est 80 travailleurs, accompagnés de leur cher et dévoué Pasteur, que les habitants de Pontchâteau admirent traversant leur ville dès le matin, la pioche ou la pelle sur l’épaule et chantant des cantiques. Quelle belle équipe pour la petite paroisse de Saint-Roch! Cette intrépide paroisse nous en a fourni de bien belles journées, mais jamais elle ne nous en a donné de semblables. C’est qu’à Saint-Roch, loin de diminuer, la foi et la piété sont de plus en plus florissantes.
Le travail a été ce que nous devions attendre de ces braves chrétiens. Nos plus sincères et nos plus chaleureuses félicitations aux hommes de Saint-Roch et à leur digne pasteur ! Nous ne pouvons manquer non plus de les chaudement féliciter de leur chant du salut.
1re journée de travail à Gethsémani, jeudi 25 février 1892. — « Ils sont plus de 50. Et si le temps n’avait été très pluvieux le matin, ils auraient dépassé la centaine. Du reste, la journée est belle, tout s’y passe admirablement, non seulement pour le travail, mais pour le chant des cantiques, la récitation du chapelet, le Salut du soir. Nul doute que le vénérable curé de Donges (M. l’abbé Arlais) n’en ait emporté une vraie consolation et de bonnes espérances. I Quant aux travailleurs, ils expriment hautement, au départ, leur désir d’être convoqués une autre fois pour revenir plus nombreux. » Ami de la Croix, t. I, b. 158.
En nous invitant à aller convoquer ses paroissiens, M. le Curé de Donges nous avait engagé à passer par le grand village de Revin, en nous rendant le samedi au presbytère. Nous conformant à ses désirs, nous sommes entrés dans toutes les maisons de Revin. Nous avons trouvé partout l’accueil le plus sympathique. Une bonne ancienne nous dit qu’elle avait travaillé sous M. Gouray, en 1821. Elle avait conservé le panier qui lui avait servi à transporter la terre.
2e journée, 31 mars 1892. — La pluie qui tombait abondamment le matin du 25 février, avait empêché un certain nombre de Dongeois de se mettre en route. Ils demandèrent une seconde convocation et sous la conduite de M. l’abbé Dautais vinrent aussi nombreux que les premiers.
Les travailleurs emploient la matinée à retirer la quantité énorme de bois qui a tenu lieu d’échafaudage. Tout fut replacé le soir pour l’exécution de la seconde partie. Ce travail fut accompli dans un ordre parfait.
On remarque parmi les travailleurs plusieurs vieillards, dont l’un a présents tous les souvenirs de la dernière restauration du Calvaire, en 1821, qu’il rappelle en détail. Ami de la Croix, p. 188.
3e journée. — Le vendredi 20 janvier 1893, c’est village d’Her, de la paroisse de Donges, et la villa des Eaux, de la paroisse de Crossac, qui réponde généreusement à notre appel, fraternisent ensemble nous donnent une excellente journée. Nous remarquons un moment, quelques jeunes, tentés d’imprimer une allure vraiment trop vive aux wagonnets chargés. Ma ils se rendent facilement aux observations des anciens qui sont là pour les modérer. Ami de la Croix p. 402. Ils transportèrent la terre qui forme colline au-dessous du Cédron, à l’aide des wagonnets et des rails loués à Nantes pour la circonstance.
4e journée. — Le jeudi 7 février 1893, les hommes de Donges, sous la conduite de M. l’abbé Arlais, leur curé, nous donne encore une excellente journée.
5e journée, 9 mai 1893. — « Les femmes de Donges, bien que fort éloignées du Calvaire, sont venues en grand nombre.
C’était le moment où tous les regards se tournaient vers le ciel pour demander la pluie. Et, de fait, apparurent ce jour-là quelques nuages plus ou moins menaçants.
Nous en fîmes l’observation, en passant, à quelques-unes de nos braves travailleuses : « Ah ! dirent-elles, nous avons demandé de tout notre cœur, ce matin, au bon Dieu et au Père de Montfort, de faire nos trois ou quatre lieues, ce soir, trempées d’eau, puissions-nous être exaucées. »
Les pieuses paroissiennes de Donges se rappelleront que ce sont elles qui ont fait les premiers préparatifs sur la Voie douloureuse pour recevoir le groupe de Jésus aidé par Simon le Cyrénéen à porter sa croix.
Le Maître aussi s’en souviendra. » Ami de la Croix, t. II, p. 489.
6e journée, 18 avril 1895. — « Voici Donges avec ses excellents travailleurs. Donges qui connut longtemps la barque du Père de Montfort, sur laquelle il n’y avait à craindre ni naufrage, ni accident. M. l’abbé Dautais. vicaire, M. l’abbé Maignein, de Donges, où il prend en ce moment ses vacances de professeur, prennent part aux travaux de la journée. » Ami de la Croix, année 1895, p. 1055.
7e journée, le mardi 14 mai 1895. — « Ce jour-là, on voit les courageuses chrétiennes des bords de la Vilaine et des rives de la Loire fraterniser ensemble au Calvaire. Elles rivalisent de zèle et d’ardeur pour la restauration de ce monument qu’élevèrent autrefois leurs aïeules à la voix de Montfort. Ce sont les paroisses de Donges et de Saint-Dolay. » Ami de la Croix, année 1895, p. 1079.
8e journée. 3 mai 1896. — « Lors de son beau pèlerinage de prière, à la fête du 25 mars, Donges avait promis son pèlerinage de travail. Les braves et nombreux travailleurs présents aujourd’hui au Calvaire accomplissent généreusement ce qui était promis. Les deux Messieurs vicaires de Donges ont leur part dans cette laborieuse journée. » Ami de la Croix, p. 213.
9e journée, le mardi 2 juin 1896. — « Beau et nombreux pèlerinage des travailleuses de la paroisse de Donges. M. le Curé, que nous avions le bonheur de revoir, à cette occasion, ne se contente pas de présider les travaux, il y met bravement la main. Impossible aussi de ne pas remarquer dans ces longues files qui montent les wagonnets, en chantant, les robes grises des Sœurs de la Sagesse. Elles paraissent bien décidées à ne pas céder leur rang, dans ce milieu si plein d’activité et de courage. » Ami de la Croix, 1896, p. 237.
N° 9 Juin 1912
Nos travaux
10e journée, 7 décembre 1896. — « Les habitants de Donges répondent aujourd’hui à l’appel qu’est allé leur faire le R. P. Directeur du Pèlerinage lui-même.
Si le temps avait été plus sûr, ce matin, les travailleurs seraient venus, sans doute, en plus grand nombre ; mais ceux qui sont présents déploient une telle ardeur, un tel courage, que la somme de travail accompli à la fin de la journée, n’en est pas moins considérable.
M. le Curé, présent au chantier, pendant toute la journée donne le soir, le salut du Très Saint-Sacrement. » A de la Croix, p. 80-81.
11e journée, 25 février 1897. — La paroisse de Donges, toujours dévouée et généreuse pour le Calvaire est représentée aujourd’hui par plus de cent travailleuses. Et quelles travailleuses ! Actives, courageuses, infatigables, chantant à ravir, tout en faisant glisser les wagons sur la pente étroite. Le nouveau vicaire de Donges, qui n’a pas oublié que sa bonne mère l’amenait tout enfant en pèlerinage au Calvaire, remplaçait dans cette journée son excellent curé. Ami de la Croix, p. 135.
12e journée, 10 février 1898. — « Encore une de ces paroisses où le souvenir du bon Père de Montfort se conserve très vivant, et où il a des clients très dévoués. On le voit bien chaque fois que Donges est convoqué. Et il nous semble que les travailleurs sont aujourd’hui plus nombreux et plus actifs que jamais. M. le Curé est remplacé par M. l’abbé Oheix, vicaire, dont l’ardeur au travail ne saurait passer inaperçue dans la journée. Nous ne croyons pas commettre une indiscrétion en nous passant le plaisir d’ajouter que nous avons aussi, dans cette journée, une preuve bien frappante que, dans le personnel des écoles laïques, il y a encore de bons et vaillants chrétiens. » Ami de la Croix, p. 135.
13e journée, 15 mars 1899. — « La paroisse de Donges compte un bon nombre d’abonnés à l’Ami de la Croix. C’est dire qu’on y est très dévoué à l’œuvre du Calvaire, très attaché au culte du bienheureux Montfort. Aussi malgré la saison avancée, nous n’avons pas hésité à demander là encore une journée de travail. Aujourd’hui mercredi, 15 mars, les Dongeoises ont répondu en grand nombre à notre appel. Elles forment une chaîne qui embrasse une grande partie de la colline. Elles se font passer de main en main des paniers chargés de terre végétale, qu’on déverse dans les anfractuosités des rochers, qui pourront ainsi se revêtir peu à peu de fleurs, arbustes et plantes grimpantes. Ce faisant, on a beaucoup chanté et bien travaillé sous les rayons d’un beau soleil d’été.
Le pasteur était représenté par ses deux vicaires.
14e journée, 9 mai 1901. — M. l’abbé Picaud, vicaire, accompagnait les hommes de Donges venus travailler à la grotte de Bethléem.
15e journée, mercredi 6 mars 1912. — Le chaleureux appel de M. l’abbé Foucher, curé de Donges a été entendu. Il était accompagné aujourd’hui de M. l’abbé Leclaire, son dévoué vicaire, et de 80 de ses paroissiens. Son désir était d’avoir surtout des jeunes. Il voulait leur inspirer l’affection de leurs ancêtres pour le Calvaire.
Nous sommes heureux de pouvoir le féliciter de son succès. Nous avions des hommes dans la maturité de l’âge, mais nous avions surtout des jeunes gens. Tous ont rivalisé d’activité au travail. Malheureusement des averses nous ont contraint plus d’une fois à chercher des abris. De nombreux blocs néanmoins ont été mis en place, beaucoup de terre transportée, d’aspérité nivelée. A nos chers Travailleurs de Donges, toutes nos félicitations et nos remerciements.
J. BARRÉ.
C’est le jeudi 17 mars 1892, que la paroisse de Sévérac est venue pour la première fois prendre part à nos travaux. Elle avait alors pour curé M. l’abbé Pouplard. C’est lui qui a invité ses paroissiens à venir travailler à Gethsémani. Voici ce que nous lisons dans l’Ami de la Croix, au sujet de cette journée :
« Sévérac a répondu grandement à l’appel qui lui a été fait. Ils sont venus près de deux cents hommes, exprimant le regret que nous partagions nous-mêmes, de n’avoir pas à leur tête, leurs prêtres retenus par le ministère. La journée a été édifiante et bien remplie. Le lit du Cédron a été creusé plus profondément. Les terres qui en ont été extraites, transportées pour faire des terrassements derrière la grotte, par des charrettes amenées des villages de la Madeleine, de la Plaie, de la Noë et de Travers. La grotte elle-même a été remplie d’une grande quantité de rondins de bois, qui tiendront lieu d’échafaudage pour la construction de la voûte. » Ami de la Croix, p. 166.
2e journée, lundi 6 février 1893. — « M. l’abbé Pouplard, curé de Sévérac, nous arrive à la tête de 150 hommes. C’est assurément une des belles journées de cette campagne de travail. Tout se passe dans un ordre parfait. Nous en voyons qui jalonnent un fossé avec la sûreté de coup d’œil de vrais géomètres.
Voici un vieillard de 73 ans qui, craignant d’arriver en retard, est parti de chez lui à deux heures du matin. Pour ne pas se charger, il n’a pas pris de pain, pensant faire sa provision en passant à Pontchâteau. Mais il doit attendre longtemps que les boulangeries s’ouvrent. Sans ce retard, il arrivait le premier. Le cœur du Pasteur devait éprouver de la joie en bénissant ses chers travailleurs. » Ami de la Croix, t. II, p. 421-422.
3e journée, le vendredi 1er mars 1895. — «L’excellente paroisse de Sévérac, bien que distante du Calvaire au moins de 4 lieues, a fourni aujourd’hui une nombreuse équipe d’ardents travailleurs ; et ce ne sera pas la dernière. » Ami de la Croix, p. 1021.
4e journée, le mardi 5 mars. — « Seconde journée (au Calvaire) de la paroisse de Sévérac. Malgré la distance et la neige tombée le matin, cette seconde section de travailleurs est plus nombreuse encore que la première. » p. 1022.
5e journée, le vendredi 8 mars 1895. — M. le Curé et son Vicaire sont venus encourager de leur présence leurs excellents paroissiens.
6e, 7e et 8e journée, les mardis, mercredi et vendredi, 14, 15 et 17 janvier 1896. — « Trois journées dans la même semaine données par la si chrétienne paroisse de Sévérac. Ce sont ces braves qui ayant 5 et même 6 lieues à faire à pied pour venir ici chantaient si bien :
Allons, marchons bon train,
Car le Calvaire n’est pas loin.
Les trois journées ont été assurément fort bien remplies ; mais le bon Curé de Sévérac ayant appris qu’un jour, en particulier, plusieurs avaient été retenus par une foire qui avait lieu dans le voisinage, a décidé qu’une journée supplémentaire serait fixée pour tous ceux qui auraient été empêchés pour une raison ou pour une autre. » 1896, p. 110.
9e journée, le mercredi 29 janvier 1896. — « Journée supplémentaire de Sévérac pour les hommes qui n’avaient pu venir la semaine précédente. » p. 137.
10e journée, 3 décembre 1896. — « Braves travailleurs de Sévérac. Par un temps incertain, ils sont partis ce matin à pied, le plus grand nombre du moins, pour faire une route de cinq à six lieues. Et les voilà qui travaillent presque sans relâche, toute la journée, plus belle qu’on ne pouvait l’espérer. Et ils ne paraissent pas préoccupés du long trajet qui leur reste à faire avant de prendre leur repos.
11e journée, 9 décembre 1896. — La seconde section de cette excellente paroisse arrive aujourd’hui en chantant :
Allons bon train !
Car le Calvaire est loin.
Et après une route si longue, monter pendant des heures les wagons chargés jusqu’au sommet de la colline ! Vraiment un tel dévouement doit être admiré et ne peut rester sans récompense.
12e journée, 9 février 1898. — Les travailleurs de Sévérac ont aujourd’hui à leur tête leur nouveau pasteur, M. l’abbé Daviaud, qui les guidera dans la bonne voie, comme l’ancien dont il était l’ami et le confident. Sévérac montre bien, pour cette excellente journée de travail que rien n’est changé pour son attachement et son dévouement au Calvaire du bienheureux de Montfort.
13e journée de Sévérac, jeudi, 7 mars 1912. — A 14 ans de distance, nous sommes heureux de revoir le bon M. l’abbé Daviaud, Curé de Sévérac, nous ramener ses dévoués paroissiens, prendre part à nos travaux de l’Ascension. Beaucoup viennent pour la première fois. De ce nombre sont tous ceux qui sont au-dessous de trente ans et ce sont les plus nombreux. C’est avec grand plaisir que nous revoyons au milieu d’eux plusieurs de nos travailleurs des premiers jours.
Aujourd’hui, ce n’est plus Gethsémani, ce n’est plus le Calvaire, c’est l’Ascension. C’est un motif de plus de travailler avec courage. Nous avons des hommes habitués à manier les gros blocs, nous sommes heureux de les utiliser. Les autres travaillent à la voie qui conduit de l’Ascension à Gethsémani ou dégagent le chantier des blocs inutiles. Ils ont installé aussi en face du rocher de l’Ascension un siège qui ne pèche pas par défaut de solidité. II se compose de deux pièces solides qu’on peut mettre à l’épreuve. Elles seront encore là au jour du jugement dernier. A la fin de la journée, nous avons dû réunir toutes nos forces pour disposer convenablement un autre siège, d’une seule pièce celui-là. Un moment nous avons même craint de ne pas réussir à l’avoir. Mais enfin nos efforts ont; été couronnés de succès et nous avons été heureux* d’adresser nos félicitations les plus sincères au digne! Curé de Sévérac et à ses dévoués paroissiens.
Nous avions compté voir terminer nos travaux de la montagne et de l’avenue de l’Ascension, la seconde semaine de Carême, par les hommes de Donges et de Sévérac. Mais le jeudi il nous fallut en reconnaître l’impossibilité. Nous eûmes heureusement la bonne fortune de recevoir ce jour-là la visite de M. l’abbé Lizé, chargé d’administrer, en ce moment, la paroisse de Crossac. Il voulut bien accepter de convoquer ses paroissiennes pour le mercredi suivant. Il y a peu de temps que le dévoué M. Guibert nous avait envoyé ses hommes. Mais les femmes de Crossac n’étaient pas venues travailler au Calvaire depuis dix ans.
Comme toujours, l’appel a été entendu. Dès le matin, près de deux cents braves nous sont arrivées avec des peilles ou des pelles sur l’épaule. On apporte les paniers mayennais, les barres de fer, les leviers et les crics. Et vite à l’ouvrage. Les plus fortes transportent ou traînent les blocs qu’elles ont bientôt mis en place. Elles débarrassent ensuite le chantier de ceux qui sont devenus inutiles. Les paniers fournissent la terre pour combler les excavations entre les rochers et permettre de planter les youcas. D’autres chargent et manœuvrent ‘es wagons pour combler au loin les défauts de la voie. C’est tout un monde de travailleuses qui rivalisent d’activité et d’ardeur. Un énorme bloc mis en place par les hommes de Sévérac, est soulevé à l’aide des crics et des barres de fer et débarrassé des rouleaux que le manque de temps n’avait pas permis de dégager. Toutes se mettent à la chaîne pour monter de la voie et disposer convenablement un second bloc d’un très bel effet. Le travail est dur, mais les efforts de nos intrépides travailleuses sont bientôt couronnés de succès. Ce qui reste à faire est relativement peu de chose et nous avons l’espoir de terminer de belle heure. Mais une pluie malencontreuse nous oblige à cesser le travail. Nous nous rendons à la chapelle pour le salut, qui est donné par le bon abbé Lizé, son confrère dirige les chants dont l’exécution ne laisse rien à désirer.
Nous sommes heureux d’adresser des félicitations bien méritées à nos braves travailleuses et de remercier aussi les prêtres dévoués venus à leur tête. Nous avons un souvenir particulier pour le cher et regretté M. l’abbé Guibert, contraint par la maladie de s’éloigner d’une paroisse où il a fait tant de bien, qui lui demeure très attachée, et lui demeurera à jamais reconnaissante.
Nous n’oublierons jamais nous-mêmes le dévouement sans borne de ce digne prêtre pour notre chère œuvre du Calvaire et nous sommes heureux de lui exprimer de nouveau, avec notre affectueux attachement, notre sincère gratitude.
J. BARRÉ.
N° 3 Décembre1912
Au Calvaire de Pontchâteau
« Je désire que ce lieu, que cette chapelle soit un foyer d’où rayonne continuellement sur toute la contrée et même au loin, la lumière bienfaisante d’une foi vive et d’un ardent amour de Dieu. »
Ainsi s’exprimait, l’année dernière, Mgr l’Evêque de Nantes, dans la chapelle des Pères de la Compagnie de Marie, devant 3.000 pèlerins accourus pour célébrer la fête du bienheureux Montfort.
Le vœu du vénérable prélat s’est accompli cette année, l’empressement des fidèles ne s’est pas manifesté avec moins d’éclat, leur nombre était plus considérable encore.
Au milieu des pèlerins appartenant à toute la contrée voisine, se faisaient remarquer plusieurs paroisses venues processionnellement à la suite de leur clergé.
La paroisse d’Ambon, du diocèse de Vannes, faisait un pèlerinage d’actions de grâces pour remercier le bienheureux Montfort des guérisons obtenues l’année dernière dans la chapelle du Calvaire.
La messe du pèlerinage fut célébrée par M. le Curé de Pontchâteau, et dans l’après-midi les pèlerins se rendirent processionnellement au Calvaire, où M. l’abbé Pellerin, curé d’Herbignac, développa magistralement ces deux points : Le bienheureux Montfort a glorifié la Croix ; la Croix a glorifié le Bienheureux.
La dévotion des populations envers le bon Père Montfort n’attend pas les jours de pèlerinage pour se manifester publiquement. Chaque fois qu’un appel leur est adressé au nom du saint missionnaire, on les voit accourir avec empressement. L’érection du nouveau Chemin de Croix fournit à toutes les paroisses voisines une nouvelle occasion de montrer leur zèle et leur reconnaissance.
Le Calvaire de la Madeleine ne devait pas rester isolé : le bienheureux Montfort se proposait d’établir sur la lande qui l’entoure un Chemin de Croix monumental, destiné à reproduire exactement les différentes scènes de la Passion. Les persécutions dont il fut l’objet ne lui permirent pas de mettre ce projet à exécution.
Mgr Jacquemet, évêque de Nantes, qui avait une âme si vaillante dans un corps si débile, conçut aussi le désir de compléter et d’embellir le Calvaire. Mais cet honneur était réservé à l’un des enfants du Bienheureux, à l’un des héritiers de son zèle infatigable poulie salut des âmes.
Le R. P. Barré, supérieur du séminaire de Pontchâteau, soutenu par les bienveillants encouragements du premier pasteur du diocèse, s’est mis courageusement à l’œuvre et le plan du P. Montfort est en voie d’exécution.
Déjà, sous l’habile direction de M. Fraboulet, architecte de la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, s’achève le Prétoire de Pilate sous les arcades duquel seront représentées les premières scènes de la Passion.
En confiant à M. Vallet l’exécution de ce travail considérable, le R. P. Barré a eu le bonheur de rencontrer un de ces « maîtres habiles » auxquels songeait Mgr Jacquemet.
Les fondations du Prétoire et de la Scala Sancta ont été creusées au mois de juillet dernier par les habitants de Saint-Joachim. Les pierres, qui représentent une masse énorme, ont été transportées par les habitants de Pontchâteau, de Saint-Guillaume, de Crossac, de Sainte-Reine, de Missillac, de Saint-Lyphard, de la Chapelle-des-Marais.
La semaine dernière, trois cents hommes de Missillac traçaient à travers la lande une large voie pour le pèlerinage qui doit inaugurer la première station de la Voie Douloureuse. Rien de plus touchant que le spectacle offert par ces braves gens. Ils passent au Calvaire une journée tout entière, commencée par la messe dans la chapelle des Missionnaires et terminée par le salut du Très Saint-Sacrement donné par M. le Curé.
A l’exemple de leurs pères au temps du P. Montfort, ils se délassent du travail par le chant des cantiques et la récitation du chapelet et se contentent du morceau de pain qu’ils ont apporté le matin et de l’eau qu’ils puisent à la fontaine de la Madeleine. Travailleurs volontaires et désintéressés, ils abandonnent leurs travaux et donnent généreusement la fatigue de leurs bras et la sueur de leurs fronts pour l’amour de Dieu et du P. Montfort.
Le dévouement est si grand dans toute la contrée que les femmes se plaignent que leur concours n’ait pas été accepté jusqu’ici. Que ces généreuses chrétiennes se rassurent, le moment viendra bientôt où les femmes aussi pourront apporter au Calvaire du Bienheureux leur pierre ou leur charge de terre. L’œuvre entreprise est assez considérable pour faire place à tous les dévouements.
Ceux que l’éloignement empêche de se joindre aux travailleurs, trouveront une autre façon de contribuer à l’exécution d’un plan qui doit glorifier l’Apôtre de nos provinces de l’Ouest, aux lieux mêmes où il fut si cruellement humilié.
N° 6 Mars 1913
Notre groupe de l’Ascension
Dimanche dernier, nous recevions une lettre de M. Vallet nous annonçant que la statue de Jésus montant au ciel était finie, et nous invitant à nous rendre la voir. Mardi matin, nous arrivions dans ses ateliers et nous admirions un nouveau chef-d’œuvre.
Nous avions déjà vu les statues de la Sainte Vierge, de Sainte Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Cléophas, de Saint Jean et de plusieurs apôtres, et nous les avions trouvées très belles. Mais notre artiste s’est surpassé lui-même dans la statue de Notre-Seigneur. Jésus est représenté s’élevant au ciel en bénissant les siens, selon les expressions des actes des apôtres. Déjà ses pieds ne touchent plus la terre ; ils sont au-dessus d’un nuage. Ses regards s’abaissent sur sa très Sainte Mère et ses disciples qu’il bénit. Il les bénit, les bras largement étendus.
Nous sommes habitués à bénir d’une main, et par un signe de croix. Ainsi nous signifions que notre puissance de bénir découle de la mort de Jésus sur la croix. Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, source de toute bénédiction, possède en lui-même la vertu de bénir. C’est pourquoi il bénit, les deux bras étendus. Il bénit largement : c’est son Eglise qu’il bénit. Ses regards exprime son amour pour les siens. Car il les a aimés, il les aime d’un ardent amour, d’un amour sans borne.
Quam dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit.
Cette magnifique statue sera placée sur le point culminant du rocher le plus élevé. Elle y sera seule. Les statues de la Sainte Vierge et des saintes femmes, celles de Saint Jean et des quatre apôtres, celle de Saint Pierre et des cinq autres apôtres formeront trois groupes distincts, et seront au pied du rocher. Tous les regards seront fixés sur Jésus montant au ciel.
Cette scène sera d’un grand effet.
Un brave ouvrier de Saint-Nazaire, m’écrivait ces jours-ci : « Que le bon Dieu bénisse vos travaux du Calvaire ! En ce moment d’incrédulité officielle, d’indifférence religieuse, l’œuvre que vous poursuivez pour la glorification de la Croix produit quand même des fruits de vie ; même l’indifférent, qui assiste à l’un des grands pèlerinages au Calvaire, sent renaître en lui l’idée de Dieu, du devoir religieux qu’il a oublié, et c’est souvent le commencement d’une conversion, d’un retour au bon Dieu. »
Oui, cela nous l’avons vu, nous en avons été plus d’une fois l’heureux témoin. Mais si la représentation des mystères de la Passion produit pareils effets, que ne produira pas l’Ascension ! Jésus est monté au ciel. Ceux qui ont assisté à son Ascension y sont montés après lui. Nous aussi, nous y monterons, et en échange des légères souffrances que nous aurons endurées sur cette terre, des courtes luttes que nous y aurons soutenues, nous recevrons en partage une éternité de gloire et de bonheur. Mementaneunt et leve tempus tribulntionis nostræ, æternum gloriæ pondus operatur in nobis.
Notre Ascension est donc une belle œuvre, une œuvre qui fera du bien, beaucoup de bien, ranimera la foi et la générosité chrétienne.
C’est pourquoi, nous la savons agréable à Dieu, agréable à Jésus et à sa Sainte Mère, agréable à notre Bienheureux de Montfort. C’est pourquoi nous renouvelons avec confiance cet appel de notre Bienheureux :
Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous,
Grands et petits de tout sexe et tout âge.
Nous renouvelons cet appel au nom de notre Bienheureux parce que nous n’avons pas encore les ressources nécessaires pour couvrir les frais de notre groupe. Nous en avons la confiance, notre appel sera entendu.
J. BARRE.
N° 7 Avril 1913
Nos travaux de l’Ascension. — Les hommes de Crossac. — Nos voisins du Calvaire
Les hommes de Crossac. — Nos voisins du Calvaire.
Pendant que l’artiste nantais travaille sans discontinuer à notre groupe de l’Ascension, nous mettons la dernière main à la montagne.
La statue de Notre-Seigneur devant être placée sur le rocher le plus élevé, a besoin d’y être solidement fixée. Elle le sera par une forte barre de fer, s’enfonçant profondément dans la pierre. Qu’il a fallu de temps et de pointes de burins pour creuser le trou dans un caillou plus dur que l’acier le mieux trempé !
Nous avons dû changer de place ou enfoncer certains blocs trop élevés qui devaient se trouver en face des statues. Pour ce travail, il nous fallait des bras vigoureux. Nous avons fait appel à nos inlassables travailleurs de Crossac. Comme toujours, ils ont répondu admirablement, Monsieur le Maire en tête, à l’invitation de M. l’Abbé Mézières, leur digne Pasteur qui, avec son dévoué vicaire, M. l’abbé Lirzé, a passé la journée au milieu d’eux. Le travail a été ce que nous devions attendre et après le Salut du Très Saint-Sacrement, donné par Monsieur le Curé, nous avons été heureux d’adresser de chaudes félicitations et de sincères remerciements à nos dévoués et intrépides travailleurs de Crossac.
Il nous restait encore quelque chose à faire. Le temps nous avait manqué pour mettre en place certains blocs. Notre avenue entre Gethsémani et l’Ascension n’était pas entièrement achevée. Il y avait une vallée à combler, et enfin un énorme bloc, quasi en face de la grotte de Gethsémani, que le défaut de temps n’avait pas permis, il y a un an, aux braves de Drefféac de mettre à la place qu’il devait occuper. Pour ces divers travaux, nous nous sommes adressés à nos bons voisins des villages de Pontchâteau les plus rapprochés du Calvaire. Nous devons les féliciter et les remercier de la manière dont ils ont répondu à notre appel. Aucun n’y a manqué et la journée a été ce que nous étions en droit d’attendre de nos chers voisins du Calvaire : elle a été parfaite. Notre Bienheureux de Montfort saura s’en souvenir.
Avant la bénédiction de notre groupe de l’Ascension, nous n’avons plus qu’un nettoyage à faire, qu’à enlever les petits cailloux, les quelques ronces et ajoncs, épars sur la voie. Ce travail sera peu de chose. Mais il y a plus à faire au Calvaire. Il faut y rapporter de la terre pour remplacer celle enlevée par le vent et les pluies. Nous comptons pour ce travail, sur les femmes de la paroisse de Pontchâteau, qui ne manqueront pas de répondre avec empressement à l’appel qui leur sera adressé par leur cher et vénéré Pasteur.
N° 8 Mai 1913
Travailleurs de Pontchâteau
Quelle heureuse surprise que celle du dimanche 30 mars quand M. le doyen de Pontchâteau annonça que le mercredi suivant était une journée de travail au Calvaire du Bienheureux de Montfort, mais cette fois pour les femmes. En effet depuis longtemps déjà on nous adressait cet aimable reproche : toujours les hommes, à quand donc le tour des femmes. Le voici, consolez-vous.
Ce jour-là elles nous arrivent 150 sous la conduite de leur bon doyen et de ses aimables vicaires. Jugez de l’animation que prend notre lande de la Madeleine un peu déshabituée à voir semblable bataillon manœuvrer paniers, pelles, pioches, etc.
Il s’agissait de nettoyer les abords des rochers où le 30 août prochain Monseigneur de Nantes procédera à bénédiction du groupe de l’Ascension. Une escouade charge de la besogne. Les paniers s’emplissent vite et les pierres nous arrivent au Calvaire servant à combler les ravinements creusés par l’eau. Pendant ce temps le gros de la bande fait circuler les paniers chargés de terre qui se déversent sur les pierres nivelant ainsi notre allée qui monte au calvaire. M. le curé, infatigable quand il s’agit d’exciter la piété parmi ses fidèles, voulant que cette journée de travail soit aussi une journée de prière fait succéder les cantiques aux cantiques, les dizaines de chapelets aux dizaines de chapelets ; en un mot c’est le chant, la prière, le travail. Bonne journée que celle du 2 avril où la joie était loin de faire défaut. La bénédiction du Saint-Sacrement donnée par M. le doyen fut le digne couronnement de cette journée de travail donnée si généreusement au Calvaire. Merci donc à tous et toutes.
N° 12 Septembre 1913
L’Ascension au Calvaire
C’est désormais chose faite : à travers cette lande peuplée de statues monumentales, et au milieu de ces gracieux sanctuaires, où l’âme vient se recueillir et prier, en méditant sur les mystères joyeux et douloureux de la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et, par-dessus toutes ces merveilles de la foi de nos pères, plane comme une apparition venue d’en haut, le Sauveur lui-même,- au sommet du rocher, la pointe des pieds reposant à peine sur un nuage, et bénissant des deux mains largement étendues, ses onze apôtres, sa mère, Marie-Madeleine et une autre sainte femme, groupés alentour au jour de sa glorieuse Ascension vers son Père.
Vues, les unes après les autres, dans le noble atelier de l’artiste qui y passa des journées entières, en contemplation et en travail, chacune d’elle constituait une œuvre vécue et qui n’a rien de commun, même avec le bel ordinaire. On reconnaît partout la touche de Maître Vallet, les saints prient, pleurent, sourient, et tout en gardant quelque chose de la terre, ils sont idéalisés autant qu’ils peuvent l’être. On les voit, on les admire, et vite on les invoque et on devient meilleur. Je ne crains pas d’être contredit, je suis au contraire, l’interprète de tous ceux qui peuvent voir, maintenant de leurs yeux, le bataillon apostolique se former, les espérances sont dépassées et, la réalité est tout simplement sublime.
Inutile de dire que ce sont des allées et venues de pèlerins d’un peu partout; ils veulent se rendre compte de ces beautés. Le long de la route, depuis Nantes jusqu’au Calvaire, elles ont éveillé les sentiments de piété et de foi, que le souvenir du calvaire ravive toujours dans ces âmes de chrétiens vaillants et convaincus.
Et maintenant nous les saluons sur ce roc béni du Sillon de Bretagne et notre cœur est ému en face de Jésus triomphant et s’élevant, par sa propre puissance, au plus haut des Cieux. Plus heureux que les apôtres, au jour de l’Ascension, nous pouvons nous, le regarder longtemps, le contempler encore. Il est là, taillé comme en un bloc de granit, légèrement incliné, avant de remonter vers son Père, en présence de cette foule d’apôtres et de témoins qu’il bénit, son visage semble s’illuminer déjà des rayons d’or de l’éternelle transfiguration et son divin sourire redit à ceux qui venaient de l’entendre prononcer, cette même parole : « Voici que je suis avec vous, tous les jours jusqu’à la consommation des siècles…. pour vous consoler, vous qui pleurez, guérir ceux qui souffrent et donner la paix aux âmes de bonne volonté. »
C’est vous, apparemment, ô divine Marie, qui la dernière, avez joui de son regard si tendre et si caressant! Sans doute, il va monter au ciel, et vous allez vous trou ver seule, en cette vallée de larmes ; oui, mais vous vous réjouirez parce que la porte va en être enfin ouverte aux élus : il va vous y préparer le trône glorieux, où bientôt vous régnerez, couronnée de lumière, de puissance et de bonté. Nous vous reconnaissons à vos traits si purs, si délicats, et s’il est vrai que votre beauté est tellement supérieure que toutes les beautés d’ici-bas ne peuvent nous en donner que l’ombre, l’ombre est suffisante pour que nous vous devinions et que nous puissions dire : Ecce mater.
Elles sont bien également, chacune avec son caractère différent, Marthe et Marie-Madeleine ; Marthe, la Vierge bonne, douce, prévenante, serviable à tous : Madeleine est admirable au milieu des larmes de son repentir, et sous son voile d’emprunt, trop étroit pour cacher sa longue et ondoyante chevelure et faire disparaître entièrement les atours et les richesses d’un vêtement de fête, changé désormais en vêtement de larmes et de repentir.
Admirons en passant, saint Jean le bien aimé, tout près de Jésus et de Marie, comme au pied de la Croix. Sa virginité rayonne de toute sa personne sainte et son visage surtout révèle une paix, une dilection, pleine de la plus suave tendresse. On dirait qu’il vient à peine de retirer ses lèvres de la plaie adorable du cœur sacré de Jésus, ou que sa tête vient, comme à la dernière cène, se reposer sur la poitrine du Fils de Dieu. Déjà, il entrevoit les visions sublimes qu’il redira dans son apocalypse et les secrets de la divinité, qui seront révélés dans son Evangile, et déchirant devant ses yeux les voiles de l’avenir, Jésus lui montre les longues années qu’il va vivre sur la terre, pour y prêcher à ses frères le règne de la charité.
Et saint Pierre, les deux mains jointes et serrées, dans un élan fait, tout à la fois, d’un repentir et d’un amour sublime, les yeux fixés sur Jésus dans un suave sourire et pourtant baignés dans les larmes. Oh ! il a confiance qu’un jour, malgré son triple reniement, il ira, lui aussi, au ciel, rejoindre son divin maître; aidé, il le sait, de cette plénitude de grâces, que le Paraclet va répandre en leurs cœurs, au jour de la Pentecôte, il pourra compenser sa faute d’un instant, par une moisson d’âmes récoltées à travers le monde, et qui, avec lui, un jour, chanteront au Ciel, le même hosanna triomphant.
Saint Jacques le Majeur, est comme ceux qui l’entourent en cette sainte assemblée des apôtres, plein de grâce et de majesté. Patron des pèlerins, il tient à la main son gourdin et il va jusqu’à Compostelle, en Espagne, donner au Christ, cette terre aux sublimes épopées et restée catholique, malgré tant de combats et de péripéties.
Il me faudrait, au surplus, nommer chacun d’eux, et après avoir décrit leurs différents attributs, leur adresser une louange. Je dois bien laisser au lecteur le soin de donner la préférence à l’un ou à l’autre, dans le détail, sûr que pour la généralité, la note dominante reste la même : le tout forme un tableau des mieux réussis et l’inspirateur de cette œuvre grandiose, comme de tant d’autres, sur cette lande fleurie, toutes du reste, faites uniquement pour la gloire de Dieu et de son serviteur Montfort, peut dire : exegi monumentum œre perennius, j’ai érigé un monument plus solide que l’airain.
Le monument est debout, en effet; mais nous n’apprendrons rien à personne en répétant ce que nous avons déjà dit, en d’autres numéros, que c’est une source de dépenses vraiment extraordinaires ; et bien qu’on ait à admirer le désintéressement de l’artiste distingué, qui l’a exécuté et qu’on ait été à l’économie le plus possible, ii ne faut pas s’étonner si, de tout côté, nous devons tendre la main aux amis du Calvaire. Déjà, et par des lettres personnelles aux bienfaiteurs toujours généreux, et par des prédications dans un certain nombre de paroisses, le Directeur du pèlerinage a pu s’assurer une certaine somme d’argent, pour parer aux premiers frais ; quelques statues ont été gracieusement offertes; mais pour les autres, ce n’est qu’en boursicotant qu’on arrivera à payer leurs délies.
Aussi, exhortons-nous chaleureusement les pèlerins qui, le 31 août, se rencontreront ici, par milliers, d’après le programme de la fête, annoncée en tête de ce numéro à se montrer prodigues et à donner largement. On quêtera, assurément, ce jour-là, pendant les cérémonies : donnée, donnes; il y a les différents troncs dans les sanctuaires, donnez, donnée; vous rencontrerez partout le P. Barré, donnez-lui, à lui-même, si vous pouvez. Il faudrait que, dans les familles, on donnât, pour chacun des membres de la maison, depuis le petit Jean-Marie, qui a 2 mois, jusqu’au vieux grand’père, qui a 90 ans. Pourquoi ne pas donner même au nom de vos défunts? L’aumône est si chère au cœur du bon Dieu !
Et vous, qui allez faire le sacrifice de ne pouvoir venir, confiez à un autre l’offrande que vous auriez portée vous-même. Vous n’aurez pas la dépense du voyage à faire : autant d’épargne pour le Calvaire. Celui qui la remettra, la donnera en votre nom, ou bien le bon Dieu qui sait tout, s’en souviendra. Et de même qu’il est monté au Ciel, pour en ouvrir la porte fermée par le péché originel, et en faire descendre ses grâces sur les hommes, ainsi vous ouvrira-t-il, à vous et aux chers vôtres, les portes de son Saint Paradis, un jour, après vous avoir, sur la terre, comblé de ses meilleures et de ses plus riches bénédictions.
VICTOR BOUTILLIER
N° 4 Janvier 1914
Un Monument au Bienheureux de Montfort
Il y a, sur le plateau de la Madeleine, en Pontchâteau, où le saint missionnaire a érigé son grand Calvaire, un vieux moulin qui ne fait plus de farine depuis des années. On lui a enlevé sa toiture, sa charpente, ses vergues et sa meule ; c’est une ruine. Mais c’est une ruine très respectable. Je constate qu’il a été planté là, sur le point culminant du sillon de Bretagne, par un propriétaire de marque à l’âme profondément religieuse, car sur le linteau de granit de la porte on découvre encore, avec la date de sa construction, 1650, le monogramme de Notre-Seigneur Jésus-Christ ; 263 ans d’âge, c’est joli pour un moulin ; il a donc été témoin des saintes prouesses du Père de Montfort. Comme il porte le monogramme du Christ, il ne peut pas disparaître, et il va se transformer en un monument de gloire. Il servira de support à un magnifique piédestal où l’on posera une statue colossale (4 à 5 mètres) du Bienheureux et puissant protecteur du pays.
Voilà le projet que caressait depuis longtemps le Père Barré, et que son successeur voudrait réaliser.
Rien de plus juste, rien de plus opportun, rien de plus sympathique à l’ardente piété des fidèles du saint missionnaire, c’est-à-dire des catholiques de la région.
Sans doute, notre apôtre n’a eu en vue, dans l’œuvre de Pontchâteau, que la gloire de Jésus crucifié et de Notre-Dame du Saint-Rosaire, son plan a été exécuté, dans des proportions grandioses, par l’un de ses fils dévoués, c’est tout un monde de statues qui habitent et animent cette ancienne lande, où votre admiration va des chapelles aux grottes et au long et monumental chemin de la Croix, en s’arrêtant à loisir devant les hauts reliefs du prétoire. Depuis 25 ans qu’on y travaille, l’œuvre n’est encore qu’à moitié faite. Beaucoup d’autres monuments à établir solliciteront la piété et la générosité des pèlerins. Mais au lendemain de l’inauguration solennelle du groupe de l’Ascension, c’est le moment de songer au grand Serviteur de Dieu ; et le vieux moulin de 1650 réclame l’honneur de fournir un fondement rare au monument à édifier à la gloire du missionnaire breton.
Rien de plus opportun. Des voix autorisées nous disent que, d’ici à deux ans, nous aurons la canonisation du Bienheureux. Il est temps de préparer l’œuvre d’art qui commémorera ce grand événement. Il faut qu’il soit digne de notre saint, digne de la religion et de la reconnaissance des peuples évangélisés par lui.
Je prévois une fête éminemment populaire, qui, bien annoncée et organisée, longtemps à l’avance, nous amènera 40 à 50.000 pèlerins, nous arrivant de 7 à 8 diocèses, conduits par les évêques et le clergé. A partir de ce jour, rayonnera dans l’Eglise, d’un éclat puis, saut, la grande et héroïque figure de Montfort qui, mieux connu, prendra rang dans l’histoire, parmi les hommes de Dieu les plus riches des dons de la nature et de la grâce, et les plus prestigieux par leur inimitable vertu, par leur action profonde et leur bienfaisance pleine de miracles.
Fiat I Fiat ! Fiat !
N° 8 Mai 1914
Nos petits travaux d’embellissement
Ce ne sont pas les travaux gigantesques du temps passé. Il ne s’agit pas non plus d’élever ces monticules qui forment le Calvaire, les grottes de Gethsémani. Bethléem, ni de rouler au pied du bloc granitique de l’Ascension ces roches énormes qui doivent lui donner l’aspect d’un mont. Tout ce premier travail a été généreusement fait, et au prix de quels efforts. Gloire en soit rendue aux généreux travailleurs volontaires qui se sont dépensés sans calcul sous la direction du bon père Barré. Nous avons essayé seulement d’embellir les abords du groupe de l’Ascension. Peu à peu la lande se transforme en petits bosquets où le buis marie sou feuillage toujours vert aux pins et aux lauriers-tins. Quelques fleurs jetées dans des corbeilles donnent à ces abords un aspect plus agréable aux yeux des pèlerins.
Nous n’avons pas eu non plus, comme autrefois, ces affluences de vaillants travailleurs, il nous a suffi du concours généreux et pieux d’une catégorie des élèves de l’école Montfort du Calvaire. Les jeunes gens sont venus, plusieurs fois déjà, nous donner le secours de leurs bras pour dégager ce large emplacement de l’Ascension des pierres qui l’encombraient. C’était plaisir de les entendre chanter ces mêmes refrains qui excitaient au travail nos bons voisins de Crossac, de Ste-Reine, de St-Guillaume, de St-Joachim, etc., quand ils élevaient la montagne du Calvaire. Les échos de la lande répétaient ces airs connus de tous :
Chers amis, tressaillons d’allégresse
Nous avons le Calvaire chez nous :
ou bien encore :
Priez pour nous, Bienheureux Montfort
Conduisez-nous au céleste port.
Avec leur élan juvénile, il leur suffit de deux soirées de congé pour déblayer la place. Le livre d’or s’est ouvert de nouveau pour recevoir leurs noms.
Par ailleurs, l’espace, se découvrant des ajoncs sous les coups répétés de la faux nous fournit un libre passage vers le vieux moulin, où se dressera, l’année prochaine, nous l’espérons, la statue monumentale du Bienheureux Père de Montfort. Pour l’érection de ce monument nous viennent les dons généreux des amis du Calvaire et des privilégiés du grand thaumaturge, mais bien rares encore.
Nous voulons le faire beau, ce monument. Ne doit-il pas être comme le signe de la glorification de notre saint apôtre?
N° 10 Juillet 1914
Le vieux moulin
Les travaux d’appropriation du vieux moulin pour en faire un piédestal convenable, vont commencer incessamment. L’artiste du monument sera Monsieur Vallet, sculpteur à Nantes. C’est dire que nous aurons je l’espère, sur notre lande, une œuvre d’art nouvelle. Fasse notre Bienheureux Père que mon appel soit entendu. Il y a tant de personnes qui dans notre région ont éprouvé l’effet de sa protection.
N° 11 Août 1914
Appel à la générosité des Amis du Calvaire
Il est enfin arrêté que nous allons travailler à la transformation du vieux moulin pour lui donner sa destination dernière : celle d’un piédestal monumental à la statue du Bienheureux. La maquette du monument entier, faite par M. Vallet, sculpteur, à Nantes, réalise bien l’idée du Père de Montfort au Calvaire de la .Madeleine. D’une main, il montre son Calvaire, à droite, et de l’autre, invite la foule à s’approcher. La dévotion de Montfort pour Marie sera représentée par un Rosaire sculpté circulant autour du sommet. Mais… il y a un mais… il nous faudra des ressources pour mener à bonne fin cette entreprise. Je la recommande donc instamment d’abord aux prières des Amis du Calvaire : la prière obtient tout, et aussi à la générosité des fidèles amis du Bienheureux Père de Montfort. Les petites comme les grandes offrandes seront reçues avec reconnaissance. La statue en pierre sera haute de 3 m. 50 et le monument entier atteindra une élévation de 12 mètres. Daigne notre Bienheureux bénir l’entreprise et ceux qui la favoriseront de leurs générosités.
J. B. C.
N° 2 Novembre 1915
Une statue aux Missionnaires – 28 avril 1916
L’Ami de la Croix de janvier 1914 signalait à ses lecteurs l’existence d’un vieux moulin en ruine, âgé de 263 ans, debout encore sur le point culminant du sillon de Bretagne, au plateau de la Madeleine, en Pontchâteau. Il a donc vu arriver dans le pays le Père de Montfort ; il a assisté aux merveilles qui se sont déroulées sur cette lande ; il a été le témoin de l’immense mouvement religieux créé dans la région par le saint missionnaire, ainsi que des travaux du digne Père Barré. Depuis 27 ans, notamment, il a vu se déployer devant lui de splendides et nombreuses manifestations religieuses. Vraiment cet antique moulin a mérité de rester là, parmi les œuvres d’art de ce lieu béni, jusqu’au jugement général, d’autant qu’il porte au front le monogramme du Christ, c’est son meilleur titre à l’immortalité…
M. Vallet, l’artiste nantais, va transformer l’ancien moulin en un piédestal monumental où il posera une statue de pierre du Bienheureux de Montfort, mesurant 4 mètres de hauteur. La tour du moulin sera couronnée de gracieux créneaux et ajourée par des œils-de-bœuf enguirlandés du rosaire sculpté dans la pierre.
Dans cette statue colossale nous verrons le missionnaire montrant son Calvaire aux pèlerins d’un geste large de la main droite, et leur présentant de l’autre main les monuments épars sur le vaste plateau.
Ce double geste si naturel est l’évocation du ministère apostolique de Montfort, prédicateur de Jésus crucifié et de Notre-Dame du Rosaire. Sa parole et sa prière ont éclairé, converti, afferventé les peuples de l’ouest qui continuent, depuis deux siècles, de planter des croix et d’égrener leur rosaire pour la sauvegarde de leurs croyances et de leurs mœurs chrétiennes. C’est bien aussi dans son crucifix et son chapelet que le prêtre breton a trouvé le principe de sa sanctification si éminente, avec la puissance d’action du convertisseur et du thaumaturge.
*
On avait insinué que l’inauguration de la statue pourrait se faire dans les fêtes de la canonisation du Bienheureux. Cette canonisation est ajournée à cause de la guerre. Mais cette guerre nous amène la victoire, et il n’est pas téméraire de croire que, au plus tard, au printemps prochain, nous la tiendrons. Et il ne sera que juste de joindre aux chants des [réjouissances nationales la louange du missionnaire patriote français. Ce sont les évêques, les moines, les missionnaires qui ont formé l’âme de la France et lui ont inspiré ces vertus, ces héroïsmes traditionnels.
Mais la tournure de cette guerre, les sourires et les gages de la victoire qui s’avance vers les alliés sur tous les fronts de bataille, nous permettent de penser que le ciel combat pour nous, et que le kaiser et son vieux dieu vont être bouclés pour longtemps, dans un avenir prochain.
Nous chanterons notre reconnaissance à saint Michel, à sainte Geneviève, à Jeanne d’Arc, à tous les saints et saintes de France et principalement à Marie Immaculée de Lourdes et au Sacré-Cœur de Jésus ; mais nous ne pourrions oublier notre Père de Montfort. Ceux et celles qui l’auront invoqué pendant cette terrible épreuve pour la conservation de leurs soldats, auront tous l’obligation de le remercier, même ceux qui seraient dans le deuil, parce que le Bienheureux aurait ouvert les portes du paradis aux chers disparus.
Donc, amis lecteurs, vous voudrez contribuer par une large offrande à la transformation du vénérable moulin de la Madeleine et à l’érection de la statue grandiose du grand apôtre. Nous voyons, tous les dimanches, 12 à 1500 pèlerins passer au Calvaire pour adresser au saint protecteur une supplication ardente qui n’est pas sans angoisse bien qu’elle soit confiante.
Rendez cette prière plus efficace encore par une aumône proportionnée à vos moyens, pour la statue du missionnaire. Les besoins pressants de l’heure présente comme les faveurs obtenues dans le passé vous engagent à faire un sacrifice qui vous méritera la protection céleste désirée pour vous et les vôtres.
Le Père Directeur a confiance en vous. Il saura vous remercier avec tout son cœur au jour du deux-centième anniversaire de la bienheureuse mort du grand serviteur de Dieu, le 28 avril 1916.
Vive Dieu !
E. R.
N° 12 Septembre 1916
Grande fête autour de l’ancien moulin de la Madeleine transformé en un monument commémoratif du deuxième centenaire du Bienheureux de Montfort 1716-1916.
Un moulin construit en 1630, au plateau de la Madeleine en Pontchâteau, et qui a fourni de la bonne farine aux boulangères des villages d’alentour au cours de deux siècles et demi, témoin des saintes prouesses du Père de Montfort et des merveilles qui ont surgi, sur la vieille lande, depuis 30 ans, devait entrer dans l’immortalité de l’histoire avec le saint missionnaire, d’autant que le monogramme du Christ, gravé sur le linteau de sa porte, a dû lui garantir la parfaite honnêteté de ses innombrables moutures. Aussi bien, quand le Père Barré fit l’acquisition de cet immeuble, non sans y mettre le prix fort, eut-il l’idée de l’utiliser pour la glorification du Bienheureux. La piété active du Père Chicotteau et le talent si apprécié de M. Vallet l’ont réalisée d’une façon splendide.
Ce fut le 19 juillet, année du second centenaire de Montfort, que fut inauguré le monument, par Monseigneur le Fer de la Motte, évêque de Nantes, accompagné de M Roboteau, vicaire général.
La tour du vieux moulin exhaussé et la statue qu’elle supporte mesurent 13 mètres 50 de hauteur ; cette statue de 3 mètres 73 est posée sur une coupole teinte d’azur, qui est le piédestal aérien du saint missionnaire. Bien centrée et d’aplomb, elle fait corps avec la coupole et présente des conditions de solidité qui défient toutes les tempêtes. Une crête gracieuse contourne cette coupole et couronne un entablement où se détachent, en lettres d’or, l’inscription : Vive Montfort, l’apôtre de la croix. Puis le monument est enguirlandé d’un rosaire sculpté, dont chaque dizaine est marquée par une croix, le tout en pierre. Le moulin de la Madeleine avait été bâti, au XVIIe siècle, sous la forme d’un ciboire dont la coupe contenait la meule qui broyait le froment et produisait la farine ; cela ne manquait pas de symbolisme. Nos artistes doivent entourer la partie inférieure du vieux moulin d’un bandeau de granit qui s’enrichira d’une frise herminée. Ces motifs de décoration évoquent vraiment tous les souvenirs qui rappellent le ministère et les bienfaits de la vie de notre héros.
La statue géante est admirée sans réserve par les connaisseurs et les pèlerins qui la regardent attentivement.
M. Vallet a représenté exactement le portrait traditionnel du Bienheureux. La physionomie exprime le mélange d’énergie et de douceur qui caractérise la perfection morale du missionnaire. Le regard est profond et contemplatif ; la lèvre entr’ouverte, est bonne et presque souriante. L’attitude est majestueuse et modeste ; la main gauche ouverte, accueillante, présente aux pèlerins l’immense chemin de croix, tous les monuments épais sur cette ancienne lande transformée par le labeur de 23 ans du puissant organisateur du pèlerinage qu’était l’excellent Père Barré. Montfort, d’un geste large et de sa main droite, montre son calvaire, et semble répéter à la foule qui passe :
Chers amis, tressaillons d’allégresse,
Nous avons le calvaire chez nous.
Courons-y, la charité nous presse ;
Allons voir Jésus-Christ mort pour nous.
Le vêtement est irréprochable. Il y a comme un souffle qui vient du calvaire et qui donne au surplis du prédicateur de la souplesse et de la légèreté.
Faites le tour du monument : de quelque côté que vous regardiez la statue, vous constatez que la silhouette est agréable et répond aux exigences de l’art.
Au risque de taquiner la modestie du sculpteur nantais, disons que l’inspiration et la perfection du travail ne font que bénéficier du grand âge de notre artiste, ce qui nous promet d’autres chefs-d’œuvre pour le pèlerinage de Pontchâteau.
La fête a été précédée d’un triduum présidé par M. le chanoine Lhoumeau, supérieur général des Filles de la Sagesse.
Donc le 19, au matin, les pèlerins arrivent en foule de tous les côtés. Voilà 10.000 personnes rangées devant la Scala, quand apparaissent Monseigneur de Nantes et Monseigneur Maurice, évêque de Lesbos, précédés d’un nombreux clergé et du Séminaire, en ordre de procession. La messe pontificale est chantée par Monseigneur Maurice, assisté de l’abbé Bonneau, prêtre assistant, des abbés Audran et Raimbault comme diacre et sous-diacre.
Après l’évangile, Mgr l’évêque de Nantes prend la parole. Il nous donne un éloquent discours su les deux noms que portait l’étendard de Jeanne d’Arc et qui résument parfaitement tout l’objectif de la vie de Montfort, tant au point de vue de sa sanctification personnelle qu’au point de vue de son ministère. Jésus nous est présenté par la parole épiscopale avec les précisions de la théologie et l’onction d’une piété communicative, remplissant son rôle et dépensant son amour de rédempteur dans le mystère de Noël, de la vie cachée, et principalement dans le drame de la passion. Marie, mère du Verbe incarné et Co rédemptrice vient ensuite, dans le discours, pour vivre, dans toute la mesure du possible, la vie de son divin Fils : ses peines, ses amours, ses vouloirs, ses souffrances, son sacrifice sanglant sur la croix. C’est ainsi que la Vierge Marie Immaculée, mère de Dieu, devient aussi la mère des hommes. Jésus, du haut de la croix, proclame et consacre cette maternité humaine, adoptive, en donnant Saint Jean à sa divine mère et la Vierge Marie à Saint Jean qui représente l’Eglise future et le genre humain tout entier.
Aucun théologien, aucun missionnaire n’a pénétré et prêché ce double mystère mieux que le Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort tout en y trouvant les motifs et l’idéal de sa vie intérieure et l’objet unique de sa prédication. C’est ce que l’éminent prédicateur a mis en pleine lumière. Monseigneur a évoqué d’une façon très heureuse l’intervention miraculeuse de Notre-Dame de l’Espérance, à Pontmain, en 1871. Le crucifix sanglant dans les mains de notre Reine symbolisait l’épreuve d’alors et peut bien symboliser aussi l’expiation que nous impose l’épouvantable guerre de nos jours. Mais nous retiendrons pour notre conduite et nos espoirs patriotiques, la recommandation et la promesse écrite sur la banderole de Pontmain : « Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera dans peu de temps; mon fils se laisse toucher. » Marie n’est pas moins puissante, ni moins aimante aujourd’hui. La Marne et Verdun en témoignent et nous assurent la victoire finale.
A la messe pontificale, les chants liturgiques ont été exécutés par la maîtrise du séminaire, sous l’habile direction de M. l’abbé Rialland, professeur.
Pour les cantiques et les prières de la foule avant et après, et au cours des cérémonies de l’après-midi, nous avons admiré la belle voix et l’entrain de M. l’abbé Deroo, chargé d’en régler le mouvement et l’ensemble.
Il y avait un certain nombre de paroisses réunies avec croix et bannières, clergé en tête. Nous avons remarqué M. le curé de Saint Joachim, avec un millier de paroissiennes et bon nombre d’hommes ; le pasteur de Crossac, avec plusieurs centaines de pèlerins, celui de Montoir, avec non moins de monde, M. le curé de Sainte-Reine, avec 300 fidèles réunis sous sa bannière paroissiale ; Cambon, Saint-Malo de Guersac fournissent un gros contingent. Drefféac est là paroissialement avec curé et vicaire en tête. Saint-Gildas y est aussi. La Chapelle des-Marais a suivi tout entière son pasteur.
Remarqués également Herbignac, Assérac, Saint-Lyphard. Guérande a mérité une mention spéciale ainsi que Trescalan ; M. le prévôt de la collégiale, accompagné de l’abbé Morice, son vicaire, nous amène 600 pèlerins ; M. l’abbé Bersihan, le pasteur de Trescalan, en compte 300 des siens.
A la tête du clergé Vannetais nous voyons le chanoine Charrie, curé d’Auray. L’abbé Malenfant, missionnaire du Calvaire, a bien mérité du bon Dieu, de la Sainte Vierge et du P. de Montfort et des pèlerins. Il a sacrifié les joies et les spectacles du dehors pour être aux confessions, aux bénédictions d’objets de piété.
Le doyen de la Roche-Bernard et celui de Nivillac ont donné en masse. Et nous saluons avec leurs ouailles le curé de la Roche, celui de Musillac, le recteur de Maizan, celui de Nivillac, celui de Billiers, et bien d’autres qu’on ne nous a pas signalés. Le diocèse de Vannes, a dit l’évêque de Nantes, a fourni plusieurs milliers de pèlerins à notre magnifique manifestation. Le recteur de Saint-Dolais est venu, à pied, processionnellement, avec sa paroisse. J’ai entendu citer aussi Férel et Péaule. Le Père de Montfort doit beaucoup aux Morbihannais dans les travaux exécutés au Calvaire. Dans le mouvement populaire que je mentionne, nous devons un merci bien mérité à M. l’abbé Joseph-Marie Gapihan, organisateur du pèlerinage Morbihannais.
Il est juste aussi de remercier M. l’abbé Moron et M. l’abbé Le Bail qui se sont chargés de décorer la chapelle du pèlerinage et tout le parcours de la procession (2 kilomètres) : mats vénitiens et banderoles, arcs de triomphe, surgissant de distance en distance, avec des couleurs et des dessins variés, du meilleur gout ; le prétoire pavoisé avec des faisceaux de drapeaux Français, Anglais, Russes, Italiens et Belges, tout cela réjouissait les yeux, parlait au cœur, à la piété et au patriotisme. Je dois dire que les Sœurs de la Sagesse ont apporté aux préparatifs de la fête un concours précieux.
La Congrégation était dignement représentée, dans cette ovation populaire à leur fondateur, par la très honorée Mère générale, une assistante, la provinciale de Nantes, avec une centaine de religieuses de la région.
Je m’en voudrais d’oublier l’union catholique du personnel des chemins de fer qui nous a fourni plusieurs groupes de pèlerins : le groupe de Sainte Anne, de Nantes, avec son riche drapeau, nous présentant sur l’une de ses faces une locomotive superbe, et sur l’autre un beau médaillon de sainte Anne ; le groupe de Savenay avec son drapeau de Saint-Martin ; le groupe Saint-Michel, de Chantenay, avec son drapeau et une importante délégation. Ils avaient avec eux M. le chanoine Ménard, leur dévoué directeur.
Honneur à ces braves cheminots. L’excellent capitaine de la petite garnison de Pontchâteau nous a envoyé un groupe de militaires qui, de temps en temps, au cours de nos cérémonies de la matinée et de l’après-midi, nous ont donné de jolies sonneries de clairons. Que le chef et les soldats soient remerciés.
A 2 heures, se déroule, du séminaire au monument du centenaire, une procession de 12.000 personnes présidées par les deux évêques devant lesquels marchent plus de cent prêtres, en habit de chœur. C’est plaisir et grande édification d’entendre la puissante voix du peuple chantant les vertus et les gloires du Bienheureux.
Voici nos seigneurs installés sur l’estrade dressée devant le vieux moulin entourés de bon nombre de prêtres. Le panégyriste apparaît. C’est M. l’abbé Péré, supérieur des missionnaires d’Orléans. C’est un dévot du Père de Montfort. Discours superbe, dont le bulletin de l’Ami de la Croix publie aujourd’hui la première partie.
En voici le résumé. Les conquérants de Dieu sont les plus admirables que l’Histoire nous présente. Montfort a eu la gloire de prendre place dans leur phalange. Il en a eu l’Ame zélée, les armes bienfaisantes et les campagnes laborieuses. Exaltons ce géant de l’apostolat. Montfort a eu l’âme d’un apôtre dès son enfance. Son zèle a été précoce, modeste, ardent, tendre, ordonné, universel et pur.
Montfort a été victorieux pur la parole, une parole de bonne doctrine et d’éloquence populaire. Il a prêché Jésus et Jésus au Calvaire, l’Eucharistie, le Sacré-Cœur, la Très Sainte Vierge. Il est naturel, vivant, convaincu, souple, entraînant. Il a pour appuyer sa prédication le prestige de la sainteté.
Montfort atteint les âmes par la prière, par ses pénitences et ses humiliations et fait triompher le bien par tout. Puis il laisse des œuvres qui vont continuer son apostolat, des monuments, des écrits, deux familles religieuses. Parlant du Calvaire, l’orateur a rendu un hommage mérité à la mémoire du Révérend Père Barré ; des larmes de regret ont coulé de bien des yeux.
Le discours s’est terminé sur un rappel aux grandes dévotions de Montfort, la Croix et le Rosaire.
Discours à grande allure, lumineux, pathétique, bien approprié aux choses tragiques du jour, et rendant bien le tempérament, l’œuvre de combat et la gloire grandissante de son héros.
Monseigneur de Nantes bénit ensuite solennellement la statue du Bienheureux, et attache une indulgence de 50 jours à l’invocation du saint missionnaire devant cette statue. Le Père Chicotteau annonce cette faveur au public, en remerciant Sa Grandeur.
On revient à la Scala pour le salut du Saint Sacrement. Puis le Te Deum d’action de grâces monte vers le ciel, chanté par la multitude. Une dernière parole de l’évêque de Nantes nous rappelle le devoir de la reconnaissance envers Dieu, Notre-Seigneur, la divine Mère le Bienheureux de Montfort et tous ceux qui nous ont préparé les joies de cette belle journée,
Au dîner de midi, qui réunissait une centaine de prêtres autour de deux prélats, il y a eu des toasts fort intéressants. Le chanoine Lhoumeau, successeur du Bienheureux de Montfort dans la direction de la très importante Congrégation de la Sagesse, a remercié en termes délicats Monseigneur de Nantes, Monseigneur de Lesbos, M. le comte de la Villeboisnet, le vénérable artiste, M. Vallet, le supérieur du Séminaire et le curé de Pontchâteau, assis à la table des évêques. Mgr Maurice nous a dit la joie d’assister à pareille fête et de pouvoir admirer l’enthousiasme religieux des populations bretonnes. Sa Grandeur a formulé les souhaits les plus gracieux pour la prospérité des œuvres de Montfort.
Mgr le Fer de la Motte a captivé tous ces bons prêtres du diocèse, ainsi que les nombreux curés et recteurs du diocèse de Vannes par une allocution tout aimable, toute doctrinale où rien ni personne n’a été oublié.
Finissons par un merci bien mérité au sympathique abbé Chicotteau, successeur du Père Barré et continuateur fervent de son œuvre. Dieu veuille lui permettre de l’appeler ces foules recueillies et priantes, d’ici à deux ans, pour inaugurer une station nouvelle du Rosaire.
E. M. B.
N° 3 Décembre 1916
Un projet
Au jour delà bénédiction delà statue du Bienheureux sur le Vieux Moulin, un grand nombre de pèlerins nous a manifesté le désir de voir se dresser un monument en l’honneur de la Très-Sainte Vierge. Ce pieux désir cadrait trop bien avec notre pensée pour que nous le laissions tomber.
Malgré la tristesse des temps, malgré les deuils qui se multiplient autour de nous, malgré la cherté de la vie, je viens vous proposer ce projet, chers amis du Calvaire du Bienheureux Père de Montfort. La Très-Sainte Vierge est bien honorée, certes, déjà au Calvaire, témoins ses sanctuaires si fréquentés de l’Annonciation, de la Visitation, de Bethléem. Mais dans ces sanctuaires, Marie est pour ainsi dire à huis clos, et c’est une statue monumentale qu’il faudrait lui élever. En cette année 1917 qui marquera, nous l’espérons tous, la fin du terrible fléau par la victoire et la paix, comme ce serait bien de notre part, l’acte filial par excellence, d’immortaliser par un monument l’assistance merveilleuse de Marie à la France et à ses enfants. Et quel mystère plus approprié aux circonstances que celui de l’Assomption de Marie au ciel.
Déjà sans que nous n’ayons provoqué la générosité des amis du Calvaire, de nombreuses et pieuses offrandes nous ont été envoyées dans cette pensée, la première liste qu’on lira ici, nous en fait foi. Merci ! Merci ! à nos bienfaiteurs, N.-D. leur rende au centuple, en grâces de toutes sortes.
N° 2 Novembre 1917
Bénédiction d’un nouveau groupe à la Santa Casa du Calvaire
Nos lecteurs connaissent l’amour du Bienheureux l’ère de Montfort pour le saint Rosaire, et le zèle ardent qu’il déploya pour développer cette suave et féconde dévotion. Depuis les jours de saint Dominique, son fondateur, et du Bienheureux Alain de la Roche, son restaurateur, le Rosaire n’a point eu de prédicateur plus convaincu et plus entraînant que lui. — « Voilà le « Père au grand chapelet », disaient les paysans bretons, quand ils le voyaient venir de loin ou quand ils l’entendaient en expliquer les touchants mystères du haut de la chaire chrétienne.
Mais nos lecteurs ignorent peut-être que parmi les quinze mystères du Rosaire, il en est un que le grand missionnaire affectionnait tout spécialement : c’est le mystère de l’Incarnation du Verbe dans le sein de Marie. Il l’avait choisi comme devant être la fête principale de la dévotion du saint esclavage de Jésus en Marie, reconnue et approuvée de nos jours par le Saint Siège sous le beau nom « de Confrérie de Marie, Reine des Cœurs. » Les historiens de Montfort nous rapportent qu’avant d’aller se prosterner à Rome aux pieds du vicaire de Jésus-Christ, il s’était rendu en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, et qu’il y avait passé près de quinze jours, malgré son vif désir de gagner promptement la ville éternelle.
Oh ! que de grâces et de consolations spirituelles Montfort n’a-t-il pas puisées dans cette maison bénie où le Verbe divin s’est fait chair, et où la Très Sainte Vierge a été élevée à l’incomparable dignité de Mère de Dieu ! Le jour, il y passait de longues heures dans la méditation. Le matin, il y célébrait la sainte messe avec une ferveur si extraordinaire qu’un pieux habitant de Lorette en fut vivement louché, et qu’il invita immédiatement le missionnaire français à loger chez lui et à y prendre gratuitement tous ses repas.
Or, nous avons le bonheur de posséder au Calvaire de Pontchâteau le fac-similé de la Santa-Casa de Lorette. Notre édicule a été construit d’après des plans qui furent dressés, à Lorette même, par un homme de l’art. Sa forme et ses dimensions sont absolument identiques à celles que présente la sainte maison de Nazareth transportée miraculeusement par les anges : d’abord à Tersatto, en Illyrie ; puis, à Lorette, en Italie.
Les matériaux ne sont pas évidemment identiques. Toutefois, on a trouvé, dans une carrière voisine de Sainte-Anne-de-Campbon des moellons crayeux et à teinte rougeâtre qui imitent assez bien les moellons dont on se servait autrefois et dont on se sert encore aujourd’hui à Nazareth pour la construction des maisons. La colline à laquelle était adossée la maison de la Sainte Vierge, a été simulée ici par un tertre d’où, émergent des rochers et des arbustes variés. Sous ce tumulus on a creusé l’une des trois grottes qui complétaient à Nazareth l’habitation de la sainte Famille. Le jardin ou verger de la Sainte Vierge n’a pas été lui-même oublié… Bref, nous avons dans tout cet ensemble une image assez ressemblante des lieux habités par la Sainte Vierge à l’heure où s’opéra l’ineffable mystère de l’Incarnation du Verbe divin.
… Puis, chose digne de remarque, notre Santa-Casa du Calvaire a été affiliée par le cardinal Rampolla à la Santa-Casa de Lorette. Les pèlerins qui la visitent et qui y prient dévotement aux intentions du Souverain Pontife jouissent absolument des mêmes indulgences et des mêmes faveurs spirituelles que s’ils accomplissaient le pèlerinage de Lorette, en Italie.
Mais comment reproduire l’ineffable mystère de l’Annonciation et de l’Incarnation du Verbe ?… C’était la grosse difficulté. — Le bon P. Barré qui voulait aller vite en besogne, s’adressa à un sculpteur de Paris. Celui-ci élabora promptement deux statues en bois polychrome qui furent placées quasi in piano : l’une du côté de l’Epître ; et l’autre, du côté de l’Evangile. — Au point de vue plastique, ces deux statues n’étaient point sans doute sans valeur ; mais elles avaient deux défauts. Le premier, c’est qu’étant habillées, elles exigeaient des costumes qui coûtaient fort cher et qui se détérioraient rapidement. Le second, c’est qu’elles exprimaient mal les sentiments des personnages à l’heure du mystère. — L’Archange Gabriel, v. g., se tenait quelque peu raide et guindé devant son auguste souveraine. La Vierge elle-même n’était point dans l’attitude de la prière et du recueillement intérieur. Elle était assise sur un escabeau et sa main droite venait de déposer la quenouille de lin qu’elle filait. Sa tête était rejetée en arrière et ses yeux vifs se fixaient béatement sur le messager céleste. — « Ce groupe ne convient pas et ne porte pas assez à la prière, disaient les visiteurs compétents. Il faut le changer ! » Nous avons cédé à leurs instances et chargé M. Vallet de ce délicat travail. L’éloge de M. Vallet n’est plus à faire ; et personne n’ignore dans notre contrée que si M. Vallet est un artiste expérimenté, il est surtout un artiste profondément religieux. Il connaît l’Evangile ; il le médite et s’en inspire admirablement dans ses œuvres religieuses.
De notre nouveau groupe je ne dirai rien, sinon qu’il plaît et qu’il porte à la piété par sa grâce, sa simplicité et sa pureté toute céleste. Ceux qui ne pourront le contempler de leurs yeux, pourront du moins le voir en cartes postales dans un avenir prochain. Pour loger notre nouveau groupe et lui faire un cadre plus digne de lui, nous avons notablement rajeuni et paré notre petit sanctuaire de Nazareth. Le plafond bleu d’azur a été repeint et enrichi d’une corniche. — Les murs de la Santa-Casa sont bleutés et propres, comme ils devaient l’être alors que Marie y entretenait elle-même l’ordre et la propreté, seul luxe qu’elle y connut jamais. Le tombeau de l’autel qui n’a d’autre ornement que le chiffre de la Vierge d’or sur fond d’azur entouré d’un chapelet aux grains d’argent a été repeint et remis à neuf… Bref, tout en restant fort simple et fort modeste, notre Santa Casa est devenue plus pieuse et plus attrayante que jamais.
*
Restait à bénir solennellement le nouveau groupe. La cérémonie avait été fixée et annoncée pour le dimanche, 7 octobre. Le jour était bien choisi, puisque c’était la fête du Saint Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie ; mais le temps était maussade et nuageux. A onze heures moins le quart, le clergé conduisait processionnellement Mgr Guiot à la Scala-santa ; et M. l’abbé Audron commençait immédiatement la célébration des saints mystères. Près de deux mille personnes y assistaient dans un recueillement parfait, et chantaient de tout cœur les incomparables cantiques du B. P. de Montfort. A l’évangile le Directeur du pèlerinage prenait la parole et rappelait brièvement les fêles anciennes.
« … Au mois de mai de l’année 1894, le chanoine Mauclerc, curé de Savenay, bénissait la première pierre de notre Santa-Casa qui, comme un lis, émergeait déjà de la terre et venait enrichir notre pèlerinage d’un nouveau fleuron. Or, c’était le B. P. Guiot qui était appelé à édifier de sa parole apostolique la foule des pèlerins et ses compatriotes de St-Guillaume venus, ce jour-là, processionnellement du Calvaire. Quelques mois plus tard, le H. P. Guiot reparaissait encore; et, du coup, c’était pour bénir lui-même le sanctuaire de Nazareth alors terminé et paré de ses statues. Le R. P. Guiot a grandi dans la hiérarchie sacerdotale. Il est devenu évêque missionnaire de la Colombie ; mais de cœur, il est resté fidèle à tous ses souvenirs d’enfance et de famille. Ce qu’il était heureux de faire comme petit missionnaire, il est heureux de le faire aujourd’hui comme évêque. » Nous lui en resterons doublement reconnaissants.
Cela dit, Mgr Guiot s’avança à son tour vers les pèlerins ; et, d’une voix haute et claire, il leur adressa une allocution de circonstance que nous sommes heureux d’analyser sommairement.
Mes bien chers Frères,
L’artiste chrétien qui s’étudie à peupler et à embellir notre Jérusalem nouvelle, a eu le ciseau particulièrement heureux pour remettre sous nos yeux le premier tableau du Rosaire vivant, ou le Mystère joyeux de l’Annonciation.
Ce n’est pas un mince mérite. Car si toute beauté attire, il n’en est point de plus difficile à rendre que celle qui captive Dieu lui-même et ses anges. Aussi l’art s’est ingénié el repris sans cesse au cours des siècles pour reproduire « l’Angélus Domini nantirait Mariae: et concept de Spiritu Sancto ». Le sujet est celui-ci : Il est minuit. Marie est à genoux dans sa pauvre chambrette : en face d’elle, sur un prie-Dieu ou une table, est ouvert le livre des Prophètes. La jeune Vierge parait absorbée dans quelque pensée sublime : elle vient de lire dans Isaïe le passage où Dieu promet à la maison de David l’enfantement du Sauveur par une Vierge; elle rassemble alors dans son cœur tous les désirs des Patriarches, tous les soupirs des Prophètes, tous les gémissements de l’humanité malheureuse, lance vers le ciel d’un effort suprême tous ces traits enflammés… A l’instant même, l’Archange Gabriel s’est précipité des cimes célestes ; il est entré, un lis en main, dans l’appartement de la Vierge el, dans-une attitude de respect — la même qu’il garde devant la Sainte Trinité dont il est l’ambassadeur — il la salue avec une suavité sans pareille.
Puis, lorsque, Vierge prudente saintement jalouse de garder à Dieu sa virginité, Marie reçoit l’assurance que les joies de la maternité divine vont de pair pour elle avec les gloires de la Virginité, elle dit : « Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole ! » L’Esprit Saint, qu’on représente sous la forme d’une colombe, survient alors en elle ; la vertu du Très-Haut la couvre et le Verbe se fait chair.
Telle est, me paraît-il, l’idée qui a inspiré M. Vallet et qu’il a gravée dans la pierre en-créant le nouveau groupe de Nazareth.
Méditons brièvement ensemble les leçons de choses qui se dégagent du mystère, à la gloire de la sainte Vierge et pour notre profit spirituel.
Commentant alors l’Evangile de l’Annonciation, Monseigneur nous montre que Dieu a cherché pour être, — autant que cela pouvait être, — la digne mère de son Fils Rédempteur :
1° Une âme totalement virginale, d’un mot, celle que le ciel et la terre appellent avec un religieux respect et un amour filial : l’Immaculée Conception.
2° Dieu a cherché encore pour être la mère de son fils, une âme humble, une femme d’ouvrier, une femme inconnue, une femme pauvre. Et dans quel lieu ? Dans une des villes les plus décriées de la Galilée, dans ce Nazareth dont on disait : Que peut-il venir de bien de Nazareth !
Dieu ne fait acception de personne ni de condition ni de lieu.
3° Enfin Dieu a cherché pour être la Mère de son Fils une âme royale. Marie avait du sang de roi, une majesté royale, une autorité royale et une ambition royale.
4° Et Dieu ayant trouvé ce qu’il cherchait : une Vierge mais Immaculée, mais humble mais généreuse, qu’est-ce qu’il lui apporte ?
Dieu apporte à Marie : la grâce, l’intimité, la bénédiction.
Quand Dieu s’approche d’un être humain pour l’appeler à remplir une mission, il lui apporte des secours et des consolations ineffables.
Tout cela est renfermé dans le salut de l’Ange. Ave gratia plena. C’est la plénitude de ce que Dieu a de plus précieux à offrir à ses créatures. Dominus tecum. Le Seigneur est avec vous. C’est la plus douce des intimités et l’accomplissement de cette parole de nos saints Livres : « Mon bien aimé », c’est-à dire Dieu, « est tout à moi et moi, je suis toute à lui».
Aussi Dieu ne se lassait pas de bénir Marie. Et ceux qui aiment Dieu comme vous ne se lassent point non plus de la chanter et de la bénir.
Tirant ensuite la pratique pour nous de ces considérations que nous ne faisons qu’effleurer, l’Evêque missionnaire nous rappelle comment, enfants par le saint Baptême de cette Vierge Immaculée, humble et royale, nous devons avoir horreur de toute souillure, de tout orgueil el de tout égoïsme.
Mais ce n’est là que le côté négatif. Il y a mieux encore, c’est d’imiter notre Mère par la pureté de nos mœurs, la dépendance de Dieu et le zèle à procurer sa gloire el le salut des âmes.
Ainsi mériterons-nous la grâce, l’intimité et la bénédiction de Dieu.
En terminant, Monseigneur forme le vœu ardent que les familles chrétiennes de cette religieuse contrée, loin de s’opposer à la vocation sacerdotale de leurs enfants, la favorisent plutôt et la cultivent avec bonheur. « La moisson est abondante et les ouvriers vont devenir moins nombreux. » Que sera-ce dans dix ou quinze ans ?
Disons comme Marie, lorsqu’elle est assurée du désir de Dieu : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon voire parole. »
Quand la messe fut terminée, Mgr Guiot se rendit à la Santa Casa pour bénir solennellement nos nouvelles statues. Des agapes fraternelles qui suivirent, je ne dirai rien, sinon que Mgr Guiot, eut le bonheur de voir assis à notre table les principaux membres de son honorable et chrétienne famille. Le soir, le vent el la pluie firent quelque peu rage : mais cela n’empêcha point la majeure partie de nos pèlerins de poursuivre jusqu’au bout les exercices solennels du chemin de la Croix. Le doyen de nos missionnaires. M. l’abbé Breny, n’était-il pas là pour les entraîner, au besoin, de ses exemples et de sa voix? A l’issue du chemin de la croix, la chapelle du pèlerinage était deux fois trop petite pour contenir la foule des pèlerins qui voulaient recevoir la bénédiction du Saint Sacrement et vénérer les reliques du grand apôtre de la Croix et du Rosaire. Le Bienheureux doit être content de nous ; car nous avons fait de notre mieux pour exalter et glorifier Notre-Dame du Saint Rosaire.
Le directeur du pèlerinage,
F. Ballu.
N° 6 Mars 1918
Chez le Maître Joseph Vallet
Quelle sensation bizarre, en ces heures tragiques, d’oublier pour un court instant, grâce à la sérénité de l’art, les réalités atroces du conflit qui ensanglante l’univers civilisé ! Cette douceur brève, je l’ai ressentie ces jours derniers dans l’atelier si connu de la rue de Rennes, où M. Joseph Vallet ne cesse depuis de longues années de pétrir pour nos sanctuaires des statues pleines de vie, d’originalité et d’élégant réalisme.
Poursuivant l’exécution du plan grandiose de son œuvre préférée, le vénérable sculpteur vient de modeler pour le Calvaire de Pontchâteau une « Assomption » qui sera le digne pendant du groupe de I » « Ascension. » Grande, svelte, la Sainte Vierge touche à peine le rocher de ses pieds menus : son visage est levé vers le Ciel où elle va trôner près de son divin Fils ; en son regard éthéré, en sa bouche entrouverte par un sourire idéal, règne déjà la béatitude. Le drapage, tantôt lourd à souhait, tantôt diaphane et aérien, de chacun de ses personnages, voilà peut-être le trait le plus typique du talent de notre concitoyen : ici encore, il affirme son habileté par la disposition gracieuse du voile et de la robe enveloppante et légère, dont les plis aux lignes contrariées savent retenir abondamment la lumière.
Au premier aspect, tout est simple, dans cette statue ; l’étude approfondie des détails révèle une longue expérience et de hautes qualités artistiques. La nouvelle œuvre du maître si justement sympathique pour sa foi chrétienne, son labeur acharné et son amabilité exquise se dressera bientôt sur la lande de la Madeleine. Puisse cette inauguration coïncider avec l’Assomption de la France, qui souffre et pleure comme Marie a souffert et pleine, el que le Dieu des Batailles élèvera vers Lui dans le triomphe d’une victoire achetée au prix du sang le plus pur répandu à flots pour le salut de la Patrie.
N° 9 Juin 1918
Le Sanctuaire de la Visitation au Calvaire de Pontchâteau, 28 avril 1918
La représentation du premier mystère du rosaire était chose relativement aisée : car la maison de la Sainte Vierge où s’est accompli ce grand mystère, est toujours debout à Lorette. — Il n’y avait donc qu’à en prendre exactement les dimensions…, à chercher des matériaux aussi ressemblants que possible avec ceux de la Santa-Casa, puis enfin, en s’aidant de la tradition, à agencer les choses de façon à ce qu’on eût sous les yeux l’aspect de la Sainte Maison telle qu’on la voyait autrefois à Nazareth.
Mais la représentation du second mystère du rosaire présentait plus de difficultés ; car il ne reste plus trace aujourd’hui de la demeure du prêtre Zacharie et de son épouse Sainte Elisabeth. — L’Evangile nous dit qu’ils habitaient dans une ville lévitique du pays de Judée, et que, pour s’y rendre de Nazareth, il fallait traverser des collines et des montagnes. Les Commentateurs ajoutent que cette ville lévitique était probablement Hébron : et c’est tout ce que nous savons sur ce point.
Il est à présumer cependant que la maison des deux époux devait être assez confortable ; car Elisabeth, en particulier, était de naissance royale et sacerdotale. Aussi, le modeste monument que l’on a construit ici pour servir de cadre à l’entrevue de la Sainte Vierge et de sa cousine, n’est-il que le portique ou vestibule de la maison de Zacharie. C’est un pavillon carré mesurant 4 m. 50 sur chaque côté. La toiture arrondie en forme de cône lui donne une physionomie toute orientale. Quand il sera entièrement restauré, il aura extérieurement l’aspect d’une Koubba arabe:
Mais, comme l’a dit la Sainte Ecriture de la Fille par excellence du roi des rois, toute la beauté de ce monument est vraiment à l’intérieur. Là, en effet, nous pouvons voir et admirer aujourd’hui le superbe haut-relief que nous devons au talent si connu et si justement apprécié de M. Vallet. Pour en savourer l’idée et les délicatesses sculpturales, le pèlerin doit connaître la scène évangélique qu’il peint sur le vif et d’une façon fort expressive.
*
… L’ineffable mystère de l’Incarnation vient de s’accomplir dans la Santa-Casa de Nazareth… Marie est devenue le ciboire vivant où le verbe fait chair repose et reposera durant neuf mois. Mais aussi discrète qu’elle est humble, Marie n’a point jugé opportun de mettre Joseph au courant de l’insigne faveur dont le ciel l’a favorisée. Elle préfère s’abandonner à la divine Providence et lui laisser la délicate mission d’arranger toutes choses selon son infinie sagesse. « Le Seigneur, se dit-elle, me gouverne : rien ne me manquera. Dominus régit me, et nihil mihi dépérit. »
Il est une chose cependant que la Vierge très aimante et très respectueuse ne peut taire à son saint époux : c’est le vif désir qu’elle éprouve de se rendre à Hébron près de sa cousine Elisabeth. — « Ah, je le veux bien, lui répond Joseph ; et, comme le voyage est long et difficile, je serai moi-même de la partie. » Pour Joseph cette visite n’était en réalité qu’une visite de courtoisie et de respectueuse sympathie. Pour Marie au contraire cette visite lui était en quelque sorte dictée et imposée par le ciel lui-même. — « Voici, lui avait dit l’Archange Gabriel, voici que votre parente Elisabeth a elle-même conçu un fils, malgré son âge avancé; et celle que l’on appelait la stérile, est déjà au sixième mois de sa fécondité ; car il n’y a rien d’impossible à Dieu. » — En allant à Hébron, Marie ne faisait donc qu’obéir à l’indication formelle de l’Archange. C’était du reste pour elle un devoir et un besoin irrésistible du cœur que d’aller offrir ses félicitations et ses services à sa pieuse et vénérable parente.
… Elle part et, au bout de cinq à six journées de marche à travers les sentiers abrupts et rocailleux de la montagne, elle arrive dans la ville sacerdotale d’Hébron… La voici devant la maison du prêtre Zacharie…, elle frappe doucement à la porte…, on lui ouvre ; et, sans se prévaloir en rien de sa dignité de Mère de Dieu, Marie se jette la première dans les bras de sa cousine, en lui adressant ce salut traditionnel : « pax tecum ! Que la paix soit avec toi ! »
Mais, ô prodige! à peine Marie a-t-elle prononcé ces mots, que l’enfant d’Elisabeth est miraculeusement sanctifié et qu’il tressaille instinctivement de joie et de reconnaissance dans le sein de sa mère. Par ce geste insolite, le petit Jean-Baptiste prélude déjà à sa future mission de Précurseur, et il redit à sa façon ce qu’il dira plus tard de notre divin Sauveur : « Voici l’Agneau de Dieu, Voici Celui qui porte et qui prend à son compte tous les péchés du monde. »
Mais Jean-Baptiste n’est pas seul à s’émouvoir à l’aspect de Marie et de son divin Fils, Elisabeth est elle-même vivement impressionnée et, divinement éclairée par l’Esprit Saint, elle comprend mieux que personne l’insigne faveur dont le ciel a favorisé la Sainte Vierge. — A ses yeux, Marie n’est plus l’humble et modeste jeune fille qui a grandi comme un lis dans les parvis du temple de Jérusalem ; elle n’est plus la simple descendante des rois de Judas. Elle est plus que tout cela : elle est la terre virginale qui recèle et nourrit le Sauveur du monde ; elle est la tige de Jessé d’où sortira bientôt le rejeton divin ; elle est, en un mot, la Mère de Dieu. — Ecoutez plutôt le langage éminemment précis de Celle qu’on a justement appelée le premier et le plus grand docteur delà maternité divine: « Vous êtes bénie dit-elle à la Sainte Vierge, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de vos entrailles est béni. — D’où me vient ce bonheur que la mère de mon Dieu daigne me visiter ? — A peine votre voix a-t-elle frappé mon oreille que mon enfant a bondi en moi… Ah, vous êtes bien heureuse Marie, d’avoir cru : car toutes les choses qui vous ont été annoncées de la part de Dieu, s’accompliront en vous. »
Quand Elisabeth eut fini de parler, la Vierge-Mère qui l’avait écoutée, silencieuse et ravie, se laissa aller à son tour au souffle de l’inspiration divine ; et sa réponse fut ce sublime Magnificat qu’aucune poésie humaine ne pourra égaler et qui, au dire du grand apologiste Nicolas, suffirait à lui seul pour confondre tous les athées du monde.
Ah ! comme elles se sont bien comprises du premier coup, ces deux saintes femmes ! On dirait deux harpes qui frémissent et qui vibrent à qui mieux mieux sous les touches du Saint Esprit. Dans leurs personnes il me semble voir une ravissante figure de l’Ancien et du Nouveau Testament, de la synagogue juive et de l’église catholique qui viennent là, en quelque sorte, se souder et s’enlacer dans une étreinte toute fraternelle.
M. Vallet a parfaitement exprimé les sentiments enthousiastes de foi, de reconnaissance et d’amour de ces deux principaux personnages. Puis, à l’arrière-plan, l’artiste nous fait assister à une autre entrevue très intéressante et très cordiale aussi : celle de Saint Joseph et du prêtre Zacharie. Cette dernière entrevue, il est vrai, n’est pas mentionnée dans l’Evangile; mais elle est si vraisemblable et si conforme aux mœurs orientales que l’illustre pape Benoît XIV approuve les artistes qui la reproduisent dans la sculpture et la peinture.
Venez au Calvaire, chers lecteurs, et, en contemplant de vos yeux l’œuvre de M. Vallet, vous conviendrez qu’il a pieusement et artistement représenté le second mystère du Rosaire.
F. Ballu.
N° 11 Novembre 1919
Le grand Pèlerinage du 28 septembre 1919 au Calvaire de Pontchâteau
Caractère de cette manifestation : Bénédiction de deux nouveaux monuments: Jésus, abandonné par Pilate, et livré aux Juifs pour être crucifié, et, La Très Sainte Vierge, escortée d’un groupe d’anges, quitte la terre pour monter au ciel.
Pendant la grande guerre, le Calvaire de Pontchâteau fut pour l’Ouest, et tout spécialement pour la Loire-Inférieure et le Morbihan, le lieu de rendez-vous, où, soldats et parents de soldats, vinrent implorer la protection de Dieu et la victoire de la France. Centre de la prière éplorée, il convenait qu’il fût celui de la reconnaissance enthousiaste au jour du triomphe. M. le directeur du Pèlerinage l’avait compris. Aussi, par l’organe de l’Ami de la Croix, des Semaines Religieuses de Nantes et de Vannes, du journal La Croix, il avait convié, pour le 28 septembre, tout l’Ouest, à une grandiose manifestation religieuse et patriotique. Il faisait appel particulièrement aux démobilisés et aux groupes de Jeunesse Catholique. A cette occasion on bénirait deux nouveaux monuments: Jésus, abandonné par Pilate, et livré aux Juifs pour être crucifié, et, La Très Sainte Vierge, escortée d’un groupe d’anges, quitte la terre pour monter au ciel. C’est la double série parallèle des œuvres du pèlerinage: Chemin de Croix et mystères du Rosaire, qui serait ainsi continuée. Enfin, comme dans toute fête de la victoire, la première place revient à nos morts, c’est à leur intention que serait célébrée la messe de pèlerinage.
Par équipes, on se donne aux préparatifs. La chapelle est artistiquement décorée, des branches de lierre s’enroulent autour des colonnes et dessinent la ligne des ogives. Des feuilles de houx, fixées aux murs, leur donnent l’aspect des draperies tombantes des jours de procession de Fête-Dieu.
Sur le parcours qui suivra le cortège des évêques, sur la moitié du pourtour du pèlerinage, vers le Prétoire et la Grotte de l’Agonie, des arcs de triomphe et des oriflammes jettent leur note claire dans la verdure sombre des cyprès. II ne manque que du soleil pour évoquer la vision des croix lumineuses et des blancs étendards qui, l’année même de la naissance du Bienheureux de Montfort, marqua la lande de la Madeleine pour le théâtre des prodiges que nous voyons aujourd’hui :
Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Avant les cérémonies officielles
Malheureusement, nous allions être desservis par le mauvais temps. Le samedi 27, des pluies continues obligent à surseoir aux travaux. On les reprend le dimanche, de bonne heure, sans être mieux favorisés. Pourtant, sans se laisser arrêter par les mauvais augures d’une matinée pluvieuse, des pèlerins arrivent déjà par les premiers trains. Ils se succèdent à la chapelle pour l’assistance à la messe. On les rencontre dans les allées du pèlerinage. Il y en a déjà au sommet du Calvaire. Quelques-uns gravissent à genoux les marches trempées de la Scala. D’autres entourent les tentes que montent les vendeurs habitués de ces fêtes. Et pourtant, la pluie tombe toujours ; le vent la projette jusqu’à l’autel du Prétoire ; et l’on se demande s’il sera possible de célébrer en plein air. Mais l’affluence des pèlerins et un peu d’accalmie emportent les dernières hésitations. On suivra le programme.
Déjà la foule s’est massée sur les degrés de la Scala et devant le Prétoire. On y chante à plein cœur — comme c’est l’habitude au Calvaire — les cantiques du Bienheureux. De la main, du haut de la Scala, des missionnaires dirigent le chant et toute cette foule ne forme qu’un chœur.
Il est 9 h. 1/4. Voici que le cortège de NN.SS. les Evêques sort du Séminaire et s’avance processionnellement, escorté par la foule, précédé de quelques croix ou bannières paroissiales et de quelques drapeaux de Jeunesse Catholique qui ont bravé la pluie.
Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes prend place au trône ; vient, à sa droite, Sa Grandeur Mgr Légal, archevêque d’Edmonton ; à sa gauche, Leurs Grandeurs Mgr Gouraud, évêque de Vannes, et Mgr Guiot, vicaire apostolique de Colombie. C’est Sa Grandeur Mgr Auneau, vicaire apostolique du Shiré, qui pontifie, assisté de trois autres enfants du Bienheureux. A signaler aussi, dans l’assistance ecclésiastique, MM. Richard, Chupin, Deval, venus pour prendre part à ce nouveau triomphe de leur Père ; M. le chanoine Thubé, vicaire général de Vannes ; M. le chanoine Terrien, supérieur du Petit Séminaire ; M. le chanoine Ménard, directeur des Œuvres catholiques du diocèse ; de nombreux curés ou vicaires, venus à la tête de leurs fidèles. Dans l’assistance laïque, il y a là M. le comte de la Villesboisnet ; M. Arthur de la Villesboisnet, député de Pontivy ; M. le maire de Pontchâteau ; des délégations de Syndicats et d’Associations catholiques.
La foule prend une grande part au chant. On a choisi à cet effet la messe de Du Mont. C’est d’une seule voix qu’elle alterne avec la Schola et qu’elle enlève tour à tour : Gloria… Credo… Sanctus… Agnus, etc.
Les pèlerins arrivent toujours ; ils débouchent par toutes les allées du pèlerinage; ils arrivent en carriole, des paroisses voisines. Après l’Evangile, Mgr l’Evêque de Vannes, l’orateur de la matinée, se trouve avoir devant lui, sur la voie triomphale, un magnifique auditoire.
Sa Grandeur envisage surtout la fin de ce pèlerinage : journée d’actions de grâces et de supplications, d’actions de grâces pour la victoire remportée, de supplications pour le maintien et l’exploitation de la paix victorieuse. L’orateur s’arrête spécialement à cette dernière considération. L’amour du sacrifice et le rappel du règne familial et social de Jésus-Christ, Notre-Seigneur, peuvent seuls fournir les bases de cette stabilité et de ce développement… Malgré le vent qui lui est contraire, la voix de l’orateur s’impose et atteint les derniers rangs de son auditoire. On peut juger de l’intérêt qu’il suscite à l’attention soutenue que lui prêtent les fidèles, malgré la pluie, malgré le vent, malgré les fatigues de la marche et d’une assistance debout. Un, moment, un frisson traverse la foule : l’orateur vient d’interpréter la scène qui occupe le panneau central du Prétoire et que l’on va inaugurer à l’instant : Jésus que Pilate abandonne et qu’il livre aux Juifs pour le crucifier. Les catholiques d’aujourd’hui, même les catholiques de l’Ouest, ne se reconnaîtraient-ils pas dans cette attitude de lâcheté en face de la grande cause du règne de Dieu ? Tout à l’heure, la victoire nous apparaissait comme la réponse divine à l’offrande du sang français unie à l’offrande du sang de Jésus ; pareillement nous ne devrons de nous établir dans cette victoire et de la faire fructifier que par l’amour du sacrifice et l’affirmation de notre foi : c’est la double leçon qui nous vient du Calvaire et de cette première station du Chemin de Croix de Jésus.
Après la messe solennelle, à son tour, Sa Grandeur Mgr l’Evêque de Nantes s’avance sous l’arc central de la Scala, pour bénir le nouveau haut-relief qui achève la décoration du Prétoire. Il est, comme les quatre autres scènes, l’œuvre du sculpteur nantais, M. Vallet, et sa valeur artistique ne le cède en rien à ses aînés. Même ordre d’idées dans la conception : au premier plan, en bas, la scène évangélique ; au-dessus, le triomphe de la croix portée par les anges et qui présidera à l’éternel jugement. L’artiste a dignement mis la dernière main à son œuvre du Prétoire.
Entre la double haie des pèlerins qui se pressent sur le passage des évêques, le cortège rentre au Séminaire.
Le temps reste maussade ; il pleut encore par intervalles ; néanmoins on garda la confiance de pouvoir sortir comme le matin et de répondre ainsi à l’empressement des pèlerins.
Leur piété vaut leur empressement. D’ailleurs, s’ils sont venus malgré les intempéries de la journée, ce ne peut être qu’en pèlerins et non en touristes.
Leur défilé, un court moment interrompu à l’heure de midi, reprend vite. On vient vénérer les reliques du Bienheureux de Montfort, faire bénir les objets de piété qui rappelleront cette journée mémorable. Sans discontinuer, on chante des cantiques. — Au Calvaire on ne cesse jamais de prier ou de chanter. — foute la journée, des missionnaires devront se tenir dans la chapelle, à la disposition des dévots du Bienheureux et faire leur sacrifice des cérémonies extérieures.
Voici qu’elles vont reprendre. On a eu le temps de prévenir aux à-coups de l’organisation dont le mauvais temps de la veille et du matin fut cause. Les paroisses s’ébranlent avec leur croix ou leur bannière : Saint-Roch, Saint-Guillaume. Saint-Joachim, etc. Dans chaque groupe, MM. les curés ou les missionnaires font chanter des cantiques. Voici la Jeunesse Catholique ; je déchiffre — on excusera le chroniqueur nouveau venu de n’avoir guère que ce moyen d’information— je déchiffre, quand le hasard des plis des drapeaux le permet, quelques noms : Syndicat des cheminots de Sainte-Anne de Nantes ; Jeunesse Catholique de Campbon, de Prinquiau, de Guenrouët, etc. Enfin, pressé par la foule, voici le défilé de NN. SS. les Evêques, avec crosse et mitre. De la chapelle au tombeau de la Sainte Vierge (Grotte de l’Agonie), le cortège se déroule. Les trains de midi ont encore grossi l’affluence. On chante, — on chante toujours au Calvaire — : Je suis chrétien…. Nous voulons Dieu…. etc.
Comme on contourne la Grotte de l’Agonie, le nouveau monument de l’Assomption apparaît. Il occupe le plus beau rocher de la lande. La Vierge se détache sur la verdure, dans un groupe d’anges, tendue dans un élan que l’artiste a su fixer. Marie, les deux mains croisées sur sa poitrine comme dans l’Assomption de Murillo, semble contenir son amour et s’offrir au baiser de son Fils. Sa figure extatique, toute transfigurée et souriante, met à elle seule de la lumière dans le ciel noir de nuages. Aussi restera-t-elle, avec quelques figures de l’Ascension et les hauts-reliefs du Prétoire, comme le plus pur titre de gloire de notre artiste nantais. M. Vallet, dont on regrette l’absence en cette journée.
NN. SS. les Evêques prennent place, avec le cierge sur l’estrade aménagée pour eux. Ensemble ils bénissent les pèlerins massés devant eux, juchés sur les rochers et jusque sur la Grotte de l’Agonie, en familiarité avec les anges qui accompagnent l’Assomption de la Sainte Vierge.
Après le chant en chœur de l’Ave Maris Stella, le T. R. P. Robert, missionnaire et fils spirituel du Bienheureux de Montfort, s’avance vers la rampe de l’estrade : « L’hiver est enfin passé, les nuages de pluie ont disparu. Lève-toi, mon amie, et riens, lu seras couronné. » A qui vont ces paroles du Cantique des Cantiques que l’orateur prend pour texte ? A Marie et à la France. S’inspirant de cette double circonstance : pèlerinage d’actions de grâces pour la victoire et érection d’un monument à l’Assomption, le missionnaire met en parallèle le martyre qui préluda, pour Marie et pour la France, au double triomphe que nous commémorons : pour toutes deux, martyre du souvenir, martyre de l’honneur, martyre de l’amour. Ce fut une vraie page d’éloquence. On sentait que l’orateur avait traversé la guerre ; et son auditoire, fait, en grande partie d’anciens combattants, communiait avec lui à cette passion du pays. On devinait des applaudissements contenus. Puis, après quatre ans et, plus de ces souffrances, voici enfin l’heure du triomphe : Hiems transiit, surge, amica mea et veni, coronaberis. Et c’est l’évocation du magnifique défilé des enfants de France devant la Patrie victorieuse. Mais, comme le matin. Mgr de Vannes, l’orateur remarque que nous nous devons d’achever ce triomphe et il termine sur un « garde-à-vous » qui est l’appel pour chacun au devoir de son âge ou de sa charge.
C’est Sa Grandeur Mgr Gouraud qui procède à la bénédiction du nouveau groupe. La foule répond aux paroles du rituel, acclame la Vierge après le directeur du pèlerinage et chante à pleine voix le Laudate Mariam.
Bénédiction du Saint-Sacrement
On repart, toujours au chant des cantiques, vers le Prétoire. Les fidèles reprennent leur place du matin dans l’allée triomphale. Sa Grandeur Mgr Légal, archevêque d’Edmonton, donne la bénédiction du Saint Sacrement.
Puis Mgr l’Evêque de Nantes prend la parole. Il ne veut que prononcer une courte allocution pour clôturer cette superbe journée de piété à laquelle il n’a manqué que du soleil. Ses paroles surnaturelles sont très bien accueillies; et comme Sa Grandeur voulut voir le gage de l’avenir d’après-guerre dans la manifestation de cette journée, ses diocésains auront su reconnaître dans les paroles de leur Pasteur la règle des devoirs nouveaux que leur imposent les conditions présentes de leur pays.
Bénédiction des Evêques
Alors le Magnificat éclate de toutes les poitrines, tandis que processionnellement ou se dirige vers le Séminaire. C’est du perron que NN. SS. les Evêques bénissent une dernière fois la foule qui s’écoule, emportant de cette journée, en dépit des contrariétés du mauvais temps, un ineffaçable souvenir.
Il sera ineffaçable aussi au Calvaire. Sans doute, avec le soleil radieux des premiers jours de septembre, ce n’est pas dix mille pèlerins, mais trente mille que l’appel des missionnaires eût attirés au pied de la Croix, de la Vierge et de Montfort.
Tel que, ce pèlerinage, sous la présidence de NN. SS. les Evêques, — qu’au nom des missionnaires. M. l’abbé Richard sut délicatement remercier — avec le concours du clergé de Nantes et de Vannes et l’affluence de leurs paroissiens, restera dans les archives du Calvaire comme une des plus belles manifestations religieuses et patriotiques de la victoire.
Il est en même temps, par la bénédiction des deux nouveaux groupes. La continuation de l’œuvre parallèle entreprise par Montfort à Pontchâteau, à la gloire de la Croix et du Rosaire, et le gage que la foi se maintiendra inébranlable tant que notre Père continuera ici son apostolat posthume.
Alphonse David.
Nos artistes
1° M. J. Vallet.
— Notre éminent statuaire n’assistait pas au pèlerinage du 28 septembre. Il avait été à la peine : nous l’aurions voulu à l’honneur. Ses œuvres du moins le rappelaient éloquemment à notre souvenir. Il vient en effet d’enrichir notre pèlerinage de deux nouveaux chefs-d’œuvre. Dommage que nous n’ayons à mettre entre ses mains que du ciment. Il lui faudrait un métal ære perennius. Du moins a-t-il écrit lui-même, dans les Annales nantaises de l’art chrétien, une page qu’aimeront à relire les siècles à venir. Daigne donc le Souverain Artiste lui donner d’achever les travaux que nous voudrions lui confier et… d’en jouir ! Parmi les travaux que nous voudrions confier immédiatement à M. Vallet, je cite entre autres le premier mystère glorieux du Rosaire : la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Nous possédons déjà l’Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ et l’Assomption de la Très Sainte Vierge. Il est donc naturel que nous songions à représenter le grand mystère de la résurrection de Jésus. Je fais pour cela un appel à la générosité des amis du Calvaire, et nous ouvrons immédiatement une souscription dans l’Ami de la Croix.
2° M. Gerbaud.
— Un artiste d’un autre genre, ouvrier de la première heure dans la restauration de notre Calvaire, mérite une mention d’autant plus spéciale que la mort vient de nous le ravir : c’est le bon Monsieur Gerbaud. Le zouave pontifical de Pie IX voua ses loisirs à la réalisation des projets du Bienheureux de Montfort. C’est à lui, si je ne me trompe, que nous devons le tracé actuel du Chemin de la Croix et surtout de ces grottes de Bethléem, de Gethsémani, du Golgotha dont chacune a son cachet particulier. Quelques-uns des coopérateurs de M. Gerbaud sont là pour l’attester ; ils ont admiré plus encore sa patience que son talent à côté d’un apôtre de feu qui, parfois, pour aller droit et vite au but, bousculait même ses amis. Puisse-t-il être déjà récompensé là-haut, lui qui ne le fut guère ici-bas1 !
N° 8 Août 1920
Un monument au Sacré-Cœur de Jésus au Calvaire de Pontchâteau
Nos pèlerins et la plupart de nos lecteurs connaissent la grande avenue qui mène du prétoire de Pilate à la colline du Calvaire. — Cette avenue bordée d’arbres verts ne mesure pas moins de 600 mètres de long et de 35 mètres de large.
Eh bien, au centre de cette grande avenue, nous avons projeté d’ériger prochainement une statue monumentale au Sacré-Cœur de Jésus.
Mais pourquoi, diront certaines personnes, pourquoi voulez-vous dresser une statue au Sacré-Cœur dans ces lieux prédestinés par le Bienheureux Père de Montfort à représenter et à nous faire méditer la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ? Ne craignez-vous point d’altérer la note caractéristique et le but primordial de ce pèlerinage célèbre dans l’ouest de la France ? Nous ne le croyons pas. J’ose même dire que la dévotion à la passion et la dévotion au Sacré-Cœur sont intimement liées l’une à l’autre, qu’elles s’impliquent et se complètent l’une et l’autre, bref, qu’elles doivent aller de pair. Le divin Sauveur lui-même ne veut pas que nous les séparions l’une de l’autre.
1° Rappelez-vous, v. g., ce qui se passa sur le Golgotha. — Jésus venait de remettre son âme entre les mains de son Père céleste, et d’exhaler le dernier soupir sur l’arbre de la croix. Des soldats romains s’approchèrent bientôt pour briser les membres et donner le coup de grâce aux deux larrons. Venant à Jésus, ils ne trouvèrent plus qu’un cadavre. Briser ses membres était peine superflue. L’un des soldats cependant, nommé Longin, voulant s’assurer que le corps était réellement sans vie, enfonça sa lance dans le côté droit, traversa la poitrine de part en part, et fit au cœur une large blessure d’où il s’échappa de l’eau et du sang, symbole des plus grands mystères.
Ah ! qui ne redira jamais avec quelle poignante émotion la Vierge Marie, l’apôtre saint Jean, Marie de Magdala et les autres saintes femmes qui avaient suivi Jésus au Calvaire, contemplèrent cette scène douloureuse ! Qui ne redira jamais les larmes brûlantes qu’ils répandirent à la vue de son Cœur blessé et largement ouvert par la lance du soldat Longin ! C’est donc bien au pied de la croix et sur les cimes ensanglantées du Golgotha que la dévotion au Sacré-Cœur a pris naissance. Et depuis ce jour, combien d’âmes d’élite qui ont aimé à se recueillir elles-mêmes dans le Cœur blessé de Jésus, comme dans un asile de paix et de salut, comme dans un sanctuaire où l’Ami divin console et révèle ses plus intimes douceurs ?
2° Rappelez-vous maintenant les célèbres apparitions de Notre-Seigneur Jésus-Christ à la pieuse visitandine de Paray-le-Monial, sainte Marguerite-Marie. — C’était le 16 juin de l’année 1675, Marguerite-Marie était plongée dans une profonde méditation, quand une lumière éblouissante envahit, soudain, tout le sanctuaire de la chapelle. Debout sur le maître-autel, Jésus apparut à sa fidèle servante et fixa sur elle des regards de complaisance. Puis, entrouvrant de ses mains divines les plis de sa robe, il lui découvrit son Cœur environné de flammes, enlacé d’épines, empourpré de sang et surmonté de la croix. — Il suit de là que, tout en invitant Marguerite-Marie à honorer son divin Cœur, Notre, Seigneur ne voulait pas qu’elle oubliât sa passion et qu’elle cessât de la méditer.
Le Divin Maître nous a du reste précisé sa pensée d’une façon plus explicite encore. —« Je désire, disait-il à sa chère petite sainte, je désire que, dans mon Eglise, on institue une fête spéciale pour honorer mon Cœur, pour réparer les outrages et les affronts qui me sont prodigués. » — Or, quel est le jour que Notre-Seigneur a choisi pour cette fête de l’amour et de la réparation ? N’est-ce pas le vendredi, c’est-à-dire le jour consacré déjà au souvenir de ses douleurs et de sa mort sanglante ? On rencontre, en certaines contrées, des gens qui regardent le vendredi comme un jour néfaste, et qui évitent, ce jour-là, de rien entreprendre d’important. Quelle sotte superstition ! Nous, chrétiens, nous devons au contraire envisager le vendredi comme un jour de bénédiction, un jour porte-bonheur, puisque c’est le jour où Jésus a expié nos fautes et nous a rachetés de la mort éternelle. Répondons à l’appel de son divin Cœur, et accomplissons, le premier vendredi du chaque mois, la communion de réparation qu’il a formellement sollicitée de toutes les âmes pieuses. Faisons de ce jour, non pas une fête bruyante, mais une fête intime et très douce, une fête toute embaumée du souvenir ému des divines douleurs.
3° Enfin, j’interroge l’Eglise et je constate que, non seulement elle n’a pas séparé elle-même le culte du Sacré-Cœur du culte de la passion, mais qu’elle les a au contraire associés très intimement dans sa liturgie; car l’office et la messe du Sacré-Cœur sont calqués, d’un bout à l’autre, sur l’office et la messe de la passion.
Pour tous ces motifs et pour bien d’autres encore que je pourrais alléguer, il me semble qu’un monument au Sacré-Cœur ne sera pas déplacé au Calvaire de Pontchâteau. Le Bienheureux Père de Montfort, qui a composé de si beaux cantiques en l’honneur du Sacré-Cœur, sera réjoui, et nos pèlerins l’auront eux-mêmes pour agréable. Faut-il ajouter encore que cela ne changera rien à nos pieux exercices. A l’avenir, comme par le passé, nous ferons ici notre chemin de croix. Nous pleurerons sur Jésus avec Marie et les saintes femmes. Nous lui essuierons la face avec Véronique. Nous l’aiderons à porter le bois de son supplice avec le Cyrénéen. Nous tomberons à genoux près de Lui, quand nous le verrons tomber, pâle et sanglant, sur le sol rocailleux de Jérusalem. Nous regretterons nos fautes qui ont tant fait souffrir Notre-Seigneur. Bref, le chemin de croix restera pour nous la grande école de la sainteté ; nous y apprendrons les secrets qui élèvent et transfigurent la vie… Puis, l’âme tout embaumée du souvenir de Celui qui nous a aimés jusqu’à souffrir et mourir pour nous, nous jetterons les yeux sur le Sacré-Cœur ; et, dans ce Cœur, nous découvrirons l’amour qui explique Bethléem, Nazareth, le Calvaire, l’Eucharistie… En un mot, tout ce que Jésus a fait pour nous dans le temps et tout ce qu’il fera pour nous dans l’éternité. « Dieu, en effet, est essentiellement amour. Deus, Caritas est » ; et son divin Fils est descendu sur la terre pour y chanter un cantique nouveau, canticum novum : le cantique de l’amour. — Il nous disait à Bethléem et à Nazareth : « Caritate perpetua dilexi te. Je vous ai aimés d’un amour éternel ». Mais distraits et obtus, nous n’aurions pas compris suffisamment le langage du Berceau et de l’atelier, l’infirmité de l’enfant et le travail du jeune homme. Alors, Jésus monta sur la croix pour se faire entendre de plus loin, et des sommets du Calvaire, voilà dix-neuf siècles qu’il nous crie : « Caritate perpetua dilexi te. Je t’ai aimé d’un amour éternel. » A son amour, nous répondrons nous-mêmes par plus d’amour sincère et dévoué.
N° 12 Décembre 1920
Erection d’un nouveau Chemin de Croix dans la Chapelle du Pèlerinage
Il y a quelques années un brave chrétien qui visitait le Calvaire pour la première fois, témoignait son désappointement devant la pauvreté relative de la Chapelle du Pèlerinage. Il s’étonnait des chaises vermoulues, des confessionnaux bien pauvres, surtout du Chemin de Croix trop modeste en un lieu où les fidèles viennent glorifier la Passion du Sauveur.
– Est-ce que les pèlerins de France et de l’Etranger qui affluent ici chaque année seraient moins généreux qu’en d’autres lieux ?
– Non, cher ami, venez parcourir la lande de la Madeleine, vous serez convaincu… Et nous voilà de faire une visite complète…
– En effet, fit-il à notre retour, ces sanctuaires, ces groupes, ces grottes, ces monuments, le Calvaire… cela ne s’est pas construit tout seul, mais votre Chapelle…
— Oui, l’ameublement est imparfait… Croyez bien que les Directeurs y ont songé, le bon P. Barré le premier, mais l’œuvre capitale était en plein air…
*
Si je revoyais aujourd’hui mon homme, je le reconduirais non sans une certaine satisfaction dans notre Chapelle où il constaterait la réalisation de ses vœux.
1Plusieurs de ces courtes réflexions sont tirées d’un toast de M. l’abbé Richard.
Sans négliger le grand côté de l’œuvre — puisqu’on lui doit le relief central de la Scala, le beau monument de l’Assomption et la grandiose statue du Sacré-Cœur — le R. P. Ballu, Directeur actuel, a remplacé, pièce par pièce, une année, les chaises boiteuses, par des bancs solides et élégants, une autre année, les confessionnaux primitifs par d’autres, plus dignes et du sacrement qu’on y reçoit et du lieu saint où ils se trouvent.
Enfin, cette année-ci aura vu disparaître le Chemin de Croix insuffisant pour faire place à une série de tableaux artistiques1 dûment rehaussés par un cadre d’un beau chêne en harmonie avec le style de la Chapelle.
*
C’est le dimanche 7 novembre qu’eut lieu cette heureuse transformation. La date était toute indiquée : le Chemin de la Croix est tellement associé à l’idée de souffrance qu’il semble aux fidèles — et à juste titre l’exercice propre de ce mois de novembre que nous consacrons au souvenir des morts. C’est du reste, après le saint sacrifice de la messe, un moyen très efficace de venir en aide aux âmes du Purgatoire qu’un devoir de charité, un devoir de justice souvent, nous invite à secourir.
A la messe de onze heures, le R. P. Ballu avait rappelé ces pensées aux pèlerins venus encore une fois malgré les premiers froids de l’arrière-saison.
*
Ce noyau de fidèles, environ deux cents, joint aux communautés du Calvaire emplissait la Chapelle à 14 heures, moment fixé pour l’érection solennelle du nouveau Chemin de Croix.
Le directeur du pèlerinage entonna l’hymne Veni Creator après avoir fait remarquer à l’assistance que par ce chant solennel, l’Eglise nous indique l’importance et le respect qu’on doit attribuer à cette cérémonie.
Suivit la double bénédiction des tableaux et des croix auxquelles sont attachées les indulgences.
Tout le monde n’a pas, dans sa vie, l’avantage d’assister à cet imposant spectacle : on le voyait à l’attention soutenue, recueillie quoiqu’un peu curieuse par instants.
Le prêtre alla s’incliner par deux fois devant chaque station pour la bénir et lui présenter avec l’encens, nos hommages, et c’était fini…
*
Mais non ! Le R. P. Ballu prenant la parole rappelle avec chaleur le geste de foi des anciens Croisés, de ces guerriers fameux qui quittèrent leurs foyers, leur pays allant au loin, par-delà les mers, batailler pour leur foi : de ces soldats qui luttèrent vaillamment sous la conduite de Godefroy de Bouillon et, terribles, forcèrent enfin les portes de Jérusalem ; de ces chrétiens intrépides qui, à peine entrés dans la Ville Sainte, oublient qu’ils sont las, qu’ils sont victorieux, pour ne songer qu’à suivre les traces de leur Sauveur le long de cette Voie douloureuse qu’ils voyaient pour la première fois et qu’ils parcoururent les pieds nus, les larmes aux jeux.
A leur exemple, l’orateur invite la dévote assemblée à mettre à profit la faveur que l’Eglise vient de renouveler à notre Chapelle et d’« étrenner » le Chemin de Croix tout enrichi des bénédictions rituelles.
Les âmes du Purgatoire auront sans doute bénéficié de la ferveur qu’avait allumé dans chacun, l’unique circonstance.
Cette ferveur se soutint du reste jusqu’au bout et passa dans les chants du Te Deum et de la bénédiction du Très Saint Sacrement qui clôtura la cérémonie.
Désormais la Chapelle du Pèlerinage à un digne Chemin de Croix.
Louis Bellamy,
S. M. M.
N° 5 Mai 1921
Les travaux
Lecteurs de « L’Ami de la Croix » vous savez que nous avions entrepris dès novembre dernier un ouvrage considérable sur le flanc de la butte du Calvaire. Nous avons dit dans le dernier numéro de « l’Ami » le dévouement d’un homme tout adonné à l’œuvre. Mais l’entreprise dépassait les forces d’un seul. Aussi la pensée vint de renouveler (en petit) ce que le Bienheureux Père de Montfort, dès le début, et le bon Père Barré, avant la guerre, avaient fait (en grand l’un et l’autre), avec tant de succès : un appel à la foi toujours vivante des travailleurs de la contrée.
L’idée fit son chemin… puis rencontra des obstacles : Viendront-ils ? Il y a si longtemps qu’on n’a demandé personne : dix ans ! Le travail des champs va les retenir ! Les poilus n’ont pas la mentalité d’avant-guerre !
Eh bien, on verra ! Le 2e dimanche de carême, à la messe de 11 heures, l’Intérimaire lance l’annonce ; « On travaillera au nettoyage de la douve-sud, deux après-midi par semaine, le mardi et jeudi. Tous les braves gens des environs du Calvaire sont invités. L’invitation s’adresse à tous, jeunes et vieux. »
On attendit le résultat avec quelques soucis : « S’ils venaient tous, comment ferait-on ? Le chantier est restreint, les brouettes en petit nombre ! Oui, mais s’il ne vient personne ? Chacun peut compter sur son voisin. Il nous en faudrait pour le moins une bonne douzaine. »
Le mardi arriva. A deux heures, la cloche de la chapelle rappela que le Calvaire attendait les bonnes volontés : « Viendront, viendront pas ? » La seconde hypothèse semblait se réaliser quand on aperçut, entrant par les allées du pèlerinage, quelques anciens et quelques jeunes la pelle sur l’épaule. Ils furent bientôt une dizaine de nos plus proches voisins qui besognèrent avec cœur sous le soleil déjà chaud. C’était un commencement. Il fallait pourtant éviter le malentendu, l’incertitude, il fallait organiser un tour de rôle : « Allez à domicile, Père, faites la ronde dans les villages et vous verrez comme ces braves gens seront heureux de répondre à votre invitation. »
Ce conseil d’un connaisseur fut mis à exécution. « Partons donc en campagne ! N’était-ce pas la méthode de nos devanciers? » Si. Que de fois le Père de Montfort n’avait-il pas parcouru les villages avoisinants ! Le souvenir s’en transmet de génération en génération. Aussi quel bon accueil partout ! : « Mais oui, Père, « mais oui, on ira, bien sûr, demain après-midi, le gars y sera et le père aussi peut-être. Quel outil faudra-t-il emporter ? » « Pelle, pioche ou brouette, répond le Père. » « C’est bien, Père, on ira, à demain. »
La présence d’un prêtre chez eux, sous leur toit, leur causait de la joie. C’était une bénédiction du ciel. On faisait un brin de causette, pas bien longtemps parce que les étapes étaient nombreuses, puis une poignée demain et : « Au revoir, Père, faudra revenir nous voir. »
Le lendemain nous avions douze à quinze travailleurs des Métairies, de la Viaudière et de la Bernerais, de Travers, de Sabot-d’Or et de la Petite-Madeleine. Ces trois derniers villages avaient bougé avant l’invitation à domicile. En arrivant au chantier, j’entends ces volontaires : « Eh bien, Père, vous embauchez ? » — « Mais oui, poilus, on embauche tous les hommes de bonne volonté et vous en êtes ; vous n’avez pas l’air manchots ! »
D’anciens poilus (car il y en a quelques-uns, grâce à Dieu, qui sont revenus de la terrible guerre), d’anciens poilus, ça sait manier une pioche et une pelle et le secteur est calme… Alors on va abattre la terre !
Il s’agit de creuser la douve-sud et de transporter la terre pour élargir le passage qui relie la voie douloureuse au mont du Calvaire. Les pioches décollent la glaise à grands coups, les pelles chargent sans relâche et les brouetteurs n’ont pas le temps de chômer. « Hein, Jules, le travail marche? » Et lui, la sueur au front, se gratte la tête tout en cherchant la réponse : « Ben oui, ça va ! Ce sont des gars solides, mais moi, je ne bourderai pas non plus. »
Le soir, après quatre heures de travail qui en valaient huit, on se rassemble, on nettoie les outils, on reprend sa veste et on s’aligne pour se rendre à la chapelle au chant d’un cantique bien connu : « Priez pour nous, Bienheureux Montfort… »
Le salut du Très Saint Sacrement, c’est le merci du bon Dieu à tous nos travailleurs. Ils le chantent eux-mêmes et ils se sentent plus assurés de prier dans cette chapelle Celui pour qui ils ont travaillé volontairement sans attendre de récompense ici-bas.
Le mardi suivant le temps boudait : brouillard très épais, vent froid. « Bah ! le Père de Montfort nous donnera du soleil ce soir… on travaille à son Calvaire ! Allons toujours faire des invitations. » Toute la matinée fut remplie par ces visites où le missionnaire est reçu comme l’envoyé du bon Dieu. Dans la soirée on fut fidèle au rendez-vous. Jeunes et vieux de la Plaie et du Hinguais se dépensèrent sans relâche et eurent tôt fait de recouvrir de terre glaise les centaines de boîtes vides que M. Fulgence amenait avec sa « Bichette » et soit tombereau. On accorda les dix minutes de pause réglementaire pour se rafraîchir d’un verre de cidre et l’entrain reprit jusqu’à la fin de la journée que l’on termina à la chapelle comme la précédente. Le jeudi, ce fut le tour des élèves du Petit Séminaire. Les plus grands d’entre eux, témoins des travaux entrepris, avaient bonne envie d’essayer leurs forces. Ils osèrent le chu-chotter près de M. le Supérieur, qui ne crut pas que quatre heures de travail manuel, un jour de congé, seraient de nature à nuire aux santés ni aux études, bien au contraire ! ! !
Les voilà donc au chantier avec l’ardeur de la jeunesse, on répare d’abord le chemin des brouettes malencontreusement entamé la veille et bientôt la terre sort de la douve avec entrain et régularité. Ce fut une soirée de travail et de gaîté jusqu’au retour de promenade des plus jeunes que l’on rejoignit au chant du cantique : « Chers amis, tressaillons d’allégresse… » etc.
Le mardi de la 4e semaine de Carême, nous eûmes un fort contingent de la ferme Bodiau, de la Hersiais, du Rocher, de Cuhain, de Calac, du Buisson-Rond, de Montmarrat et de la Planche-Marion. Le chantier devint trop étroit. L’animation fut grande et les brouetteurs montrèrent la vigueur de leurs biceps et de leurs jarrets : grosses pierres et bonne mesure. Ils ont manqué de faire « bourder » Jules, le vaillant. Deux jours après, c’est le tour des braves de Beaulieu, de la Morissette, de Malabri ; de la Richardais, du Parc, de la Salmouette-Pie, de la Joubrais, de Belair, de la Grande-Madeleine. Le Buisson-Rond est représenté une seconde fois ainsi que Cailac, Cuhain, Candais, etc. Si j’en passe, ils me le pardonneront, mais le bon Dieu et le Père de Montfort à qui je les ai tous recommandés les auront bien distingués et auront pris bonne note de leurs noms.
1Ces tableaux, signés Luigi Morgari, sont riches de couleurs et réalistes la manière italienne mais sincères, pieux et fidèles à la vérité évangélique, sont des peintures sur toile.
Pendant tout le travail les cheveux grisonnants tinrent tête… aux jeunes qui fournissent une bonne besogne …! Braves chrétiens, eux aussi, qui remportèrent tout heureux à la maison la bénédiction du bon Dieu.
Jusqu’alors, le temps nous avait été favorable, mais le mardi suivant, le chantier était envahi par l’eau. La pluie n’avait guère cessé la veille. Aussi point d’invitation pour ce jour-là. Que ferait-on dans la glaise détrempée ?
Il vint cependant trois travailleurs, 2 de la Morissette et un de la Grande-Madeleine, et Jules, l’infatigable Jules, l’acharné Jules médisait le soir : « Hein, Père, j’ons ben travaillé à quatre ! » La bonne bouche était réservée aux jeunes gens du Petit Séminaire. Sacrifiant encore une fois leur promenade, ils vinrent piocher ferme au pied du Calvaire. Le Père de Montfort leur en saura gré. Eux-mêmes en garderont bon souvenir jusqu’au jour où ils pourront peut-être revenir à la tête de leur paroisse en pèlerinage. En attendant ils se sont acquis un titre à la protection de notre Bienheureux Père qui veillera sur leur chère vocation grandie à l’ombre de son œuvre.
Il les a bénis du haut du ciel comme tous les vaillants chrétiens qui se sont montrés fidèles aux traditions de foi chrétienne de cette contrée. Nous savions bien que l’on y garde un culte profond au Père de Montfort, mais ces travaux acceptés volontairement malgré les occupations multiples en sont une preuve de plus. Le Bienheureux Père de Montfort et son digne fils le défunt Père Barré doivent sourire à toute la région de voir qu’on tient toujours à leur œuvre.
Les plans ne sont pas tous remplis. La saison avancée nous oblige cependant à remettre à plus tard la continuation des grands travaux. Nous sommes assurés désormais que le jour où nous aurons besoin de bras vaillants, il nous suffira de faire un signe ; et la foi vive qui répond ainsi à notre appel n’est pas la chose la moins admirable d’un pays dont le Père de Montfort chantait :
« Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Que de conversions
De guérisons, de grâces sans pareilles
Faisons un Calvaire ici !
Faisons un Calvaire ! »
J. E. T.
N° 5 Mai 1922
Chronique du Calvaire
Chaque jour, surtout depuis le retour du beau temps, nous voyons avec édification des pèlerins isolés ou des groupes de pèlerins qui viennent remercier leur « bon Père de Montfort » de faveurs obtenues ou lui demander des grâces pour eux et leurs familles.
Pieusement ils visitent les Sanctuaires du Rosaire et font le Chemin de la Croix.
Toutefois nous devrons attendre la belle saison pour avoir le concours de peuple qu’elle amène chaque année sur notre lande de la Madeleine. C’est donc le moment de travailler à l’embellissement de l’Œuvre du Calvaire et c’est ce que font en ce moment les ouvriers, tailleurs de pierre, charpentiers et maçons.
Dans la bataille le général court au plus pressé et vole à la défense du point menacé.
Un examen attentif ayant relevé que le point menacé sur la lande dû Calvaire c’était le monument du Prétoire, nous avons dû laisser de côté pour le moment tout autre projet; et voilà pourquoi devant le Prétoire se dresse un gigantesque échafaudage — échafaudage qui fait honneur au talent de Monsieur V. Ricordel, de Pontchâteau et à l’habileté de ses ouvriers. Et l’échafaudage est construit de telle façon que le pèlerin n’est nullement gêné pour graver à genoux la Scala-Sancta et contempler les groupes si expressifs de l’Accusation, de la Flagellation, du Couronnement d’épines, de l’Ecce Homo et de la Condamnation à mort.
Tous les gens et pèlerins de goût déploraient que ce beau monument du Prétoire fut masqué par une ferme qui, bien que de modeste apparence, nuisait à la beauté de l’édifice. — Et de fait, cette maison placée presque en face du monument faisait l’effet d’une verrue sur un beau visage.
A quelque chose malheur est bon, dit un vieux proverbe. — Il y a quelques mois un incendie dévorait une partie de la ferme et, par- là, a hâté sa disparition complète.
On la démolit en ce moment et dans quelques semaines le monument consolidé et rajeuni apparaîtra dans toute sa beauté architecturale.
Près de l’hôtellerie du pèlerinage, une série de petits édifices forts utiles et depuis longtemps désirés des pèlerins est également en construction.
N° 6 Juin 1922
Chronique
Le temps pascal n’a pas été, cette année, le temps des belles et agréables promenades et n’a point par là même favoriser les pèlerinages au Calvaire. La pluie tombait tous les jours et en abondance. Le vent qui, sans obstacle, nous arrive de la mer, la grande mangeuse d’hommes, comme dit le barde breton, soufflait en tempête et menaçait de tout emporter. Pourtant les arbres de nos allées ont tenu bon ; pas un seul n’a été brisé, pas un seul n’a été jeté par terre. Tous « ont tenu », preuve qu’ils sont de bonne qualité, et je sais un habitant des environs du Calvaire qui, les voyant résister aux plus rudes assauts, a dit : rien d’étonnant, nous les avions si bien plantés… au chant des cantiques et des Ave Maria.
… Pendant ce temps les ouvriers continuaient leur travail de restauration ; sous l’action du ciseau la pierre reprenait sa blancheur d’il y a 30 ans ; les joints étaient refaits et la veille de la fête nous avions la joie de voir disparaître les échafaudages qui auraient bien un peu gêné pour les cérémonies du 28 avril.
N° 1 Janvier 1923
Les travaux
Malgré tout ce que l’on avait fait pour empêcher la pluie de pénétrer dans la chapelle de la Visitation et les grottes de Nazareth, de Bethléem et Gethsémani, cette « indésirable » trouvait moyen de passer et de causer des ravages. Le dôme de la Visitation est maintenant revêtu d’un manteau de plomb fabriqué par M. V. Ricordel, de Pontchâteau. Le monument aura plus bel aspect. Les cataractes du ciel peuvent s’ouvrir, le déluge peut venir, le voilà pour longtemps à l’abri et l’intérieur du sanctuaire remis à neuf ne présentera plus sur ses murs ces petits sillons désagréables que la pluie y creusait, — bizarres cartes de géographie que nous ne regrettons pas. — Sur les grottes, une charpente habilement disposée par notre menuisier, M. Bidet, du Calvaire, soutient de grandes plaques ondulées, dites Everite, de 3 et 4 mètres de longueur et là aussi la pluie sera bien habile, si elle réussit à s’introduire et à menacer encore la solidité des voûtes.
Pendant que s’accomplissait ce beau travail, deux maçons, très dévoués également au Calvaire, MM. Belliot et Thoby, faisaient des conduits en ciment pour l’écoulement des eaux tombant sur ces plaques ondulées. Un soir, avec leur concours, nous nous ingénions à hisser jusque sur la grotte de Bethléem une pierre d’un poids considérable. Deux jeunes gens du voisinage viennent à passer avec un charriot que traînaient deux-bœufs d’un pas tranquille et lent. Un coup de main, s’il vous plaît, les amis ! Les bœufs s’arrêtent et restent à la garde du bon chapelain si connu et si estimé de tous, M. l’abbé N…
Celui-ci, tout en demeurant au poste qu’il s’est prudemment assigné, encourage du geste et de la voix ; et l’énorme caillou soulevé par des bras vigoureux est vite rendu à sa place, au cri si souvent poussé jadis en ce même endroit par le P. Barré : Oh ! hisse !
An remerciement qui suivit, les jeunes gens répondirent : « C’est pour le Père de Montfort ». Non, ici on ne sait rien refuser au Père de Montfort.
Nous l’avons bien constaté encore, le mardi 5 novembre.
La paroisse de Saint-Guillaume. — Le dimanche précédent, au prône de la grand’messe, M. le curé avait convoqué ses hommes et jeunes gens à venir donner au Calvaire une journée de travail. Ils n’ont point manqué au rendez-vous. Pasteur en tête, ils sont arrivés au Calvaire, au jour fixé, avec pics, pelles ou tranches sur l’épaule. — Sur une bonne longueur, ils ont débarrassé la voie douloureuse des ronces et mauvaises herbes qui l’envahissaient avec une impétuosité désespérante ainsi que des trop grosses pierres qui l’encombraient. Le petit chemin de fer Decauville, utilisé si avantageusement autrefois, fut sorti de la cachette où il dormait rongé petit à petit par la rouille ; placé le long de la voie, il fut bien étrenné. Quel plaisir pour les jeunes de 13 et 14 ans ! Nous ne dirons pas que tout incident fut évité. Le terrain en pente se prêtait aux déraillements, étant donné surtout la bouillante ardeur de la jeunesse de Saint-Guillaume, mais les wagonnets étaient vite remis sur rails, et en avant ! Roule, roule, petit chemin de fer. Ce fut une bonne journée. Aussi le soir venu, le directeur ne manqua pas d’adresser à ses braves travailleurs, au moment de la bénédiction du Saint-Sacrement, un cordial merci pour cette première journée de travail. Tous, avant de regagner leur demeure, inscrivirent leurs noms sur le livre d’or des travailleurs du Calvaire.
Mais si les jeunes de St-Guillaume fuient particulièrement heureux en ce jour de travail, il est un vieux pépère — je dis vieux car je le juge sur les apparences — qui le fut plus qu’eux tous ensemble. C’est l’homme du Calvaire, vous savez, Jules Letylly dont je vous ai esquissé la silhouette il y a quelques mois. Il s’est cru revenu au temps du P. Barré, j’ai retrouvé mon chemin de fer, dit-il maintenant à tous ceux qu’il rencontre ; c’est comme au temps du P. Barré. Roule, roule, mon petit chemin de fer ; c’est pour le Père de Montfort.
N° 2 Février 1923
Chronique du mois
Bravo ! vous avez recommencé au Calvaire les travaux d’autrefois. Voyez comme vous avez eu raison de compter sur la fidélité et le dévouement de nos populations. Voilà ce que nous ont dit plusieurs voix autorisées.
Et de fait, toutes les paroisses convoquées ont répondu avec un élan magnifique à l’appel qui leur a été fait, et ils ont repris le refrain de Montfort, vieux de deux siècles mais toujours d’actualité :
Allons au Calvaire, allons,
Allons au Calvaire,
Travaillons tous à ce divin ouvrage :
Dieu nous bénira tous.
Il ne s’agit plus, comme il y a vingt-cinq et trente ans, de remuer d’énormes pierres ; les blocs géants sont toujours là à leur poste et continue de faire l’admiration des touristes et amateurs de choses extraordinaires.
Mais un ouvrage de cette importance demande à être entretenu et perfectionné et pour cela le concours de nombreux ouvriers est absolument nécessaire.
Ils sont venus les travailleurs du Père de Montfort : ils ont travaillé ferme et nous serions bien embarrassés s’il nous fallait décerner un premier, second et troisième prix d’excellence.
Un jour que les généraux grecs demandaient qui avait le plus contribué à la victoire de Salamine, chacun d’eux s’attribuait modestement la palme, mais donnait ensuite sa voix à Thémistocle. L’histoire en a conclu que Thémistocle avait été le vrai héros de Salamine. Ferait-il un jugement téméraire celui qui affirmerait que chaque paroisse consultée à dix lieues à la ronde s’adjugerait le premier prix et se mettrait au premier rang des paroisses dévouées au Calvaire du Père de Montfort? Cette belle émulation les honore grandement et ne peut qu’attirer sur ces paroisses la protection du grand bienfaiteur de la contrée.
Drefféac, 13 décembre. — C’est la deuxième journée des travailleurs. En tête de ses paroissiens, le dévoué pasteur, M. Patron, qui, toute la journée, a, comme ses paroissiens, travaillé à remuer terre et cailloux. Les voilà à la besogne et pas n’est besoin de stimuler leur ardeur. Quel est donc celui-ci qui arrive après tous les autres ? c’est un jeune homme qui, obligé, ce jour-là, d’aller jusqu’à Saint-Nazaire, a si bien fait diligence qu’il peut fournir encore une bonne demi-journée de travail. N’est-ce pas beau et méritoire ?
Le Père de Montfort chantait :
Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous,
Grands et petits, de tout sexe et de tout âge.
Ils sont là en grand nombre les petits de Drefféac, les jeunes de douze à quinze ans. Mais qu’ils sont intrépides à la besogne ! Une double voie est établie, chaque voie à son équipe, En un instant, les wagonnets sont chargés et… en route ! et attention ! ce n’est pas un train de marchandises, c’est un express qui file à toute vitesse. Pauvres wagonnets, ils en ont vu de rude ce jour-là encore ! Quel entrain et quelle vigueur dans ces gars de Drefféac !
J’avais l’âge de ces petits, disait un vieillard, quand, pour la première fois, je suis venu travailler au Calvaire, voilà de cela plus de cinquante ans. A part la montagne du Calvaire, il n’y avait pas un arbre là où nous voyons aujourd’hui ces belles avenues ; partout de la lande et des cailloux, quelle transformation !
Cette transformation, mais c’est vous qui l’avez opérée, brave vieillard, vous et tous vos pareils à dix lieues à la ronde. Au nom du Père de Montfort, merci.
Crossac, 14 décembre. — La paroisse de Crossac est, dans le bon sens du mot, la paroisse gâtée par le Père de Montfort, il n’est point de paroisse, en effet, où il ait répandu tant de grâces, obtenu tant de faveurs et opéré tant de guérisons depuis l’époque de sa Béatification (1887). Les habitants de Crossac ne l’oublient pas. Tout le monde connaît leur dévouement pour le Calvaire et si les gens de la contrée avaient à exprimer leurs suffrages sur cette question, ils s’adjugeraient sans doute à eux-mêmes le premier prix comme il est dit plus haut et s’accorderaient vraisemblablement à donner le second à Crossac. Mais chaque paroisse n’ayant que sa seule voix pour s’adjuger le premier, n’en faudrait-il pas conclure que ce premier prix revient de plein droit à la paroisse de Crossac ?
Quoiqu’il en soit de ce débat, le travail de la réfection de la Voie Douloureuse a été vigoureusement poussé ce jour-là. Le temps était sombre, un épais brouillard a, tout le jour, enveloppé la colline, mais tout cela n’a pas empêché l’entrain et la bonne humeur.
Monsieur le Curé qui, tout le jour, resta au milieu de ses paroissiens, fut heureux de leur donner au départ la bénédiction du Saint-Sacrement. Le soir, près de cent noms étaient inscrits au livre d’or des travailleurs du Calvaire.
Pontchâteau, 19 décembre. — La veille de ce jour, le vent soufflait en tempête, la nuit fut affreuse. Par un temps pareil il n’y a pas à compter sur les travailleurs de Pontchâteau : c’est le jour fixé, mais ils ne paraîtront pas. Ah ! on voit que vous ne les connaissez pas, les habitants des villages avoisinant le Calvaire. Ne pas venir, eux, parce que, le matin, des nuages chargés de pluie se promènent lentement dans l’atmosphère 1 mais ils ne seraient plus les dignes fils de ceux qui, en plein été, vinrent à l’appel de Montfort édifier le célèbre Calvaire de la lande de la Madeleine. Dès 8 heures, au bas de la colline on entend le bruit d’un lourd camion. Quoi ! un camion ! Eh oui, c’est sans nul doute le premier camion volontaire servant aux travaux du Calvaire, et nous n’avons pas à regretter sa présence. A chaque tour il nous amena près de 10 tonnes de gravier. Toute la journée, malgré le chemin détrempé par la pluie des jours précédents il fit la navette entre le Calvaire et la carrière de Bodis, où M. Lucas-Bretéché nous a si gracieusement permis de puiser.
Merci à M. Lucas que nous compterons désormais parmi nos bienfaiteurs ; merci à M. Mercier, commerçant à Pontchâteau, pour nous avoir si aimablement envoyé son camion.
En cette journée tous les moyens de transports, anciens et nouveaux, furent utilisés, des tombereaux fournis par nos plus proches voisins rivalisèrent d’entrain et de nombreuses charretées de gravier furent amenées sur la Voie Douloureuse. Depuis la route de Crossac jusqu’au Calvaire une allée nouvelle fut tracée sous la direction de M. le Doyen venu dès la première heure encourager ses paroissiens, une tranchée fut creusée et des arbustes y furent plantés ; puis, on procéda au nivellement du terrain de façon à ne faire des deux allées qu’une seule allée, avec, au milieu, les arbres verts où les pèlerins seront protégés contre les ardeurs du soleil pendant l’exercice du chemin de la Croix.
M. le Doyen, accompagné de ses deux vicaires, n’a quitté le Calvaire qu’après avoir béni ses paroissiens, lesquels se montraient heureux d’avoir travaillé pour « leur Père de Montfort ». Ils le revendiquent en effet, comme leur Père et Bienfaiteur ; c’est leur gloire la plus pure et la meilleure : aussi est-ce avec bonheur que, le premier dimanche de janvier, ils ont entendu leur bon Doyen annoncer une cérémonie en l’honneur du Bienheureux : la bénédiction d’une grande et belle statue dans leur église paroissiale ; statue semblable à celle de la chapelle du Calvaire.
Si donc le Père de Montfort trouve de l’indifférence chez quelques Pontchâtelains à l’égard de son Calvaire, c’est l’exception, et hâtons-nous de le dire, il trouve chez d’autres de beaux actes de dévouement. Ecoutez plutôt : Je viens, nous dit, dès le matin, un des travailleurs de cette journée, un homme étranger à la paroisse, je viens de la part de Monsieur Un Tel. Empêché de venir et surtout ne s’entendant guère à manier pics, pelles et pioches, il m’envoie le remplacer et se charge de me défrayer de ma journée. Deux autres nous dirent à nous-mêmes : « nous ne pourrons aller, car la besogne presse et notre métier nous appelle ailleurs, mais nous ferons une offrande représentant une journée de travail ». Cette délicatesse nous a vivement touchés. Mais voici mieux encore :
Dès la première heure de cette journée qui s’annonçait maussade et pluvieuse, nous avions remarqué deux jeunes gens dont la figure annonçait assez qu’ils s’étaient, jusqu’à ce jour, plus penchés sur les livres que sur les outils, et sans nul doute leurs mains blanches avaient manié la plume beaucoup plus que la pelle et la bêche.
Braves jeunes gens, n’allez pas si fort pour commencer, vous ne tiendrez pas ; ils tinrent jusqu’au bout comme de vieux terrassiers, et nul, ce nous semble, ne trouvera mauvais que nous les citions à l’ordre du jour de l’armée des travailleurs avec MM. Mercier et Lucas : les fils Juhel et Dréno.
Sainte Reine, 27 décembre. — C’est là, tout près de l’église de ce nom, que le Père de Montfort avait tout d’abord projeté d’édifier son gigantesque Calvaire et pour le faire renoncer à ce lieu, il fallut le prodige suivant.
Le Père de Montfort avait réuni ses travailleurs à la chapelle et ensemble ils avaient prié.
Groupés autour du bon Père ils n’attendaient plus que le signal pour continuer le travail commencé depuis deux ou trois jours. Soudain, sur le monticule déjà formé apparaissent deux blanches colombes. On les voit un instant becqueter cette terre fraîchement remuée, ou plutôt en remplir leur bec et s’envoler à tire-d’aile, Mais c’est pour reparaître bientôt sur le monticule, remplir de nouveau leur bec, et s’envoler dans la même direction, une seconde, une troisième, une quatrième, une dixième fois. Cependant on a suivi attentivement le vol des colombes mystérieuses. Bientôt ont pu constater qu’il s’arrête au point le plus élevé de la lande de la Madeleine, non loin de la lisière de la forêt.
On les y a suivies, et à l’endroit même, d’où, après s’être reposées un instant, elles reprennent leur vol, une dernière fois, pour ne plus reparaître, on voit, pour employer l’expression des pieux travailleurs, toute une nichée de terre fraîchement déposée sur la lande desséchée. Montfort ne doute plus de la volonté du ciel. Ce jour-là même il trace trois grands cercles concentriques, l’un de quatre cents, le second de cinq cents et le troisième de six cents mètres. Le premier marque la base de la montagne qu’il a en vue. Entre le second et le troisième, on va creuser un vaste fossé, et toute la terre qui en sera extraite formera la montagne elle-même. Plan aussi simple que grandiose. A partir de ce moment, les ouvriers volontaires affluent autour de Montfort. On travaille avec une ardeur incroyable, au chant des cantiques et en récitant le Rosaire.
Grâce à ce prodige les habitants de Sainte-Reine ne gardèrent point rancune au saint missionnaire d’avoir renoncé à édifier chez eux son Calvaire. Bien plus, ils lui prêtèrent le concours le plus empressé. Les petits-fils et arrière-petit-fils ressemblent à leurs ancêtres et le 27 décembre, sur l’invitation faite par le pasteur, le dimanche précédent, ils vinrent en grand nombre. Huit tombereaux déchargent du gravier, tandis que des bras vigoureux s’attaquent aux troncs d’acacias qui émergent entre les allées et qu’il faut enlever. Mais voici que la pluie se met à tomber et oblige à cesser le travail. En attendant le retour du beau temps, allons dîner, bien qu’il ne soit pas encore midi. Le modeste repas est terminé : voici une éclaircie : vite à l’ouvrage. Ce ne fut pas long. La pluie recommença à tomber drue, incessante, impitoyable. Les braves gens ! ils restaient là sous la pluie continuant à piocher. Ils tenaient bon, comme ils avaient tenu pendant la guerre sous les bombes et la mitraille. Mais enfin sur l’ordre donné, ils battirent en retraite et après avoir reçu la bénédiction du Saint-Sacrement et invoqué le Père de Montfort, retournèrent tout trempés de pluie à leurs demeures mais heureux d’avoir travaillé pour le Père de Montfort qui ne peut manquer de les bénir.
Missillac, 2 janvier 1923.
Un Dieu brise nos chaînes :
Que ferons-nous à notre tour?
Portons-lui pour étrennes
Des cœurs brûlants d’amour.
C’est ce qu’ont répété les habitants de la grande et belle paroisse de Missillac. L’amour se prouve par les actes plus que par les paroles, il y a tant de gens à qui les belles paroles ne coûtent guère, mais qui s’en tiennent toujours aux paroles sans en venir aux actes. Le premier janvier, c’était fête chômée, et dès le lendemain ils venaient donner au Calvaire les prémisses de leur travail de l’an de grâce 1923. S’ils travaillent toujours ainsi et dans les mêmes sentiments l’année sera bonne et pleine de mérites, car ce 2 janvier fut une bonne journée. »
Une douzaine d’hommes s’en prennent aux vieux troncs d’acacias que faute de temps pour en venir à bout, les gens de Sainte-Reine avaient abandonné. Il suffit de les considérer un instant pour deviner en eux des hommes habitués au rude métier de bûcherons. Une fois le tronc dégagé, ils l’enlacent dans une forte chaîne de fer, et munis d’un levier exécutent un mouvement tournant. Le tronc s’agite lentement, tourne sur lui-même, les racines se tordent et l’arbre cède. Tout-à-coup, en un clin d’œil, les voilà parterre, couchés les uns sur les autres. Que s’est-il passé ? vous n’avez pas de mal au moins, les amis ? Non, non, rassurez-vous. C’est tout simplement un chaînon qui s’est brisé sous l’effort. Des femmes ainsi projetées auraient poussé des clameurs ; eux, pas un mot, ils se relevèrent tranquillement, se talent bien un brin, pour constater qu’il n’y a pas d’autre brisure que celle de la chaîne, puis, se remettent à l’ouvrage. Mais l’équipe la plus nombreuse fut occupée à creuser une tranchée tout le long de la Voie Douloureuse et le soir, avant de partir, ils eurent, les braves travailleurs, la satisfaction de planter quelques arbustes verts derrière les premières stations, et de même qu’ils disent : c’est nous qui avons amené et placé la grosse pierre qui se trouve à tel endroit, de même, ils diront et rediront à leurs fils et petits-fils, c’est nous qui avons planté ces arbres. Montfort aussi s’en souviendra et bénira les fils comme il a béni les pères.
Le P. Barré écrivait dans l’Ami de la Croix de novembre 1898 : « Quant à la Voie Douloureuse nous allons la modifier suivant les désirs que j’entends exprimer de toutes parts.
Les cailloux seront remplacés par du sable rouge. Nous aurons ainsi une triple voie avec quatre rangées d’arbres. Je crois que le coup d’œil n’y perdra rien.
Mais ce sera surtout beaucoup plus commode pour les foules faisant l’exercice du chemin de la Croix. »
Le projet du P. Barré est enfin, après plus de vingt ans, mis à exécution. Il est vrai, le sable apporté n’est pas d’un rouge écarlate, mais au moins on ne verra plus ces amas de cailloux qui présentaient à la surface les plus rugueuses aspérités. Quelques-uns sans doute regretteront la disparition de ces cailloux, disant comme je l’ai entendu moi-même que ces cailloux représentaient au naturel les rues mal pavées de Jérusalem. Que les rues de Jérusalem au temps de Notre-Seigneur Jésus-Christ fussent mal pavées, il est permis d’en douter. Jérusalem comme toute la Judée, était alors sous la domination des Romains et les Romains, bons ingénieurs, connaissaient l’art de faire de belles routes, ces routes appelées voies romaines, voies si solides qu’elles ont résisté au temps et dont on trouve encore de nombreux vestiges en notre pays, notamment tout près du Calvaire et de la forêt de la Madeleine.
N° 3 Mars 1923
Les travaux
Pendant ce mois les travaux du Calvaire ont fait un véritable progrès. Les marches de la montée du Calvaire ont été refaites de façon à faciliter l’ascension de la sainte montagne. Sous la direction de l’infatigable abbé Guitton, et avec l’aide de nos deux fidèles ouvriers, Pierre Belliot de Missillac et Henri Thoby de la Chapelle-des-Marais, la voie qui contourne les trois croix au sommet du Calvaire a été élargie. Ce fut une opération difficile et dangereuse. Il s’agissait de déplacer d’énormes blocs de pierre et de les avancer aussi loin que le permettaient les assises placées en-dessous. Le moindre mouvement violent, un coup donné mal-à-propos pouvait précipiter dans le vide le rocher auquel on s’attaquait. Grâce à Dieu et au Père de Montfort qui veillait sur ses travailleurs, il n’y eut pas le moindre accident, pas la plus petite égratignure. Reconnaissance au Père de Montfort et félicitations aux travailleurs pour leur habileté et leur dévouement.
La plateforme elle-même devant la douzième station, sans perdre sa forme primitive, a subi une légère modification, et désormais la foule pourra s’y tenir et s’y mouvoir sans crainte de chute, d’entorse et de contusion.
Nommons maintenant les paroisses généreuses qui ont pris part aux différents travaux de la Voie Douloureuse et du Calvaire.
Lundi 15 janvier. — La Chapelle-des-Marais est sise le mot le dit assez — au bord de l’eau. En ce moment de pluie abondante, on n’y voit guère que des îlots entourés d’eau. Aussi le travail des champs y est presque nul, il faut aller chercher ailleurs de la besogne. Hélas ! à l’heure actuelle, c’est le chômage forcé : les usines de Saint-Nazaire et de Trignac se sont vues obligées de congédier bon nombre de leurs ouvriers, n’ayant plus de travail à leur fournir. Bienheureux Père de Montfort, trouvez du travail à ces braves gens, qui, à (‘encontre de tant d’autres, chevaliers du soleil, ne demandent qu’à travailler et à gagner honnêtement leur vie et celle de leurs nombreuses familles.
Bien que ce fut jour de foire à Pontchâteau, plus de 60 hommes de la Chapelle sont venus le 15 janvier au Calvaire. Quelques-uns ont fait à pied onze et douze kilomètres, et l’on nous a signalé un vieillard de 78 ans, éloigné du Calvaire de douze kilomètres, qui, pour arriver dès le commencement du travail, est parti à pied de chez lui à cinq heures du matin. N’est-ce pas admirable ? Il n’y a que la foi et le désir de plaire à Dieu qui puissent inspirer de pareil dévouement.
L’aimable et dévoué curé de la paroisse ne quitta pas une minute ses braves paroissiens. Ce fut une journée pleine d’entrain. Ayant achevé d’extraire les dernières souches qui encombraient la double allée qui monte au Calvaire, ils eurent la satisfaction de planter de jeunes troènes sur une longueur de 100 mètres environ, et nous espérons bien que ces jeunes plants formeront dans quelques années une belle haie le long de la voie douloureuse.
En résumé, très bonne journée de travail ; aussi un vieux poilu disait le soir avec fierté et en toute vérité : « C’a bien marché, parmi nous il n’y a pas eu un seul « tire au flanc. »
Besné. — Mercredi 17janvier. —C’est le jour de Besné: ce matin-là nous eûmes l’agréable surprise de voir nous arriver de cette paroisse un bon groupe de femmes et de filles, car nous ne comptions que sur des hommes : « Monsieur le Directeur, nous n’avons point apporté d’instruments, mais nous allons bien travaillé quand même ; avez-vous de l’ouvrage à nous donner, sinon nous allons faire notre chemin de croix et retourner chez nous. » Vite on se mit en quête de petits paniers pour monter du gravier au Calvaire. Mais malgré les recherches on ne trouva trace des fameux paniers du P. Barré ; tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse ; de même les paniers du P. Barré ; ils ont fait tant de fois l’ascension du Calvaire, chargés de terre et de cailloux, que leurs débris ont dû subir l’épreuve finale à laquelle ils n’ont pas résisté : l’épreuve du feu ; on s’ingénie donc à trouver autre chose : seaux, caisses en bois, etc., et le soir venu, une bonne couche de gravier couvrait la montée du Calvaire jusqu’à la grotte d’Adam et en facilitait l’ascension.
Le travail des hommes ne le céda point à celui des dames et demoiselles de Besné : ce fut une belle et légitime émulation. M. l’abbé Gasnier, ancien professeur à l’école du Calvaire, vicaire à Besné, représentait M. le curé. De la première heure à la dernière, il prit part aux travaux et paya largement de sa personne.
Saint-Roch. — Mardi 23 janvier. — Des voix mâles, fortes et bien timbrées, résonnent au sommet de la colline sur la route de Pontchâteau au Calvaire. Que chantent ces voix ? Ecoutez :
Chers amis, tressaillons d’allégresse.
Nous avons le Calvaire chez nous :
Courons-y, la Charité nous presse ;
Allons voir Jésus-Christ mort pour nous.
C’est Besné qui nous arrive, le pasteur est en tête et guide son nombreux bataillon de travailleurs ; nombreux, en effet, très nombreux même, et si l’on tient compte du chiffre de la population, nous devons dire à l’honneur de Saint-Roch, que pas une paroisse encore n’a fourni pareil contingent. Honneur à la paroisse de Saint-Roch !
On nous avait dit : à Saint-Roch, tout le monde chante à l’église, hommes et femmes, jeunes et vieux. Nous nous en serions douté rien qu’à entendre les chants qui, ce jour-là, ont retenti sur la lande et à la Chapelle au salut du Saint-Sacrement. Le matin ils avaient traversé la ville de Pontchâteau, en chantant : « Chers amis, tressaillons d’allégresse, nous avons le Calvaire chez nous : courons-y », et les habitants delà petite ville sortaient sur leurs portes pour voir passer ces braves, pelles et pioches sur l’épaule, et entendre ces voix qui chantaient si fort et si bien.
Le soir, ils avaient remonté la colline et disparu à l’horizon qu’on les entendait chanter encore ce cantique de Montfort :
Pour aller à Jésus, Allons, chrétiens, allons par Marie.
En toute vérité le pasteur de Saint-Roch peut être fier de ses paroissiens ; à lui et à ses ouailles cordial merci et vives félicitations.
Saint-Joachim. — Jeudi 25 janvier. — A l’exemple du P. Barré, ne ferez-vous pas appel aux femmes, ne les inviterez-vous pas, elles aussi, à venir travailler au Calvaire ? Plusieurs fois cette question nous avait été posée ; on devine par qui. Or, on vient de le voir par le compte-rendu ci-dessus, les chrétiennes de Besné étaient venues sans convocation spéciale. S’adressant à ses paroissiens le pasteur avait dit simplement : Nous sommes invités à un pèlerinage de travail au Calvaire le mardi 23, et elles étaient venues, elles aussi ; elles firent bien ; elles nous décidèrent à lancer un appel aux travailleuses.
Retenus par les travaux de l’usine et de l’atelier, les hommes de Saint-Joachim sont dans l’impossibilité de s’absenter une journée entière ; les femmes sont plus libres de leur temps et, tout le monde le sait à dix lieues à la ronde, les femmes de Saint-Joachim valent les hommes, je ne dis pas seulement en piété, ce serait un piètre compliment, mais en fait de travail. Elles l’ont prouvé bien des fois au Calvaire depuis 30 ans. Elles l’ont montré une fois de plus dans la journée du 25 janvier.
C’était un intéressant spectacle que celui de ces paniers — chacune avait apporté le sien — passant rapidement de main en main, puis, soulagés de la terre qu’ils contenaient, redescendant plus rapidement encore ; et la manœuvre se renouvelait sans interruption.
Inutile de dire que la journée fut un peu plus bruyante, moins silencieuse que de coutume, sur la lande de la Madeleine, en cette saison d’hiver. Ce n’est certes pas un reproche que nous voulons faire ici. Car si les travailleuses du 25 janvier usèrent largement de leur langue et de leur voix, ce fut surtout pour redire et redire encore les louanges de Jésus crucifié, de Marie et de leur pieux serviteur, Montfort.
La plupart firent à pied le trajet, aller et retour, même les jeunes de 12 à 13 ans, et ce soir-là, j’imagine, les mamans ne durent point user d’autorité pour obliger ces dernières à aller prendre un repos bien mérité.
31 janvier. — Depuis la reprise des travaux, c’est la première paroisse du Morbihan qui nous apporte son précieux concours.
La tradition rapporte que c’est du grand village de Burin, actuellement de Saint-Dolay, mais alors de Missillac, que fut amené le chêne qui fit la première Croix du Calvaire, la Croix qui reçut le beau Christ du Bienheureux. Est-ce le Bienheureux lui-même qui choisit cet arbre ? L’histoire est muette sur ce point, elle nous dit seulement que c’était le plus bel arbre de la contrée et qu’il fallut douze paires de bœufs pour le traîner au Calvaire. Comment s’étonner que Saint-Dolay ait toujours été rangée parmi les paroisses les plus dévouées au Calvaire ?
Bon nombre sont venus à pied, quelques-uns en voiture, et la jeunesse en vélo ; nous ne saurions parler de l’activité et du dévouement des travailleurs sans nous répéter. Disons seulement que nous avons eu la joie de compter parmi les travailleurs leur dévoué pasteur, M. l’abbé Haguet, et le premier magistrat, M. le Maire, car Dieu merci, à Saint-Dolay, l’accord est parfait entre autorité civile et religieuse. Fendant la journée, mais surtout au salut du Saint-Sacrement, les chants furent fort bien exécutés.
Heureux les pasteurs dont les paroissiens chantent ainsi à l’église les louanges du Seigneur.
Nous n’avons rien dit encore de nos bons voisins du Calvaire qui, à plusieurs reprises, sont venus avec leurs charrettes et ont permis aux gens de Besné, Saint-Roch et Saint-Dolay, de pousser activement les travaux.
Après avoir été à la peine, ils ont bien mérité d’être à l’honneur :
C’est tout d’abord la famille de Mgr Guyot, évêque de Colombie, qui a donné trois journées ; puis, de la même paroisse de Saint-Guillaume :
Les familles Privet, du petit Buisson-Rond,
« « « Rialland « « «
« « « Lebeau « « «
« « « Privet, de la Bernerais,
« « « Joalland, de la Plaie,
« « « Chedotal « « «
De Pontchâteau :
« « « Le Thiec, de Terre-Neuve,
« « « Trouillard, du Haut-Bodio,
« « « Ramette, de la Joubrais,
« « « Thomas, du Bey,
« « « Poulard, du Montmara, en Sainte Reine.
Travaillons tous à ce divin ouvrage ;
Dieu nous bénira tous ;
Grands et petits, de tout sexe et tout âge.
Du haut du ciel où il règne dans la gloire, Montfort peut voir comment cette invitation qu’il faisait entendre, il y a plus de deux cents ans, sur notre lande, y est encore accueillie. C’est avec le même empressement que tous, grands et petits, y répondent.
Aujourd’hui, 30 janvier, aucune paroisse n’est convoquée, et pourtant quel est ce mouvement du côté du Saint Sépulcre ? car il y a du mouvement, de ce côté-là, beaucoup de mouvement même.
Ce sont des petits plutôt que des grands. Mais qu’ils paraissent intrépides à la besogne ! Et quels sont-ils ? Ce sont les élèves de l’Ecole du Calvaire. — Travailler au Calvaire, avoir leur journée ou du moins une demi-journée, est une faveur plus estimée que n’importe quelle promenade, n’importe quel congé. Aussi, s’en donnent-ils à cœur joie, les braves enfants.
Sous la garde vigilante de M. l’abbé Malenfant qui, à l’exemple du divin Maître, manifeste une prédilection toute spéciale pour les enfants, les vagonnets se chargent, puis roulent avec une telle rapidité que leur chef d’équipe improvisé croit devoir de temps en temps modérer l’ardeur juvénile de ses élèves d’un jour, et sa claire voix retentit à tous les échos : attention ! pas si vite ! Arrivé à l’endroit voulu le vagonnet est déchargé, puis retourne plus vite encore qu’il n’était venu, recevoir un nouveau chargement.
A voir la bonne volonté et l’ardeur de ces jeunes enfants, on sent bien qu’ils entendent la voix de Montfort : Travaillons tous à ce divin ouvrage, et qu’ils veulent être du nombre de ceux dont il disait : Dieu nous bénira tous, et qu’ils ont même l’ambition d’être des privilégiés parmi ces bénis.
Ils le seront, nous en avons la douce confiance : bénis dans le cours de leurs études, bénis quand ils auront le bonheur de monter au saint autel et de prêcher comme Montfort la Croix et le Rosaire, Jésus crucifié et Marie, sa divine Mère.
N° 4 Avril 1923
Chronique
Il voyait dans l’avenir, assurément, ces prières si nombreuses et si ferventes faites les bras en croix sur de pèlerins à peine interrompu même pendant la saison d’hiver, le P. de Montfort, quand il disait de son Calvaire de Pontchâteau :
Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Certes, il est d’autres sanctuaires qui voient les mêmes fêtes qu’ici, les mêmes foules pieuses agenouillées, priant et chantant, mais il est un point au sujet duquel aucun autre sanctuaire, aucun autre rendez-vous de dévotion et de prière ne peut être comparé à notre Calvaire : c’est ce merveilleux concours de travailleurs volontaires. Des milliers d’hommes et de femmes de toute condition, mais pour le très grand nombre de la condition de ceux qui gagnent leur pain à lu sueur de leur front, venant donner une journée de travail, sans autre but que d’accomplir une œuvre agréable à Dieu et de s’assurer la protection du Bienheureux P. de Montfort : Voilà ce qui ne cesse d’être un sujet d’étonnement et d’admiration pour les personnes étrangères à notre région, soit qu’elles en entendent parler seulement, ou mieux encore, qu’elles en soient un jour témoins.
Commencés par les paroissiens de Saint-Guillaume toujours dévoués au Calvaire, les travaux se sont poursuivis chaque semaine, ordinairement le mardi et le jeudi.
On sait que le travail de cette année est au travail non pas précisément de construction mais d’embellissement. La Voie Douloureuse a été débarrassée de la lande et diverses plantes indésirables qui, malgré tous les efforts tentés jusqu’ici, réussissaient à pousser et à encombrer le Chemin de Croix. Derrière chaque station on a planté des arbres verts dans le but de faire mieux ressortir encore les statues déjà si expressives par elles-mêmes et de les faire apparaitre dans toute leur sévère beauté. La montée du Calvaire a été élargie et l’ascension a été rendue plus facile ; de plus un immense rosaire se déroule depuis la base jusqu’au sommet, fait le tour des croix et redescend jusqu’à la treizième station du côté de la forêt de la Madeleine, — car c’est de ce côté qu’elle vient d’être placée. — L’expérience avait montré, en effet, l’inconvénient d’avoir la descente de croix du côté de la route de Guérande. La station du crucifiement terminée, il fallait revenir sur ses pas et refouler le flot de pèlerins qui remplissaient le chemin montant, étroit et malaisé. Cet inconvénient n’existera plus et la procession continuera tout naturellement sa marche en avant vers le lieu de la descente de croix, puis vers le saint sépulcre.
Selon les désirs qui nous étaient exprimés de tous côtés, nous avons placé la belle statue du Sacré-Cœur au sommet de la lande de la Madeleine, à l’intersection des routes de Saint-Nazaire et de Guérande.
Tendant ses bras aux pèlerins, il semble leur redire ces consolantes paroles : venez à moi, vous qui souffrez, vous qui portez le poids de douleurs de la vie, venez voir comme je vous ai aimés le premier, venez contempler les mystères de ma naissance, de ma vie, de ma Passion et de ma mort, venez méditer mon amour pour vous ; venez tous à moi, venez avec confiance ; venite ad me omnes.
Autour du merveilleux groupe de l’Ascension un chemin de ronde a été pratiqué et après avoir admiré le personnage principal, Notre-Seigneur Jésus-Christ montant en ciel en bénissant ses Apôtres, ils pourront passer derrière le groupe et contempler à loisir les physionomies si expressives de la Très Sainte Vierge, des saintes femmes, de l’Apôtre saint Jean, « le disciple que Jésus aimait, discipulus quem diligebat Jesus », de saint Pierre et des autres apôtres»
Pour réaliser ces diverses améliorations, nous avons eu, grâce à Dieu, le concours des chrétiennes populations qui nous entourent. Le dernier compte-rendu s’arrêtait à la paroisse de Saint-Dolay. Continuons.
Herbignac, 20 février. — Le mardi précédent, une pluie abondante et persistante avait empêchâtes paroissiens d’Herbignac de venir au Calvaire, mais ce ne fut que partie remise. Le mardi 20, une escouade de braves travailleurs nous arrive, ayant à leur tête M. l’abbé Lizé, représentant M. le curé empêché. M. Lizé est un vieil ami du Calvaire. Quand jadis il était vicaire à Crossac, tout près d’ici, le P. Barré trouva en lui le plus fidèle et le plus dévoué des collaborateurs. Après une longue absence il revient non loin du Calvaire et nous constatons avec bonheur que le temps qui use tout n’a point eu prise sur les sentiments de son cœur à l’égard du Calvaire. C’est toujours le même zèle, le même entrain pour Dieu et les âmes. Merci à M. Lizé et à ses braves travailleurs.
Crossac. 21 février, — Après les hommes, les femmes, et celles-ci ne méritent pas moins d’éloges que les hommes qui pourtant nous avaient donné une excellente journée. — Savez-vous que ce sont des travailleuses intrépides les femmes de Crossac. Jeanne d’Arc disait : « Je ne sais ni A ni B, mais pour coudre et filer je ne crains femme de Rouen. — Les femmes et filles de Crossac aussi ne craignent femmes de France pour manier pelles et pioches, remplir de terre les paniers et les faire arriver promptement à destination, pour planter et porter des fardeaux. Nul doute que Montfort ne continue, à l’égard de cette paroisse, si dévouée à son œuvre de prédilection, son sourire et sa protection.
Saint Gildas-des-Bois, 22 février. — Ce fut la journée des braves et des courageux. Malgré les nuages qui contenaient dans leurs flancs des déluges d’eau, une escouade de travailleurs se mit en route. La pluie tombait en abondance et sur la remarque du directeur, qu’on ne pouvait tenir plus longtemps, on s’arrêta, mais ce fut pour recommencer bientôt : Nous sommes venus pour travailler ; en avant ! c’est pour le Père de Montfort ! Tant de courage eut une première récompense le jour-même, car l’après-midi le ciel s’éclaircit et nombreux furent les wagons et tombereaux de terre amenés à l’endroit désigné. Malgré ses 74 ans, le bon et dévoué doyen fit la route à pied, aller et retour, mania l’outil toute la journée comme ses dévoués paroissiens. M. le vicaire et les trois instituteurs de l’école chrétienne rivalisèrent de zèle et payèrent largement de leur personne. A tous, félicitations et remercîments.
Les environs du Calvaire, 8 mars. — Répondant à l’appel qui leur avait été fait le dimanche dans la chapelle du Calvaire, nos voisines toujours dévouées sont venues avec empressement mettre la dernière main aux travaux poursuivis pendant tout l’hiver. Comme nous, elles désirent vivement que tout y soit en parfait état et que les pèlerins ayant été édifiés de tout ce qu’ils auront vu, s’en retournent en disant : au Calvaire on fait bien les choses ; une journée passée au Calvaire est une journée de paradis. On y trouve tout ce qui peut satisfaire la vue, l’esprit et le cœur.
En racontant les travaux exécutés au Calvaire en 1709, sous la direction même du P. de Montfort les historiens rapportent qu’on voyait parmi les travailleurs non seulement des paysans, mais des personnes de tout rang et de toute condition. On y voyait de grandes dames descendre de leurs carrosses, pour mettre la main à l’œuvre. Le 8 mars dernier on pouvait voir aussi pareil spectacle. Parmi les travailleuses, en effet, nous avons compté les trois demoiselles de M. le compte Arthur de la Villeboisnet, du château du Deffay. Arrivées dès la première heure, en compagnie de leur vénérée grand-mère, Mme la comtesse, qui porte allègrement ses 80 ans, elles ont travaillé tout le jour avec une ardeur qui ne s’est pas ralentie un instant. Comme leur regretté grand père, dont il sera parlé plus bas, elles aiment le P. de Montfort, et si, malgré la fatigue, elles ont tenu bon toute la journée, c’était par dévouement assurément, mais aussi par reconnaissance, car on m’a dit que, dernièrement, se voyant menacées par un animal furieux, elles invoquèrent le P. de Montfort et échappèrent au danger.
Maintenant que le Calvaire est bien restauré, nous pourrons chanter plus haut que jamais :
Chers amis, tressaillons d’allégresse,
Nous avons le Calvaire chez nous :
Courons-y» la charité nous presse
Allons voir Jésus-Christ mort pour nous.
Et espérons qu’en voyant les dépenses qu’un pareil travail a dû occasionner, plusieurs auront la délicate et charitable pensée de nous venir en aide et qu’ils ajouteront :
Laissons-y nos cœurs et nos offrandes ;
Embrassons la croix d’un cœur joyeux,
Pour avoir l’effet de nos demandes
Et monter de ce Calvaire aux deux.
Inauguration de deux vitraux dans la chapelle du Pèlerinage, le dimanche 11 mars
Ce dimanche l’Eglise commence son office liturgique par nous inviter à la joie : lætare, réjouissez-vous. Ce jour-là, au Calvaire, nous pouvions nous réjouir, en effet, car c’était l’inauguration de deux magnifiques vitraux offerts par l’excellente famille de la Villeboisnet en souvenir du grand bienfaiteur du Calvaire, le regretté comte de la Villeboisnet.
A l’issue de la grand’messe, les élèves de l’école du Calvaire entonnèrent le cantique du P. de Montfort :
Un ange du ciel descendit
Et salua Marie ;
Elle conçut du Saint-Esprit,
Jésus, le fruit de vie.
Un Dieu prend notre humanité,
L’unit à sa Divinité,
Une Vierge est féconde !
Adorons tous l’humilité
D’un Dieu qui vient au monde.
Puis le directeur du Pèlerinage prenant la parole adressa à l’auditoire l’allocution que nous reproduisons ci-dessous.
Un chant en quatre parties de H. Clémens, et intitulé : En avant pour Jésus, termina cette belle cérémonie.
Saint Gabriel et saint Jean, Apôtres
Vous connaissez la cérémonie qui va s’accomplir, mais vous vous êtes peut-être demandé pourquoi l’on a représenté, dans les deux vitraux que tout à l’heure nous allons bénir, l’archange saint Gabriel et l’apôtre saint Jean. Prêtez-moi quelques instants votre bienveillante attention et vous comprendrez la raison et l’opportunité de ce choix.
Saint Gabriel. — Saint Gabriel est un des sept anges qui se tiennent constamment devant le trône de Dieu.
Son nom signifié la force de Dieu, virtus Dei, et c’est à ce titre qu’il a mérité d’annoncer l’avènement de Notre-Seigneur Jésus Christ qui est appelé et qui est bien en toute vérité la force de Dieu, virtus Dei. C’est ce même titre qui lui valut de fortifier la Vierge Marie, effrayée de la surprenante merveille à laquelle le Ciel l’appelait à concourir et c’est avec raison qu’on l’a appelé l’ange de la Rédemption.
N’est-ce pas lui, en effet, qui dicta à Daniel ses plus célèbres prophéties et lui dévoila le secret de la mort du Messie, Fils de Dieu, Sauveur du monde ?
N’est-ce pas lui qui annonça la naissance de Jean- Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ ? N’est-ce pas lui que Dieu envoya à la Vierge de Nazareth pour lui annoncer que les temps étaient accomplis, que le Verbe de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité allait, pour sauver l’humanité, s’incarner, se faire petit enfant et que c’était elle l’humble Vierge même que Dieu avait choisie pour être sa mère ?
C’est lui encore qui fit part aux bergers de la naissance du Sauveur à Bethléem et leur indiqua à quels signes ils le reconnaîtraient : « Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple ; aujourd’hui il vous est né un Sauveur ; voici le signe auquel vous le reconnaitrez : vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. »
C’est lui qui apparut à saint Joseph et l’avertit des projets homicides du cruel Hérode : prenez l’enfant et sa mère et fuyez, car on en veut à la vie de l’enfant.
Cette simple énumération doit suffire, ce me semble, pour justifier le titre donné à saint Gabriel d’ange de la Rédemption, comme aussi la dévotion spéciale qu’avait au saint archange le bon et regretté comte de la Villeboisnet. Il avait lu et relu, ce chrétien éclairé et fervent, le beau livre du P. de Montfort ; la Vraie Dévotion à Marie, et il avait appris à l’école du Bienheureux que « l’Incarnation du Verbe Eternel de Dieu dans le sein de Marie, après l’annonce de Gabriel, est le mystère de Jésus-Christ le plus caché, le plus élevé, le moins connu et un abrégé de tous les autres mystères, renfermant la grâce de tous ».
C’est pour rappeler et perpétuer souvenir de la très grande dévotion du regretté et cher défunt, à saint Gabriel et au mystère de l’incarnation, qu’on » représenté dans ce vitrail Saint Gabriel, l’Ange de la Rédemption, un lis à la main.
Comme vous le voyez, sur un fond d’or étoilé, il se tient debout sur un nuage, vêtu de blanc, dans l’encadrement frissonnant de ses six ailes. Deux de ses ailes viennent se croiser devant lui, comme pour arrêter un instant son élan perpétuel de messager de Dieu ; deux autres s’élèvent comme deux flammes d’amour vers le ciel. Il porte au front la claire flamme des missions divines, dans sa main droite le sceptre où fleurit un lys éclatant de blancheur : et dans sa main gauche le globe des archanges. Au-dessus de lui scintille le triple cercle entrelacé, symbole de la Sainte Trinité, et, sous ses pieds, au milieu des lys, l’inscription : Ego sum Gabriel, gui adsto ante Deum : Je suis Gabriel qui me tiens debout devant Dieu.
Saint Jean, apôtre. — Un mot maintenant de l’apôtre saint Jean que l’Evangile appelle le disciple que Jésus aimait : discipulus quem, diligebat Jésus. Ce seul nom de disciple que Jésus aimait renferme à l’adresse de l’apôtre le plus magnifique des éloges. Car Jésus ne l’aurait pas aimé d’une affection particulière si, croyez-le bien, de tout point il n’en avait pas été digne.
Au moment de l’institution du grand sacrement d’amour, l’Eucharistie, il eut, l’incomparable bonheur d’appuyer sa tête sur la poitrine du Sauveur, et les Pères de l’Eglise nous enseignent que c’est là, dans ce contact intime avec le bon Sauveur, qu’il connut les plus hauts secrets de nos mystères dont il a fait part à toute l’Eglise.
C’est lui qui, après l’Ascension de Notre-Seigneur, devenu le fils, adoptif de Marie, offrît chaque jour devant la Très Sainte Vierge, les saints sacrifices de la messe et lui donna la sainte communion. — Aussi est-il considéré à bon droit comme l’apôtre de l’Eucharistie, — et c’est pour exprimer cette idée et rappeler encore la grande dévotion de M. le comte de la Villeboisnet à l’Eucharistie, que l’artiste a, dans ce vitrail, représenté saint Jean offrant l’hostie à nos adorations, nous redisant par ce geste : voilà le pain de vie : celui qui mange ce pain vivra éternellement, au dernier jour il ressuscitera glorieux.
Debout, sur un sol gazonné derrière lequel se devine la mer, pour rappeler sans doute l’ile de Patmos où l’apôtre reçut les révélations du Ciel telles qu’on les lit dans l’Apocalypse, l’apôtre, dans un geste fervent, élève le calice que surmonte une hostie. L’auréole rouge des martyrs encadre sa tête ; à ses pieds se tient l’aigle symbolique; au-dessus de lui, dans un vol fougueux, passe un aigle qui déroule un phylactère ou parchemin partant écrit les premiers mots de l’Apocalypse. Sous ses pieds, sur un fond rouge semé de flammes, un livre ouvert où se lit les premiers mots de son Evangile : In principio erat Verbum : au commencement était le Verbe.
Tels sont, mes bien chers frères, les deux vitraux que nous, allons bénir avec les enseignements qu’ils renferment. Vous voyez maintenant la haute, raison du choix de ces deux vitraux représentant saint Gabriel, l’ange de la Rédemption, et saint Jean, l’apôtre de l’Eucharistie.
Et maintenant comment témoigner notre reconnaissance, à la noble famille de Monsieur le comte qui fait à la chapelle du Pèlerinage l’offrande de ces vitraux, superbes tous les deux, bien que d’un genre différent. Ah ! que le Bienheureux Père de Montfort la bénisse et la protège toujours ! C’est ce que nous lui demanderons en souvenir de celui qui fut l’ami et le soutien des Œuvres du Calvaire, disons mieux, qui, en des jours mauvais, en fut véritablement le sauveur. A. G.
N° 11 Novembre 1923
Une nouvelle statue du Bienheureux Père de Montfort au pied de la montagne du Calvaire
Le Père de Montfort ne terminait jamais une Mission sans ériger une croix destinée à en perpétuer le souvenir. Mais les croix dont il a couvert le sol de la Bretagne et de la Vendée ne lui suffisaient pas ; il projetait depuis longtemps d’élever un monument qui fut la représentation fidèle du Golgotha, où le Sauveur a été crucifié.
Ce dessein reçut un commencement d’exécution à la fin d’une Mission que le Bienheureux donna à Montfort même, sa ville natale. Une éminence d’où la croix eut été aperçue de très loin, avait été choisie, la place des chapelles destinées à rappeler les principales scènes de la Passion était marqué ; les travaux étaient poussés avec activité, lorsqu’un ordre du gouverneur vint les interrompre.
Montfort courba la tête et attendit. Il devait être plus heureux à Pontchâteau où il prêchait une mission en 1709. Nul emplacement ne lui parut plus favorable que la vaste lande de la Madeleine, à une lieue de la ville, d’où la vue s’étend sur un immense horizon.
Son projet fut accueilli avec enthousiasme par le clergé et le peuple, et le Cardinal de Coislin, à qui appartenait la lande, accorda gracieusement au saint missionnaire tout l’espace dont il avait besoin.
Au jour indiqué, Montfort se rendit à la lande, suivi d’une multitude de travailleurs volontaires et donna le premier coup de bêche pour commencer les travaux.
Un de ses historiens trace en ces termes le plan du monument.
« Il traça trois cercles concentriques : le premier de 400 pieds, le second de 500, le troisième de 600. Dans celui de 400 devait surgir la montagne du Calvaire.
Entre la douve qui devait fournir la terre et la montagne, se déroulait circulairement une promenade ou chemin de ronde large de 20 pieds… C’était une immense masse de terre qu’il fallait creuser, porter et disposer en cône dont le sommet dépassait de 70 pieds la profondeur de la douve.
C’est pour conserver et rappeler ce souvenir que, dans l’Octave de l’Assomption, on a placé une nouvelle statue du Bienheureux, au bas de la montagne, devant la petite chapelle, à côté du tombeau du vénéré M. Gouray, curé de Pontchâteau et restaurateur du Calvaire en 1821.
Montfort est représenté jeune encore, mais déjà le visage amaigri par les mortifications et les rudes travaux de ses missions, sur sa poitrine son cher crucifix, à son côté le Rosaire. La main droite s’appuie sur sa bêche retournée, comme fait d’ordinaire le laboureur qui s’arrête un instant pour se reposer, réfléchir ou causer. La main gauche un peu abaissée est légèrement ouverte et l’on croirait entendre Montfort expliquer son plan gigantesque à ses dévoués travailleurs. Tout autour les arbustes qui commençaient à tout envahir ont été taillés, les herbes folles arrachées, les épines et les ronces soigneusement coupées ; la blanche statue se détache fort bien sur la façade de la modeste chapelle et produit très bon effet. Il en est peut-être qui connaissant le Calvaire, diront : pourquoi ce changement? car enfin il y avait déjà une statue de Montfort à cet endroit. A la vérité, il y avait là une statue, mais il fallait s’approcher de bien près et lire sur le socle : « le bon Père de Montfort » pour deviner que c’était lui elle n’avait rien qui rappelât l’intrépide missionnaire qu’était Montfort.
Déjà nous avons constaté que ce nouveau monument qu’aperçoivent maintenant tous les pèlerins qui s’apprêtent à faire l’ascension du Calvaire, est fort visité.
Au Calvaire, Montfort fut à la peine, il est juste que maintenant il soit à l’honneur.
C’est l’avis de M. le Curé de Pontchâteau toujours si dévoué à l’œuvre du Calvaire, c’est l’avis de tous les amis de Montfort.
N° 2 Février 1924
Le Saint Sépulcre
Les lecteurs de l’Ami de la Croix appellent de tous leurs vœux les jours où ils verront, sur la colline de la Madeleine, une représentation complète et aussi fidèle que possible de ces Lieux saints par excellence, sanctifiés par la présence de l’Homme-Dieu, par l’accomplissement des grands mystères de notre foi.
Commencée par Montfort lui-même, cette œuvre se poursuit toujours et au moment où nous écrivons ces lignes, les ouvriers sont occupés à faire les plateformes destinées à recevoir les statues représentant, au Saint Sépulcre même, la Résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
En attendant le jour de l’inauguration de ce nouveau groupe, on ne lira pas sans intérêt, pensons-nous, l’histoire du Saint Sépulcre dont le nôtre est l’exacte reproduction.
N° 4 Avril 1924
Echos du Calvaire
Un des chapelains du Calvaire parcourant les villages voisins à la recherche de travailleurs volontaires fait la rencontre d’un vieillard. La conversation s’engage. Et que faites-vous de nouveau, cette année au Calvaire ? — Une grande allée qui conduira du Calvaire à Gethsémani, en passant devant le Sacré-Cœur, le moulin du Père de Montfort, le monument de l’Ascension, du Cénacle (en projet), et de l’Assomption. Ce sera le digne pendant de l’allée, admirée de tous, qui va du Calvaire à la Scala Sancta, si l’on veut bien nous aider dans ce travail. — Et aussitôt le vieillard de répliquer : Monsieur l’abbé, quand il s’agit de travailler au Calvaire du Père de Montfort, on laisse tout et l’on va, et nous irons comme les années précédentes. Oh ! comme je voudrais voir cette œuvre terminée avant de mourir, avant d’aller rejoindre le Père de Montfort dans le paradis, car j’espère bien qu’après avoir travaillé pour lui, le Père de Montfort ne m’oubliera pas et, au besoin, me tendra la corde pour accoster au rivage. Donc à jeudi.
Partout ce fut le même accueil, sympathique et cordial. Citons tout d’abord à l’ordre du jour ceux qui gracieusement, prêtèrent leurs bœufs pour le premier travail de nivellement du terrain :
MM. Nicolas et Ramet, de la Joubrais ;
Poitevin, de Beaulieu ;
Ollic, duSabot-d’Or;
Letiec, de Terre-Neuve ;
Drouillet, du Calvaire;
Chédotal et Vignard, de la Mauriçais ;
Moisan, de la Noë ;
Pabœuf, de Travers.
Puis vinrent par escouades, à différents jours, des hommes et jeunes gens du Calvaire, des Métairies, du Buisson-Rond, de la Plaie, de Bodio, de Callac, etc., etc.
Le mardi, 5 février, le dévoué pasteur de Drefféac arrivait au Calvaire à la tête d’un bataillon d’élite. Leur tâche consista à abattre une longue rangée de lambertianas destinés à faire des bancs pour asseoir les pèlerins pendant les offices à la Scala-Sancta. A les voir manœuvrer, on aurait dit sans hésitation, que tous, des plus jeunes aux plus âgés, étaient des bûcherons de profession.
Ce fut une bonne journée, et le Père de Montfort du haut du ciel dut sourire à ces braves et dire : je vous bénis. Ne laissons pas se perdre un beau mot entendu au cours de la journée. Un arbre était près de tomber, encore quelques coups de hache et subitement peut-être, plus tôt qu’on ne s’y attend, — comme il arrive parfois, — l’arbre allait lourdement s’étendre sur le sol. M. le Curé vient à passer, lui aussi, sa hache à la main ; monsieur le curé, lui crie un brave paroissien, éloignez-vous, vous vous exposez ; vous êtes plus nécessaire et plus utile que moi, à Drefféac, savez-vous !
Le jeudi, 14 février, près de 60 hommes de Crossac continuaient le travail commencé par Drefféac et ouvraient une large avenue pour arriver du Prétoire au beau monument de l’Ascension. Le pasteur empêché s’était fait représenter par son vicaire. Ce ne fut pas une journée de huit heures, que l’on fit ce jour-là, car il faisait nuit quand, la bénédiction du Saint-Sacrement terminée, on sortit de la chapelle. Gaiement nos travailleurs, leurs outils sur l’épaule, reprirent le chemin de leurs demeures. Que Montfort les bénisse et les ait toujours sous sa sainte garde !
N° 6 Juin 1924
Chronique du Mois
Le monument de la Résurrection. — Les amis du Calvaire et les souscripteurs pour le monument de la Résurrection se demandent sans doute où nous en sommes de nos travaux. Les plates-formes destinées à recevoir les statues sont complètement terminées et les statues ne tarderont pas de nous arriver.
Voici en effet ce qu’on nous écrit de Vaucouleurs : « La création des trois modèles : (Jésus ressuscité et les deux soldats) nous a demandé beaucoup de temps, car c’était un gros travail de modelage.
Mais, malgré les difficultés, ces modèles sont très bien réussis, c’est le point capital.
Actuellement le Christ ressuscité est en cours de moulage à la fonderie, et les deux soldats, dont on termine en ce moment les modèles, seront mis au moulage dans quelques jours ; nous ne perdons pas une minute pour activer la besogne.
Vous aurez satisfaction, n’en doutez pas, et vous pouvez compter sur nous, car nous avons à cœur de mener à bien ce beau travail.
Une fois ces trois statues en place, vous pourrez faire prendre la photographie d’ensemble, et nous sommes certains d’avance que ce sera parfait ».
Ainsi-soit-il.
N° 8 Août 1924
L’atelier de Saint Joseph
L’atelier de Saint Joseph. — Tout le monde sait que la sainte maison de Nazareth, où l’Archange Gabriel vint offrir à Marie l’honneur incomparable de devenir la Mère du Messie, du Sauveur promis et attendu, était adossée à une colline, et qu’une grotte creusée dans cette colline et communiquant avec la sainte maison, servait d’atelier à saint Joseph.
Tous les lecteurs de l’Ami savent également que le projet du Père de Montfort était de transporter Jérusalem en France, c’est-à-dire de représenter, ici, d’une manière aussi frappante que possible, les mystères de notre sainte religion.
La Sancta Casa a été construite en 1893, et depuis ce moment, que de milliers d’Ave Maria ont jailli des lèvres et du cœur des pèlerins, en ce modeste sanctuaire, devant la représentation si vivante de l’Annonciation. A droite, on montrait aux pèlerins l’atelier de saint Joseph. Mais rien dans cet atelier ne rappelait le souvenir de l’humble charpentier ; pas un établi, pas une scie, pas un rabot. C’était une lacune, et, grâce à Dieu, elle vient d’être comblée, cette lacune.
Le 6 juin, premier vendredi du mois, un artiste-peintre de Saint-Nazaire, M. Victor Simon, a magnifiquement décoré cet atelier. Une grande toile prenant tout le fond de la grotte représente l’Enfant Jésus travaillant le bois sous la conduite de saint Joseph et sous le doux regard de la Vierge, sa Mère.
Sur l’établi portant maillet et autres instruments, l’Enfant Jésus exécute un tracé ; sa main mignonne appuyée sur le compas, il s’est arrêté pour écouter sa Très Sainte Mère. La figure du divin adolescent est plein de majesté et de ravissante douceur et l’on se dit : c’est bien ainsi que devait être l’enfant Jésus. D’une épaisse planche usagée, saint Joseph vient d’arracher un clou encore entre les dents des tenailles que tient sa main droite ; son regard, comme celui de la Vierge, s’est porté sur Jésus, et il reste comme en extase, en contemplant le grand fabricateur des mondes devenu par amour pour nous, un modeste ouvrier, le plus humble des apprentis.
J’ai lu qu’un jour, un bloc de marbre fut apporté dans l’atelier de Michel-Ange.
D’un œil dans lequel éclate le feu du génie, l’artiste le scrute jusqu’en ses profondeurs… Un travail lent, difficile, pénible se fait dans son esprit et l’on peut — sur son front mobile — suivre les traces de sa laborieuse pensée.
Enfin, l’œil de l’artiste se repose, ses traits se détendent, sa figure s’illumine… l’œuvre est finie… l’idéal est créé…
Alors saisissant ses outils, le maître attaque le bloc et se met à tailler.
De ce long regard, de cette conception puissante, que va-t-il sortir ?
Attendons…
Des mois se sont écoulés… L’artiste a travaillé sans, relâche. Il vient de donner à son Moïse le dernier coup de ciseau.
Satisfait, le maître s’arrête… s’éloigne quelque peu et contemple…
Le voilà, le grand législateur des Hébreux !… Le voilà, tel qu’il l’a rêvé, dans toute la majesté, toute la noblesse de son attitude.
La vue de son chef-d’œuvre jette l’artiste hors de lui-même. Alors, dans un élan d’admiration et d’enthousiasme, d’un ton suppliant, il l’apostrophe en ces termes :
« Parle !… Mais parle donc, maintenant !… »
Son Moïse ne parla pas.
L’auteur du tableau de l’atelier de saint Joseph est un modeste, et j’en suis bien sûr, il n’a jamais eu la prétention d’être un Michel-Ange, ni un Murillo, ni un Fra-Angelico. Mais rendant hommage à son réel talent de peintre chrétien, je puis lui dire en toute vérité : votre tableau parle ; il parle à l’esprit et au cœur. Aux âmes qui s’arrêteront à l’étudier et à le contempler, il parlera et il fera du bien. C’est le but que vous vous êtes proposé ; aussi de tout cœur nous vous disons merci.
Relation1 de la cérémonie qui a eu lieu à Pontchâteau pour la Translation d’une Parcelle de la vraie croix à la chapelle du calvaire le 8 septembre 1825
S’il en était de ce qui intéresse la religion et réjouit les âmes pieuses, comme des événements ordinaires, qui sont presqu’aussitôt oublies qu’appris, et n’ont importance que leur nouveauté, nous n’oserions pas, après un mois presque d’intervalle, entretenir nos lecteurs d’une cérémonie touchante qui a eu lieu le 8 de septembre, auprès de Pontchâteau. Mais nous savons le ces détails, si pleins tout à la fois de simplicité et grandeur, ne sont jamais imprimés trop tard pour les vrais chrétiens, c’est pourquoi nous pensons qu’on nous saura gré de les rassembler ici, sinon avec cette vérité de description qui pénètre et transporte, di moins avec l’exactitude d’un récit fidèle.
Tout le monde a entendu parler du calvaire de Pontchâteau, pieux monument du zèle du vénérable M. de Montfort et de la ferveur des peuples d’alentour. On sait qu’au milieu d’un vaste plateau a été élevée une haute colline destinée à représenter la montagne di Calvaire. La piété toute seule a excité et soutenu d’abord en 1709, puis de nouveau en 1747, et enfin de nos jours, l’ardeur d’une foule de peuples, qui se sont empressés de creuser de larges douves, d’établir de belles terrasses et de former une plate-forme de 40 pieds de haut sur 90 pieds de circonférence au sommet, où est dressée une croix de 50 pieds entre deux autres moindres, et portant un Christ de 6 pieds, le même que M. de Montfort avait fait faire.
Ce Calvaire et une chapelle bâtie au pied, avaient été bénits, en 1821, par Mgr d’Andigné, évêque de Nantes, à la clôture de la mission qui fut donnée à Pontchâteau.
La cérémonie dont nous voulons parler, avait pour objet la translation d’une parcelle de la vraie croix, de l’église paroissiale à la chapelle du Calvaire, où elle doit demeurer pour bénir le peuple après le Chemin de la Croix qu’on y fait tous les dimanches.
On célébra d’abord une messe solennelle dans l’église paroissiale, à 8 heures du matin. M. Bizet, chanoine honoraire, chef de la mission, y prêcha sur le culte intérieur et extérieur dû à la croix.
Après la messe, la procession se mit en marche dans le plus bel ordre. Elle était ouverte par la gendarmerie à cheval, qui fit preuve d’un zèle admirable et des sentiments les plus religieux.
Un groupe déjeunes filles, vêtues de blanc, portaient, à la tête de la procession, la statue de la Sainte Vierge, sur un brancard richement orné. Après elles, venaient les Sœurs du Tiers-Ordre, humbles filles, moins séparées du monde par leur habit que par leur vie innocente et l’ardeur de leur charité.
Suivaient deux rangs d’étendards, dont deux mille sept cents de couleur blanche et ornés d’une croix rouge, étaient portés par autant de filles ou femmes ; les autres, au nombre de douze cents et de couleur rouge, étaient portés par des hommes.
Entre les rangs, de distance en distance, marchaient les croix et les bannières de 9 paroisses : Pontchâteau, Crossac, Sainte-Reine, la Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Montoir, Missillac, Sévérac et Saint-Gildas. Plusieurs de ces paroisses se trouvèrent sur la route et prirent place dans les rangs, entr’autres celle de Montoir, venue processionnellement de 4 lieues, et dont un grand nombre de jeunes gens, qui avaient pour costume habit bleu, pantalon blanc, ceinture rouge, avaient porté, pendant toute la route, la statue de la Sainte Vierge. Les femmes la reprirent dans la lande de Pontchâteau.
Vingt-six prêtres en aube assistaient à la cérémonie. Douze jeunes clercs aussi en aube, avec des ceintures rouges, portaient, les uns un brancard, où étaient croisées la lance et l’éponge avec la couronne d’épines fixée au milieu, les autres, des branches de laurier.
Sur le passage de la sainte Relique, 8 jeunes enfants vêtus de blanc et couronnés de verdure, jetaient des feuilles et des fleurs. Le dais, sous lequel M. Bizet portait la précieuse parcelle de la vraie Croix, était porté par des bourgeois de la ville. Aux quatre coins flottaient les quatre étendards de la Mission portés par des jeunes gens. Les autorités, entourées de la Garde Nationale, fermaient la marche ; et derrière elles une foule innombrable de peuple.
Au moment où la sainte Relique sortit de l’église, la Garde Nationale fit une décharge de mousqueterie.
Après une demi-lieue de marche, la procession qui occupait presque tout cet espace, arriva sur la lande (cette lande qui a plus d’une lieue de tour, s’élève de tous côtés en plateau). Alors, les deux rangs d’étendards s’ouvrirent, laissant entr’eux une distance de 600 pas, puis, ils se réunirent à l’entrée du Calvaire. Les croix, les bannières et les groupes dont nous avons parlé, continuèrent cependant leur marche, et se rendirent directement.
Les rangs des femmes qui portaient les étendards blancs, se replièrent sur les terrasses au bas du Calvaire. Les hommes au contraire montèrent sur la plateforme, et se rangèrent en groupe au pied des trois croix. Avons-nous besoin de dire quel admirable effet devaient produire douze cents étendards rouges, flottant comme des flammes, au haut de cette colline, et contrastant par leur vif éclat avec la blancheur des aubes et des autres vêtements de la fête ?
Alors, on célébra la sainte Messe dans la chapelle du Calvaire. Quinze ou dix-huit mille personnes, répandues sur la lande, autour du Calvaire, s’unissaient au Saint Sacrifice, en chantant des cantiques avec une ferveur admirable. La Messe fut suivie d’un sermon prêché par l’un des missionnaires (M. Leray) lequel, placé aux pieds de la statue du vénérable Grignon de Montfort, cet ardent prédicateur du mystère de la Croix, semblait en traitant le même sujet, accomplir le vœux de cet homme apostolique, dans un lieu qui lui fut si cher.
Après le sermon, la sainte Relique fut portée processionnellement autour de la montagne, tout le monde chantant l’hymne Vexilla Regis. Le circuit achevé, M. Bizet, précédé de tout le clergé, monta sur la plateforme la plus élevée du Calvaire, d’où il donna la bénédiction de la vraie Croix à la foule innombrable que cette touchante cérémonie avait attirée. Nous laissons l’imagination de nos lecteurs, ou plutôt aux âmes capables de sentir, le plaisir de se peindre à elles-mêmes le spectacle de cette multitude prosternée dans un religieux et profond silence sur les degrés du Calvaire, sur les terrasses, et tout à l’entour, sur cette vaste lande, en recevant avec une humble foi, dans les bénédictions célestes, le prix de ses travaux, de ses sueurs, de ses sacrifices et de sa piété.
La cérémonie finit par le chant du Te Deum, et la bénédiction d’une fontaine creusée à trois cents pas du Calvaire pour la commodité des pèlerins.
Nous ne terminerons pas ce récit sans parler de la vive expression de joie que laissaient éclater, en se retirant, tous ceux qui avaient vu ce beau spectacle. Il y en avait qui étaient venus de 6, 7 et 8 lieues, qui étaient exténués, n’ayant, par dévotion, pris aucune nourriture, et qui s’en retournaient tous occupés de leur bonheur, en chantant de pieux cantiques, sans songer à leur besoin. Fervents chrétiens, ils ne perdront jamais ce souvenir ; ils le transmettront à leurs enfants de génération en génération : ils le viendront ranimer au pied de ce même Calvaire, objet de la vénération du pays depuis plus de cent ans, et en demeurant fidèles à Jésus crucifié, par une dévotion simple et sans ostentation, ils assureront leur bonheur pour le temps et pour l’éternité.
N° 4 Avril 1925
Chronique
A la lecture de ce titre plus d’un abonné n’a-t-il pas dit : « Enfin nous allons avoir des nouvelles du Calvaire. On commençait à croire que le chroniqueur avait brisé sa plume ou passé de vie à trépas. » Il est vrai, chers lecteurs, que depuis novembre le chroniqueur s’est tu : il a pris ses vacances. Au Calvaire, comme en tout lieu de pèlerinage, il y a une morte-saison : peu ou point de pèlerins. Ils sont rares pourtant, même en plein hiver, les jours où l’on ne voit pas quelques personnes parcourir les allées du pèlerinage, visiter les Sanctuaires du Rosaire et faire pieusement, sous la brise qui vous fouette au visage, le Chemin de la Croix.
Mais en attendant les beaux jours qui vont nous amener la foule des pèlerins, nous n’avons pas fait la grève des bras croisés. C’est le temps des vacances pour le chroniqueur mais non le temps du repos. Nous avons largement profité de ces mois de solitude pour travailler de notre mieux à l’amélioration et à l’embellissement du pèlerinage.
Le torrent du Cédron a été soigneusement nettoyé des hautes herbes qui l’envahissaient et qui bientôt l’auraient si bien soustrait aux regards qu’on n’en aurait pas même soupçonné l’existence.
Au jardin de Gethsémani, les arbres assez rapprochés les uns des autres, désireux de vivre et respirer à l’aise, avaient gagné en hauteur, mais les branches d’en bas, privés d’air, se desséchaient et n’auraient pas tardé à donner au domaine l’aspect d’une propriété abandonnée. Toutes les branches mortes ou inutiles ont été coupées et le pieux pèlerin pourra se promener sous ces arbres pendant les fortes chaleurs de l’été, s’y reposer à l’aise et méditer, dans la solitude, les souffrances endurées pour nous par Notre-Seigneur à Gethsémani, à quelques pas de la Grotte.
1Ancienne relation trouvée parmi de vieux papiers.
Dans sa « Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, exposé historique, critique et apologétique, » Fillion dit au Chapitre IV du Tome III : « Après son admirable prière, Jésus se remit en marche et ne tarda pas à atteindre la vallée du Cédron, très resserrée en cet endroit. Il traversa sur l’un des ponts, qui le franchissaient alors, le lit presque toujours à sec de ce ruisseau1, et arriva bientôt à l’entrée du domaine2 de Gethsémani. Ce lieu, dont le nom hébreu signifie « Pressoir à huile, » est l’un des plus sacrés de la terre ; aussi, a-t-il toujours été, de la part des chrétiens, l’objet d’une vénération particulière. Sa forme est celle d’un carré irrégulier, qui mesure environ cinquante mètres de côté, et qui est entouré d’un grand mur. Ce qui frappe le plus le regard, lorsqu’on y pénètre, ce sont huit oliviers vénérables, qui portent les marques de la plus haute vieillesse. Ils sont soutenus par une maçonnerie, et chacun d’eux a trois ou quatre troncs, séparés les uns des autres par un assez large intervalle, parce qu’ils ont repoussé dans la suite des siècles, en s’écartant de plus en plus du tronc primitif. Leur écorce est toute rugueuse et crevassée, comme couverte des cicatrices ou des rides de la vieillesse. Si ces oliviers ne sont pas les mêmes qui ont été témoins de l’agonie du Sauveur, ils en sont du moins les rejetons… Ces troncs eux-mêmes sont certainement plusieurs fois séculaires et leur aspect contraste singulièrement avec celui des jeunes pousses qu’ils produisent encore. »
Le climat n’a pas permis de planter des Oliviers à notre Gethsémani, on y a mis différentes essences, et ces arbustes, plantés assez près les uns des autres, en arrivaient avec l’âge à former un fourré impénétrable et peu gracieux.
Ceux d’entre eux (une demi-douzaine et de peu de valeur) qui masquaient la Grotte de l’Agonie et le monument du Prétoire ont été abattus, et maintenant les pèlerins qui, pour la première fois, viendront au Calvaire, ne seront plus embarrassés pour se rendre de Gethsémani au Prétoire ou du Prétoire à Gethsémani. Une allée de 15 mètres de largeur relie maintenant, en ligne directe, le Prétoire à Gethsémani. Mais les pèlerins qui le désireront et les âmes poétiques qui, dans les allées ombragées, aiment à entendre frémir « la brise qui vient du large avec les flots (ici, c’est vrai, à la lettre) pourront comme par le passé suivre le chemin de ronde tout en égrenant leur chapelet, protégés contre les ardeurs du soleil d’été. Ceux qui font du sport — ils sont légion à notre époque — au lieu de franchir le Cédron sur le vieux pont de pierre, pourront se donner la satisfaction de descendre et de remonter les pentes du torrent. Ils passeront à pied sec comme les Hébreux la Mer Rouge. Puis, regardant à droite, ils verront que le jardin de Gethsémani, s’il a été visité par la serpe du jardinier, n’a pas été détruit pour cela. Bon nombre même déclarent spontanément qu’il leur apparaît plus gracieux et plus attrayant.
Et maintenant, chers pèlerins et visiteurs, détournez-vous et admirez là-bas le beau monument de la Scala-Sancta. Comme il ressort bien au bout de la nouvelle allée ! Pourquoi ne l’a-t-on pas tracée dès le début, cette allée directe du Prétoire à la Scala ? Le Père Barré en avait le désir, mais alors il ne possédait pas tout le terrain nécessaire. Ce n’est qu’après de longues années qu’il en put faire l’acquisition. Mais, dans sa pensée, elle devait se faire cette avenue : d’abord pour la beauté de la perspective, la facilité de l’ornementation aux jours des grands pèlerinages et enfin polir le motif suivant.
Dans l’exécution des monuments des principales scènes de la Passion, il y aura la grande salle du palais de Caïphe où Jésus, saisi et garrotté comme un dangereux malfaiteur, fut tout d’abord amené : Jésus devant Caïphe et tout le Sanhédrin. Si l’on plaçait cette grande salle à droite, en venant de Gethsémani, toute l’ouverture donnerait au vent et à la pluie, en second lieu il n’y aurait pas de correspondance avec le Prétoire, tandis qu’en plaçant à gauche le palais de Caïphe on éviterait tous ces inconvénients.
Plus d’une fois déjà on nous a posé cette question : Allez-vous nous donner quelque chose de nouveau, cette année ? Car vous avez encore plusieurs monuments à construire, et tout d’abord le Temple de Jérusalem ou du moins deux salles pour y représenter : la Présentation de Jésus et la Purification de Marie, et : le Recouvrement de Jésus. Certes nous ne demandons pas mieux : nous désirons vivement marcher de l’avant, mais pas d’argent, pas de suisse ! pas d’argent, pas d’orgue ! pas d’argent, pas de monument ! Que des âmes riches et généreuses nous viennent en aidé, et sans retard nous réaliserons le plan qu’une main habile et amie vient de mettre sous nos yeux avec au bas : Temple de Jérusalem au Calvaire de Pontchâteau.
En attendant l’exécution de ce beau rêve, les pèlerins peuvent venir en grand nombre. Trois grandes allées, sans compter l’allée de la Voie Douloureuse, aboutissent au Prétoire où se font toutes les grandes cérémonies, et fussent-ils 80.000 comme à Nantes le 1er mars dernier, ils pourront se mouvoir à l’aise, et sans haut-parleur, entendre chacune des paroles qui leur seront adressées. Comme au Folgoët, à Saint-Brieuc, à Rennes, à Nantes, à Angers, nous prierons pour la France et le Père de Montfort, le grand bienfaiteur de nos contrées de l’Ouest, présentera nos vœux et nos supplications au Christ qui aime les Francs, et à la Vierge Marie, patronne de la France.
N° 3 Mars 1926
Bénédiction d’un nouveau Chemin de la Croix
Saint-Roch. — Que de fois ce nom a paru dans l’Ami de la Croix et toujours avec les plus grands éloges. A l’époque des grands travaux du Calvaire, on ne fit jamais appel en vain aux travailleurs volontaires de la paroisse de Saint-Roch. Toujours ils sont venus nombreux, empressés, ardents à la besogne, n’ayant qu’une peur, celle de n’en pas faire assez, dans la journée, pour leur « bon Père Montfort. » Depuis la guerre, pour exprimer son admiration, on a inventé des locutions qui ne figurent pas encore dans le Dictionnaire de l’Académie, mais qui sont passées dans le langage courant ; aussi je crois que le bon Père Barré, rendant compte des travaux effectués au Calvaire, n’aurait pas hésité à écrire le mot, s’il avait été alors en usage : « ce sont des As, les gars de Saint-Roch ! »
De fait, les paroissiens actuels de Saint-Roch n’ont pas dégénéré ; ils restent toujours dignes de leurs aïeux si profondément religieux. Ils l’ont montré une fois de plus, dimanche dernier, 24 janvier, jour fixé pour la bénédiction et l’inauguration d’un nouveau chemin de la Croix dans leur église paroissiale fort bien restaurée, et comme remise à neuf.
Combien de personnes, dans la soirée de dimanche, demeurèrent en leurs demeures ? Il serait facile, je crois, de les compter, car il n’y resta que le nombre strictement nécessaire pour garder.
Délégué, à la demande du pasteur, par Mgr l’Evêque de Nantes, le Directeur du Calvaire, accompagné d’un de ses dévoués collaborateurs, présida la touchante cérémonie.
Avant de procéder à la bénédiction des Croix et des tableaux, il prit la parole devant l’auditoire le plus attentif qu’il soit possible de trouver, et commença par féliciter le digne curé d’avoir fait l’acquisition du très beau chemin de la Croix qui désormais décorera sa coquette église et où ses fidèles viendront puiser, comme à une source intarissable, les grâces du ciel. Aux paroissiens revenaient aussi les éloges les plus mérités, car c’est grâce à leur grande et inlassable générosité que le pasteur a pu restaurer leur église, la maison du Bon Dieu ; leur maison, celle de la grande famille paroissiale et l’orner d’une manière digne de l’Hôte Divin qui y réside.
En vue de leur faire aimer de plus en plus cette dévotion, le prédicateur leur rappela en quelques mots, qu’un des plus ardents propagateurs de la Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur, en notre pays de France, ce fut le Bienheureux Père de Montfort. Que de Calvaires et de Chemins de Croix, il a érigés dans le cours de ses Missions ! Mais, dès le début de son apostolat, son amour pour Jésus crucifié, son zèle pour le salut des âmes lui avaient fait concevoir un projet plus grandiose que ne l’était l’érection d’un simple Calvaire. Il parlait souvent à son auditoire de le transporter à Jérusalem pour lui mettre sous les yeux les souffrances et les humiliations qu’un Dieu a bien voulu accepter pour notre amour. Il en vint au projet de transporter Jérusalem en France, selon sa propre expression, en représentant quelque part, d’une manière aussi fidèle et aussi saisissante que possible, les différentes scènes de la Passion du divin Maître.
Le lieu qu’il choisit, ou mieux que la Providence choisit, pour lui, c’est cet endroit appelé aujourd’hui le Calvaire de Pont-Château où tant de grâces sont demandées et obtenues.
Mais pourquoi ce zèle de notre Bienheureux à ériger des Calvaires et des Chemins de Croix ! Ah ! c’est qu’il savait les grands Avantages que cette dévotion nous procure.
Eh ! oui, il savait par expérience la merveilleuse efficacité du Chemin de la Croix pour ramener les pécheurs à Dieu et à la vertu ; pour ranimer et réchauffer les tièdes, pour perfectionner les justes, pour nous consoler dans nos peines et nos épreuves, pour nous enrichir des dons du ciel, nous les vivants, et nos chers défunts du Purgatoire : pour réparer et par là même apaiser la divine justice irritée par les crimes de la terre, pour attirer enfin sur nous et les nôtres toutes sortes de grâces dans l’ordre temporel et spirituel.
Après le développement de ces pensées écoutées dans le plus profond recueillement, on sortit en procession. Tout nous y invitait ; le soleil brillait comme en un beau jour de printemps, l’air était tiède, et, oubliant qu’ils étaient en hiver, les oiseaux chantaient dans les halliers.
Sept petites filles portaient les sept premières stations et sept petits garçons, les sept dernières ; sur leur visage, se lisait une expression de bonheur, unie à un air de gravité, marquant aux yeux de tous combien ils appréciaient la faveur qui leur était faite. Ils en garderont fidèlement souvenir, et dans 50 et 60 ans d’ici, ils diront à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants : « c’est moi qui avais l’honneur de porter telle station en procession, le jour de la bénédiction, c’est moi qui l’ai présentée au prêtre pour la fixer à cet endroit. »
Tandis que la longue théorie des mamans et des jeunes filles marchaient en tête, en égrenant pieusement leur chapelet, une masse compacte d’hommes et de jeunes gens entourant le clergé, chantaient à plein cœur et à pleine voix nos « bons vieux cantiques » en l’honneur de la Croix.
Au retour de la procession eut lieu l’exercice du chemin de la croix prêché par M. Malenfant ; les enseignements tombés de ses lèvres furent avidement recueillis et ils porteront des fruits qui demeureront.
Saint Léonard de Port-Maurice, ardent propagateur de la dévotion au chemin de la Croix, en Italie, rapporte dans un de ses ouvrages que Notre-Seigneur dit un jour à une sainte : « pour une seule personne qui fera avec dévotion le chemin de la croix, je protégerai la population tout entière du lieu où l’on honorera de la sorte le souvenir de ma Passion, et je la délivrerai des fléaux temporels qu’elle aura mérités par ses péchés. »
A Saint-Roch, ce n’est pas seulement une personne qui, par le chemin de Croix fait avec dévotion, honorera le souvenir de la Passion du Sauveur, mais la grande majorité de la population, aussi continuera-t-elle, — c’est notre vœu le plus cher, — d’attirer sur elle les bénédictions du ciel et la protection du grand bienfaiteur de la contrée : le Bienheureux Père de Montfort.
N° 1 Janvier 1927
Les travaux du Calvaire en 1709-1710
Au témoignage des premiers historiens du Père de Montfort, ce fut de trente lieues à la ronde que les populations chrétiennes vinrent offrir leurs bras au saint missionnaire pour la construction de son gigantesque Calvaire.
« Pendant 15 mois, dit M. Grandet, on y vint de toutes part, de 12 à 15 lieues pour y travailler. » Or, la lieue de M. Grandet équivaut au moins à 8 de nos kilomètres, puisque, selon lui, Missillac est à une demi-lieue du Calvaire, Herbignac à 8 lieues, Camoël à 3, tandis que nous comptons 6 kilomètres de Missillac au Calvaire, 16 d’Herbignac et 24 de Camoël. C’est donc de tous les points du diocèse de Nantes que les populations affluent dans la lande de la Madeleine pour prêter leur concours au Bienheureux Montfort, et les diocèses de Vannes, de Rennes, de Saint-Malo, de Saint-Brieuc, de Luçon, d’Angers et de la Rochelle rivalisent de zèle avec celui de Nantes.
Les populations les plus rapprochées répondent les premières à l’appel du saint missionnaire. Ces paysans à la foi robuste y amènent avec eux leurs bœufs et leurs charrettes pour transporter la terre. M. Ollivier y a compté un jour jusqu’à cent bœufs tirant les charrettes.
Arrivent ensuite les paroisses qui ont eu le bonheur d’avoir été évangélisées par le Bienheureux. Ces fiers chrétiens, ayant toujours présents à la pensée les précieux bienfaits dont ils sont redevables, et saintement avides de revoir leur apôtre bien-aimé, de lui exprimer de nouveau leur reconnaissance, et de recevoir encore de sa bouche quelque avis salutaire, ne peuvent compter la distance qu’ils ont à franchir, quand il s’agit de retrouver leur bon Père de Montfort. Méprisant donc les fatigues d’une longue marche, remplis de joie et d’allégresse, ils se dirigent d’un pas rapide vers la Sainte Montagne du Calvaire.
Ravis et enthousiasmés de tout ce qu’ils entendent raconter, et non moins avides de voir le saint missionnaire, d’être témoins de ses miracles et surtout de jouir de la vue de la Très Sainte Vierge, les habitants des contrées qui n’ont pas eu le bonheur de posséder le bienheureux, s’empressent de se mettre en marche à leur suite.
De toute part c’est un élan unanime vers le nouveau Golgotha qui s’élève dans la lande de la Madeleine.
Aucune condition n’est exceptée. Sans doute, comme à la crèche de l’Enfant-Dieu, les humbles de ce monde, les hommes à la foi simple, les bonnes gens de la campagne ont le glorieux privilège d’arriver les premiers. Mais les grands de ce monde ne tardent pas à les suivre et à venir eux-mêmes rendre hommage à l’envoyé de Dieu, en s’abaissant jusqu’à se mêler humblement, à la foule des travailleurs pour concourir de leurs mains à son œuvre du Calvaire : « J’ai vu toutes sortes de gens y travailler, dit M. Ollivier, témoin oculaire, des messieurs et des dames de qualité et même plusieurs prêtres y porter la hotte par dévotion. » — « Il y avait même des personnes de condition, ajoute M. Barrin, qui allaient en carrosse y travailler (Lettre à M. Grandet). »
La vertu et l’exemple de celui qui, étant au-dessus de toute créature, n’a pas dédaigné par amour pour nous de s’abaisser jusqu’à la condition la plus humble au point de devenir l’opprobre de Dieu et des hommes, en prenant sur lui la honte et l’ignominie de nos péchés, étaient seuls capables d’enfanter de tels prodiges d’humilité, et de fondre dans une aussi parfaite unité des hommes des conditions les plus diverses. Le Bienheureux Montfort donne au monde, dans sa lande de la Madeleine, la vraie et unique solution de la question sociale : réunir au pied du Calvaire les peuples de toutes conditions, pour leur faire méditer Jésus crucifié, et les pénétrer tous de l’esprit d’humilité, de sacrifice, de charité de ce divin modèle.
La foi qui transporte les montagnes, opère parmi ces travailleurs des merveilles non moins étonnantes. Elle décuple leur force et leur énergie naturelle : « J’ai vu, dit M. Ollivier, une jeune fille de 18 ans, porter avec joie sur la montagne, une pierre si pesante que quatre hommes avaient eu beaucoup de peine à la charger dans sa botte. »
Les bonnes gens de la contrée ont conservé le souvenir de ce fait, ou d’un fait semblable, bien qu’ils le racontent un peu diversement.
La montagne étant presque achevée, l’on trouva au fond des douves une pierre énorme que le Bienheureux voulut faire monter sur le sommet. « Qui va monter cette pierre ? dit-il. » Comme personne ne se présente, il choisit une jeune fille, dans la foule des travailleurs et lui dit : « C’est vous, mon enfant, qui allez monter cette pierre sur le sommet de la montagne. Confiante dans la puissance de Dieu, la jeune fille s’approche docilement de la pierre. Sur la parole du père, six hommes la lui placent sur ses faibles épaules et celle-ci, recevant de Dieu une force surhumaine, porte facilement son énorme fardeau, en présence des travailleurs stupéfaits, et le dépose sur le sommet de la montagne.
« J’ai vu, raconte encore M. Ollivier, tirer des douves, à l’aide d’une faible corde, des pierres d’un poids entièrement disproportionné.
Ce qui semble non moins prodigieux c’est que dans cette immense multitude qui augmentait chaque jour, non seulement il n’y avait pas la moindre confusion, mais que tout s’y faisait avec un ordre parfait, comme s’il y avait eu un grand nombre de personnes préposées à la direction des travaux. — Le silence n’était interrompu que par le roulement des charrettes, le bruit des instruments, la récitation du Saint Rosaire, et le chant des cantiques. »
« Quand j’étais sur le haut de la montagne, continue M. Ollivier, il me semblait me trouver au milieu d’une ravissante mélodie céleste. »
Le salaire que le Bienheureux donnait à ses travailleurs à la fin de la journée, était de leur permettre dl vénérer le crucifix qui était dans une grotte couverte de terre. Là se trouvaient aussi les statues de la Sainte Vierge, de saint Jean, de sainte Marie-Madeleine et des deux larrons. Ce spectacle, qui ne se voyait qu’à la lueur d’une lampe, les excitait à la componction et leur tirait les larmes des yeux.
Mais ce ne sont pas seulement les personnes valides qui s’empressent d’arriver au Calvaire pour seconder les desseins du saint missionnaire, ce sont aussi les malades qui s’y font transporter de toutes parts pour demander leur guérison. La confiance des peuples en le bon Père de Montfort est sans borne et elle est justifiée, car Dieu se plaît à glorifier son fidèle serviteur en accordant tout à son intercession, tant pour attirer de toutes parts les peuples à son Calvaire et les faire participer à son humiliation et à son sacrifice que pour les prémunir contre le terrible scandale qu’ils vont bientôt avoir sous les yeux. Une femme malade de la fièvre est instantanément guérie en touchant la soutane du bienheureux. Un enfant, de 12 ans est aussi délivré de la fièvre à la parole du missionnaire qui lui dit : « Ayez confiance en Dieu, mon enfant. » Suivant une pieuse tradition, cet enfant parvint jusqu’à l’âge de 80 ans sans éprouver depuis lors la plus légère maladie.
1C’est pour cela sans doute que saint Jean, XVIII, l’appelle « torrent d’hiver. »
2C’est ce mot qui traduit le mieux le substantif (xioeiov) employé par saint Matthieu et par saint Marc (Vulg., Villa et proedium). Saint Jean parle d’un «jardin » mais dans un sens large.
A la vue de chaque nouvelle guérison les pieux travailleurs éclatent en transports enthousiastes et entonnent le cantique de la reconnaissance avec les accents d’une indicible émotion.
La renommée des merveilles opérées par Montfort dans la lande de la Madeleine, allant toujours grandissant, parvient jusqu’aux extrémités de la France et passe au-delà de nos frontières. Ce ne sont plus nos provinces les plus éloignées qui envoient leurs habitants au Calvaire du Bienheureux Montfort, ce sont aussi les nations étrangères qui tiennent à concourir à l’érection du nouveau Golgotha. « J’ai vu des peuples y venir de tous côtés, dit M. Ollivier. Il y en avait d’Espagne et même de Flandre. » Le moyen le plus efficace dont il plut à Dieu de se servir pour amener au Calvaire les peuples des contrées éloignées, ce fut la multitude des miracles opérés au loin et dans toutes les directions par la terre emportée de la sainte Montagne.
Au témoignage de M. Ollivier, on présenta à l’Evêché de Nantes une liste de cent cinquante miracles opérés de la sorte.
Aussi partout on se plaisait à répéter le couplet prophétique.
« Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles,
Que de conversions,
De guérisons, de grâces sans pareilles.
N° 2 Février 1927
Première restauration – Nouvelle destruction 1748
Les saints ne meurent jamais tout entiers ; leurs œuvres restent.
Mais il en est qui se survivent d’une manière plus particulière. Ce sont ceux dont Dieu se sert, comme il s’est servi de Montfort pour féconder son Eglise et faire naître en son sein, une nouvelle famille religieuse. Nous ne faisons que traduire ici les paroles de l’Oraison chantée à Rome, au jour de sa Béatification.
Il semble, un moment, que le premier de ses fils, son digne successeur dans le gouvernement de cette famille, est appelé, lui-même, à relever les ruines de la nouvelle Jérusalem, et à réaliser le grand dessein, pour lequel notre Bienheureux a dépensé tant de sueurs et de fatigues, a subi tant d’épreuves et d’humiliations.
Près de quarante ans se sont écoulés depuis les événements que nous avons essayé de décrire, lorsque les fils de Montfort, ayant à leur tête le R. P. Mulot, de sainte mémoire, sont appelés à Pontchâteau, pour y donner une grande Mission. Ils y sont accueillis comme le Père lui-même. Tous les anciens souvenirs semblent revivre.
Et au lendemain de cette Mission, abondante en fruits de salut, c’est avec la même piété, la même ardeur, le même élan, que les travaux sont repris sur la lande de la Madeleine. On y chante les mêmes refrains ; et l’on croit entendre comme un écho de la voix de Montfort, qui suffit à mettre l’enthousiasme dans tous les cœurs.
Cette fois, il semble que rien ne viendra entraver la grande et pieuse entreprise. Tout la favorise, au contraire. Pendant la Mission même, le premier représentant de l’autorité, dans la province, le duc de Penthièvre, gouverneur général de Bretagne, allant de Rennes à Nantes, a mis pied à terre à Pontchâteau. Sur la demande qui lui en est faite, il lève gracieusement la défense portée sous le règne précédent de réédifier le Calvaire. Bien plus, à son retour de Nantes, il tient à paraître lui-même sur la lande de la Madeleine, et à encourager de sa présence les travailleurs. Il pose la première pierre du monument qui doit supporter la Croix principale, et y laisse un don de vingt-cinq louis, pour commencer la construction de la chapelle qui doit s’élever près du Calvaire.
De son côté, l’autorité ecclésiastique ne ménage pas son concours. Mgr de la Muzanchère, nouvellement intronisé sur le siège de Nantes, auparavant doyen du Chapitre de Luçon, vient du théâtre des derniers travaux de Montfort. Il a vu à l’œuvre ses enfants et successeurs dans de nombreuses Missions.
Il profite d’une de ses premières sorties dans le diocèse, pour s’arrêter à Pontchâteau, et faire visite, au Calvaire. Il y est accompagné par ses grands vicaires et un grand nombre d’autres prêtres. Sur le monticule, non encore achevé, mais où l’on a déjà planté une petite Croix, il entonne, lui-même, le Vexilla régis. Puis il adresse aux travailleurs et à la foule qui l’a suivi une exhortation pathétique.
Mais, du premier coup d’œil, il a compris qu’il faut là autre chose qu’un amoncellement de pierres et de terre, pour en faire un foyer de vie spirituelle pour son diocèse, ou, si l’on aime mieux, puisqu’on a parlé de fort, une véritable forteresse pour la défense de la vraie foi, dans toute cette contrée. Il faut des gardiens du Calvaire, il faut des desservants à cette chapelle, déjà à moitié construite.
Et à qui peut être offert, peut échoir ce poste, si ce n’est aux enfants et héritiers de Montfort lui-même ?
Le R. P. Mulot ne peut qu’acquiescer à la demande du pieux Evêque. De son côté, le digne curé de Pontchâteau entre, de tout cœur, dans les vues du premier Pasteur du diocèse. Et c’est sur son initiative, que toutes les autorités de la petite ville s’empressent de faire les démarches nécessaires pour la prompte réalisation de ce projet.
Mais on avait compté sans la haine et aussi sans la puissance de la secte Jansénienne, chez qui la seule annonce de l’Etablissement projeté avait excité une véritable fureur. On a peine à comprendre, à distance, la force dont disposait cette affreuse hérésie, qui, anathématisée par le Saint-Siège, s’obstinait à rester dans le sein de l’Eglise, pour le mieux déchirer et y exercer secrètement les plus épouvantables ravages.
Mais, les faits sont là pour l’attester. Une lettre ministérielle désavoue tout ce qu’a fait et permis le gouverneur général de Bretagne, duc de Penthièvre, et ordonne, de nouveau, la destruction du Calvaire.
Sous la même pression, le Gouverneur de Nantes, seigneur de Pontchâteau, M. de Menou, retire l’autorisation d’établir une résidence au pied du même Calvaire.
L’heure de la réparation et de la glorification n’était point encore venue. Le P. Audubon, que son Supérieur, le R. P. Mulot, avait laissé là, pour présider les travaux, et qui habita, près de deux ans, la maison noble du Deffais, dans la forêt de la Madeleine, se hâta de faire, sans appareil et comme en cachette, la bénédiction du monument inachevé.
N° 3 Mars 1927
Le Calvaire pendant la Révolution
Le Calvaire demeura seize ans dans l’état où l’avait laissé le Père Audubon. En 1764, les croix des deux larrons tombèrent : Les figures furent déposées dans la chapelle. Dix ans plus tard, la croix principale tomba également et le calvaire demeura privé du signe de la Rédemption jusqu’à ce que les Fils de Montfort revinssent l’y ériger de nouveau. En 1782, ils donnèrent encore une mission à Pontchâteau. Les Missionnaires étaient les Pères Javelot, Aérien, Renaud, Suppiot, Arquet et Méquignon. Ils reçurent l’accueil le plus sympathique de la part du vénérable M. Audrain, Curé de Pontchâteau et de ses vicaires.
M. Audrain était né au village de la Lande en Pontchâteau, le 2 novembre 1725. Comme il n’entra au séminaire que vers l’âge de 25 ans, il avait assisté à la mission donnée par le Père Mulot, en 1747, et avait pris part aux travaux de la première restauration du Calvaire. « Ordonné prêtre, en 1752, M. Audrain devint immédiatement vicaire dans sa paroisse natale, où il se fit promptement apprécier par sa science et son dévouement sacerdotal. Aussi grande fut la joie de ses compatriotes lorsque, douze ans plus tard, le 18 Juillet 1764, ils le saluèrent du titre de Recteur ou Curé (M. l’Abbé Audrain, Curé de Pontchâteau, par M. l’abbé Marchand).
La population de Pontchâteau partageait les sentiments de son Curé à l’égard des Missionnaires. Elle les accueillit comme elle eut accueilli Montfort lui-même dont le souvenir était toujours chez elle en grande, vénération. Du 5 mai, jour de l’ouverture de la mission, jusqu’au 15 juin, jour de la clôture, on accourut en foule entendre la parole de Dieu. Le Calvaire fut restauré autant qu’on pouvait le faire et trois nouvelles croix furent plantées sur la montagne. Les fruits de la mission furent sérieux et durables.
« En 1787, à la visite pastorale, M. Audrain pouvait affirmer avec une légitime fierté, que le nombre des communiants s’élevait à trois mille dans sa paroisse (Abbé Marchand, Revue mensuelle de la Conférence Grignon de Montfort de Pontchâteau). »
Viennent les jours mauvais, les habitants de Pontchâteau seront prêts à tout affronter pour la défense de leur foi et de leurs prêtres. « Ils pouvaient d’ailleurs être fiers de leurs prêtres en face de la persécution religieuse. Trois furent martyrs ; tous ont été confesseurs de la foi (Abbé Marchand, ibid). »
Jamais l’on ne put réussir à établir à Pontchâteau de prêtres assermentés. Un bon nombre de prêtres chassés de leur paroisse pour refus de serment s’y étaient retirés comme dans un refuge assuré. Ainsi les abbés Mahé, recteur de S. Lyphard, Moyon, recteur d’Auverné, Ménard, recteur de S. Dolay, Guihéneuf, recteur de la Renaudière, Charbonneau, chanoine, Mahé, vicaire de Saint-Herblain, Cousin, vicaire de Sion, étaient venus habiter Pontchâteau.
Les deux commissaires nommés par les districts de Guérande les jugeant coupables d’éloigner les fidèles des prêtres constitutionnels établis dans les paroisses voisines obligèrent de partir pour Nantes ces vénérables ecclésiastiques ainsi que les deux vicaires, les abbés David et Richard. Le 12 février 1792, la municipalité de Pontchâteau réunit les habitants de la commune dans le cimetière. Une pétition réclamant énergiquement au nom de la liberté le renvoi de ces prêtres fut rédigé, signée et expédiée sur l’heure. Ce document qui fait grand honneur aux habitants de Pontchâteau mérite d’être cité en partie :
« L’assemblée, considérant que la paix qui avait toujours régné dans cette municipalité jusqu’au neuf janvier de la présente année y règne encore malgré quantité d’espèces de lettres de cachets notifiées les dits jours à Messieurs les vicaires et prêtres de cette paroisse par lesquelles il leur est enjoint de se rendre le onze du dit mois au chef-lieu du département sous peine d’y être conduits par la force armée. Attendu, est-il dit, que leur présence nuit au culte salarié. Tous ces Messieurs ont obéi sur le champ ; mais que celle paix si précieuse serait infailliblement troublée si on se refusait à la supplique des habitants pour le prompt retour de leurs vicaires et autres ecclésiastiques de la paroisse, Considérant de plus la dite assemblée que le culte salarié n’étant point établi dans la paroisse de Pontchâteau les prêtres qui y résident ne pouvaient le troubler, que la généralité et presque la totalité des habitants étant inviolablement attachée au culte de la Religion Catholique, Apostolique et romaine, qui était celle de leur pères et au pasteur qui les gouverne depuis près de quarante ans et qui ainsi que ses coopérateurs jouissent de leur confiance, ils sont bien décidés à ne pas suivre les étrangers qu’on voudrait y substituer, qu’il n’est d’ailleurs que très notoire que le trouble dont on se plaint dans les paroisses vient uniquement de l’inconduite, de l’intolérance et des vexations des curés constitutionnels qui veulent forcer les fidèles à les suivre contre le décret formel qui accorde à chacun la liberté du culte ; considérant enfin que les dits arrêtés contiennent des dispositions purement arbitraires, contraires aux principes de la constitution et notamment à la liberté religieuse et individuelle, l’Assemblée a arrêté et arrête que les arrêtés du directoire du département et du district de Guérande seront dénoncés au roi comme inconstitutionnels, arbitraires, oppressifs, contraires à la liberté religieuse et individuelle, propres à exciter les plus grands troubles en privant de la liberté de leur culte presque la totalité des habitants des campagnes du département, que des exemplaires du dit arrêté seront envoyés au ministre de l’intérieur et que sa Majesté sera suppliée de les supprimer, de défendre aux administrateurs de la Loire-Inférieure et du district de Guérande d’en poursuivre l’exécution, enfin qu’à la diligence du procureur de la commune il sera notifié au district de Guérande que la commune de Pontchâteau regarde comme inconstitutionnels et oppressifs les arrêtés des six juin et neuf décembre derniers… que comme tels ils ont été dénoncés au chef suprême de l’administration, qu’elle proteste contre leur exécution même provisoire, et qu’elle charge la municipalité de s’y opposer de toutes ses forces (Archives de la mairie de Pontchâteau )…
N° 4 Avril 1927
Seconde restauration du Calvaire 1823-1824
Durant les années 1823 et 1824, M. Gouray ne demeura pas inactif. Il s’efforça de rendre plus attrayant les pèlerinages du Calvaire du Bienheureux de Montfort. S’il convenait à un sanctuaire de posséder une relique de la Vraie Croix c’était bien à celui du Calvaire. M. Gouray adressa une supplique à Rome et il eut la joie d’obtenir la précieuse relique. Sa translation au Calvaire sera l’objet d’une splendide manifestation dont nous parlerons bientôt.
A cette époque, le Calvaire du Père Montfort (c’est ainsi que le nomma toujours M. Gouray) était éloigné de toute habitation.
Les maisons les plus rapprochées étaient celles du village des Métairies. C’est là que devaient aller les pèlerins pour étancher leur soif. Il y avait bien une source à quatre cents pas du Calvaire, c’est l’eau de cette source, d’après la tradition, qui avait désaltéré la Bienheureux de Montfort et ses travailleurs. Mais cette source servait alors d’abreuvoir au bétail : puis elle s’était souvent tarie pendant l’été. M. Gouray fit creuser une fontaine « pour la commodité des pèlerins (Compte rendu de la cérémonie de la translation de la Vraie Croix). »
Le 14 mai 1825, le maire de Pontchâteau lut au Conseil municipal une lettre de M. Gouray par laquelle celui-ci : « demandait à être autorisé à faire construire sur le terrain communal, hors de l’enceinte des douves du Calvaire de la Madeleine, un petit édifice de dix à quinze pieds. Cet édifice serait destiné à servir de sacristie où seraient déposés à l’avenir les ornements sacerdotaux et autres objets nécessaires à l’exercice du culte, lesquels se détériorent promptement dans II chapelle du Calvaire qui, en raison de sa position, se trouve être très humide. » Comme la construction projetée ne devait rien coûter à la commune, la demande fut accordée1.
M. Gouray ne donna pas suite à ce projet. Mais il profitera de cette autorisation pour faire construire en 1843, une maison pour servir de logement aux desservants du Calvaire.
Le 22 juillet 1825, le tonnerre éclata sur le Calvaire. M. l’abbé Bertho raconte ainsi le fait : « M. Vaillant, curé de Sainte-Reine, disait la messe à la Chapelle du Calvaire. Pendant le dernier évangile, la foudre tomba sur la principale croix du Calvaire qu’elle endommagea surtout à la base, et dont elle détacha 25 cœurs de plomb doré, en les faisant voler de tout côté sur la butte. Toutes les personnes présentes furent saisies d’effroi et tombèrent à genoux. M. Vaillant lui-même fut tellement effrayé, qu’il oublia de faire la génuflexion au dernier évangile. « J’ai eu peur, disait-il ensuite, j’ai cru que le tonnerre était tombé sur la chapelle2. »
TRANSLATION D’UNE RELIQUE DE LA VRAIE CROIX
« Le 8 septembre 1825, on fit la translation de l’église paroissiale au Calvaire d’une parcelle de la Vraie Croix, reçue de Rome et destinée à bénir les fidèles après le chemin de le Croix3. Cette cérémonie fut des plus célèbres et demande ici une petite relation4. »
… « On célébra d’abord une messe solennelle, dans l’église paroissiale, à 8 heures du matin, M. Bizet, chanoine honoraire, chef de la mission, y prêcha sur le culte intérieur et extérieur dû à la Croix.
Après la messe, la procession se mit en marche dans le plus bel ordre. Elle était ouverte par la gendarmerie à cheval, qui fit preuve d’un zèle admirable et des sentiments les plus religieux.
Un groupe déjeunes filles, vêtues de blanc, portaient à la tête de la procession, la statue de la Sainte Vierge, sur un brancard richement orné. Après elles, venaient les Sœurs du Tiers-Ordre, humbles filles, moins séparées du monde par leur habit que par leur vie innocente et l’ardeur de leur charité.
Suivaient deux rangs d’étendards, dont deux mille sept cents de couleur blanche et ornés d’une croix rouge, étaient portés par autant de filles ou de femmes : les autres, au nombre de douze cents et de couleur rouge, étaient portés par des hommes.
Entre les rangs, de distance, en distance, marchaient les croix et les bannières de neuf paroisses : Pont-Château, Crossac, Sainte-Reine, la Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim, Montoir, Missillac, Sévérac et Saint Gildas. Plusieurs de ces paroisses se trouvèrent sur la route et prirent place dans les rangs, entr’autres celle de Montoir, venue processionnellement de 4 lieues, et dont un grand nombre de jeunes gens, qui avaient pour costume habit bleu, pantalon blanc, ceinture rouge, avaient porté, pendant toute la route, la statue de la Sainte Vierge. Les femmes la reprirent dans la lande de Pont-Château.
Vingt-six prêtres en aube assistaient à la cérémonie. Douze jeunes clercs aussi en aube, avec des ceintures rouges, portaient, les uns, un brancard, où étaient croisées la lance et l’éponge avec la couronne d’épines fixée au milieu, les autres, des branches de laurier.
Sur le passage de la sainte Relique, huit jeunes enfants vêtus de blanc et couronnés de verdure, jetaient des feuilles et des fleurs. Le dais, sous lequel M. Bizet portait la précieuse parcelle de la vraie Croix, était porté par des bourgeois de la ville. Aux quatre coins flottaient les quatre étendards de la Mission portés par des jeunes gens. Les autorités, entourées de la Garde Nationale, formaient la marche, et derrière elles une foule innombrable de peuple.
Au moment où la sainte Relique sortit de l’église, la Garde Nationale fit une décharge de mousqueterie.
Après une demi-lieue de marche, la procession qui occupait presque tout cet espace, arriva sur la lande, (cette lande qui a plus d’une lieue de tour, s’élève de tous côtés en plateau). Alors, les deux rangs d’étendards s’ouvrirent, laissant entr’eux une distance de 600 pas, puis, ils se réunirent à l’entrée du calvaire. Les croix, les bannières et les groupes dont nous avons parlé, continuèrent cependant leur marche, et se rendirent directement.
Les rangs des femmes qui portaient les étendards blancs, se replièrent sur les terrasses au bas du Calvaire. Les hommes au contraire montèrent sur la plate-forme, et se rangèrent en groupe au pied des trois croix. Avons-nous besoin de dire quel admirable effet devaient produire douze cents étendards rouges, flottant comme des flammes, au haut de cette colline, et contrastant par leur vif éclat avec la blancheur des aubes et des autres vêtements de la fête ?
Alors, on célébra la sainte Messe dans la chapelle du Calvaire. Quinze ou dix-huit mille personnes, répandues sur la lande, autour du Calvaire, s’unissaient au Saint-Sacrifice, en chantant des cantiques avec une ferveur admirable. La messe fut suivie d’un sermon prêché par l’un des missionnaires (M. Leray) lequel, placé aux pieds de la statue du vénérable Grignion de Montfort, cet ardent prédicateur du mystère de la Croix, semblait en traitant le même sujet, accomplir les vœux de cet homme apostolique, dans un lieu qui lui fut si cher.
1Abbé Marchand
2Abbé Marchand
3On faisait alors tous les dimanches le chemin de la Croix au Calvaire
4Abbé Gouray. Supplément aux registres de paroisse, p. 32
Après le sermon, la sainte Relique fut portée processionnellement autour de la montagne, tout le monde chantant l’hymne Vexilla Régis. Le circuit achevé, M. Bizet, précédé de tout le clergé, monta sur la plateforme la plus élevée du Calvaire, d’où il donna la bénédiction de la vraie Croix à la foule innombrable que cette touchante cérémonie avait attirée. Nous laissons à l’imagination de nos lecteurs, ou plutôt aux âmes capables de sentir, le plaisir de se peindre à elles-mêmes le spectacle de cette multitude prosternée dans un religieux et profond silence sur les degrés du Calvaire, sur les terrasses, et tout à l’entour, sur cette vaste lande, et recevant avec une humble foi, dans les bénédictions célestes, le prix de ses travaux, de ses sueurs, de ses sacrifices et de sa piété.
La cérémonie finit par le chant du Te Deum, et la bénédiction d’une fontaine creusée à trois cents pas du Calvaire pour la commodité des pèlerins.
Nous ne terminerons pas ce récit sans parler de la vive expression de joie que laissaient éclater, en se retirant, tous ceux qui avaient vu ce beau spectacle. Il y en avait qui étaient venus de 6, 7 et 8 lieues, qui étaient exténués, n’ayant, par dévotion, pris aucune nourriture, et qui s’en retournaient tous occupés de leur bonheur, en chantant de pieux cantiques, sans songer à leur besoin. Fervents chrétiens, ils ne perdront jamais ce souvenir ; ils le transmettront à leurs enfants de génération en génération : ils le viendront ranimer au pied de ce même Calvaire, objet de la vénération du pays depuis plus de cent ans, et en demeurant fidèles à Jésus crucifié, par une dévotion simple et sans ostentation, ils assureront leur bonheur pour le temps et l’éternité.
N° 5 Mai 1927
La seconde restauration du Calvaire (suite)
Les travaux
Nous croyons devoir mettre ici sous les yeux de nos lecteurs la brève description faite par M. Gouray de l’état du Calvaire avant la Révolution et avant sa deuxième restauration. « Ce Calvaire avait, avant la révolution de 1793, une petite chapelle placée au nord de la montagne, et qui lui était contiguë, ce qui la rendait très humide. La montagne avait une partie de la forme actuelle. Auprès de cette montagne, on avait jeté les fondations de plusieurs petites chapelles dont la plus grande n’aurait pas été de 10 pieds carrés. Ces chapelles ne furent jamais terminées. La montagne était couronnée de trois croix. Telle était à peu près ce Calvaire, lorsqu’en 1793, il subit le sort des monuments religieux. La chapelle principale fut incendiée, les croix renversées et brisées. Vers l’année 1802, des pieux fidèles des environs y firent placer trois petites croix qui ont été remplacées par celles qu’on y voit maintenant1. »
M. Gouray parle ensuite de ses démarches en vue d’obtenir l’autorisation de restaurer le Calvaire, puis des préparatifs et des travaux. — « Le 5 février 1821, on commença la démolition des ruines de l’ancienne chapelle. On creusa ensuite la montagne pour y placer la chapelle actuelle. Ces travaux furent longs et pénibles. Des milliers de bras y concoururent jusqu’au mois de juin 18212. »
Le recteur de Besné est plus explicite sur ces travaux préparatoires à la construction de la chapelle : « On commença par préparer l’emplacement de la nouvelle chapelle, qui est à 30 pieds de l’ancienne, au sud et précisément à l’endroit où était autrefois le Saint-Sépulcre. On éleva un contre mur pour appuyer les terres de la montagne qu’il fallait creuser à une distance de 40 pieds et de 30 de hauteur. Ce travail était difficile ; mais les travailleurs pleins de zèle et de courage, en vinrent bientôt à bout, et l’emplacement de la chapelle fut creusé et aplani en peu de temps3. »
« Le 1er mars 1821, on fit la pose de la première pierre de la chapelle. Elle porte cette inscription : « J’ai été placée par M. Dufeugray, sous-préfet de l’arrondissement de Savenay et bénite par M. Gouray, curé de Pontchâteau, 1er mars 1821. » Cette pierre se trouve dans le fondement de l’angle de la partie latérale, au midi de la chapelle.
MM. les Curés de Sainte-Reine, Crossac, Saint-Joachim, Besné, Missillac, Sévérac, les vicaires de Pontchâteau et Campbon y assistaient. Les autorités civiles, la garde nationale du lieu et près de 3000 âmes étaient présentes4. « A la fin de la cérémonie, M. le Sous-préfet prononça un discours sur les avantages de la légitimité, sur la protection que nos Princes accordaient à la religion et sur la nécessité du bon accord entre les autorités civiles et ecclésiastiques5. »
— « Les travaux de la montagne du Calvaire continuèrent pendant presque toute l’année, surtout ceux de la chapelle, des croix, etc.6 »
Non seulement les paroissiens de Pontchâteau, mais les habitants des paroisses voisines, leurs curés en tête, se rendaient avec empressement travailler au calvaire. M. Gouray aimait à passer au milieu d’eux tout le temps dont il pouvait disposer, stimulant leur ardeur par quelques paroles brûlantes, leur rappelant le souvenir du Bienheureux de Montfort et le zèle de leurs ancêtres pour la belle œuvre du Calvaire. Il leur racontait les merveilles accomplies en ce lieu privilégié. Ainsi le travail se poursuivait avec une prodigieuse activité, activité excitée encore par les nombreuses faveurs accordées alors au Calvaire par l’intercession du Bienheureux de Montfort. On a consigné dans les archives de la compagnie de Marie les paroles de M. Gouray au Père Deshayes : « On assure que de nombreux malades sont guéris par l’eau des douves : je me contente d’en bénir Dieu. » Tout en travaillant, on chantait avec entrain les cantiques du Bienheureux de Montfort ainsi que celui de M. Gouray. Aussi ne se lassait-on pas de venir travailler au Calvaire et durant les années 1821 à 1822 l’on fournit gratuitement un nombre considérable de journées de travail. Voici une note de M. Gouray à ce sujet :
« Sommaire des journées données gratis au Calvaire pour reconstruire la montagne en 1821 et 1822.
Pontchâteau 4550 journées
Sainte-Reine 1810 »
Missillac 2110 »
Les Marais 1906 »
Crossac 1307 »
Saint-Joachim 1110 »
Besné 937 »
Prinquiau, Drefféac, Campbon, Donges, Saint-Dolay,
Saint-Gildas, Montoir et autres paroisses 3305 »
17035 journées7. »
DESCRIPTION DU CALVAIRE
M. Gouray donna à la nouvelle butte 13 mètres d’élévation et la couronna d’une claire-voie soutenue par 16 piliers. La plate-forme avait 11 pieds de diamètre. C’est au milieu de cette plate-forme que fut plantée la croix de Notre-Seigneur. Elle avait 51 pieds de hauteur ; les deux autres avaient 41 pieds chacune ; des douves, larges de 9 mètres et profondes de 4, formant un circuit de 300 mètres, environnaient la butte du Calvaire qui avait la forme d’un cône tronqué, avec une large échancrure à l’un des côtés de la base pour y faire entrer la nouvelle chapelle. Un mur de 200 mètres de circonférence, soutenait les terres d’une terrasse ; un second mur de 124 mètres soutenait les terres de la butte.
La nouvelle chapelle avait 45 pieds de long et 21 de large. Deux escaliers, chacun de 63 marches, qui partaient des deux côtés de la chapelle, conduisaient au sommet de la montagne8.
LE CHRIST
M. Gouray ne négligeait rien de ce qui put donner au Calvaire plus d’attrait pour la piété des fidèles. Les statues placées par le Père de Montfort et rapportées au Calvaire en 1748 avaient été réduites en cendres pendant la Révolution. Mais la principale avait été préservée des flammes. Le Christ avait été donné par M. le Curé de Saint-Similien aux Missionnaires de la Compagnie de Marie probablement dès 1728, à la suite d’une mission que ceux-ci venaient de faire dans sa paroisse. Cette précieuse relique était à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1748, et elle s’y trouvait encore. M. le Curé de Pontchâteau fit des démarches auprès du Révérend Père Deshayes pour obtenir le retour du Christ au Calvaire de Pontchâteau. Le magnanime Supérieur de la famille de Montfort, qui avait toujours en vue la plus grande gloire de Dieu et le plus grand bien des âmes, se rendit volontiers au désir de M. Gouray. Ainsi de telles âmes ne peuvent pas ne pas se comprendre. M. le Curé de Pontchâteau eut la grande joie de pouvoir replacer sur le Calvaire, le Christ de Montfort, ce Christ, cause et compagnon des prodigieuses humiliations de l’homme apostolique, ce Christ pour lequel il s’était fait mendiant à Saint-Brieuc et que dès lors il avait entrepris de glorifier, ce Christ comme lui rejeté de sa ville natale ; ce Christ devant lequel avaient été répandues tant de larmes et de prières durant les travaux du Calvaire, alors l’objet de tant d’honneur de la part des fidèles, puis devenu tout à coup signe de contradiction, outragé par les uns, vénéré par les autres d’une manière si touchante ; ce Christ que Montfort avait porté sur ses épaules et pour lequel il avait supporté de si rudes fatigues et de si sanglantes avanies ; ce Christ dont il avait annoncé le glorieux retour au Calvaire et qui allait enfin être replacé sur la sainte montagne comme sur son trône d’honneur.
1Supplément aux registres des paroisses, p. 32.
2Supplément aux registres des paroisses, p. 32
3Abbé Le Maistre, p. 55
4M. Gouray, Supplément aux registres de paroisse
5Recteur de Besné, p. 54
6M. Gouray, ibid
7Supplément aux registres de paroisse
8Abbé Marchand, abbé Le Maistre
LA BÉNÉDICTION DU CALVAIRE
Pour préparer sa paroisse à la grande cérémonie de la bénédiction du calvaire et de la chapelle, M. Gouray fit donner une grande mission qui s’ouvrit par une procession solennelle du Saint-Sacrement. La veille de l’ouverture de la mission, le maire, M. Lescot, fit faire une publication à ses administrés : « Le maire invite les habitants du chef-lieu de cette commune à ne rien laisser sur les rues et places publiques de ce qui peut nuire au passage des habitants et des voyageurs, spécialement dimanche prochain, 1er du présent mois (octobre), jour de l’ouverture de la mission, où il sera fait une procession du Saint-Sacrement. Les rues devront être soigneusement nettoyées et balayées. »
— « La bénédiction du Calvaire eut lieu le 23 novembre 1821. Mgr d’Andigné de Mayneuf, évêque de Nantes, fit cette bénédiction ainsi que celle de la chapelle du Calvaire. M. l’abbé Bodinier, Vicaire général, y dit la première messe, le même jour. Trois Vicaires généraux du Diocèse, M. Deshayes, Supérieur de Saint-Laurent-sur-Sèvre, trente-sept Curés et vicaires du diocèse, la garde nationale, les autorités locales, environ 10.000 âmes assistaient à cette auguste cérémonie. Le Christ de la principale croix est le même que le feu M. de Montfort avait placé au Calvaire, il y avait 112 ans, et que M. le Supérieur de Saint-Laurent avait bien voulu nous céder et nous envoyer de Saint-Laurent où il avait été transporté après la première destruction, 17101 »
Les anciens, qui tant de fois avant la Révolution avaient prié dans ce lieu, ne pouvaient retenir leurs larmes. M. Gouray n’était pas le moins ému. Mais surtout il se réjouissait du bien que la reprise des pèlerinages allait produire dans toute la région (Abbé Marchand.).
ERECTION DU CHEMIN DE LA CROIX (1822)
Dès l’année suivante, M. Gouray fit ériger le chemin de Croix et placer dans la chapelle du Calvaire les statues de Saint Louis et de Sainte Hélène. Voici la note qu’il nous a laissée à ce sujet.
« Le neuf septembre 1822, M. Bochet, Vicaire général capitulaire (sic), fit la bénédiction du Via Crucis, Quatorze ecclésiastiques y assistèrent en aube. — Les autorités comme ci-dessus, (comme l’année précédente), MM. les Missionnaires prêchèrent à toutes les stations. Ces Messieurs venaient de donner une retraite à la paroisse. L’année précédente, du 1er octobre au 23 novembre, ils avaient donné une mission à la même paroisse.
Le 9 décembre 1822, les statues de Saint Louis et de Sainte Hélène furent portées processionnellement au Calvaire 2».
N° 6 Juin 1927
Seconde restauration du Calvaire (suite)
Ordonnance de Mgr de Guérines, évêque de Nantes (13 décembre 1825)
A M. Gouray seul incombait jusqu’alors la responsabilité de la nouvelle restauration du Calvaire. C’est lui qui en avait pris l’initiative, fait les démarches nécessaires, fait appel à la population, obtenu les ressources indispensables en nature et en argent, dirigé les travaux. Il ne devait de compte et n’en avait rendu à personne, puisqu’il était seul responsable.
Il crut le moment venu de se décharger d’une partie de sa responsabilité, en la faisant partager à la fabrique. Il rendit d’abord compte à son évêque de la gestion de son œuvre ; il le fit de son plein gré, dans le but de montrer, ce dont personne ne doutait, qu’il avait été l’administrateur intègre et pleinement désintéressé des deniers du Calvaire. Puis il obtint de Mgr de Guérines l’ordonnance suivante, qui contient avec de précieuses faveurs, d’importants règlements.
Ordonnance épiscopale concernant le Calvaire
Joseph M.-J. B.-Auguste Micolon de Guérines, par la miséricorde de Dieu et la Grâce du Saint-Siège apostolique, évêque de Nantes,
Ayant égard aux différentes demandes que nous a faites M. le Curé de Pontchâteau concernant le Calvaire élevé dans la commune, par les soins des habitants et par le concours de plusieurs paroisses environnantes.
Vu l’état qu’il nous a présenté des travaux qu’il a fait exécuter et l’ensemble du compte qu’il nous a rendu des libéralités de chaque paroisse, soit des journées de travail qui se sont élevées à 17.233 (Du 5 février 1821 au mois de décembre 1825), soit en offrandes en numéraires, qui se sont montées à la somme de 9.522 fr. 15.
Vu pareillement le compte qu’il nous a rendu de l’emploi de la dite somme, dont il résulte qu’il ne reste en caisse à ce moment que celle de 221 fr. 30, la dépense s’est élevée à 9.300 fr. 85.
Ayant pris connaissance du produit des offrandes des années précédentes qui font présumer, année commune, une recette d’environ 900 fr., ainsi que des réparations considérables qui restent à faire pour achever l’ouvrage.
Vu le désir que le sieur Gouray, curé, nous a exprimé de ne pas rester seul à l’avenir, chargé de la perception des dites offrandes.
Vu enfin la demande qu’il nous a faites de statuer par un règlement sur les services religieux qu’il conviendrait d’établir pour exciter et maintenir la dévotion qui amène à ce pieux monument un grand concours de peuple.
Considérant en premier lieu que l’érection du Calvaire est un témoignage subsistant de la piété des paroisses qui l’ont édifié et de leur entière confiance dans le pasteur qui y a donné ses soins, que nous devons nous-même des encouragements à cette œuvre et de la reconnaissance à leur auteur.
Considérant en deuxième lieu que néanmoins dans les premiers temps l’ardeur des fidèles et confiance particulière dans le pasteur, son zèle et la difficulté de l’entreprise ne permettaient pas de confier à une administration, une opération de cette nature, il convient cependant, pour en assurer la stabilité, d’en attribuer pour l’avenir la surveillance au Conseil de fabrique concurremment avec le curé de la paroisse.
Considérant en troisième lieu que la connaissance que nous avons prise et l’examen que nous avons fait des différentes pièces de comptabilité, nous ont prouvé que M. le Curé a mis autant d’exactitude dans ses comptes qu’il a apporté de zèle dans les constructions et qu’il convient de lui donner une décharge de toute la gestion pendante, quoique faite de sa part sans obligation de responsabilité.
Considérant enfin qu’il nous appartient de statuer sur les services religieux de la chapelle du Calvaire qui en dépend et de fixer les honoraires des dits services.
Nous avons statué et statuons par les présentes : Article premier. — Nous approuvons autant qu’il est en nous les travaux exécutés pour la construction du Calvaire, nous applaudissons au zèle des fidèles et au dévouement de M. le Curé. Voulant encourager la dévotion dont le pieux monument est l’objet, nous accordons à perpétuité une indulgence de quarante jours, à tous ceux qui iront faire les stations du chemin de la croix ou qui assisteront à la messe pour les bienfaiteurs.
Art. 2. — Nous donnons à M. le curé de Pontchâteau, pleine et entière décharge de toute la gestion précédente et nous approuvons les comptes qu’il nous a rendus à ce sujet.
Art. 3. — Nous nommons pour surveiller à l’avenir la perception des offrandes concurremment avec lui la fabrique de l’église de Pontchâteau. Le compte des recettes du Calvaire sera tenu sur un registre séparé de celui de l’église pour être le produit des dites offrandes entièrement employées conformément aux intentions, à l’entretien de la chapelle, de son mobilier, aux honoraires des fonctions ci-après spécifiées, à l’achèvement de l’édifice. Sa construction achevée, l’excédent des recettes sur la dépense ordinaire pourra recevoir une autre destination d’utilité générale aux communes ou paroisses qui y auront contribué.
Art. 4. — Nous ordonnons : 1° Qu’il sera célébré chaque mois, le premier vendredi qui ne sera pas empêché, une messe pour les bienfaiteurs de l’œuvre, qu’il en sera dit également une le jour de l’Invention et celui de l’Exaltation de la Croix ; elles seront annoncées au prône de la messe paroissiale. L’heure en sera fixée pour la commodité des habitants qui voudraient y assister et la rétribution de chaque messe sera de trois francs.
2° Que les prières du chemin de la croix seront récitées tous les dimanches de l’année non empêchés, aux diverses stations, et dans le cas d’empêchement un autre jour de la semaine ; l’honoraire de cette cérémonie sera rétribué chaque fois 2 fr. à M. le Curé.
3° La fabrique devra fournir au blanchissage du linge, aux réparations des ornements, au luminaire de la chapelle ; elle recevra pour ces services 60 fr.,
4° Les messes de dévotion qui seront demandées seront rétribuées à 3 fr. à raison de l’éloignement.
5°Enfin le Conseil de fabrique déterminera, sur la proposition de M. le Curé, les réparations à faire pour achever le monument, le procès-verbal de notre visite indique spécialement celles qui tiennent à la décoration de la chapelle, et fait connaître son dénuement de calices, d’ornements, de linges, la réparation du tableau de l’autel et de l’entablement, la nécessité de construire des armoires ou commodes pour les ornements, enfin le besoin qu’il y aurait de repeindre le Christ ; de réparer l’escalier et surtout de fermer le Calvaire par une enceinte qui en interdise l’entrée aux bestiaux. Les réparations seront faites au moyen des premiers fonds disponibles.
Donné à Nantes, en notre palais épiscopal, sous notre seing et le sceau de nos armes, le contreseing de notre secrétaire, le treize décembre mil-huit-cent-vingt-cinq.
JOS, évêque de Nantes.
Par Mandement de Monseigneur.
ANGEBAULT, chan. secret,
enregistré le 20 décembre 1825.
GOURAY, curé.
NOTA. — Par une lettre particulière du 22avril 1827, Mgr l’Evêque de Nantes a accordé la permission de donner solennellement la bénédiction de la vraie croix au Calvaire le 3 Mai et 14 Septembre et de donner la bénédiction, sans cérémonie, de la vraie croix, les dimanches où l’on fait les stations.
(Supplément aux registres de paroisse, p, 4,5, 6, 7).
Cette Ordonnance est d’une grande importance. Elle fait entrer l’œuvre du Calvaire dans une phase nouvelle. Jusque-là, cette œuvre avait été œuvre particulière : d’abord en 1709-1710, œuvre du Bienheureux de Montfort, son fondateur, qui en sera toujours le principal auteur ; en 1747-1748, le Calvaire fut restauré par ses Fils ; enfin, M. Gouray, curé de Pontchâteau, avait pris, en 1819, l’initiative d’une seconde restauration et y travaillait depuis lors avec un grand zèle. En vertu de cette ordonnance l’œuvre du Calvaire devient une œuvre diocésaine, qui aura désormais son autonomie, sa personnalité canonique avec son budget. L’administration en est confiée au Conseil de fabrique de l’église paroissiale de Pontchâteau sous la dépendance de l’Evêque.
Cette Ordonnance est l’origine des droits de la fabrique de Pontchâteau relativement au Calvaire du Bienheureux de Montfort et en détermine la nature et l’étendue. Jusque-là, la fabrique n’avait aucun droit sur le Calvaire dont elle ne s’était jamais occupée. Cette Ordonnance ne donne à la fabrique ni la propriété de l’œuvre, ni la propriété des offrandes des fidèles ; elle lui en confie seulement la perception et l’administration, en en déterminant l’emploi. Jusqu’à l’achèvement complet du monument, toutes devront, selon les intentions des donateurs, être appliquées aux honoraires du service religieux du Calvaire, à son entretien et son achèvement. La Fabrique est chargée du blanchissage du linge sacré et de l’entretien des ornements. La somme qu’elle perçoit pour ces services est déterminée.
Après l’achèvement, une nouvelle Ordonnance déterminera l’emploi de l’excédent des recettes qui même alors ne sera pas la propriété de la fabrique, mais pourra recevoir une destination d’utilité générale aux paroisses qui auront contribué à l’érection du monument.
Enfin des faveurs spirituelles sont accordées aux pèlerins, des exercices fixés et des messes fondées, pour les bienfaiteurs de l’œuvre.
N° 7 Juillet 1927
Monseigneur Jacquemet et le Calvaire de Pontchâteau
Au lendemain des grandes commotions politiques, qui ensanglantèrent une fois de plus les rues de la capitales, (1848), Mgr Jacquemet, dont le nom est inséparable de celui de l’Archevêque-martyr qu’il accompagnait sur les barricades, fut appelé à gouverner l’Eglise de Nantes. Dès le début de son épiscopat, l’éminent prélat vit dans le Calvaire de Montfort une source de grâces et de bénédictions pour son diocèse.
Une occasion se présente bientôt. C’est le grand Jubilé semi-séculaire. Le 26 décembre 1851, à la clôture des saints exercices, dans une lettre adressée à son clergé, il rappelle le pieux usage de ces contrées chrétiennes, où chaque paroisse ne manque pas, à la suite d’une mission ou après avoir reçu quelque autre preuve signalée de la miséricorde divine, d’élever un Calvaire, au moins une Croix, en mémoire des grandes bontés de Dieu. Pour exprimer les sentiments d’action de grâces de tout le diocèse, ce n’est pas l’érection d’un nouveau calvaire qu’il demande, mais il propose à tous ses prêtres de réunir leurs efforts pour faire du Calvaire du vénérable Père de Montfort, en le complétant et en l’embellissant, un monument digne d’être offert à la Majesté divine, dans un sentiment de reconnaissance pour ses miséricordes et d’espérance pour l’avenir.
Il entre dans quelques détails sur les projets qu’il a en vue. Il ne désespère pas, si on lui vient puissamment en aide, de pouvoir réaliser presque complètement la pensée première du saint Fondateur, en faisant représenter par la sculpture les diverses stations de la voie douloureuse, et en rattachant aussi, au Calvaire, le souvenir des pieux mystères du Rosaire.
Les offrandes furent loin d’être ce qu’avait espéré Mgr Jacquemet. Aussi eut-il le regret de ne pouvoir exécuter son magnifique plan.
Le zélé prélat dut renoncer à représenter les quinze mystères du Rosaire en dehors des douves. Les stations du chemin de Croix ne purent être transformées. Toute la restauration consista dans un monument en fonte placé sur le sommet de la montagne et remplaçant les trois croix en bois. Sur la partie antérieure de la base de ce monument était ciselé un double bas-relief, la chute d’Adam et d’Eve, et leur expulsion du paradis terrestre. La base de ce monument avec son double bas-relief est encore à la même place. Il forme le fond de la grotte d’Adam. Sur cette base étaient fixées trois colonnes surmontées de chapiteaux dans lesquels étaient plantées les trois croix. Au-dessus de celui du milieu se trouvait une Madeleine enlaçant la croix de ses bras. Un christ en fonte, le même qui s’y trouve à l’heure actuelle, était placé sur la principale croix. Les deux autres croix étaient sans figures.
1M. Gouray. Supplément aux registres des paroisses, p. 32. Le Christ fut transporté par le Bienheureux lui-même de Pontchâteau à Nantes en 1714. Ce n’est que plus tard, probablement en 1728, que le Curé de Saint-Similien le donna aux fils du Bienheureux qui l’emportèrent alors à Saint-Laurent.
2Supplément aux registres de paroisse, p. 32
Bénédiction du calvaire restauré.
— Mgr Jacquemet fixa la bénédiction de ce monument au 14 septembre 1856.
Voici le dispositif de cette fête :
Evêché de Nantes
Bénédiction
du
Calvaire de Pontchâteau
faite par
Monseigneur l’Evêque de Nantes
le 14 septembre 1856
Dispositif de la Cérémonie
Toutes les paroisses du canton de Pontchâteau et les paroisses voisines sont invitées à assister à la bénédiction du Calvaire de Pontchâteau qui aura lieu le dimanche 14 septembre 1856.
Toutes ces paroisses viendront avec leurs croix et bannières, sous la conduite de leur clergé paroissial.
Tous ceux qui n’auront pas la volonté ou la facilité de marcher en procession pourront se rendre immédiatement au Calvaire.
Tous ceux, au contraire, qui voudront faire partie de la procession se rendront jusqu’à Pontchâteau pour concourir à la procession générale qui partira de l’église de Pontchâteau, à 1 heure précise, pour se rendre au Calvaire.
Mais, pour éviter la confusion qui naîtrait infailliblement d’une réunion si nombreuse, si le rendez-vous général était dans la ville même de Pontchâteau, les dispositions suivantes ont été arrêtées pour procurer le plus grand ordre possible.
1° Aucune paroisse n’aura son point de départ dans la ville même, mais elles s’établiront toutes dès le moment de leur arrivée, en ordre de procession et en dehors de la ville, sur la route qui conduit de Pontchâteau au calvaire.
Pour faciliter ce déplacement, des poteaux seront placés sur la route avec des inscriptions qui indiqueront le lieu où devront s’arrêter les paroisses. Le premier qui sera le plus rapproché de la ville désignera la station qui arrivera la première.
Un deuxième poteau marquera sa place à la paroisse qui arrivera la deuxième. Un troisième servira de signal à la paroisse qui arrivera la troisième, et ainsi des autres.
La population de la ville de Pontchâteau marchera la dernière en procession, elle s’établira en ordre de marche dans les rues de la ville même à midi 1/2 ; elle formera le cortège de Monseigneur l’Evêque, à sa sortie de l’Eglise.
Plusieurs poteaux, les plus éloignés de Pontchâteau, indiqueront les lieux, où devront se placer les paroisses voisines qui ne sont pas du canton, telles que Campbon, la Chapelle-Launay, etc. Ces paroisses devront traverser la ville et s’avancer sur la route, pour former la tête de la procession.
(Il serait à désirer que les paroisses arrivassent assez tôt au lieu qui leur sera marqué, pour que chacun, sans quitter sa place, eût le temps de prendre les aliments qu’il aura eu soin d’apporter : ce serait un moyen de diminuer les fatigues de cette journée).
2° MM. les curés et autres membres du Clergé paroissial seront les maîtres des cérémonies de toute la population, et seront chargés de la tenir en ordre, pendant tout le temps de la cérémonie, sous la direction de M. l’abbé Raguideau, chanoine, maître des cérémonies de la cathédrale, que Monseigneur l’Evêque a désigné comme maître en chef des cérémonies.
C’est par le maître en chef des cérémonies uniquement, que seront donnés tous les ordres généraux,
3° MM. les Curés de toutes les paroisses sont très instamment priés de former autant de chœurs de cantiques qu’ils pourront, parmi les hommes et les femmes de leurs paroisses, afin que le chant des cantiques soit continuel et général sur tous les points de la procession.
Les Cantiques du P. de Montfort seront les seuls que l’on chantera ce jour et surtout ceux qui se rapportent à la Croix et à la Passion de N.-S. J.-C.
4° MM. les Curés sont également priés d’inviter tous ceux de leurs paroissiens qui voudront marcher en procession d’avoir tous à la main un étendard ou une oriflamme. Les hommes autant que possible, auront un étendard rouge, et les femmes des étendards blancs, tous décorés d’emblèmes religieux et surtout d’une croix.
Ceux qui ne pourraient pas se procurer un étendard seront également admis dans les rangs de la procession ; mais ils marcheront devant ceux qui porteront un étendard.
5° A la tête de chaque paroisse seront portées les bannières et les croix. Les femmes marcheront les premières et les hommes à leur suite.
On marchera par rang de quatre personnes, en laissant au milieu le plus grand espace vide que l’on pourra, sur tout le chemin de la procession.
6° A 1 heure précise, Monseigneur l’Evêque, assisté de tout le clergé qui ne sera pas employé à la conduite de la procession, et précédé de ses porte-insignes, fera son entrée solennelle au sanctuaire de l’église de Pontchâteau, pour entonner, à genoux, l’hymne : Vexilla Regis prodeunt.
Après la première strophe, la procession se mettra en marche, en continuant l’hymne jusqu’à la fin.
Ensuite tous les chœurs commenceront leurs chants par le cantique : Vive Jésus, vive sa croix ! et les continueront pendant toute la procession.
7° En arrivant au Calvaire, toute la procession montera par les deux grands escaliers.
Tous les hommes qui porteront un étendard rouge entreront seuls sur la plate-forme du Calvaire, aux pieds des croix. Ils s’y placeront de manière à ne laisser vide aucun point de cet espace, afin que les représentants de toutes les paroisses puissent avoir l’honneur de s’y placer.
Les hommes qui n’auront pas d’étendard rouge, et toutes les femmes se rangeront dans le plus grand ordre, tout autour de la montagne, en se serrant le plus possible, et en garnissant toujours tous les points les plus élevés, afin que toute l’assistance puisse être placée sur la montagne du Calvaire.
8° Lorsque Monseigneur sera arrivé au sommet du Calvaire, au pied de la Croix, des sons de clochette annonceront la fin de tous les chants, et sa Grandeur chantera : Adjutorium nostrum in nomine Domini, — Qui fecit cœlum et terram, etc. — Oremus, Deus qui crucis patibulum… (Rituel, 373.)
Après cette oraison, trois prédicateurs se partageront l’assistance par les trois points les plus opposés de la montagne, et lui adresseront une exhortation pendant un quart d’heure à peu près.
A la fin de ces discours, Monseigneur ayant entonné l’antienne Curramus (Rituel, p. 373), les chantres commenceront le Psaume : Deus misereatur nostri.
Après l’antienne Curramus, Monseigneur chantera : Sicut Moyses exaltavit, etc… Oremus Deus qui nos vetita arboris, etc. (Rituel, 374).
Puis l’assistance avertie par le son des clochettes, en même temps que Monseigneur, se mettra à genoux, pour adorer la croix dans le plus profond silence, pendant quelques instants.
Monseigneur baisera la croix en disant : Benedictum lignum per quod fit justitia (Rituel, 375), ce que fera ensuite le clergé qui assistera sa Grandeur.
Alors Monseigneur entonnera le Te Deum, qui sera chanté tout entier au pied de la Croix.
Ensuite Monseigneur donnera la bénédiction pontificale qui terminera la cérémonie.
Après la bénédiction pontificale, l’assistance entière entonnera d’une même voix, autant que possible, le cantique : Bénissons à jamais. Et ce sera en le chantant que toutes les paroisses se remettront en ordre de départ, chacune reprenant le chemin de son territoire.
N° 8 Août 1927
Le Calvaire pendant la Révolution (suite)
« Cette protestation, dit l’abbé Marchand, admirable de logique, de foi et de fierté chrétienne, était l’œuvre de Thibault du Moustier. Le tribunal révolutionnaire de Nantes la lui reprocha plus tard. Thibault du Moustier avait parfaitement traduit la pensée de ses concitoyens qui ne tremblaient pas devant la tyrannie. Quatre-vingt-six signatures se joignirent immédiatement à celle de Thibault du Moustier, et quelques jours plus tard de nouveaux noms s’ajoutèrent encore aux premiers, de sorte qu’on peut dire que la population tout entière était debout défendant ses prêtres et sa foi. Le Bienheureux de Montfort put reconnaître les descendants de ceux qu’il avait évangélisés (Abbé Marchand, Revue mensuelle de la Conférence Grignon de Montfort. N° 4, p. 37.). »
Les habitants de Pontchâteau ne se bornaient pas à protester ; ils priaient, organisaient des pèlerinages au Calvaire. Ils s’y rendaient pieds nus et processionnellement. (Archiv. dép. série L. 131). Un jour à l’occasion d’un grand pèlerinage régional, la force armée intervint, et, si personne ne fut tué, quelques pèlerins furent blessés. On aime à chercher dans la Lande de la Madeleine les traces du sang chrétien versé ces jours-là, sang qui a rendu plus vénérable le lieu déjà sanctifié par le Bienheureux de Montfort. Les habitants de Pontchâteau ont le droit de dire qu’ils ont signé de leur sang leurs protestations de fidélité à Dieu. »
« Le Calvaire, continue le Recteur de Besné, devenu célèbre dès son origine, par la dévotion des peuples, n’avait pas cessé d’être un lieu de pèlerinage très fréquenté : on citait même plusieurs miracles qui s’y étaient opérés. Mais quand la Révolution éclata, la foi des peuples se ranima. Les pèlerinages devinrent plus fréquents et plus nombreux. Les peuples s’y portaient en foule ; ils y allaient en procession pour prier le Dieu des miséricordes de détourner de sur eux les malheurs dont ils étaient menacés. De pieux prêtres des environs y allaient fréquemment célébrer les saints mystères. On remarquait parmi eux un saint prêtre, M. Moyon, ancien recteur d’Auverné, retiré au village du Clos, près Pontchâteau ; il allait souvent dire la messe au Calvaire.
L’anarchie révolutionnaire, qui étendait ses fureurs dévastatrices sur toute la France, ne voyait qu’avec rage cette dévotion du peuple et le concert de prières qu’on adressait à Dieu dans ce sanctuaire (La Chapelle construite par le Père Audubon) si vénéré.
Elle décréta de faire cesser la superstition en détruisant le monument qui en était l’objet. Les agents arrivèrent au Calvaire la nuit, en 1793. De pieux fidèles étaient en prières dans la chapelle. Quelle ne fut pas leur frayeur à la vue des cavaliers entrant avec leurs chevaux dans ce sanctuaire vénéré. Les impies abattirent les Croix, mirent le feu à la chapelle, la réduisirent en cendre avec tout ce qu’elle contenait, brûlèrent les statues. Le Christ se trouvait heureusement à Saint-Laurent. Les bonnes gens rapportent que le misérable qui abattit la croix à coups de hache, coupa les bras du Christ : quelque temps après, lui naissait un fils qui n’avait pas de bras.
Tous les efforts de l’enfer pour empêcher les fidèles d’aller au Calvaire ne firent qu’augmenter leur vénération pour ce saint lieu. Ne pouvant plus s’y rendre publiquement, ils se dérobaient à la faveur des ténèbres et y venaient en foule supplier Dieu de mettre fin aux maux qui pesaient sur notre malheureuse patrie. Quand la tempête fut passée, tout le monde voulut aller de nouveau au Calvaire rendre grâces à Dieu. En 1803, des âmes pieuses firent planter trois modestes croix sur le sommet de la montagne. Le Calvaire demeura dans cet état jusqu’en 1821. Le fils de l’un des anciens travailleurs, M. l’abbé Gouray, entreprit alors de le restaurer.
N° 3 Mars 1928
POURQUOI une statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus au Calvaire du l’ère de Montfort
Quand on connaît, quand on a médité le Secret de Marie et le Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge par le Bienheureux Louis-Marie de Montfort et qu’on lit la vie de cette admirable petite sainte qui s’appelle sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, on est fortement porté à croire qu’elle a eu entre les mains ces deux ouvrages de notre Bienheureux, et cette croyance est d’autant plus fondée qu’au Carmel on a en grande estime et on pratique fidèlement son enseignement sur le saint Esclavage de la Mère de Dieu, esclavage tout d’amour, d’humilité, de confiance et de total abandon. Au fond c’est la même méthode de spiritualité que la petite sainte a appelé sa « petite voie », voie très rapide et très sûre qui, en peu de temps, l’a conduite aux plus hauts sommets de la perfection, voie lumineuse et attrayante par où elle voudrait entraîner une légion d’âmes, voie où elle a eu pour guide, lumière et maîtresse la Très Sainte Vierge .Marie.
Ecoutez la sainte nous révéler elle-même son secret de sainteté, son moyen de n’agir en tout que pour le bon plaisir et la plus grande gloire de Dieu.
Voici ce que nous lisons dans l’ « Histoire d’une âme » qui n’est autre chose que sa vie écrite par elle-même sur l’ordre de ses supérieurs :
« Les Novices du Carmel lui témoignaient leur surprise de la voir deviner leurs plus intimes pensées : « Voici mon secret, leur dit-elle : je ne fais jamais d’observations sans invoquer la Sainte Vierge ; je lui demande de vous inspirer ce qui doit vous faire le plu-de bien ; et moi-même je suis souvent étonnée des choses que je vous enseigne. Je sens simplement en vous les disant que je ne me trompe pas et que Jésus vous parle par ma bouche. »
Son secret est donc le « Secret de Marie », celui qu’enseigne si bien le Bienheureux de Montfort : « la Parfaite Consécration à Marie, secret de grâce et de sainteté. »
Pour faire les saints, Dieu se sert toujours de Marie t aussi bien souvent des mères chrétiennes, mais chrétiennes dans toute la force du mot. La mère de sainte Thérèse avait une très grande dévotion à la Sainte Vierge. Elle avait eu neuf enfants, dont trois garçons et six filles et au prénom de chacun d’eux elle avait ajouté celui de Marie. Notre petite sainte, qui était la dernière, porta aussi, il va sans dire, ce nom béni et elle suça pour ainsi dire avec le lait, l’ardente dévotion de sa mère de la terre pour sa Mère du Ciel.
Sa mère, en effet, gardait précieusement dans sa chambre une statue de Marie qu’elle priait et consultait souvent. C’est à ses pieds qu’elle faisait prier ses enfants et les formait à la piété. Cette statue s’était même animée deux fois pour éclairer et consoler, en de graves circonstances, la mère de Thérèse.
Aussi n’est-il pas étonnant que la petite Thérèse, après avoir prié souvent devant elle, ait voulu se la faire au Carmel de Lisieux.
Et quand, par obéissance, elle dut se mettre à écrire I’ « Histoire d’une âme », de son âme, elle commença par s’agenouiller devant cette statue.
Elle avait à peine cinq ans, un an après la mort de sa bonne et sainte mère, qu’elle faisait déjà son mois de Marie toute seule à la maison, ne pouvant aller tous les soirs à l’église ; c’était le mois de mai 1878… Je restais avec la bonne, dit-elle, et faisais avec elle mes dévotions devant mon autel à moi, que j’arrangeais à ma façon… »
« Marie, dit le Père de Montfort, est appelée par saint Augustin, et est, en effet le moule vivant de Dieu forma Dei, c’est-à-dire que c’est en Elle seule qu’un Dieu-Homme a été formé au naturel, sans qu’il lui manque aucun trait de la Divinité ; et c’est aussi en Elle seule que l’homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable, par la grâce de Jésus-Christ. »
« Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité ; quiconque y est jeté et se laisse aussi manier y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, d’une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine… d’une manière sûre, sans crainte d’illusion, car le démon n’a point eu et n’aura jamais d’accès en Marie; et enfin d’une manière sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tâche du péché. Oh ! qu’il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire, et s’appuient sur leur industrie, et une âme bien maniable, bien fondue, qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s’y laisse manier à l’opération du Saint-Esprit. Qu’il y a de taches, qu’il y a de défauts, qu’il y a de ténèbres, qu’il y a d’illusions, qu’il y a de naturel, qu’il y a d’humain dans la première âme : et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ ! (Secret de Marie, p. 20, 21, 22.)
Pour former sa petite Thérèse, Mme Martin avait donc bien choisi le bon moyen : Heureux les enfants ainsi formés ! heureux leurs parents !
A la fin de l’année 1882, la petite Thérèse fut prise «’un mal de tête continuel et d’un mal étrange qui la faisait beaucoup souffrir : « Dans les moments où la souffrance était moins vive, je mettais ma joie, dit-elle, à tresser des couronnes de pâquerettes et de myosotis pour la Vierge Marie. Nous étions alors au beau mois de mai, toute la nature se parait de fleurs printanières : seule la petite fleur (elle se désigne ainsi) languissait et semblait à jamais flétrie. Cependant elle avait un soleil auprès d’elle et ce soleil était la statue miraculeuse de la Reine des Cieux. Souvent, bien souvent, la petite fleur tournait sa corolle vers cet astre béni. »
Son papa fit demander une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Mais comme elle allait de plus en plus mal, sa sœur aînée, Marie, s’agenouilla en pleurant au pied de son lit, continue-t-elle, et se tournant vers la Vierge Marie, elle l’implora avec la ferveur d’une mère qui demande, qui veut la vie de son enfant. Léonie et Céline (ses deux autres sœurs, car Pauline était déjà entrée au Carmel de Lisieux), l’imitèrent et ce fut un cri de foi qui força la porte du Ciel. Ne trouvant aucun secours sur la terre et près de mourir de douleur, je m’étais aussi tournée vers ma Mère du Ciel, la priant de tout mon cœur d’avoir enfin pitié de moi.
Tout à coup la statue s’anima ! La Vierge Marie devint belle, si belle, que jamais je ne trouverai d’expression pour rendre cette beauté divine. Son visage respirait une douceur, une bonté, une tendresse ineffable ; mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de l’âme ce fut son ravissant sourire ! Alors toutes mes peines s’évanouirent, deux grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement.
Ah ! c’étaient des larmes d’une joie céleste et sans mélange ! La Sainte Vierge s’est avancée vers moi ! Elle m’a souri… Puis, sans aucun effort, je baissai les yeux et je reconnus ma chère Marie ! Elle regardait avec amour, semblait très émue et paraissait se douter de la grande faveur que je venais de recevoir.
Ah ! c’était bien à elle, à sa prière touchante que je devais cet inexprimable sourire de la Sainte Vierge ! En voyant mon regard fixé sur la statue, elle s’était dite : Thérèse est guérie ! Oui, la petite fleur allait renaître à la vie, en attendant qu’elle allât s’épanouir au Carmel et le remplir du parfum de ses vertus.
Au jour de la première communion, elle fut choisie pour prononcer, le soir, au nom de ses compagnes, l’acte de Consécration à la Sainte Vierge : « Mes maîtresses me choisirent sans doute, dit-elle, parce que j’avais été privée bien jeune de ma mère de la terre. Ah ! je mis tout mon cœur à me consacrer à la Vierge-Marie, à lui demander de veiller sur moi. Il me semble qu’elle regarde sa petite fleur avec amour et lui sourit encore. Je me souvenais de son visible sourire, qui m’avait autrefois guérie et délivrée : je savais bien ce que je lui devais ! Elle-même, le matin de ce 8 mai, n’était-elle pas venue déposer dans le calice de mon âme, son Jésus, « la fleur des Champs et le Lis des Vallées » (Cant. 11.).
Vers l’âge de 13 ans, ayant été un peu malade, on la retira de pension pour remettre sa santé, tout en lui faisant suivre quelques cours.
« En attendant, dit-elle, je résolus de me consacrer tout particulièrement à la Très Sainte Vierge, en sollicitant mon admission parmi les enfants de Marie. »
Enfin elle entre au Carmel, à l’âge de 15 ans, par une spéciale permission des Supérieurs, après un pèlerinage à Rome, auprès du pape Léon-XIII. Elle y trouve sa sœur Pauline supérieure sous le nom de Mère Agnès de Jésus.
Là, quand elle prononce ses vœux en la fête du 8 septembre, elle écrit : « A la fin de ce beau jour, ce fut sans tristesse que je déposai, selon l’usage, ma couronne de roses aux pieds de la Sainte Vierge ; je sentais que le temps n’emporterait pas mon bonheur. La Nativité de Marie ! Quelle belle, fête pour devenir l’épouse de Jésus. C’était la petite sainte Vierge d’un jour qui présentait sa petite fleur au petit Jésus. »
Elle se sert de Marie comme Médiatrice puisqu’elle se fait présenter, elle, petite fleur, comme elle s’appelle, par Marie qui vient de naître ou la petite Sainte Vierge d’un jour, au petit Jésus, vers lequel celle-ci fait tout passer ce qu’on lui donne, mais purifié et embelli par ses soins comme dit le Bienheureux de Montfort.
Toujours, suivant cette belle et consolante doctrine, notre petite carmélite faisait ses communions en union avec Marie. « Que vous dirai-je de mes actions de grâces ? dit-elle. Je me représente mon âme comme un terrain libre et je demande à la Sainte Vierge d’en ôter les décombres, qui sont les imperfections ; ensuite je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel et de l’orner de ses propres parures. Puis, j’invite tous les anges et les saints à venir chanter des cantiques d’amour. Il me semble alors que Jésus est content de se voir si magnifiquement reçu et moi je partage sa joie. »
Voilà, glanés çà et là dans I » « Histoire d’une âme » quelques faits qui nous font connaître quel fut le caractère de sa Dévotion à Marie, en un mot, le secret de sa petite voie d’enfance spirituelle, le secret de son éminente sainteté.
Après ce qu’où vient de lire, nul, je pense, ne s’étonnera qu’on ait songé à ériger une statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dans la chapelle du Pèlerinage au Calvaire du Père de Montfort.
Interrogée un jour sur l’espérance qui faisait battre son cœur à la pensée de son entrée prochaine au ciel i « Une seule, répondit-elle : l’amour ! aimer, être aimée et revenir sur la terre pour faire aimer l’amour. Puis, soulevant le voile de l’avenir dans une vue prophétique, elle ajouta en termes plus clairs encore : « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu… »
Comment, dès lois, pourrait-elle ne pas s’intéresser à l’Œuvre du Calvaire qui a pour unique but : l’Amour : faire naître et faire grandir dans les cœurs l’amour de Jésus crucifié ?
Pourrait-elle ne pas s’employer à hâter l’heure de la canonisation du grand Apôtre de l’Ouest de la France, dévoré comme elle du zèle du salut des âmes, allant comme elle à Jésus par Marie, ayant, comme elle, à chaque instant recours à Marie :
Marie est ma grande richesse
Et mon Tout auprès de Jésus !
Sanctifiés par les mêmes moyens, nos deux saints se serviront de la puissance dont ils jouissent dans les Cieux, pour obtenir aux pèlerins les grâces qu’ils solliciteront et faire tomber sur ce sol béni du Calvaire une pluie de roses, des grâces précieuses et abondantes dans l’ordre temporel et spirituel.
Autre raison d’avoir une statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus au Calvaire du Père de Montfort.
Il est dit, dans la vie de cette petite sainte, que ses parents, M. et Mme Martin, avaient fait d’ardentes et persévérantes prières pour obtenir de Dieu « un petit missionnaire » ou du moins un fils qui pût travailler très efficacement à l’extension de son règne dans le monde. Ils eurent neuf enfants : neuf filles. Et cependant il faut dire que Dieu exauça leurs prières, non comme ils avaient demandé, mais bien au-delà de ce qu’ils avaient espéré. Thérèse, leur neuvième fille, fut le « petit missionnaire » qui, par ses prières et ses souffrances pour les missionnaires, les aida puissamment à gagner des âmes à Dieu, et depuis qu’elle est là-haut, au bienheureux séjour, elle les a aidés plus efficacement encore ; par la puissance de son intercession et de ses prodiges, elle a conquis plus d’âmes que les apôtres les plus réputés.
Aussi le Souverain Pontife, le pape Pie XI, glorieusement régnant, vient-il de l’établir et de la proclamer la patronne des missionnaires.
Elle a promis, avant de mourir, de passer son ciel à faire du bien sur la terre : dès lors pourrait-elle ne pas venir en aide aux missionnaires dont l’unique but est d’étendre le règne de Jésus et de Marie dans les âmes ?
Mais si elle est la patronne des missionnaires, pourrions-nous bien ne pas l’honorer ici, comme telle, et l’invoquer avec confiance ? A l’ombre du Calvaire on forme des aspirants-missionnaires, des jeunes gens qui sentent au cœur la flamme de l’apostolat.
N’est-il pas naturel et de toute convenance, n’est-il pas avantageux qu’ils aient sous les yeux l’image de leur sainte patronne?
On sait maintenant pourquoi nous désirons si vivement posséder dans notre chapelle du Calvaire une belle statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
Que les amis du Père de Montfort et les nombreux dévots de sainte Thérèse veuillent bien nous venir en aide, et si, comme nous l’espérons, on répond largement à notre appel, nous aurons, après Pâques, vers la fêle du Père de Montfort, la bénédiction solennelle d’une belle statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : le modèle même approuvé par l’Office central de Lisieux, le modèle si apprécié du R. P. Marie-Bernard.
Depuis quelques jours, en entrant à la chapelle, le pèlerin lit sur le mur à droite, en gros caractères :
Offrandes pour l’achat d’une statue de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
On peut nous adresser les offrandes, soit par lettres et mandats-poste, soit encore — ce qui est plus économique : 0 fr. 40 quelle que soit la somme — par mandat-chèque :
Monsieur l’abbé Gourier, c/c. 86-97. Nantes, Au Calvaire de Pontchâteau (Loire-Inférieure).
N° 11 Novembre 1928
M ; L’Abbé Gourier
Le Calvaire a perdu M. l’abbé Gourier. Le P. Gourier, comme on l’appelait, fut ici pendant six ans le bon ouvrier de Dieu.
C’est un redoutable honneur que de succéder au Père de Montfort et à ce gigantesque remueur de terre que fut le P. Barré, à ces deux entraîneurs de foules.
Je connais quelqu’un qui réorganisait un centre de pèlerinage. Un confrère le félicitait : « Comme vos successeurs vous béniront d’avoir créé tant de facilités ! » « Oui, répondit-il, à moins qu’ils ne me maudissent de leur avoir créé tant de besogne ! »
Songe-t-on à ce que représente de fatigue une journée de pèlerinage au Calvaire ? Le P. Barré, qui était un sage, exigeait pour le moindre dimanche, à la belle saison, un minimum de trois missionnaires. Le seul exercice du chemin de la croix, départ de la chapelle et retour compris, c’est, et le plus souvent en plein soleil, une heure un quart de louange divine « in vociferatione. » Comment, après cela, ne pas ressembler à un malheureux qu’on repêche de la rivière ?
L’après-guerre a été dur pour tous. Pénurie d’hommes d’abord. Un des auxiliaires du P. Gourier, le P. Malenfant, devait succomber à la tâche. Il est aujourd’hui mourant.
Remercions le P. Gourier de tout ce qu’il a fait. Il a principalement entretenu, restauré, mis en plus belle lumière l’œuvre de ses devanciers. Ce n’est pas là un mince mérite. L’homme se désintéresse si facilement de ce qui n’est pas sorti de ses mains.
Un royal bâtisseur, Salomon, disait mélancoliquement : « J’ai haï tout le travail que j’ai fait sous le soleil et que je laisserai à l’homme qui viendra après moi. Qui sait s’il sera sage ou insensé ? Cependant il sera maître de mon travail, dans lequel j’ai mis ma peine et ma sagesse. » (Eccl. Ch. II).
Les grands pionniers du Calvaire n’ont pas eu à s’inquiéter ainsi. De là-haut, ils ont vu le prétoire restauré, l’innombrable peuple des statues frotté, blanchi, remis à neuf, les plantations accrues et rajeunies, de vastes avenues ouvrant des perspectives nouvelles, la voie douloureuse déblayée, de nouveaux groupes enrichissant les mystères du Rosaire, d’autres mis en meilleure place, la chapelle en plus fraîche toilette ; que sais-je encore? La petite Thérèse de l’Enfant Jésus, à laquelle ils ne pouvaient songer, prenant, en face de l’Apôtre de la Vendée et de la Bretagne, sa place de Patronne des missionnaires, la Vierge des Douleurs regardant tristement vers le prétoire où l’on condamne son Fils; bref, tout un ensemble d’améliorations exécutées avec conscience et avec goût. Pour une période de six ans, avouons que ce n’est pas mal. Les plus difficiles, s’ils ne votent pas une statue, ne refuseront pas un large satisfecit.
Certes, tout n’est pas achevé ! Le P. Gourier avait trop le sens des choses pour ôter à ses successeurs le plaisir d’entreprendre à leur tour. Il reste quelques bagatelles à mettre sur pied, par exemple : le Temple de Jérusalem. Il faudrait pour cela frapper un grand coup… à la poche du contribuable. Les gens qui savent tout prétendent que le P. Gourier fut tenté de le faire. La tentation pourrait bien se renouveler, et je ne voudrais pas jurer que le Directeur actuel du Pèlerinage n’y succombera pas.
Chers Pèlerins, chers Amis du Calvaire, un petit souvenir, s’il vous plaît, pour celui qui, trois jours après la magnifique fête du 8 septembre, quittait, non sans émotion, le champ de son labeur et qui, lui, ne vous oubliera pas.
N° 7 Juillet 1929
La restauration du Calvaire
En 1821, Pontchâteau a pour curé un enfant de la contrée. Né à Sainte Reine, l’abbé Gouray est le petit-fils d’un de ces ardents travailleurs qui répondirent à l’appel du grand missionnaire. Nul plus que lui n’a le culte du P. de Montfort et de son Calvaire; nul ne connaît mieux les merveilles qui s’accomplirent jadis sur la lande de la Madeleine. Il sait aussi les sentiments de la population.
Il demande à Mgr d’Audigné, évêque de Nantes, l’autorisation de relever ces déplorables ruines. De janvier à septembre 1821 d’immenses travaux sont exécutés sous sa direction. Le 23 septembre, Mgr l’évêque peut venir faire la bénédiction solennelle du Calvaire enfin restauré. Plus de dix mille personnes assistent à la touchante cérémonie.
La grande pensée de Montfort va enfin se réaliser. Des prodiges annoncent qu’on touche à cette heureuse époque. Dès 1816, nombre de personnes dignes de foi ont attesté avoir vu de longues processions d’êtres mystérieux se déployant dans la lande de la Madeleine et se dirigeant vers l’ancienne enceinte consacrée.
Depuis la restauration de 1821, un bien plus grand nombre encore affirment avoir entendu des chants, des concerts mélodieux autour du Calvaire et aussi au-dessus de l’endroit qu’on appelle la Clairaie, où s’élève aujourd’hui la chapelle du pèlerinage. Ces chants, ces concerts se font entendre, à diverses heures du jour et de la nuit, et se prolongent quelquefois longtemps. Ce ne sont pas seulement quelques voix, c’est toute une foule qui répète des airs inconnus et parfois des cantiques populaires en l’honneur de la croix. Et cependant on ne voit personne. Ces manifestations se renouvellent souvent, notamment en 1824, en 1832, en 1840 et jusqu’en 1847.
Dans ce même temps, les grâces signalées, les guérisons extraordinaires se multiplient autour de la sainte montagne, où la population vient de plus en plus se recommander à la protection du grand missionnaire.
Les Pères de la Compagnie de Marie au Calvaire
En 1851, année du grand jubilé demi-séculaire, le 26 décembre, à la clôture des saints exercices, le nouvel évêque de Nantes, Mgr Jacquemet, dont le nom est inséparable de celui de Mgr Affre, l’archevêque martyr qu’il accompagnait sur les barricades, adressait une lettre à son clergé. Rappelant le pieux usage de ces contrées chrétiennes où chaque mission se termine par l’érection d’une croix, il conviait ses prêtres, au terme de ce solennel jubilé, à réunir leurs efforts pour achever au Calvaire de Pontchâteau le dessein du vénérable serviteur de Dieu, en le dotant d’un digne chemin de croix et en y représentant les mystères du Saint Rosaire.
Quelques années après, pour assurer la réalisation de ce projet, il décidait d’établir des chapelains au pied du Calvaire et faisait appel aux enfants mêmes du P. de Montfort. A sa demande et sur l’avis favorable du conseil municipal de Pontchâteau, l’établissement est approuvé par décret impérial en 1865. Quelques mois plus tard, le 29 août, fête de la Décollation de saint Jean-Baptiste, quatre missionnaires venaient en prendre possession.
Les missionnaires se mirent à l’œuvre. Dès 1873 une nouvelle et plus vaste chapelle était terminée, Mgr Fournier vint en faire la bénédiction au mois d’avril et l’ouvrir au culte sous le vocable de N. D. de Pitié. En 1873, le 13 octobre, Mgr Guilloux, archevêque de Port au Prince, en Haïti, en faisait la consécration solennelle. En cette même année, le Calvaire est le théâtre d’une grandiose manifestation. On évalue à 60.000 les pèlerins qui font cortège à NN. SS. les évêques de Nantes, de Luçon, de Vannes et du Cap-Haïtien
De la béatification jusqu’à nos jours
Le 21 janvier 1887, Rome mettait au front du P. de Montfort l’auréole des Bienheureux. Grandes fêtes naturellement au Calvaire de Pontchâteau, auxquelles le ciel s’associe par de nouveaux miracles. Dieu lui-même veut glorifier son serviteur.
C’était dans les jours mêmes du Triduum de Béatification au Calvaire, au mois de Juin, sous la présidence des évêques de Nantes, de Luçon et d’Hiéropolis.
Une pauvre malade, Anne-Marie Gauthier, femme Pabœuf, du village de la Noë, en Pontchâteau, mère de six enfants, demande avec instance qu’on la transporte aux fêtes du Calvaire. Elle est percluse de tous les membres. Depuis huit jours, étendue sur son lit, elle ne peut faire aucun mouvement. On ne se rend à ses supplications que le troisième jour. C’est avec beaucoup de peine qu’on la place dans une voiture et qu’on la ramène. Mais, le lendemain, elle se réveille parfaitement guérie. Et ce jour-là même elle tient à paraître au marché voisin, pour que tous puissent constater la puissance d’intercession du Bienheureux. Une jeune fille de Crossac, — paroisse voisine du Calvaire — Stéphanie Corbillé, est dans un état désespéré. Les soins de cinq habiles médecins n’ont pu enrayer le mal. L’estomac ne supporte plus aucune nourriture, la faiblesse est extrême, et le dénouement ne peut être éloigné.
Elle aussi veut, à tout prix, être transportée au Calvaire. Les parents cèdent enfin, malgré leur crainte sur l’issue du voyage.
C’est un dimanche. On l’a déposée devant l’autel où les saintes reliques sont exposées. Soutenue par ses compagnes, qui ont voulu venir prier avec elle, elle reste là pendant le chant de vêpres, la récitation du chapelet et le salut du Saint-Sacrement.
Cependant, elle éprouve des douleurs de plus en plus intenses. Quand le reste de l’assistance s’est retirée, sans perdre confiance, elle demande à ses compagnes de réciter un second chapelet. A mesure qu’il s’achève, elle éprouve un changement étrange. Lorsqu’il est fini, elle se lève, va coller ses lèvres sur le reliquaire et, se retournant, elle dit : « Je suis guérie. »
Elle l’est en effet complètement. La reconnaissance lui inspire de se consacrer à Dieu dans la Congrégation des Filles de la sagesse. Trente-trois ans elle se dévoue au chevet des malades.
Les prodiges continueront à se multiplier, le P. Barré, alors supérieur au Calvaire, pensant que Dieu manifestait par là sa volonté de glorifier son serviteur dans le lieu même où il avait été tout humilié, conçut le dessein de réaliser aussi parfaitement que possible le projet de son Bienheureux Père, de transporter Jérusalem en France.
Il appela des volontaires. On lui répondit de quinze et vingt lieues à la ronde.
Curé ou vicaire en tête, pelle et pioche sur l’épaule, les travailleurs, partis de grand matin, arrivaient au Calvaire au chant des cantiques. Après une prière à la chapelle ils se mettaient à l’œuvre, chantant, priant, travaillant tout à la fois.
Le midi ils allaient à l’hôtellerie manger les provisions qu’ils avaient apportées et le travail reprenait.
Leur salaire, c’était, le soir venu, la bénédiction du Saint-Sacrement, la vénération des reliques du Bienheureux et les remerciements du directeur.
Telle petite paroisse des environs donna plus de trois mille journées.
Tous les travaux de terrassement, l’adduction des matériaux, le déplacement et le transport des énormes blocs erratiques dont le terrain du Calvaire est semé furent l’œuvre de ses volontaires. La générosité publique fit le reste. Le reste c’est le chemin de croix monumental dont le parcours a été copié sur celui de la voie douloureuse à Jérusalem, c’est le prétoire avec ses magnifiques hauts-reliefs représentant en grandeur naturelle les scènes de la Passion au palais de Pilate, et sa Scala Sancta que l’on ne gravit qu’à genoux ; c’est Nazareth, fidèle reproduction de la Sancta casa de Lorette ; c’est la grotte de Bethléem avec la scène de la Crèche, la grotte de l’agonie avec la si expressive statue de Jésus ; la grotte d’Adam au sommet du Calvaire ; la maison de sainte Elisabeth où se trouve représenté le mystère de la Visitation; c’est le groupe si animé des apôtres et des saintes femmes autour du Sauveur qui s’élève aux cieux ; c’est Marie, entourée d’anges et disant adieu à la terre ; c’est le Père de Montfort à son poste d’observation et de commandement, ou, si l’on veut, sur son piédestal et sur son trône de gloire, au sommet du Vieux Moulin.
Incomparable ensemble, inachevé encore ; mais unique au monde. Livre immense aux belles images, où chacun s’intéresse : pèlerins et touristes, peuples et gens cultivés, hommes mûrs et enfants.
Dieu a manifestement béni l’œuvre de son dévot serviteur. Le Calvaire de Pontchâteau, c’est la prédication prolongée du Bienheureux Père de Montfort. C’est là qu’il demeure ce qu’il fut pendant sa vie : l’Apôtre de la Croix et du très saint Rosaire.
Pèlerinages et travailleurs
D’abord.
Jour mémorable où, du haut de la chaire de Pontchâteau, au cours de la mission de mai 1709, le Bienheureux, après avoir dépeint, comme il savait le faire, les souffrances du Sauveur, demanda à ses pieux auditeurs s’ils ne seraient pas bien aises d’avoir à leur portée, sur une de leurs collines, une fidèle représentation du calvaire ! C’était le matin. L’on ne remit pas au lendemain la grande entreprise. Voilà la première équipe en route, équipe qui sera suivie de tant d’autres ; premiers croisés, modèles de tous ceux qui viendront après eux ; travailleurs volontaires qui ne demanderont rien que de peiner pour la gloire de Dieu.
De cinq à six cents paires de bras se succéderont sans discontinuité pendant quinze mois, à ce gigantesque ouvrage, dont le bruit se répand au loin.
On y vient jusque de Flandre et d’Espagne. Peuple des chaumières et hôtes des châteaux y confondent volontiers leurs rangs. Les femmes ne sont pas les dernières à manifester leur zèle, portant la terre à pleine hotte sur le sommet toujours croissant de la sainte montagne.
Vrais pèlerinages, où l’on chante les cantiques du Père, où l’on prie, où l’on récite le rosaire.
130.000 journées sont ainsi données. Mais Dieu ne veut pas priver les générations suivantes du plaisir de se dévouer aussi. Les pèlerinages de travailleurs seront repris pendant deux siècles, attachant les populations à une œuvre qui leur aura tant coûté, créant des traditions et ouvrant la voie au grand mouvement des pèlerinages de prière.
Le calvaire est donc démoli et presque complètement rasé. Deux fois, au cours du XVIIIe siècle, on tente de le restaurer. Mais la Révolution vient, qui ruine jusqu’aux ruines, abattant les croix, pillant tout, brûlant, avec la chapelle, les statues du Bienheureux, seuls restes du premier ouvrage.
Et voici qu’à peine la tempête passée, en 1803, des mains pieuses replantent sur le mamelon informe trois modestes croix, en attendant mieux.
Et voici, avec 1821, les pèlerinages de travailleurs qui recommencent. Un homme a été suscité de Dieu pour reprendre la grande œuvre. C’est le propre curé de Pontchâteau, l’abbé Gouray, enfant de Sainte-Reine, et petit-fils d’un des travailleurs de 1709. A sa voix, levée en masse dans toute la région. Pelles, pioches, attelages réapparaissent sur la lande de la Madeleine. De janvier à septembre le zélé constructeur enregistre 21.953 journées.
Puis, le siècle étant sur son déclin, c’est la Compagnie de Marie au Calvaire, et le P. Barré à la tâche. Tâche immense, car c’est bien la Terre-Sainte qu’il projette lui aussi de transporter en France. Pendant des années et des années, sous l’impulsion de cet homme extraordinaire, des équipes de volontaires se succéderont sur le vaste chantier. Les noms de ces travailleurs, ou simplement le plus souvent de leurs paroisses, remplissent trois gros registres : véritable Livre d’Or. 150.000 journées au moins sont inscrites là. De dix lieues à la ronde, tous les villages, toutes les bourgades y figurent, la plupart même avec une insistance émouvante. Le travail eût duré un siècle que personne ne se fût lassé. Ils parlent encore, ces anciens pionniers, de ces jours fameux ; et nous demandent avidement si on ne les reverra pas.
Ils venaient par tous les temps, surtout aux jours rigoureux de l’hiver, pendant que les travaux champêtres étaient suspendus. Le 10 décembre 1891, c’était Crossac, paroisse chérie du Bienheureux de Montfort, qui inaugurait ses travaux. Cent cinquante hommes s’attaquèrent aux énormes blocs erratiques semés sur la crête où le Directeur du Pèlerinage venait de tracer l’enclos du Jardin de l’Agonie. C’était l’édification de la Grotte de Gethsémani que l’on pré » parait. Quelques jours après, une même troupe arrivait de Saint-Joachim, paysans, mélangés de marins, d’anciens contremaîtres et ouvriers des chantiers de la Loire, experts dans l’art de manier le vérin. Bientôt viendront, de Saint-Malo de Guersac, jusqu’à des capitaines de vaisseau retraités. On en comptera une dizaine le 3 mars de l’année suivante.
Après les hommes, les femmes. Elles arrivent avec des paniers, ou tout simplement avec leurs tabliers. On leur a réservé la cueillette des cailloux pour les travaux de drainage. Parfois, c’est une véritable fourmilière. Un jour glacial du mois de mars, plus de 400 Briéronnes de Saint-Joachim sont ainsi éparpillées à travers la Lande.
Pèlerinages de travail, pèlerinages de pénitence aussi. Beaucoup viennent à jeun, bien qu’à pied et de plusieurs lieues, de Nivillac par exemple, de l’autre côté de la Vilaine. Parfois l’on n’a pas dormi la nuit précédente. On s’est couché tard, revenant d’un voyage ou retenu par les affaires ; on s’est levé tôt pour ne pas manquer le départ ; et l’on s’appuie quelques instants la tête contre un rocher, vaincu par la fatigue et le sommeil.
C’est au chant des cantiques que commencent ces journées ; c’est le chant des cantiques qui soutient aussi les travailleurs : « Je suis chrétien… Chers Amis, tressaillons d’allégresse… Priez pour nous, Bienheureux Montfort. » La Providence a doté le P. Barré d’une voix tonitruante et d’une musculature de taureau. C’est lui qui soutient le chœur de ces paysans et s’attelle le premier à la chaîne qui crie sur le bloc de pierre et qu’une centaine d’hommes tire avec un ensemble irrésistible réglé par les retentissants « 0 hiss ! » de leur capitaine. Parfois pourtant c’est le bloc qui se montre le plus têtu. La chaîne rompt, et voilà toute l’équipe par terre. Mais on n’a pas le temps de rire. Le P. Barré est déjà debout, chantant avec plus d’ardeur : « Priez pour nous, Bienheureux Montfort ! »
Elan et enthousiasme incomparables et qui pourtant vont grandir encore à l’annonce de ce que sera l’entreprise maîtresse, la restauration complète du Calvaire. Elargir et surélever la puissante colline ; y entasser des rochers abruptes, la sillonner de lacets, la revêtir de verdure ; y amener la Voie douloureuse et une vaste avenue ; y préparer une plate-forme suffisante à recevoir les stations du Dépouillement de Jésus, de son Crucifiement et les groupes des personnages présents autour de la Croix ; y prévoir aussi la place des pèlerins qui y monteront par troupes serrées ; vaste programme, mais bien digne de l’entrepreneur et de ses ouvriers.
Le soir même du 12 décembre 1895, quelques heures seulement après le départ de la Commission des travaux, qui s’était réunie au Calvaire, à la demande du P. Barré, et que présidait M. l’Abbé Allaire, vicaire général de Mgr l’Evêque de Nantes, une voix se faisait entendre de porte en porte dans les villages voisins de la Lande de la Madeleine. Les gens sont couchés, car à cette époque de l’année la nuit vient vite. Pourtant l’huis s’entrebâille. Un mot a suffi : « C’est demain que commencent les travaux du Calvaire, et c’est vous qui êtes invités les premiers. » — « Comptez sur nous ! A demain I » — « Oui, à demain tous les hommes de Guémené, de Calla, de la Brionnière, du Buisson-Rond, et dans huit jours, vos femmes et vos filles. — Oui, oui ! » répondent de l’intérieur d’autres voix.
On voit que le P. Barré n’était pas l’homme des temporisations.
Avec quelle fougue il mena l’œuvre, on en pourra juger à ce tableau des deux premiers mois :
13 décembre, les villages susnommés ; le 14, les villages de Coimeux, la Bassinais, Cunta, Loruais, Bosselas ; le 15, Bergon ; le 17, lundi, Aignac ; le 18, la Guène, la Giraudais, le Souchet ; le 19, les femmes de Bergon ; le 19, les femmes des villages venus le 13 ; le 21, les femmes des villages venus le 14. Suspension pour les fêtes de Noël. Reprise, jeudi 28 avec les femmes des villages venus le 18.
Le 2 janvier 1896, Saint-Joachim ; le 3, villages de Pontchâteau ; le 4, Sainte-Reine ; le 1, Crossac ; le 8, Besné ; le 9, femmes de Saint-Joachim ; le 10, Saint-Guillaume ; le 11, Frairie de Saint-Dié ; le 14, Burin-en-Saint-Dolay ; le 15, Besné; le 16, Manzin et Pandille-en-Saint-J. ; le 17, villages autour de Casso ; le 18, section de Missillac ; le 21, Cusiac en-Sainte-R. ; le 22, section de Besné ; le 23, Fédrun-en-Saint-J. ; le 24, Saint-Roch ; le 25, Frairie de Sainte-Luce-en-M.
Et malgré le verglas, la neige et une bise terrible, la série continue ; lundi 28 janvier, Drefféac ; le 29, section de Besné ; le 31, cinq villages de Pontchâteau : la Joubraie, la Houssaye, la Jatte, l’Epinaie et Saint-Michel ; 1er février, Sainte-Reine ; le 4, section de Drefféac ; le 5, Quémessé, la Mondraie, la Brionnière-en-Crossac; le 6, Branducas et Catiho-en-Drefféac ; le 7, Bosselas, la Haie, Cunta-en-Crossac ; Travers et la Poterie-en-Sainte-R. ; le 13, la Chapelle-des-Marais ; le 14, Bergon-en-Missillac ; le 15, Sainte-Luce-en-M. ; le 18, La Chapelle-Launay ; le 20, Rault, l’Hôtel-Guérif, le Souchet, la Guêne-en-Crossac ; le 21, Fédrun-en-Saint-J. ; Béraud-en-Pontchâteau ; le 22, Coimeux, la Cossonnais, Bélébat, l’Ile-Olivais, le Bran, la Ricordais, la Noë, le Blanchet-en-C. ; le 23, Section de la Chapelle-Launay ; le 26, Camers, Camérin, Québrite-en-la-Ch. Des-M. ; le 27,1e bourg d’Herbignac; le 28, Saint-Gildas-des-Bois.
Quarante-sept jours en deux mois et demi et cela malgré les fêtes de fin d’année et un temps exécrable !
Le 17 janvier les évêques de Nantes, de Vannes, de la Rochelle étaient sur le chantier, félicitant et encourageant les travailleurs, qui certes le méritaient bien.
Châtelains, maires, conseillers d’arrondissement, conseillers généraux donnaient l’exemple. C’était, sans qu’ils en aient eu sans doute la pensée, la meilleure des propagandes électorales.
L’entrain devint tel qu’on vit des femmes venues en pèlerinage de prière ou d’actions de grâce, épier le départ des hommes pour le repas de midi, envahir le chantier et s’emparer des pelles, des pioches, des brouettes, avides de donner elles aussi leurs sueurs et comme impatientes de voir terminé ce grand ouvrage.
Lorsque les hommes de Saint-Joachim feront les fouilles pour les fondations du Prétoire, et que ceux de Pontchâteau, de Saint-Guillaume, de Crossac, de Sainte-Reine, de la Chapelle-des-Marais, de Saint-Lyphard, pressant leurs attelages, amèneront les matériaux du futur monument, les femmes se plaindront, non sans quelque amertume, que leur concours n’ait pas été accepté !
On devine à cet enthousiasme des travailleurs ce qu’avaient été et ce que furent
Les Grandes Manifestations
Il en est une dont le souvenir hante encore la mémoire des anciens.
En 1875, à l’occasion du jubilé de quart de siècle, Mgr Fournier, évêque de Nantes, rappelant la coutume chère aux populations de l’ouest de la France de couronner une mission par la plantation d’une croix, donnait rendez-vous à son clergé et à ses fidèles au calvaire du Père de Montfort.
Le curé de Pontchâteau, M. l’abbé Nouel, ancien vicaire à St-Similien de Nantes, fit venir de cette dernière paroisse des jeunes filles pour préparer les décorations. La cathédrale envoya ses tentures et ses oriflammes. Des équipes accoururent des paroisses voisines pour dresser des arcs-de-triomphe, pour planter, sur le parcours des quatre kilomètres qui séparent Pontchâteau du calvaire, une double haie de mâts et jeter de cinq mètres en cinq mètres, au-dessus de la route, des guirlandes de verdure et de fleurs, et des banderoles multicolores, ornées d’inscriptions.
A deux heures du matin, celles des paroisses qui devaient passer par la petite ville commencèrent à défiler au chant des cantiques. A dix heures, on annonça l’arrivée de Monseigneur ; et les guetteurs ayant déclaré que toutes les paroisses qui devaient traverser Pontchâteau étaient passées, Pontchâteau se mit en marche. Sur les trois autres routes qui se joignent au calvaire un pareil mouvement s’était produit. Quand nous arrivâmes, me racontait dernièrement une bonne religieuse des Sœurs de Saint-Gildas-des-Bois, dont les ans commencent aujourd’hui à compter et qui alors sortait à peine du noviciat, je ne m’y reconnaissais plus. Nous étions pourtant venues plusieurs fois au calvaire, mais tout disparaissait sous la foule. Seule émergeait, comme une île au milieu des flots, la montagne avec ses trois croix. Des pelotons de gendarmes à cheval se mouvaient lentement à travers cette multitude, témoins ravis d’un ordre qui se maintenait tout seul. Croix et bannières servaient de signe de ralliement à chaque paroisse, et la consigne qui interdisait, avec une frêle clôture, l’enceinte du calvaire, avait été fidèlement gardée. Pontchâteau pénétra seul dans cette enceinte, escortant les évêques de Nantes, de Luçon, de Vannes et du Cap Haïtien. Bientôt la montagne elle-même fut couverte, et des chants, des acclamations éclatèrent de toutes parts. Puis, au milieu d’un religieux silence, quatre orateurs, distribués aux quatre coins du ciel, se mirent à haranguer ce vivant océan. Jamais, ajoutait cette bonne religieuse, je n’ai retrouvé pareille multitude et pareille manifestation. J’étais transportée dans un autre monde. C’était à n’en pas croire ses oreilles et ses yeux.
En 1888, 19, 20 et 21 juin, mardi, mercredi et jeudi, le Calvaire célébra le Triduum de la Béatification. Revanche de Dieu qui glorifie son serviteur ou lui-même de la grande humiliation. Trois jours, les chants, les acclamations, les discours ne cessent de retentir au pied du Calvaire. Avec l’enthousiasme, la dévotion se donne libre cours. Dans la chapelle des Missionnaires, le peuple se presse autour des confessionnaux, des premières heures du matin jusqu’au soir. Des piétons arrivent à midi passé et demandent à communier. Toute la région est en fête. A Crossac, à Saint-Guillaume, à Saint-Joachim, à Sainte-Reine, à Missillac, dans les villages de Pontchâteau, les travaux sont comme suspendus. Toute la matinée les paroisses ne cessent de se succéder, les plus proches à pied et en procession, les autres en véhicules de toute sorte. Voilà Fégréac par exemple qui aligne pour sa part cent voitures.
Le 24 juin 1899, érection du Chemin de Croix. Un prince de l’Eglise, son Eminence le Cardinal Richard, archevêque de Paris, originaire du diocèse de Nantes, quatre évêques : Nantes, Vannes, Angers, Luçon ; trois cents prêtres ; cinquante mille pèlerins… Nuit d’adoration et de prières d’abord avec procession aux flambeaux. Au matin sonnerie des puissants carillons dans tous les clochers des paroisses voisines pour le départ des processions. Le P. Bouvier, le grand orateur jésuite, invité à glorifier l’œuvre de ses obstinés travailleurs, eut des accents incomparables.
En 1910, nouveau triduum les 19, 20 et 21 juin, pour le second centenaire du Calvaire. Trente mille pèlerins le premier jour, vingt mille le deuxième, cinquante mille le troisième, dont dix mille Morbihannais, se pressent autour d’orateurs choisis : le P. Ricordel, supérieur des Missionnaires diocésains ; le P. Robert, de la Compagnie de Marie ; Mgr Arlet, évêque d’Angoulême, Mgr Duparc, évêque de Quimper ; Mgr Touchet, évêque d’Orléans, dont la parole pittoresque et enflammée est couverte d’applaudissements. Au-dessus des rangs de cette immense armée qui se lève et se met en marche vers le Calvaire, se dressent des bannières, des croix paroissiales, et le lit d’honneur du grand Christ du Bienheureux de Montfort, sorte d’estrade garnie de velours, ornée de panaches et surmontée d’un dais, où repose le Christ du premier calvaire. Dix équipes de quarante hommes chacune se relayent pour mettre à tour de rôle l’épaule aux brancards de ce monument et le porter, à travers cette mer houleuse, comme le pavois d’un triomphateur.
En 1926, c’est la Fédération Catholique qui convoque les hommes du diocèse de Nantes au Calvaire de Pontchâteau. Ce fut une des plus grandioses manifestations de l’année pour toute la France. Quarante mille hommes applaudirent le P. Janvier et M. le Cour-Grandmaison.
Entre-temps à chaque monument qui surgissait de terre : sanctuaire, grotte, groupe de statues, c’étaient des fêtes qui attiraient les pèlerins par milliers.
Une autre chose les attirait aussi : la confiance qu’ils avaient dans la puissance d’intercession du Bienheureux de Montfort et que le ciel encourageait par de multiples faveurs. Le bruit se répandait de guérisons merveilleuses. On citait les noms de Fanny Corbillé et de Françoise Moyon, de Crossac ; de Marie Guyot et de Mlle Savary, d’Ambon ; de Marie Sérot, de Fégréac. La présente revue du Pèlerinage : l’Ami de la Croix, dut ouvrir une rubrique de faveurs obtenues. Toute la belle saison c’étaient des paroisses, des groupes ou des isolés qui venaient en des
Pèlerinages particuliers de prière ou d’actions de grâces
« Le dimanche de la Trinité, écrit vers 1890 un promeneur, j’avais dirigé mes pas vers le Calvaire, afin de jouir du splendide panorama que l’on découvre du sommet. Le spectacle dont je fus témoin était si touchant que je ne l’oublierai jamais.
Il était une heure du soir, une foule nombreuse entourait le pied de la montagne et faisait pieusement le chemin de croix. Il y avait des pèlerins à toutes les stations à la fois. Quelques-uns parcouraient isolément la voie douloureuse. Mais le plus grand nombre, se rappelant que Dieu a promis d’accueillir plus favorablement une demande quand elle lui est adressée par plusieurs, étaient réunis par groupe de six, de neuf ou de douze personnes. Tous paraissaient absorbés dans la méditation des souffrances du Rédempteur.
Oubliant le but de mon excursion, je ne me lassais pas de contempler cette scène édifiante. Il me semblait que le Bienheureux, entouré des travailleurs qui l’aidèrent à élever le Calvaire, était là, regardant chaque pèlerin d’un œil attendri.
Tout à coup, portant mes regards vers la route de Pontchâteau, j’aperçois un groupe d’hommes nu-tête et le chapelet à la main, priant à haute voix. J’en comptai neuf. Ils venaient demander la guérison d’un malade.
Au même moment, sur la route de Saint-Guillaume vient une autre neuvaine d’hommes : comme les premiers ils marchent aussi nu-tête, le rosaire à la main. C’est une guérison qu’eux aussi viennent solliciter.
Les deux groupes vont droit au Bienheureux, c’est-à-dire à ses reliques exposées dans la chapelle des Pères, où je m’empresse de les suivre!
A genoux, rangés en cercle autour des reliques vénérées, ils alternent d’une voix mâle les prières du rosaire, et les litanies du Bienheureux. Puis ils se relèvent et toujours priant vont au Calvaire terminer leur pèlerinage en parcourant pieusement les stations du chemin de la croix.
Profondément ému par un spectacle aussi touchant, je me retire à mon tour en promettant de revenir bientôt au Calvaire. A mon insu ma promenade s’était transformée en pèlerinage.
De trois et quatre lieues, de Saint-Gildas-des-Bois par exemple, on vient en groupes de cinq et six cents à pied et à jeun, trompant la fatigue par le chant des cantiques et la récitation du chapelet. A l’arrivée le prêtre qui accompagne, curé ou vicaire, à jeun lui aussi, monte à l’autel, célèbre la sainte messe et distribue à tous le pain eucharistique.
La pratique touchante et salutaire s’établit de renouveler alors Je contrai d’alliance avec Dieu, selon la formule que le Bienheureux avait dictée aux ancêtres :
1° Je crois fermement toutes les vérités du saint Evangile de Jésus-Christ.
2° Je renonce pour jamais au démon, au monde, au péché et à moi-même.
3° Je promets, moyennant la grâce de Dieu qui ne me manquera point, de garder fidèlement tous les commandements de Dieu et de l’Eglise, évitant le péché mortel et ses occasions, entre autres les mauvaises compagnies.
4° Je me donne tout entier à Jésus-Christ par les mains de Marie, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie.
5° Je crois que si je garde fidèlement ces promesses jusqu’à la mort, je serai éternellement sauvé, mais que si je ne les garde pas, je serai éternellement damné.
En foi de quoi j’ai soussigné…
Toute la journée se passe en pieux exercices. Dès l’arrivée ou immédiatement après la messe, on se met sous la direction d’un chapelain pour visiter les différents sanctuaires des mystères du Rosaire, en chantant les couplets appropriés et en récitant le chapelet. On vague ainsi pendant une heure à travers l’immense lande qui se transforme de jour en jour en un parc magnifique. L’après-midi, on assiste au Chemin de Croix prêché et chanté, qui dure pareillement au moins une heure. On revient processionnellement à la chapelle recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement et vénérer les Reliques du Bienheureux. Quelquefois une instruction, un sermon a complété ces exercices auxquels chacun a pris soin d’ajouter encore dans les intervalles libres, par exemple en gravissant à genoux la Scala Sancta ; en allant prier, dans l’humble et ancienne chapelle du calvaire, au pied du grand Christ du Bienheureux ; en s’attardant encore devant l’autel et la statue du saint Missionnaire, près du cierge que l’on a mis à brûler ; surtout en purifiant son âme par une confession que l’on a préparée avec un soin tout spécial.
Pendant la guerre, ce fut mieux encore. C’est nu-pieds que, de paroisses voisines du Calvaire, s’accomplit alors maint pèlerinage.
Ralenti par la terrible secousse, le mouvement des foules vers le Calvaire reprit à la fin des hostilités pour ne cesser dès lors de s’accentuer. En cet an de grâces 1929, malgré quatre grandes fêtes précédemment organisées, nous avons eu, presque en fin de saison,
Les deux grands pèlerinages du 25 août et du 8 septembre
Le premier, malgré une grande fête sportive qui battait son plein à la Roche-Bernard, sous la présidence de Mgr Tréhiou, et réunissait les principales sociétés gymnastiques catholiques du Morbihan, de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure, avec un nombre considérable de curieux, le premier, dis-je, de ces deux pèlerinages, nous amenait des représentants de plus de soixante paroisses, comme il était facile de le constater aux adresses laissées sur les listes de nos souscripteurs.
Voici d’abord Blain, Campbon, St-Joachim, Quilly qui arrivent clergé, croix et bannière en tête ; Guenrouët, Prinquiau, Ste-Anne de Campbon qui défilent en rangs serrés ; des groupes petits ou gros de plus de cinquante paroisses du pays Nantais ; des Morbihannais de Saint-Nolff, de Treffléan et de Questembert ; des Angevins de Cholet et de Noyant ; des Manceaux et des Parisiens en rupture sans doute de station balnéaire ; des Bruxellois qui viennent, comme leurs compatriotes flamands d’autrefois, apporter, sinon leur bras, du moins leur offrande au calvaire du Bienheureux.
Le 8 septembre en la fête de la Nativité de la Sainte Vierge, foule bien plus nombreuse encore. C’est d’ailleurs la grande journée du calvaire, celle où, selon une ancienne et chère tradition, Pontchâteau et son canton se donnent rendez-vous ici. On sait que la fête sera belle et l’on y vient de partout. Voici le Finistère avec Châteaulin et des Bigoudènes arborant sur leur opulente chevelure un élégant clocher à jour ; le Morbihan avec Théhillac, Auray, Saint-Gildas-de-Ruys, Vannes, Questembert, Ploemeur, Nivillac, Pont-Scorff ; la Touraine, avec un petit groupe de Langeais, venu tout exprès la veille coucher à Nantes ; des Parisiens, des Orléanais, des Manceaux, des Vendéens, des Angevins que la piété, la curiosité, ou tout simplement le hasard d’une promenade a conduits par ici ; enfin les gros bataillons ramassés à travers toute la région nantaise, d’Arthon-en-Retz à Chateaubriand, de Vallet à Herbignac ; Couëron par exemple avec ses Polonais et les gens de La Montagne débarquant d’un copieux autobus.
C’est au milieu de cette foule, à la fois joyeuse et recueillie, qui a envahi les abords du prétoire, que vers dix heures les paroisses attendues font processionnellement leur entrée. Pontchâteau, sa croix et son vénéré curé-doyen en tête, son groupe de chanteuses entraînant tout un peuple ; Crossac qui arbore une magnifique bannière et se fait aussi précéder de sa jeunesse chantante, Saint-Guillaume avec ses enfants de chœur ; Saint-Roch, Drefféac, Prinquiau, Besné, Missillac et sa chorale, paroisses dont la plupart, malgré la distance, arrivent à pied, avec leur croix et leur clergé, soutenant les vieilles jambes du chant des cantiques et s’emparant, d’un pas alerte, des degrés du prétoire, de sa plate-forme et de tout ce qui reste d’ombre à gauche et à droite du monument. Le plein est vite fait. Les retardataires, s’il y en a, n’auront de refuge qu’à soixante-dix mètres de là, sur l’herbe.
L’âme d’un pèlerinage, c’est le chant. Jusqu’à la mi-juillet nous avons l’avantage, que beaucoup d’illustres sanctuaires sont en droit de nous envier, de posséder dans la maîtrise du Petit Séminaire des Missions assis au pied même du calvaire, le chœur rêvé. Pendant les vacances, c’est autre chose. Il faut chercher. Le 23 août le Grand Séminaire des Missions de Montfort-sur-Meu, patrie du Bienheureux, voulut bien venir à l’aide et le fit de splendide façon. Voix puissantes et parfaitement exercées qui soutinrent l’enthousiasme, on peut bien dire, dans sa plus haute tonalité. Le 8 septembre, c’étaient, comme il convenait, les chœurs de chant des paroisses, les chanteuses de Pontchâteau et de Missillac, jeunesse ardente qui y alla d’un tel cœur qu’on peut déclarer qu’elle fut la grande animatrice de la fête.
C’est un plaisir d’ailleurs de voir comme, eu ces jours solennels, ces descendants des grands travailleurs, anciens travailleurs, pour un grand nombre, eux-mêmes, en s’ébranlant vers la montagne, monument de leur foi et de leur piété, reprennent avec ardeur le vieux cantique des aïeux et du grand missionnaire, alors si bien de circonstance :
Chers amis, tressaillons d’allégresse.
Nous avons le calvaire chez nous.
Le point culminant de ces fêtes c’est le moment où l’exercice du chemin de croix, ayant conduit de station en station, la multitude mouvante et chantante jusqu’au sommet du Calvaire et, grâce aux pathétiques allocutions du prédicateur, jusqu’au sommet aussi de l’émotion, celle-ci explose en des acclamations prolongées en l’honneur de Jésus, de la Croix, de Marie et du Bienheureux de Montfort.
Heure d’enthousiasme, mais de fatigue extrême pour l’orateur que ce long exercice du Chemin de Croix. Il faut avoir la voix de M. l’abbé Bernard, notre prédicateur du 8 septembre, pour s’en tirer sans la briser et parler encore une demi-heure à l’office de l’après-midi, avec la même fraîcheur de timbre et la même puissance d’émotion.
Ces belles journées se terminent par la vénération des reliques du Bienheureux à la chapelle. Le 8 septembre trois reliquaires suffirent à peine, pendant trois quarts d’heure, à satisfaire la piété de nos pèlerins.
Puis l’on se retire lentement, « laissant là son cœur et ses offrandes », pendant que les chants s’éteignent et qu’autour des autels d’innombrables cierges achèvent de se consumer.
A côté de ces grandes dates, peu de jours à la belle saison où la Lande de la Madeleine ne retentisse du chant des cantiques. C’est une procession à peu près continuelle. Groupes d’Anjou, de Vendée, de Bretagne ou de la région voisine. Voici par exemple, ces deux derniers mois, une communauté entière, celle de la Haie-Mahéas à Saint-Etienne-de-Montluc, en deux fois à dix jours d’intervalle ; le noviciat d’abord, les professes ensuite, avec la Révérende Mère supérieure générale, les aumôniers et M. le Supérieur général lui-même. Voici deux ouvroirs d’Angers, un petit bataillon de Landemont ; des jeunes filles de Neuvy-en-Mauges, retour de Sainte-Anne d’Auray, d’autres de Saint-Germain en Maine-et Loire. Voici Briac et Noirmoutier, Saint-Hilaire-de-Mortagne que nous aurions voulu retenir plus longtemps ; voici des groupes de Chateaubriand, de Vallet et de la Regrippière ; de St-Martin-sur-Oust, de Renac, de Guipry et de Messac de l’autre côté de la Vilaine. Voici un gros peloton de Baden, encadré de séminaristes, et précédé de M. le Vicaire ; les orphelines de Saint-Rogatien et toute la maison de Saint-Charles de Nantes. Quant aux promeneurs, aux curieux mi-touristes mi-pèlerins qui viennent ici cueillir, espérons-le du moins, une bonne pensée, on ne les compte pas.
Pèlerinages de prière, pèlerinages de reconnaissance aussi, car le Calvaire continue à justifier l’exclamation prophétique du Bienheureux.
« Oh ! qu’en ces lieux l’on verra de merveilles !
Que de conversions,
De guérisons, de grâces sans pareilles ! »
Des guérisons, la foi ne cesse d’en obtenir du saint missionnaire. Dernièrement encore c’était un typographe de Redon, François Noblet, qui remerciait le P. de Montfort de l’avoir guéri de glandes traitées en vain depuis sept ans; un enfant de Sainte-Reine, le petit Joseph Leduc, atteint d’épilepsie et considéré comme incurable par plusieurs docteurs, qui cessait de tomber, sur la promesse que faisait sa pieuse mère d’une neuvaine de pèlerinages et de la célébration d’une messe à l’autel du Bienheureux ; un garçonnet de Marsac, mis au plus mal par une broncho-pneumonie et qui s’en tirait aisément sur une promesse analogue de sa mère ; une personne de Campbon atteinte de rhumatismes et qui se déclarait soulagée pour s’être recommandée au saint missionnaire.
Des conversions, cela est plus souvent le secret de Dieu. Cependant voilà, le 8 septembre, une pèlerine qui dépose dans la corbeille de la souscription son offrande sous enveloppe, avec cette mention : « Une grande pécheresse » ; un pèlerin, lui, qui signe carrément et ajoute : « Pour les défunts que j’ai spoliés ; en réparation. Merci, Bienheureux Montfort ! Merci, merci ! »
*
Tel est en raccourci le mouvement qui emporta et emporte toujours les corps et les âmes vers le Calvaire du Bienheureux. Théâtre incomparable pour les grandes manifestations religieuses, avec sa montagne triomphale, sa vaste esplanade du prétoire, ses avenues et ses allées majestueuses où les foules évoluent tout à leur aise, cette reproduction de la Terre Sainte, par la multiplicité et la variété de ses sanctuaires ; par son site qui domine toute la région et, la détachant de la terre, semble la rapprocher du ciel ; par son étendue solitaire et ses coins d’ombre et de silence, offre aussi au pèlerin isolé tout ce qu’il faut pour occuper les yeux, élever l’âme et apaiser le cœur.
Unissant ainsi la convenance du site et la perfection de l’appareil religieux au charme spirituel que lui valent le souvenir d’un saint et la marque de maint prodige, le Calvaire de Pontchâteau se présente comme un des lieux les plus favorisés de la France et du monde pour l’essor des pèlerinages.
N° 8 Septembre 1930
Le Cantique des Travailleurs du Calvaire
Il y a quelques mois, le R. P. Fradet, dont on connaît la belle édition critique des cantiques du Bienheureux Père de Montfort, avait la bonne fortune de recevoir un recueil manuscrit de cantiques de Missions, où on lui signalait la présence du cantique que composa le Bienheureux pour entraîner ses travailleurs.
Le R. P. Fradet a pensé être agréable aux lecteurs de l’Ami de la Croix en leur offrant la primeur de cette belle composition, dont on n’avait jusqu’ici que quelques couplets. Qu’il en soit remercié I
Hélas! le Turc retient le saint Calvaire
Où Jésus-Christ est mort;
Il faut, chrétiens, chez nous-mêmes le faire;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Tâchons d’avoir cette sainte montagne
Par un divin transport
Dans notre cœur et dans notre campagne.
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Que n’ont point fait les plus grands de la terre
Pour recouvrer ce lieu !
Ayons-le ici, sans croisade et sans guerre;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Laisserons-nous dedans l’ignominie
Notre-Seigneur et Dieu,
Qui par amour nous a donné sa vie ?
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Laisserons-nous Jésus dans la poussière ?
Non, non, fervents chrétiens,
Employons tout pour le mettre en lumière;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Il est moqué des Juifs, des hérétiques,
Des Turcs et des païens;
Et par sus tout des mauvais catholiques;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Les lieux sacrés par sa sainte présence,
Arrosés de son sang,
Sont méprisés malgré toute puissance;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Reprenons-les, non par la violence,
Mais en les imitant,
Malgré le temps, la peine et la dépense;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Oh ! qu’en ce lieu l’on verra de merveilles !
Que de conversions !
De guérisons, de grâces sans pareilles !
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Oh I que de gens y viendront en voyage,
Que de processions,
Pour voir Jésus et pour lui rendre hommage !
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Mettons-le en croix, pour nous mettre en mémoire
Sa mort et passion,
Pour notre bien et sa plus grande gloire;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Sur cette croix, il calmera son Père,
Il vaincra le démon,
II recevra nos vœux et nos prières;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Plantons la croix, c’est l’épouse fidèle,
C’est le trône royal
Du Roi des Rois, la Sagesse éternelle;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Pour les Gentils, elle est une folie,
Pour les Juifs, un scandale,
Mais aux chrétiens elle est sagesse et vie;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Ce mystère est notre unique exemplaire,
Le à tous maux,
Et le trésor du ciel et de la terre;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Depuis longtemps, mon Jésus, je désire
Vous élever plus haut,
Pour attirer les cœurs sous votre empire;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Jésus en croix, que votre règne arrive,
Il est temps, il est temps,
Afin que tout vous adore et vous suive;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Montez en croix, élevez-vous, vous-même,
Nous sommes impuissants ;
Nous chanterons votre pouvoir suprême ;
Faisons un Calvaire ici,
Faisons un Calvaire.
Oui, je le veux, il y va de ma gloire,
Et du haut de la croix,
Je chanterai dans ce saint lieu victoire;
Faites mon Calvaire ici,
Faites mon Calvaire.
J’attirerai les cœurs les plus rebelles,
Tout pliera sous mes lois,
Je guérirai les plaies les plus mortelles;
Faites mon Calvaire ici,
Faites mon Calvaire.
Travaillez tous, mon pouvoir est immense;
Je travaille avec vous;
Et je serai plein de reconnaissance ;
Faites mon Calvaire ici,
Faites mon Calvaire.
(Tous s’écrient ensemble)
Travaillons tous à ce divin ouvrage,
Dieu nous bénira tous;
Grands et petits, de tout sexe et tout âge,
Faisons un Calvaire à Dieu,
Faisons un Calvaire !
(pour s’exciter d’aller au Calvaire)
Allons au Calvaire, allons,
Allons au Calvaire I
Bx Grignion de Montfort.
Note. — Le recueil de cantiques où l’on trouve cette pièce la fait suivre du cantique si connu au Calvaire :
Chers Amis, tressaillons d’allégresse. .
Il y produit déjà la faute que nous affligeront presque tous les éditeurs des cantiques du Bienheureux :
Allons voir Jésus-Christ mort pour NOUS.
Le texte original du Père de Montfort, consulté de nouveau, porte, comme il fallait s’y attendre, non pas : mort pour nous, ce qui ferait rimer le mot nous avec lui-même puisqu’il y a au-dessus :
Nous avons le Calvaire chez nous;
mais bien : mort pour TOUS, trait manifestement dirigé contre les Jansénistes.
N° 4 Avril 1931
Un sinistre au Calvaire
Le dimanche « Lætare », 15 mars, la croix si chère au cœur du Bienheureux Père de Montfort visitait ses enfants au pied de son Calvaire. Un incendie, qui avait sans doute couvé lentement pendant les vêpres, éclatait dans la maison des Sœurs comme on sortait de la chapelle, un peu après 2 heures de l’après-midi. Trois heures plus tard, malgré le dévouement des pompiers de Pontchâteau et d’un renfort accouru de Saint-Nazaire, du vaste immeuble à deux étages, couvrant 350 mètres carrés, il ne restait plus que les quatre murs et quelques cloisons fumantes. Si encore lingerie et mobilier avaient pu être arrachés aux flammes I Hélas ! à part quelques meubles et quelques articles de literie précipités par les fenêtres, tout périt ! Le matériel important qui servait aux retraites des Sœurs, pendant les vacances du Petit Séminaire, draps, oreillers, couvertures, serviettes, etc. ; les réserves de lingerie et de tissus pour les séminaristes, le trousseau des prochains soutanes de juillet ; le stock des chapelains du Pèlerinage pour les réceptions des jours de fête, la lingerie et le vestiaire de leur chapelle, conservés là à cause de l’humidité de la sacristie : aubes, surplis, nappes d’autel, nappes de table de communion, ornements ; les magnifiques tentures du trône épiscopal, la parure en velours du brancard d’honneur, tout cela est présentement enfoui sous des monceaux de briques et de gravois, continuant à alimenter un feu couvert que la nappe d’eau répandue par les trois lances des pompes n’a pas réussi à noyer complètement et qu’en ce 19 mars, où j’écris, on surveille toujours.
Les seize religieuses et la douzaine de jeunes filles de leur école ménagère n’ont sauvé de leur vestiaire que ce qu’elles avaient sur elles ; et des deux dortoirs, les premières salles envahies par le feu, rien ne put être retiré.
Pour comble de malheur, les nouvelles polices d’assurance dont on sentait l’impérieux besoin, avaient été retardées par de multiples contre-temps. Nous ne savons pas encore ce qu’accorderont les Compagnies. Il est à craindre que ce ne soit fort peu.
Aux paroles de sympathie entendues de toute part, des amis nous conseillent d’ouvrir une souscription, nous assurant que le public, touché de notre grande épreuve, n’attend qu’un appel pour .venir à notre secours.
Malgré les 2.000 abonnés que nous devons compter dans la région voisine du Calvaire, ce n’est certainement pas notre petite revue qui a la voix assez puissante pour lancer un tel appel. Elle publiera cependant avec reconnaissance les noms de tous ceux qui s’adresseront à elle pour remettre leur offrande à la commune infortune des enfants du Bienheureux Père de Montfort.
Sans attendre plus longtemps, chers lecteurs, vous pouvez donc nous envoyer l’aumône que votre grand cœur vous inspirera. Il est probable que vous n’aurez jamais pareille occasion de témoigner au Bienheureux de Montfort combien ses œuvres vous sont chères.
H. Daniel
N° 3 Mars 1934
Nos Volontaires
Inscrivons au Livre d’or des travailleurs du Calvaire :
1re et 2* équipes de Missillac, 22 novembre et 15 février
Pierre Poidevin, Joseph Poidevin, Pierre Poidevin, Jean Deux, Joseph Leroux, Joseph Noblet, Emile Poidevin, J.-M Leroux, S. Guiheneuf, J.-M. Guiheneuf, J. Deux, Joseph Leroux, J. Poidevin, Henri Poidevin, Henri Perriot, Jean Perriot, J. Vaillant, Ernault, Emile Bertrais, Podevin, Th. Guihard, Joseph Bernier, Arnault, Joseph Guihard, Fr. Mahé, Eugène Guihard, Prudent Deux, J. Guihéneuf, Jean Mahé, Tranchant, Perrault, Beauchêne, Olivaud.
Auguste Sébilot, Etienne Bernier, Auguste Perrigaud, Jean Perrigaud, Fr. Plaud, Eugène Bouyer, Joseph Mahé, J.-M. Danet, Louis Noblet, Joseph Mahé,
2° équipe de Crossac, le 30 novembre.
Auguste Avenard, Pierre Thibodeau, André Gourhand. Armand Tua, Henri Guiheneuf, J.-B. Mahé, J.-B. Olivaud, Généreux Danais. Jean Ollivaud.
1re et 2° équipes de Sainte-Reine, 7 décembre et 18 Janvier.
Magré (au Fresne), Pierre Allaire, Pierre Lucas, Jean Bugel, J.-M. Robard, Joseph Boisrobert, Jean Guiheneuf, Louis Meignen, Jean Guigand, Raymond Guigand, J.-M. Bivaud, Fr. Moisan, Georges Martin, Sim. Joalland, Robert Joalland, Marcel Joalland, Pierre Bivaud, Pierre Guigand.
Louis Halgand, Camille Halgand, Jean Leduc, Donatien Perraud, Jean Lecomte, Emilien Hilbert, Leduc, Jean Ménoret, Jules Rual, Henri Boisrobert, Jean Boisrobert, Louis Broussard, Joseph Mahé, Jean Jouin, Fr. Ménoret, Julien Moyon, Louis Delahaye, Joseph Barré, Aug. Lebeau, Louis Allain, Auguste Maisonneuve, Henri Guiheneuf, Louis Belliot, Fr. Belliot, Alph. Belliot, J.-B. Mahé, Victor Cuzon, Louis Rual, Joseph Belliot, Victor Tual.
Equipe de Saint-Roch, 1er février.
Albert Judée, François Chabot, Jean Libeau, Francis Morand, Joseph Béranger, Chédotal, Moisan, Loyer, Vignard, Jean Chabot, Riot, Yves Bertrais, Gougeon, Moisan, Morand (et un omis).
Equipe de Drefféac, 14 février.
Jean Poulain, Bapt. Poulain, Ferd. Poulard, Jean Porcher, Pierre Busson (bourg), Pierre Clément, P. Audrain, P. Boistuaud, Joseph Busson, Pierre Busson, Fr. Moyon, Fr. Bernier, Gab. Ramet, S. Vaillant, Pierre Busson, H. Vaillant, P. Clément, A. Béguet, E. Richard, A. Clément, Joseph Poulard, E. Loreau, Joseph Lecamp, J.-M, Pérais, J.-M. Malnoë, Jér. Malnoë, Joseph Clément, R. Clément, Paul Briand, Fr. Moyon.
Equipe de Pontchâteau, 16 février.
J.-B. Joalland, Pierre Leray, Jean Meignen, St. Allain, Alex. Vallée, Armand Vallée, Fr. Célestin, P. Guillé, Louis Leroux, Alex. Noblet, Gilles Guillé, J.-B. Chédotal, J.-M. Vaillant, Pierre Joalland, Lucien Lemesle, Pierre Hervy, André Duval, P. Allain, Pierre Guillé, Joseph Lehur, Aug. Vignard, Marcel Busson, Bidet, Louis Château, Pierre Guillé, Jean Demy, René Vaillant, J.-B. Vaillant, J.-B. Belliot, Louis Letilly, Jean Bivaud, Pierre Letilly. Albert Drouillet, Fr. Cadio, Fr. Joalland, A. Gourhand, Alph. Bernard, Alex. Ramet, Alph. Rialland, Louis Prioux, Georges Vaillant, Ernest Lehur, Jean Cornet, Louis Durand, Pierre Thobie, Jules Letilly (Saint Guillaume), Fr. Thobie.
Equipes modestes qui ne rappellent que de loin les légions du P. de Montfort et du P. Barré ; mais le chantier n’est pas immense, et il faut se modérer, sauf à demander de nouvelles équipes aux mêmes paroisses que l’on divise par villages. Mais on voit que les temps héroïques ne sont pas révolus, et il a suffi d’un signe pour amener sur le terrain trois ou quatre attelages en renfort aux wagonnets. Merci à tous ces généreux travailleurs et à MM. les Curés qui les ont alertés avec tant de diligence !
Le Calvaire reste manifestement l’œuvre la plus populaire du P. de Montfort.
N° 4 Avril 1934
Nos Volontaires
Inscrivons au Livre d’or des Travailleurs du Calvaire :
Le 20 février, Quilly qui nous arrive avec son maître en tête, M, Rogatien Oheix et-vingt-un compagnons : Baptiste Guiné, Pierre Ducoin, Emile Potiron, Fr. Meignen, Fr. Clouet, Jean Bousseau, D. Lévêque, J. Oheix, Georges Pageot, Aug. Sylvestre, R.Fr. Ducoin, Agasse, Baconnais, J. Ballu, Baptiste Lévêque, Eloi Le Gentilhomme, L. Séroux, Fr. Ménard, J. Caillon, E. Gaudain, Glotain.
Le 22 février, une première équipe de Besné : Fernand Gergaud, R. Russon, Jh. Russon, Gériais, Francis Dalaits, Louis Champion, J. M. Moisan.
Le 23 février, La Chapelle-des-Marais, avec son excellent curé, M. l’abbé Blais, qui travaillera comme un sapeur, et dix-sept ardents : Jh Perraud, Louis Legoff, Aug. Gervot, Louis Gervot, Louis Belliot, Jean Delalande, Henri Bertho, Aug. Hervy, Pierre Gervot, Aug. Lelièvre, Jean Gervot, Jean Bertho, Emile Dréno, Pierre Chauvel, Pierre M. Taconnet, Jean Montfort, Baptiste Cornet.
Le 27 février, Sainte-Anne de Campbon, son sympathique curé M. l’abbé Mérel, et soixante-douze hommes : Clair Meignen, Fr. Moriceau, Pierre Moriceau, Emmanuel Plissonneau, Lucien Fleury, E. Legentilhomme, E. Morice, Fr. Legentilhomme, A. Moriceau, E. Charpentier, E. Moriceau, V. Glotin, M. Gattepaille, Jean Cornet, J. Busson, Louis Claireau, Ferd. Oheix, Maurice Anizan, Jean Judic, Louis Judic, Paul Glotin, R. Claireau, Gustave Guihéneuf, Joachim Gattepaille, F. Lebas, Gilbert Guillon, Jean Tégret, P. Couëron, A. Legentilhomme, Jean Coquet, P. Morice, J. Fleury, D. Guihéneuf, R. Moriceau, Al. Cran, Pierre Glotin, A. Guillet, Donatien Oheix, Francis Legentilhomme, Aug. Cran, J. Legentilhomme, Dalibert, Aristide Mainguy, Fr. Loyer, Fr. Moriceau, E. Morice, Pierre Gatepaille, Jean Plissonneau, P. Desmars , P. Roger, L. Couëron, A. Couëron, Louis Leray, P. Moriceau, Emmanuel Legentilhomme, P. Gérard, P. Sauvrais, Rogatien Dalibert, P. Trégret, François Loyer, A. Legentilhomme, Donatien Morice, P. Launay, P. Guinée, Emmanuel Oheix, Félix Cran, Fr. Oheix, Aug. Legentilhomme, Jean Fleury, Jh. Oheix, R. Lebas, R. Plissonneau.
Le 1er mars, la deuxième équipe de Pontchâteau, avec M. l’abbé David, vicaire, Emile Cornet, Henri Maisonneuve, P. Billy, P. Cadiot, V. Clarier, J. Morand, Jh Lebrun, R. Docet, E. Glotin, David, E. Chevalier, C. Corbé, Guillé, Jh. Rialland, P. Moricet, Ch. Gougeon, F. Fleury, Armand Fleury, C. Napper, P. Vignard, Guérin, P. Juhel, R. Marchand, L. Thébaud, Jh. Thobie, Paul Bertaud, A. Poulain, H. Pabois, Jean Cornet, Gabriel Guiot, Jh. Alliot, Fr. Moricet, Nicolas, J. Menuet, Fr Morand.
Le 2 mars, Herbignac, avec M. de la Monneraye, Conseiller général, Leroux, Hervy, Jh Thobie, P. David, P. Thobie, L. Delalande, L. Crusson, A. Rivalland, Jh. Blouët F. Delalande, Léon Bouillo, Delalande, A. Menet, M. Garino, Jh. Maurice, J. Guihéneuf, Jh. Bernard, J. Crusson, Jh. Tendron, P. Bertho, Jh. Gergot, A. Maurice, C. Bichon, L. Maurice, Th. Guégan, Jh. Evain, A. Gouret.
Une bonne dizaine de paroisses se sont encore promises et seront venues sans doute au moment où paraîtront ces lignes. Quelle est, dans tout le voisinage, celle qui n’aspire à mettre de nouveau sa signature au bas de la grande œuvre du Calvaire ? Nous serions presque tenté de créer de nouveaux chantiers pour employer toutes les bonnes volontés qui s’offrent. Attendons l’automne, et il y a chance que les femmes elles-mêmes ne seront pas négligées avec leurs petits paniers. Merci à nos braves travailleurs et à leurs dévoués recruteurs, curés et vicaires, sans oublier les transporteurs bénévoles ! A tous notre très sincère reconnaissance.
N° 5 Mai 1934
Nos Volontaires
Continuons à inscrire au Livre d’or des Travailleurs du Calvaire.
Le mardi 6 mars, Saint-Gildas et Sévérac, avec le plus pittoresque défilé de véhicules automobiles qu’ait probablement jamais vu le Calvaire. Tout a été mobilisé ; après quoi, les deux chers curés, grands dévots du P. de Montfort, se sont mobilisés eux-mêmes. Les voici avec leur troupe.
Saint-Gildas : Michel Gautier, Alfred Agasse, Pierre Poulain, Louis Chauvel, François Loreau, Jean Duval, Baptiste Barreau, Joseph Moyon, Joseph Robert, Jean Chauvel, Pierre Mercy, Pierre Porcher, Baptiste Chauvel, Jean Louis, Baptiste Daniel, Pierre Gervaud, Antoine Malnoë, Aristide Agasse, Chatelier, Raguet, Busson, Champion, R. Roussel, A. Bouvron, A. Meluc, Houis, Moricet, J. Biguet, J. Houis, Ch. Moricet, Ménager, Houis, J. Chaillon, J. Meluc, Blain, Chauvel, Robert, Letertre, Clément, Jean Gervaud, B. Daniel.
Sévérac : Pierre Rialland, Henri Lanio, Th. Marchand. J.-B. Rialland, Fr. Roux, P. Lelièvre, P. Roux, Al. Lando, M. Robin, J.-F Duval, Jh Marchand, Pierre Roux, L. Chéron, J.-B. Tréhello, Fr. Balac, J.-B. Couëdel, Al. Roux P. Chevalier, P. Frêlle, J.-M. Moreau, F. Biguet, J. M Biguet, Pierre Ménager, P. Roux, J. Chéron, R. Ricaud, J.-B. Ricaud, M. Lelièvre, J.-B. Lelièvre, J. F. Roux, J. -B. Roux, J. Mahé, J. Chéron, J. Biguet, Jh Rialland, J. ChailIon, F. Ménandais, Jh Roux, J. Tréguet, L. Mahé, Al. Roulet, Bonhomme, Huet, H. Charrier, Ad. Tanguy, Chauvel, Bouvron, Ferrand, Couélier, Meluc, Fréhel, Bonhomme, Al. Biguet, Albert S., Yves Josso, David, P. Marchand. Jean Gui…, Jean Ménager, P. Régent, Ch. Biguuet, E. Guillard, J. Marchand, A. Rousseau, A. Chauvel, Y. Rousseau, A. Demy, E. Marchand, F. Marchand, P. Marchand, B. Richard, P. Roux, J.-B. Duval, J. Guillard, Frère, M. Gautier, J.-B. Roux, A. Roulet, Haspot. Proust, J. Chaillon, Lecand, Chauvel, Régent, Normand, Chéron, Joux, Trégré, J.-B. Rialland, Robin, P. Praud. Chevalier, H. Marchand, Trelo, et quelques amis.
Nous massacrons sans doute quelques noms. On comprend qu’après de pareilles journées de pelle et de pioche, nos terrassiers, en prenant la plume pour signer, n’aient pas tous une écriture de notaire.
Le mercredi 7 mars, Saint-Dolay piloté par M. l’abbé Lelièvre, jeune et intrépide vicaire : F. Noblet, H. Hodet, Jh Sébillot, P. Le Clève, A. Lévesque, H. Montoir, P. Magré, L. Pério, A. Guihard, J. Guihard, A. Vallée, J.Chesnin, Th. Magré, J. Crespel, P. Ganguet, A. Pretrel, M. Mayas, Emile Fréhel, Crespel, J. Montois, C. Sébilo, Crespel, B. Fréhel, E. Périon, L. Fréhel, M. Noguet, A. Grouhan, L. Juhel, H. Géraud, B. Fréhel, E. Vallée, H. Vallée, E. Magré, J.-L. Chesnin, A. Savourel, A. Préour, Chau .., F. Savourel, Jh Logadin, J.-L. Sébilo, L. Crespel, J.-B. Grouhan, M. Mahé, Jh Niget, J-L. Chotard, J. Pérais, B. Bompoil, J.-M. Grouhan, C. Perio, Léon Gombaud, E. Pério, Leroux, Bernard, Le Corre, Chotard, P. Sébilo.
Le jeudi 8 mars, troisième équipe de Missillac : Désiré Jagu, Jean Vaillant, Julien Gougeon, J. Guado, H. Sarzeau, Fr. Plaud, H. Morand, Y. Potrel, A. Duval, P. Poitevin, Sébilo (La Bretesche) Mahé (La B.), Desbois (La B.), Louis Morice, J. Nicolais, A. Regardin, J. Vaillant.
Le jeudi 9 mars, Campbon avec une quarantaine de fervents du P. de Montfort qui faillit bien élever chez eux son Calvaire : Louis Houin, Pierre Paussaud, Emile Maillard, Francis Mozery, Marcel Caillon, Jh Lemarié, Pierre Caillon, P, Paressant, Jh Houis, Jh Briand, Fr. Guiné, Paul Trivière, Pierre Guillé, Fr. Legof, Jean Ouïsse, Pierre Jouhaud, Jean Orain, Pierre Oheix, Jh Guiné, Jean Gérard, Charles Legentilhomme, Donatien Caillon, Pierre Anizan, Fr. Sourget, Alfred Fleuret, Fr. Lemarié, Pierre Caillon, Fr. Abin, Célestin Géaard, Jh Ferrand, Fr. Orain, Jean Orain, Louis Orain, Albert Orain, Léon Rouby, O B. Pierre Tréguet, François Longuet, Louis Orain.
Le mardi, 13 mars, deuxième équipe de Besné : Félix Russon, Jean Motreux, Fr. Couëdel, Ed. Château, Ambroise Barbin, Henri Lemarié, René Bernier, Félix Legentilhomme, Pierre Roux, Emile Lalaite, Jean Lanoë, Alph. Richard, Jh Château, J.-B. Gergaud, Ferd, Gouin, J. M, Aupiais, Marcel Aupiais.
Le mercredi, 14 mars, par un temps douteux qui va se résoudre en une pluie battante et ne laissera pas à la vaillante équipe le temps même d’inscrire tous ses noms, Marzan, avec M. l’Abbé Carel, vicaire, et vers onze heures, malgré le ciel qui fond, l’intrépide M. l’abbé Jean Huet, curé : Julien Mitaillé, Fr. Mitaillé, Jean Rio, André Anézo, Jean le Bras, Alexis Robert, Etienne Kerouault, Jean M…, Jean Duparc, J. B…, Alfred L…, Pierre S…, Marcel Lérideau, Edouard Merlet, Jh Le Masle, Léon Blo…, Jean Guyot, Jean O,. Jean-Pierre Le Thiec, Julien Le Mauff, Paul Le Chatel.
Le mercredi 21 mars, Saint-Lyphard et Pompas avec leurs zélés pasteurs, M. l’abbé Rolland, et M. l’abbé Delhommeau, et tout un train de voiturettes et de camionettes.
Saint-Lyphard : Louis Yviquel, H. Moranton, I. Moranton, L, Hougard, Pierre Denier, Jean Cadiet, Maurice Orain, Louis Retailleau, P. Harzelaire, A. Yviquel, R. Cadiet, J.-M. Cadiet, Clément Lebihain, F. Retailleau, Jh. Yviquel J -M. Magré, M. Lebeau. Jh Hougard, Ed. Guihaie, G. Gourdi, P. Perrais, J.-M. Denigot. A. Cholet, Isidore Jubé, J. Dilhuidy, P. Beliot, Fr. Mahé, M. Avenard, J. Béliot, Fr. Denigo, B. Terrien, A. Denier, Ed. Lefeuvre, Jh Audrain. Cl. Aguesse, A. Legal, Jh Guilloré, M. Cadiet, H. Nicole, Jh Crusson, Léon Hougard, CI. Guihard.
Pompas : CL Perrais, E. Crusson, P. Nédélé, Fr Bernard, P. Frappin, A. Voilant, Jh Lopion, P. Halgand, M. Terrien, A. Advenard. H. Hachette, A. Pédron, D. Lebert, Jh. Sablé, A. Le Maignen, L. Bouillo, L. Berthe, Roger Blandin, J. Dalino, A. Hougard, Fr. Amisse, J. Crusson, J. Lebert, A. Bernard.
Nous dirons un jour tout ce que ces vaillants ont fait. Que du haut du ciel le P. de Montfort, qui a toujours sans doute les yeux sur son Calvaire continue à les protéger et à les bénir !
N° 6 Juin 1934
Le Temple au Calvaire de Pontchâteau
Il ne pouvait être question d’édifier, même en matériaux inférieurs, une copie du Temple de Jérusalem. Le terrain du pèlerinage n’y eût pas suffi, et encore bien moins les ressources qu’on avait lieu d’espérer. Il convenait toutefois, si l’on ne voulait pas être ridicule, de donner de ce monument gigantesque une réplique quelque peu imposante, ainsi qu’on avait fait pour le Calvaire et le Prétoire. Le béton armé s’offrait comme le « matériau » bon marché, à la fois souple et robuste, et l’architecture militaire, la plus simple de toutes les architectures et la plus évocatrice de l’original, comme la mieux indiquée. Un sanctuaire, une vaste cour ou parvis, des galeries, des salles, une enceinte fortifiée, le tout avec un cachet oriental, et la suggestion serait assez forte pour créer l’illusion et parler à l’imagination populaire. Nous disons bien : « populaire », car c’est pour l’enseignement et l’édification du peuple que le Bienheureux de Montfort, apôtre et artiste populaire par excellence, voulut son Calvaire de Pontchâteau.
C’est dire que, sans dédaigner les appréciations des délicats, nous mettons par-dessus tout, en pareille matière, les suffrages de nos bons pèlerins. Leur procurer aussi un abri ne fut pas la moindre de nos préoccupations, car ces braves gens ne viennent pas, comme les amateurs et les esthètes, les seuls jours qu’il fait beau. Or, grâce à Dieu, bien que la grosse construction ne soit pas encore achevée, qu’elle présente même quelques parties énigmatiques, et que l’ornementation soit à peine ébauchée, ces chers pèlerins se déclarent déjà hautement satisfaits. Nous n’en demandons pas davantage, espérant bien cependant que cette satisfaction chantera plus haut encore lorsque, l’édifice terminé, ils pourront juger de sa commodité et de sa vivacité de suggestion, surtout les jours prochains où de belles fêtes et l’animation pieuse de leur foule donneront âme et vie à ces pierres mortes.
Puisse la générosité de ce bon peuple, à qui nous devons sou par sou toutes nos ressources, ne pas se relâcher malgré la crise ! Alors l’Année Sainte, mettant le point final en acquittant nos dettes, justifiera pleinement l’inscription-date gravée sur une des grandes portes de l’enceinte.
N° 11 Novembre 1934
Nos Volontaires
Avant de clore, en cette fin d’octobre, la grande saison de l’Année jubilaire, saluons encore une fois nos Travailleurs.
Voilà, doublant l’allée des Tilleuls, la spacieuse avenue qu’embroussaillait à l’automne dernier une rangée difforme de pommiers malingres et courbaturés, implorant la lumière de leurs bras tordus par les vents. Les bannières des processions ne s’y accrocheront plus. Les camions roulants n’en feront plus tomber les fruits étiques. En un après-midi, l’exécution fut achevée, les troncs arrachés et mis en cordes, les branches fagotées, et le tout acheminé vers le four. Puis des attelages chargés de cailloux, des brouettes procédèrent à l’empierrement de la voie élargie. Pour le cylindrage, l’on s’en remit à la bonne volonté des autocars, et il faut convenir que les mastodontes ont assez bien répondu à l’attente. Encore quelques charretées de pierres pour renforcer l’échine, et l’avenue sera digne du Temple dont la voix publique commence à lui donner le nom.
Le Temple ! A l’Ecole Apostolique, notre voisine d’en face, lorsque la division des petits, partant pour la promenade, défile sous les murs de la forteresse les nouveaux de l’année dernière se plaisent à décrire non sans fierté, à leurs cadets de cette année, le passé lointain où jardin et verger étalaient leur verdure sur l’emplacement de ces bastions gris. Sunt lacrymœ rerum… Comment ne pas donner quelques larmes à cette figure des choses à jamais disparue ? Où s’allonge ce soubassement de moellons jointoyés au ciment, une haie vernissée de fusains, pomponnée çà et là de pommiers touffus, encadrait d’opulents carrés de légumes. Une terre molle que remuait la bêche occupait tout cet espace où résonne maintenant un dallage de béton. Dans ce quadrilatère qu’assombrit la terrasse d’un vaste hall, le soleil mûrissait l’oignon et la tomate. A la place où se dressent, rigides et anguleuses, ces colonnes de béton armées de fer, s’épanouissaient de béates laitues, grimpaient les haricots, et bedonnaient les citrouilles. De pacifiques vaches paissaient à l’ombre des pommiers dans cet enclos désert duquel des murs crénelés, des tours percées de meurtrières donnent l’air d’une place d’armes. Tombés les grands pins où s’ébattait le vent ! Tombé le bosquet de daphnés et de pruniers sauvages où se régalaient les merles ! La dentelle des créneaux à jour court sur la corniche du sanctuaire à la hauteur où les conifères tendaient vers la nue leurs longs bras de candélabre. La pelle, la pioche et la cognée ont passé par là. Charrettes et wagonnets ont changé jusqu’à la configuration du terrain. Adieu, jardin ! adieu, verger ! adieu, beaux arbres qu’on ne vit pas tomber sans peine ! Adieu ! mais vous ne serez pas oubliés. Vous reviendrez dans les récits des anciens ; et la légende, qui auréole tout ce qu’on regrette, vous embellira encore.
N° 1 Janvier 1935
Nos Travailleurs
« Mais où sont les neiges d’autan ?» Oui, où sont-ils ces soirs de décembre 1933 dont les premières étoiles nous apercevaient sur les terrasses de la grande salle du Temple achevant, à la lueur fantomatique des phares à acétylène, de couler les dernières travées et de les couvrir minutieusement de bâches, de sacs, de planches et de bottes de paille ?
Il pleut. L’eau tant désirée remonte lentement dans les puits. Le sol devient spongieux et flasque, l’ont est gris sous le ciel gris, et le chantier fait plus triste figure que jamais avec ses amoncellements de terre et de cailloux, ses tas de planches rébarbatives, déchiquetées et hérissées de pointes, ses poteaux de mine qui champignonnent. Ah ! qu’ils seraient bien accueillis les bras qui viendraient nous aider à mettre un peu d’ordre dans ce chaos !
Puis il y a le verger, un pauvre verger, dont les pommiers agonisants font un masque honteux à la façade des murs d’enceinte. Ce serait bien le moment de ne pas les laisser languir dans une pénible vieillesse.
Mais voici des camions et des camionnettes arrivent, et cinquante-huit pionniers qui en débarquent, armés pour le massacre. Vive Notre-Dame de Grâce et son bon Curé qui nous les envoient. Désolez-vous, buveurs de cidre ! Ce soir le verger ne sera plus.
Voici en effet les arbres qui tombent, les troncs débités et mis en cordes, les branches liées en fagots. Le monument semble sortir de terre. Le soleil, un soleil que personne n’attendait, éclaire tout d’un trait la joyeuse exécution… Inscrivons au tableau d’honneur :
Joseph Surget, Jean Richard, François Petiteau Jean Pelé, Clément Dupas. Joseph Blandin, Léon Guillet, Pierre Langlais, Alfred Beaupérin, Pierre Talbourdel, Julien Amossé, Pierre Duruet, Victor Rousseau Jean Letort, Julien Bugel, Francis Belliot, Paul Maudet, Aristide Guillard, Martial Legrand, Gustave Legrand. Eugène Legrand, Albert Agasse, Léon Fraslin, Jean Petiteau, Ferdinand Perraud, Pierre Tessier, Louis Cornet, Alphonse Bily, Jean Moureau, Louis Vaillant, Paul Martin, Joseph Etourmy, Pierre Guichou, Jean Bugel, Julien Hougeard, Francis Lemaître, Julien Rousseau, Pierre Agasse, Louis Beaupérin, Julien Thébaud, Emile Plaisance, Francis Guitton, Jean Sicard, Jules Fourage, Jacques Faidal, Pierre Rocherioux, Joseph Petiteau, René Ballu, François Macé, Pierre Ollivier, Edouard Ollivier, Ambroise Joly, Jean Tremblay, Jean Chatelier, Baptiste Deruet, Célestin Château, Joseph Richard, Théophile Maudet.
Cela, c’était le lundi 3 décembre. Une autre équipe nous est promise de Missillac, la quatrième de cette excellente paroisse. On nous l’annonce pour le jeudi 20.
Le jeudi 20, la voici en effet, vingt et un jeunes à bicyclette, la pelle et la pioche au cadre de leur véhicule, et qui, par miracle, nous ramènent le soleil. On ne va pas chômer. Les petites tailles sous la terrasse inférieure du sanctuaire, pliées en deux, pour niveler les déblais des fouilles et des empattements ; les autres au dallage du béton, à la taille des haies, à la tranchée pour le passage du câble électrique souterrain. L’après-midi, la division des Benjamins de l’Ecole vient nous prêter main forte, trie les planches de coffrage, range à l’abri les poteaux de mine, s’attelle comme une fourmilière aux fagots du verger. Minette elle-même est réquisitionnée et, stimulée par de si beaux exemples, donne allègrement du collier.
A la suite donc au tableau d’honneur tous nos vaillants de Missillac :
Pierre Jagu. Julien Poidevin, Pierre Leroux, J.-P. Ernaut, Jean Tainguy, Maurice Mayet, Mathurin Gauthier, Francis Broussard, Pierre Hudiger, Auguste Bouyer, Pierre Guihéneuf, Auguste Sébilo, Louis Morice, J.-M. Danet, Auguste Poidevin, Jean Perriot, René Busson, Pierre Thobie, Joseph Lethiec, Raymond Guihéneuf, Auguste Riot.
A la fin d’une année si bien remplie, pendant que toute la région est dans la sainte effervescence du Jubilé, on voit que l’ardeur ne mollit pas au Calvaire. On peut même dire que, grâce à tous ces dévouement, 1934 s’achève en crescendo. Qu’à leurs généreux concours, nos chers travailleurs, nos charitables souscripteurs, nos fidèles pèlerins et leurs dévoués pasteurs veuillent bien ajouter une petite prière pour que 1935 puisse carillonner le baptême du Temple. C’est d’un cœur bien reconnaissant que nous disons à tous merci !
N° 6 Juin 1935
Nos Travailleurs
A force d’attendre un ou deux beaux jours sûrs pour achever le plus pressé autour du Temple de Jérusalem, le printemps allait venir avec les travaux des champs. Adieu l’espoir de belles équipes ! Donc, fin février, malgré le vent épileptique qui ne cessait de rouler de l’est à l’ouest, sifflant, grondant, bavant de la neige fondue, crachant pluie et grêle, on tourna les yeux vers le Morbihan. Il y avait de ce côté-ci de la Vilaine quelques vaillantes paroisses qui n’avaient pas encore été sollicitées et à qui il suffirait de faire signe. On alla donc frapper à la porte des excellents recteurs de Nivillac, Théhillac, Férel et Camoël. Frapper à ces portes-là, c’est frapper au cœur. « Oui, oui, nous enverrons nos paroissiens. Quand au juste ? On vous dira. Mais vous pouvez y compter. Des pelles, des pioches, des serpes, des haches… Attendez que je marque cela… Un repas froid dans les musettes. Une soupe chaude à l’hôtellerie. Ils savent cela par cœur. C’est la vieille tradition ; et ce n’est pas la première fois qu’ils iront travailler au Calvaire… Vous aurez de la besogne pour tous ? — Ah! Monsieur le Recteur ! » Et le solliciteur levait les bras en l’air.
Voici donc, le 12 mars, le premier arrivage, une compagnie de pionniers armés pour la dévastation. M. le Vicaire de Nivillac est à leur tête. C’est un mardi. Il a plu la veille et le dimanche précédent. Il pleuvra le lendemain, et tout le reste de la semaine ou peu s’en faut. Mais on joue de bonheur. Assurément quelqu’un veille là-haut. Le beau temps, un brin de soleil surtout, c’est la moitié du courage. Mais ce n’est pas un brin de soleil seulement qui brille, c’est un grand soleil de printemps. Le P. Joret prend la moitié de l’équipe pour niveler la nouvelle avenue qui file du Temple au vieux Moulin, et voilà pelles et pioches en train de raboter l’échine. On plante aussi ; on prépare des trous pour les plantations futures ; on fagote ferme.
En bas, autour du Temple et dans le Temple, l’autre moitié de l’équipe, les corps de métiers, les professionnels de la truelle et du pinceau, de la hache et de la scie, de la massette à casser les cailloux. Voici les coiffeurs improvisés en train de tondre les haies ; les badigeonneurs affublés d’invraisemblables défroques de théâtre, grimpés sur les échelles et les échafaudages, passant à la chaux murs et plafonds de la grande salle; d’autres à l’extérieur aspergeant le ciment triste d’une belle sauce blanche dont le vent généreux leur renvoie la moitié. Une demi-douzaine étrillent à tour de bras avec des brosses d’acier les moellons où traînent des bavures de ciment et de chaux. D’autres empierrent et cassent des cailloux. Les maçons bétonnent le parvis d’entrée et préparent l’escalier. Les menuisiers, le pinceau en main, font la toilette des portes et des panneaux. De temps en temps un coup de cidre vient rappeler qu’on est breton et retremper les muscles.
Le soir venu, chacun se retourne pour contempler son œuvre, « Père Directeur, avons-nous bien travaillé et êtes-vous content ? » Comment donc ? Assurément ce n’est pas fini encore ; mais quel changement depuis ce matin ? Partout un air de propreté. Les haies n’ont plus leur affreuse tignasse. Les allées en fondrières commencent à prendre des airs de princesses ; la salle blanchie aux deux tiers ne fait plus grise mine… Allons à la chapelle rendre grâces à Dieu et lui demander sa bénédiction. C’est là, au pied de l’autel, après le Salut du Saint-Sacrement, que le Directeur du Pèlerinage, tenant en main les reliques du Père de Montfort, remerciera, au nom du grand Missionnaire dont le Calvaire est toujours l’œuvre, ces braves gens, M. l’Abbé qui les accompagne et les dévoués Recteurs qui les ont alertés.
Au tableau d’honneur :
Travailleurs de Nivillac :
P. Magrez, P. Baudhet, L. Leroy, François Geffray, Eug. Tendron, François Bizeul, Alexis Morice, Eug. Fréour, Alexis Roy, Etienne Brieux, Félix Fréour, Jean Fréour, Jean-Louis V., Joseph Levraud, Eugène Bompoil, Emile Ouédignac, Auguste Maurice, Benoît Chatal, Pierre Le Hur, Paul Le Goff, Emile Thobie, François Bompoil, Basile Blanchard, Auguste Huguet, F. Le Thiec, J. Thobie, J. Cocard, André Denigot, J. Oillic, Jean Sablé, Ambroise Sébillot, F. Le Fur, Jean Noblet, J. Sébillot, Maurice Le Fur, A. Thobie, Basile Chatal, Félix Le Thiec, Eugène Chesnin, Marcel Robert, Pierre Evain, Jean Levraud, Paul Oillic, J. Le Thiec, J. Morice, François Pabœuf, A. Rivalland, F. Blanchard, Ambroise Oillic, Paul Panhelleux, Alexandre Morice, J. Rio, Auguste Chabot, Victor Moureaux, Basile Panhelleux, André Oillic, Amédée Le Thiec, Ernest Fréour, J. Picaud, Rialland, J. Thobie, François Vallée, Emile Sébillot, Eugène Fréour, Basile Le Thiec, E. Logodin, J. Allain, Le Frère Théophile, Levrault, Léon Lévêque, Raphaël Rialland, Guichard, Sébillot, Rialland, Morice, Robert, P. Chesmin, Crespel, Adrien Prioux, F. Guihéneuf, Louis Fréour, Pierre Robert, Guihéneuf.
Travailleurs de Théhillac :
Rousseau, Chesnin, Rabillard, Denis, Périon, Bompoil, Durand, Chesnin, Baucherel, Perion, Montoir, Tinguy Busson, Gauthier, Baucherel, Perion, Lesnée, L. Perion, E. Tinguy, L…, Duval, Renaud, Guillard, Rich…, Montoir, chesnin, Perion, Rousseau, Lopion, Mahé, Duval, Bizeul, Chesnin, Renaud. M. Chesnin, Théophile Vaillant, Pierre Rutin, Duval, P. Chesnin, David, H. Chesnin, P. Chesnin, Renaud, E. Chesnin, Gauthier.
+
Quinze jours après, le 26 mars, c’est Férel qui débarque, le jeune vicaire en tête. Camoël suit, « Cela fait du nombre, nous dit l’Abbé ? Allez-vous pouvoir les occuper tous ? — Ah ! pour cela, soyez sans crainte. Ils seraient cinq cents qu’on leur trouverait de l’ouvrage pour huit jours. » Il reste en effet, rien qu’autour du Temple, des arbres à éclaircir, des fagots à faire, de vieux troncs à débiter, des coins à niveler, des cailloux de quartz qui attendent encore le coup de massette, de jeunes plantations à remettre d’aplomb, des plates-bandes à rectifier, des trous à élargir pour vingt-quatre érables et platanes qui arrivent justement de la gare et qu’il va falloir planter en quinconce bien régulier dans la cour du Temple. Brosses et pinceaux occuperont le reste des bras, si tant est qu’il en reste encore. Et si le prédicateur de carême de Saint-Père-en-Retz était là, tout un autre chantier s’offrirait là-haut. Voilà nos gens à l’œuvre.
Chacun reste à son poste et en met un coup. La salle blanchit à vue d’œil, les tours à l’extérieur aussi. Voilà érables et platanes en bel ordre de bataille contre les assauts du vent, les rondins en cordes, les fagots qui s’entassent, le quartz qui éclate sous les coups, l’avenue qui bouche ses derniers cahote, Pâques peut venir. La toilette n’est pas finie. Il faudra longtemps bichonner encore. Mais enfin c’est présentable.
Que le Père de Montfort sur le grand livre, que là-haut il tient sans doute à jour, le grand livre d’or des travailleurs du Calvaire, veuille bien inscrire à la suite de son nom et des noms des ancêtres :
De Férel :
Clément Perraud, J. Rivalland, Alexis Santerre, Ambroise Le Thiec, Th. Denigot, J. Delalande, Julien Amice, Pierre Crusson, Paul Clavier, F. Anézo, Louis Delalande, Alexis Delalande, J. Delalande, Jean Guihéneuf, Eugène Guihéneuf, Auguste Anézo, Pierre Anézo, Eugène Cadiet, J. Noblet, Célestin Santerre, J. Le Gentil, Menandais, Pierre Thébaud, J. Rivalland, Marcel Haumont, Jean Chatal, Pierre Guriec, Isidore Vallée, Alexis Sablé, Alexandre Josso, Jean Chatal, J. Eonnet, J. Anézo, F. Anézo, Pierre Guihéneuf, Alexis Vollant, Célestin Santerre, Alexis Perraud, Alexis Delalande, J. Denigot, J. Bèchepay, Jean Denigot, Alexis Durand, J. Monneray, F. Leray, J.-L. Simon, J. Lucas, Pierre Perraud, F. Guillorée, Jean Sablé, Jean Quélard, Alexis Rousse, Bernard Sablé, J. Sablé, J. Thomas, Edouard Belliot, Célestin Chatal, Pierre Lennuffe, Henri Anézo, Basile Le Lay, Basile Denigot, J. Delalande.
De Camoël :
Alexis Gervot, J. Gervot, Pierre Gentil, Louis Boulard, Louis Josso, Marcel Bernard, Théophile Chevrel, Jean Vaillant, G.-M. Bertho, Gicquiau, Chatal, Thomas, Lescop, Henri Logodin, J.-P. Logodin, Tendron, Gouret, Michel Logodin, Tendron, Marcel Gouret, Francis Gouret, Donatien Gouret, François Bellegot, Célestin Volland.
+
A ces travailleurs, il faudrait ajouter les volontaires de l’Ecole Apostolique qui profitèrent des vacances de Pâques pour mettre aussi la main à la pelle, à la pioche, au râteau, à la scie, au marteau, à la brosse, au pinceau et s’atteler à la brouette. Le P. Le Jannou fit, pour un moment, de la géométrie pratique et de la chimie appliquée, rectifiant, avec son équipe de jeunes, les bordures des allées, ratissant, peignant, épilant ; passant tendrement sur les statues écorchées à vif par les rafales de l’hiver une lénifiante couche de blanc de zinc.
Il n’est pas un petit qui, ayant barbouillé de chaux quelque pan de mur, ne se trouve tout fier d’avoir droit aux prières que l’on récite aux messes de chaque dimanche pour les Travailleurs du Calvaire. Les touristes n’étaient pas peu surpris de revoir ce petit monde se démenant comme des fourmis et faisant ici ou là des travaux de véritables ouvriers et très convenablement réussis.
+
Nous sommes ainsi prêts à recevoir par tout temps nos chers pèlerins. Malgré la crise qui menace de s’éterniser, comment ne pas avoir bon espoir de trouver bientôt les ressources nécessaires à l’ornementation du nouvel édifice ! Ces équipes qui ont si puissamment marqué l’Année Sainte ne nous ont pas seulement apporté une aide appréciable, elles ont entretenu le courant de sympathie à l’œuvre du Calvaire. C’est une double raison pour nous de les remercier de tout cœur.
N° 11 Novembre 1935
La bénédiction du Temple de Jérusalem.
Ce n’est que le 8 septembre, au Prétoire, devant la foule des pèlerins, que le Directeur du Pèlerinage put enfin annoncer comme une chose décidée pour le 22 septembre la solennité que chacun attendait : la bénédiction du Temple par S. E. Mgr Gaillard, archevêque de Tours. Depuis plusieurs mois déjà, Son Excellence avait bien voulu nous promettre de faire en faveur du Calvaire de Pontchâteau une exception à la loi qu’elle s’était imposée en assurant l’administration du diocèse de Nantes, de n’y présider aucune solennité. Mais jusqu’au premier jour de septembre la date de la fête n’avait pu être fixée de façon ferme.
Du 8 septembre au 22, la distance permettait de souffler un peu et de laisser souffler aussi les paroisses voisines, naturellement les premières en mouvement. La présence de Monseigneur de Tours est un gage de succès. Elle permet de présenter la cérémonie sous un aspect grandiose, telle qu’on l’entrevoit et qu’on la décrit déjà jusque dans les cantons d’outre Vilaine, comme il nous en revient des échos. On parle des grandes journées du P. Barré qui reparaissent enfin. Malheureusement le temps, qui depuis le début du mois n’avait pas été merveilleux, se gâte encore. Le vent qui virevoltait de l’est à l’ouest, se cale enfin en pleine marée et crache de toutes ses bronches. Si le Père de Montfort n’intervient pas, voilà la grandissime fête à l’eau. Prières et supplications. Le samedi, veille du grand jour, on semble exaucé. Pourtant ce soleil qui brûle, cette température qui monte soudain ne sont pas absolument rassurants. Cela ressemble trop à une poussée de fièvre.
Monseigneur s’est annoncé pour cette après-midi du samedi. En compagnie de M. Chaplais qui nous pilote obligeamment, nous allons prendre Son Excellence à sa descente du train. A notre arrivée au Calvaire, on dirait que c’est le soleil lui-même qui veut faire à l’éminent visiteur les honneurs du Pèlerinage. Un tour à l’Ecole Apostolique où professeurs et élèves attendent dans la cour d’honneur. La retraite de commencement d’année bat son plein, et les physionomies recueillies font sur Son Excellence la meilleure impression. Après une brève allocution où l’humour se joint à la gravité, l’octroi d’une promenade illumine tous les visages et provoque un éclatant Vive Monseigneur !
Hélas ! comme on le craignait, voilà le baromètre qui se remet à faire des siennes, et l’ouest qui se brouille. Le lendemain matin, hum !… On espère quand même, lorsque, la messe de six heures et demie achevée, un crépitement signale la première averse. Et voilà tout l’horizon côtier qui fume. A travers les tourbillons d’eau on distingue à peine les moulins de Sainte-Reine. Le P. Joret et son équipe, occupés à décorer les murs du Temple, sont obligés d’abandonner la partie et de remiser leurs échelles. Les prophètes ne manquent pas pour déclarer qu’on en a pour toute la journée. Bienheureux Père de Montfort, serait-il possible ! Cramponnons-nous à l’espérance comme ces forains qui, fouaillés par la pluie, n’en dressent pas moins leur étalage au bord de la route.
Confiance largement récompensée. A neuf heures, l’horizon se découvre. A la question répétée des pèlerins : Où est-ce que se dira la messe ? on n’hésite plus à répondre triomphalement : Mais, au prétoire ! Plus de doute en effet. La nuée sombre qui couvrait tout le ciel se déchiquète en lambeaux qui se roulent en gros paquets d’ouate. Çà et là apparaissent des coins d’azur ; et tout à coup, illuminant l’étendue, voici le soleil !
De tous les abris sortent des fourmilières de pèlerins et le Temple surtout à l’honneur de leur visite. La vaste salle ordinairement close a levé ses panneaux de contreplaqué et forme une ample galerie de tous les points de laquelle on a vue sur la cour et sur le sanctuaire. Sur la plate-forme centrale se dresse une grandiose estrade surmontée d’un autel, la réédition du reposoir de la Croisade Eucharistique. Des fleurs, des candélabres, des tentures éclairent le fond gris du ciment. A l’opposite, sur la droite, par-dessus les murs crénelés et le rideau des conifères, la cime du Calvaire apparaît avec sa triple croix.
Mais déjà la foule roule vers la Scala Sancta, en quête d’un bout de banc, d’un coin d’herbe sèche à l’abri des arbres, d’un bon endroit d’où l’on pourra mieux voir et mieux entendre. La multitude des coiffes morbihannaises proclame que le prestige du Calvaire ne décroît pas de l’autre côté de la Vilaine. Il faut dire aussi que le Morbihan est à l’honneur dans la personne de M. le Chanoine Le Quintrec, archiprêtre de la cathédrale de Vannes, un orateur dont le nom est une réclame.
Dix heures un quart. Une rumeur de cantique, de claires voix de soprani. C’est l’Ecole apostolique qui approche, précédant Son Excellence. Une foule suit, et pendant toute la messe ce sera par tous les points du parc de nouveaux arrivants.
Monseigneur est à son trône, entouré de M. le Chanoine Lemoine, vicaire général, et de M. le Chanoine Masson, supérieur des Missionnaires diocésains. M. le Curé de Pontchâteau et le R. P. Drousset assistent Son Excellence. Le R. P. Le Dorlot, Supérieur de l’Ecole, est à l’autel ; et le R. P. Le Nours dirige les cérémonies avec une maîtrise dont Monseigneur nous dira toute sa satisfaction. Les chants liturgiques s’élèvent sous les arcades. Au « Kyrie » la foule, sous la direction du P. Joret, répond à la chorale de l’Ecole.
Après l’Evangile, le Révérend Père Directeur du Pèlerinage salue Son Excellence et la remercie d’avoir donné à l’œuvre du Calvaire et à nos chrétiennes populations cette marque de très particulière sympathie. Il évoque le passé lointain où un certain chevalier Rodoald ou Rouaud, seigneur de Pont-Château, fit don de notre paroisse à la fameuse abbaye bénédictine de Marmoutier, fondée aux portes de Tours par le grand saint Martin. C’était au début du XI° siècle. Un groupe de bénédictins vint prendre possession de l’église, fonda le prieuré et, peu de temps après, établit dans la forêt, dite depuis lors de la Magdeleine, un ermitage et une léproserie. Saint Martin devint ainsi le patron de la paroisse de Pontchâteau. Ainsi donc ce n’est pas seulement le métropolitain de la province ecclésiastique de Tours qui se trouve aujourd’hui ici, conclut l’orateur, c’est encore le successeur de saint Martin. « Que d’excuses, Monseigneur, pour manquer à la résolution que vous aviez prise de ne présider aucune solennité ! »
M. l’Archiprêtre de la Cathédrale de Vannes nous dit ensuite la géniale idée du Père de Montfort de représenter ainsi, autour de son Calvaire, les grandes scènes de l’Evangile sous la forme si populaire des mystères du Rosaire. Il célèbre la puissance de l’image, l’apostolat de cette reconstitution des principaux lieux historiques de l’Evangile, de ce Temple, centre spirituel de la nation juive et théâtre de tant d’épisodes de la vie du Sauveur et des premiers disciples. Il presse ses chers auditeurs de s’aider des monuments du Calvaire pour méditer, pendant la récitation du chapelet, les grands actes de Jésus et de Marie. Bonne et opportune leçon donnée avec la chaleur d’un apôtre et la clarté d’un professeur, et tout à fait dans la ligne de pensée du Bienheureux de Montfort.
Le célébrant entonne le Credo et la messe s’achève au milieu de chants de plus en plus nourris. Puis c’est le départ en procession vers le Temple pour la cérémonie de la bénédiction. La foule, qui doit dépasser sept mille, déborde l’avenue triomphale. Bientôt elle entoure le Temple ; et le cortège épiscopal a quelque peine à se frayer un passage au milieu de cette marée. Enfin Son Excellence pénètre dans la cour et atteint, au milieu des chants de l’Ecole, les degrés du sanctuaire. Bientôt sa voix s’élève solennelle, implorant dans les termes liturgiques la bénédiction divine sur ce lieu de prière. Le Pontife entonne ensuite le « Miserere » et, l’aspersoir à la main, fait le tour intérieur des murs. De retour sur la plate-forme du Sanctuaire, Son Excellence dit au peuple avec quelle ardeur de désir elle a prié Dieu de faire descendre ses grâces sur cette enceinte, sur ceux qui y sont venus en ce jour et sur tous ceux qui y viendront.
Puis l’on se rend à la chapelle pour y chanter l’Angélus. Le nombre incalculable des mamans qui tiennent à présenter leurs enfants à Monseigneur n’accélère pas le mouvement.
L’après-midi, quand le cortège épiscopal se rend au Prétoire pour le Chemin de Croix, le soleil, décidément de la partie, jette tous ses feux. La foule du matin semble s’être accrue encore.
Bientôt des milliers de bras s’étendent en croix. Magnifique et touchant spectacle dont Son Excellente qui, à genoux, donne l’exemple de la plus tendre piété, est visiblement touchée.
Le prédicateur du matin, M. le Chanoine le Quintrec, se surpasse. Commentaires délicieux en effet, neufs et suggestifs ! Le vent qui souffle toujours emporte bien quelques paroles, car les derniers auditeurs, malgré les flots pressés, sont si loin ! Mais à quelle distance à la faveur de cette brise d’ouest doivent porter ces chants puissants de la multitude en marche, et surtout ces acclamations qui explosent bientôt au sommet du Calvaire !
Le Chemin de Croix terminé, retour au Temple pour la dernière cérémonie : le Salut du Saint-Sacrement. Mais auparavant, Son Excellence tient à adresser à ce bon peuple qui remplit la cour le mot final que chacun attend. Elle recommande à la piété filiale de l’assistance le grand Evêque qui eût été si heureux de présider cette fête, Mgr Le Fer de la Motte, et elle invite à réciter avec elle pour l’éminent prélat un Pater et un Ave. Puis elle parle du Temple, explique en termes pathétiques ce qu’était le Temple pour les Juifs de l’Ancienne Loi et, de là, par une transition toute naturelle, ce que doit être la religion pour eux chrétiens, quelque chose de vivant et de personnel, de réfléchi et de convaincu, d’universel aussi et de vraiment catholique, d’actuel et de moderne ; autant de mots qui témoignent combien le zélé Prélat, tout en louant sans réticence la tradition religieuse de nos populations, souhaite que la foi jette encore plus profondément ses racines.
A ces paternelles et vibrantes paroles répond une triple ovation : « Vive Monseigneur ! » C’est le merci enthousiaste de ces pèlerins ravis de la belle fête à laquelle la présence si désirée de Mgr l’Archevêque de Tours a donné un si vif éclat.
Quand le salut s’achève, il est tout près de cinq heures. Journée bien remplie.
Cependant les trompes d’autos appellent. On jette un dernier regard sur le vaste parc planté d’arbres magnifiques, peuplé de statues et de monuments. Les anciens n’ont pas de peine à évoquer la lande désolée qu’ils ont connue. Quelle transformation ! quel accroissement depuis un demi-siècle !… Voici maintenant bâti le Temple de Jérusalem. Il reste peu de chose pour achever l’œuvre du Père de Montfort. Rendons-en grâces à Dieu.
Retour des cendres du P. Barré.
On sait que le P. Barré, comme le rappelait le R. P. Boutillier en 1921 dans notre petit bulletin, avait choisi, pour dormir son dernier sommeil, une place modeste près de la grotte de l’Agonie. Mais eût-il été muet sur ce point, son œuvre eût parlé pour lui. Sa place était dans ce coin de terre qu’il avait transfiguré par vingt-cinq ans de labeur, dans ce pèlerinage ressuscité par ses soins et dont les voix continueraient autour de sa tombe ce bruit de prières et de cantiques qui avait enchanté sa rude vie de pionnier et d’apôtre. Encore que personne ne se fût décidé à mettre à l’ordre du jour la translation de ses cendres, sa tombe à Saint-Laurent sur-Sèvre échappait au sort commun : elle attendait.
Depuis ce soir de novembre 1914 où le P. Barré, succombant à une congestion cérébrale, s’était éteint dans ce cher pays de Saint-Laurent qui avait été son berceau, vingt et un ans s’étaient écoulés. La mort avait eu le temps d’éclaircir les rangs de ses anciens travailleurs. Si donc l’on voulait lui ménager de leur part une réception imposante au Calvaire, il était sage de ne plus tarder.
La famille consultée se montra enthousiaste d’un projet qui n’était que l’accomplissement d’un désir bien légitime du défunt.
On prit date; et, le 22 septembre, le Directeur du Pèlerinage profita de l’extraordinaire concours de peuple qu’avait provoqué la fête de la bénédiction du Temple pour annoncer la cérémonie et inviter les anciens travailleurs du P. Barré, leurs familles et leurs paroisses, à se retrouver au Calvaire quinze jours plus tard : le dimanche 13 octobre. Pour favoriser la publicité, le programme de la cérémonie fut distribué à toute l’assistance. Quelques jours après, des lettres de faire-part étaient expédiés aux quelque cent dix paroisses qui avaient envoyé au P. Barré des équipes de Travailleurs, couvrant de signatures quatre gros registres du Livre d’or.
« La fête du P. Barré », comme on disait, s’annonçait au mieux. Les musiques de Pontchâteau et de la Roche-Bernard, qui avaient été invitées pour mettre de la vibration dans cette pompe funèbre et lui donner un caractère triomphal, se préparaient fiévreusement. Mgr Deval, archiprêtre de la Roche-sur-Yon, compatriote et ami du P. Barré, avait accepté de grand cœur de présider la solennité. De différents points de la région alertée le mot attendu nous arrivait : « Oui, oui, on y ira. » Oui, mais, dès le surlendemain de la fête du 22, la pluie a repris, une pluie battante qui ne s’interrompt que pour redoubler. Tempête sur mer. De la Grande-Bretagne à Lyon où l’on enregistre des catastrophes, l’atmosphère est bouleversée. L’avant-veille de la cérémonie, le vendredi 11 octobre, les restes mortels du P. Barré nous arrivent de Saint-Laurent sous un ciel que continue à balayer un impitoyable vent d’ouest. Il faut se résigner. Au lieu d’une pompe triomphale, le P. Barré n’aura qu’un lugubre enterrement.
Mais voilà soudain, le soir même, contre toute attente, le vent qui tourne au nord. La nuit, le ciel lavé se poudre d’étoiles. Le lendemain, de vieux amis du P. Barré triomphent : « On l’avait bien dit. Le P. Barré allait ramener le beau temps pour sa fête. » Il n’est pas téméraire de croire que plus d’un lui avait adressé de ferventes prières à cette intention.
Grâce à Dieu et à ce beau soleil qu’il nous renvoie, la journée sera en effet telle qu’on l’avait rêvée, quelque chose comme une apothéose. Le prétoire sera là avec ses arcades tendues de deuil ; sur son esplanade un catafalque monumental, des torchères de verdure flambant aux quatre coins, musiques instrumentales, plein air qui permettra d’étaler la cérémonie dans toute son ampleur et de lui donner aux yeux innombrables de la foule ce caractère grandiose et inusité que chacun attend.
Dès le matin, à la grand’messe de Requiem, une assistance qu’on peut évaluer à quinze cents, sinon à deux mille. A gauche du catafalque, à côté des représentants de la famille Barré venus une trentaine de Saint-Laurent-sur-Sèvre, a pris place, avec M. le Maire de Pontchâteau, M. le Comte de la Villesboisnet, petit fils du généreux et pieux châtelain à la porte duquel le P. Barré, au temps des confiscations légales, n’alla pas frapper en vain. Sous les arcades, entourant Mgr. Deval, le T. R. P. Richard, et MM. les Curés de Pontchâteau, de Crossac, d’Herbignac, de la Chapelle-des-Marais, de Missillac, de Quilly, de Donges, de Saint Vincent sur-Oust, de Saint-Laurent-sur-Sèvre, M. l’abbé Bernard, ancien curé de Montois, M. l’abbé Rosellier, vicaire de Nivillac, et celui qui fut le deuxième successeur du P. Barré au Calvaire, le R. P. Ballu.
Après l’Evangile, le Directeur du Pèlerinage recommande aux assistants de faire de cette journée, comme ils l’entendent bien sans doute, une journée de prière ; et aux paroisses qui ont été invitées à veiller auprès du catafalque il rappelle leur tour de garde :
De la fin de la messe à midi : Saint-Gildas, Missillac, Saint-Joachim.
De midi à midi et demi : Sainte-Reine, Saint-Dolay, Ste-Anne-de-Campbon, Besné.
De midi et demi à une heure : Crossac, La Chapelle-des-Marais, Herbignac.
D’une heure à une heure et demie : Saint-Guillaume, Drefféac, Quilly.
D’une heure et demie aux vêpres : Pont-Château, Campbon, Donges.
Nul spectacle plus édifiant que celui dont chacun pourra être témoin tout à l’heure entre la messe et les vêpres. Autour du catafalque, ce ne sont pas de simples groupes, c’est une foule qui chante et qui prie. Au son du glas qui tinte de demi-heure en demi-heure à la chapelle, les paroisses désignées et toutes fières de cet honneur se relèvent avec une ponctualité exemplaire, tandis qu’autour d’elles, formant un cadre mouvant, la masse des pèlerins ne cesse de se renouveler. Celles des paroisses voisines du Calvaire qui n’ont pu être alertées à temps pour prendre leur tour de garde, Saint-Roch par exemple, se dédommagent amplement. Le P. Barré doit être satisfait. Ses anciens travailleurs et ses anciennes travailleuses ne lui rendent pas de vains honneurs.
2 heures… les vêpres. Sur l’esplanade, en arrière du catafalque, silencieuse et immobile, une masse compacte de six mille personnes, que de nouveaux arrivants, fidèles et membres du clergé, ne cesseront de grossir. Groupées sur les marches du monument, les musiques de Pont-Château et de la Roche-Bernard. L’instant est solennel où les instruments, préludant aux vêpres que préside Mgr Deval, font entendre leurs accords plaintifs. Puis la maîtrise de l’Ecole Apostolique chante, partie à l’unisson, partie en faux-bourdon, les psaumes des morts. Les vêpres terminées, le Directeur du Pèlerinage s’avance au sommet des degrés. Pour mieux unir dans une même glorification celui qui repose sous ces voiles funèbres et ceux qui furent les compagnons de son dur labeur, il commence par proclamer le nom des paroisses qui envoyèrent — et certaines d’entre elles, souligne-t-il, jusqu’à trente, quarante et cinquante fois — des équipes de volontaires au P. Barré : toutes les paroisses des Cantons de Pont-Château, de Saint-Gildas-des-Bois, d’Herbignac, de La Roche-Bernard, de Savenay, de Blain, de Guérande, de Guémené-Penfao, de Saint-Nicolas-de-Redon, de Saint-Nazaire, du Croisic, d’Allaire, de Malestroit.
Celles de Paimbœuf, de Cordemais, de Saffré, de Vay, de Saint-Victor-de-la-Grigonnais, de Péaule, de Muzillac, de Noyal-Muzillac, d’Arzal, de Billiers, d’Ambon, du Guerno, de Caden, de Malansac, de Limerzel, des Fougerets, de Saint-Martin-sur-Oust, de Sérent, de Saint-Guyomard, de Lizio, de La Chapelle, d’Augan, de Cruguel.
Et l’orateur entonne l’éloge du P. Barré et de ses travailleurs. Cette œuvre du Calvaire, l’œuvre la plus populaire du Bienheureux de Montfort, celle que le grand missionnaire, poète, orateur, écrivain mystique n’a pas écrite avec sa plume ni composée avec des mots, mais qu’il conçut pour la foule comme un livre ont en images où serait condensée la substance du livre par excellence : l’Evangile, — car les mystères du Saint Rosaire dont il se proposait d’achever la représentation au pied de son Calvaire, n’est-ce pas l’Evangile dans son essentiel ? — cette œuvre, l’orateur la montre, après une première destruction, reprise par les successeurs de Montfort, restaurée par M. Gouray, curé de Pont-Château, mais ne devenant ce livre grandiose, ce commentaire monumental qui déborde même le projet du Bienheureux, que par la foi audacieuse du P. Barré et le dévouement inlassable de ses travailleurs. Quelle foi en effet dans cet homme taillé d’ailleurs providentiellement pour la lutte, et pour qui l’impossible n’existe pas, une de ces âmes de feu, un de ces cerveaux puissants pour lesquels il ne peut y avoir qu’un danger, qu’une tentation : de chercher les difficultés pour le plaisir de mesurer ses forces. Oui, quelle foi !
Témoin ces œuvres qu’il fonde partout, qu’il entretient parfois même, gouverne et administre, écoles apostoliques et séminaires ici et en terre d’exil, emportant de haute lutte l’assentiment de ses supérieurs ou des évêques d’Haïti ; témoin surtout cette gigantesque entreprise du Pèlerinage au succès de laquelle personne ne voulait croire et pour laquelle il dut en somme se passer de plan pour ne pas effrayer même les plus hardis. Foi obstinée en Dieu et dans son Bienheureux Père, foi aussi dans ce bon peuple dont il était lui-même issu et dont il connaissait l’âme, ce fut le secret de sa réussite. Ainsi donc cette journée exalte tout à la fois l’œuvre et l’ouvrier, et ces populations chrétiennes, ces cent dix paroisses qui répondirent à sa confiance et à ses innombrables appels. Il avait voulu reposer dans cette terre du Calvaire où il savait qu’on ne l’oublierait pas. Son juste vœu est aujourd’hui réalisé.
L’orateur ayant terminé, la musique de la Roche-Bernard exécute un morceau d’une touchante inspiration et qui porte bien l’accent de la prière. Puis M. le Curé de Pontchâteau donne l’absoute.
Voici le moment venu de faire avec le P. Barré un dernier tour de pèlerinage. Aux accents d’une marche funèbre, le cortège s’ébranle, M. le Maire de Pont-Château, MM. Assailly, Chaplais, Guihaire, Moyon, Rouault portant le cercueil. Aux différentes haltes prévues : à la Grotte de Bethléem, à Nazareth, au pied du Calvaire, à l’Ascension, les porteurs de Saint-Guillaume, de Crossac, de Sainte-Reine et de Missillac succèdent à Pont-Château dans ce pieux office. En tête du deuil, le propre frère du P. Barré, un vieillard de soixante-dix-sept ans qui en porte une cinquantaine ; puis la suite de la parenté, une trentaine de Vendéens et de Vendéennes. Une foule innombrable déborde des avenues, priant, égrenant son chapelet, mêlant sa voix au chœur de l’Ecole Apostolique qui chante, accompagné par les deux musiques, les cantiques qu’entonna si souvent le P. Barré et que M. Macé, le distingué organiste de Pont-Château, a, pour la circonstance, admirablement orchestrés : Nous venons encore, Bienheureux Montfort I… Chers amis tressaillons d’allégresse.
Une dernière marche funèbre, et l’on arrive au lieu de la sépulture. A une dizaine de mètres de la grotte de l’Agonie, côté de l’Assomption, un caveau a été pratiqué entre d’énormes blocs de rocher, décor symbolique. Tout près, le monument qu’on posera demain sur ce caveau a été exposé. Sur la stèle de granit se détache en lettres noires l’inscription que vient de justifier la générosité de l’assistance :
Les Travailleurs du Calvaire
à Celui qui fut
25 ans leur chef et leur apôtre
1888-1913
et sur la pierre tombale comme des noms de victoires :
Prétoire, 1891. Chemin de croix, 1899.
Grotte de l’Agonie, 1892. Visitation, 1900.
Nazareth, 1894. Grotte de Bethléem, 1902.
Grotte d’Adam, 1895. Ascension, 1913.
Le Calvaire restauré et agrandi
Enfin sur le pan inférieur :
Jacques Barré
Missionnaire de la Compagnie de Marie
1847-1914
La tombe bénite par M. le Curé de Pont-Château, l’assistance se dispute l’honneur d’asperseur les restes mortels du P. Barré et l’avantage d’emporter une image-souvenir. Les quatre bénitiers et les quatre distributeurs d’images ne suffisent pas à faire prendre patience, et pendant une demi-heure on s’écrase. Malheur à qui laisse tomber sac à main ou parapluie ! Impossible de se baisser pour les reprendre. En vain l’Ecole Apostolique et les musiciens essayent d’entraîner la foule vers le Prétoire. Chacun ne se retirera que dûment servi.
Heureuse d’avoir rendu ses derniers hommages au grand ouvrier du Calvaire, la foule se disperse, couvrant de son fourmillement serré l’immense avenue du Vieux Moulin ; et c’est devant un millier de personnes à peine que se donne au Prétoire le salut du Saint Sacrement.
« Un triomphe ! », nous murmurait à l’oreille, pendant la marche du défilé, un Pontchâtelain. Un triomphe en effet, et auquel Pont-Château, sa ville et sa campagne, a contribué plus que nul autre, témoignant ainsi de sa gratitude envers l’homme qui, en dépit de tant d’obstacles, donna un tel couronnement de beauté à son vieux Calvaire.
Il repose là maintenant dans ce coin resté seul sauvage de cette lande de la Madeleine où tout parle de lui. Plus d’un de ses anciens travailleurs viendra prier sur sa tombe ; plus d’un aimera à raconter près d’elle à ses enfants et à ses petits-enfants les jours héroïques d’autrefois.
N° 6 – 7 Juillet – Août 1939
Le Cénacle au Calvaire de Pontchâteau
Sa construction
Le temple construit et orné de ses fresques, restait à représenter encore deux mystères du saint Rosaire : la Pentecôte et le Couronnement de gloire de Marie.
La Pentecôte demandait le Cénacle, et l’on ferait d’une pierre deux coups, car le Cénacle par son nom même évoque surtout la dernière Cène, c’est-à-dire le dernier souper, en latin cena, que Jésus prit avec ses apôtres et qu’il marqua par l’institution de l’Eucharistie. La salle où l’Esprit-Saint descendit au jour de la Pentecôte se présenterait donc comme un reposoir tout fait pour la procession de la Fête-Dieu. Problème peu difficile à résoudre. Cette salle étant à l’étage, « une chambre haute », il suffirait d’ouvrir largement le mur de façade, de faire précéder cette baie d’un escalier, et il ne manquerait plus qu’un autel pour avoir le reposoir désiré.
La place où devait se poser le petit monument avait été prévue et préparée déjà depuis plusieurs années : une avenue de vingt mètres de large qui partait de l’hôtellerie, parallèlement aux murs du temple, et traversait tout le pèlerinage. De jeunes plantations de cèdres et autres conifères la dessinaient déjà très nettement. L’édifice serait là bien en vue, d’accès facile, et on aurait soin de ne pas le placer trop loin pour que, les dimanches de la saison, la visite aux sanctuaires des mystères glorieux ne se change pas en une course essoufflante.
Le 11 octobre, Emile Perrais, Mathurin Gauthier, Auguste Rutin, Jean Cornet, les deux Baptiste Cougeon, père et fils, Georges Noblet, Marcel Perrais, François Perrais, Emile Allain, Louis Courjal, Jean Vaillant, Jean Tainguy, Jean Poidevin, tous de la paroisse de Missillac, déblayaient le terrain et faisaient les fouilles; le mardi 18 octobre, on plantait dans le béton des fondations les premières armatures, et le samedi, 18 décembre, deux mois donc après, jour pour jour, on descendait des échelles, ayant terminé la petite plate-bande en retrait qui couronne la corniche. A part, sur la fin, quelques journées maussades où la pluie venait par averses, la température avait été des plus favorables ; mais il était temps ! Le lendemain le thermomètre commençait à descendre, et dans la nuit du dimanche au lundi on sait ce qui arriva. On gardera longtemps le souvenir de ce coup de froid qui n’épargna ni les autos dans les garages les mieux fermés, ni les betteraves dans les granges, ni les cyprès Lambert de Cherbourg à Bordeaux. Bien qu’encore insuffisamment durcie, la plate-bande fut protégée par le coffrage. Quant à la terrasse, coulée depuis quatre jours seulement, la douceur de la température lui avait déjà donné ce son métallique qui rassure contre toutes les menaces de l’atmosphère. Elle s’en tira sans le moindre dommage.
Bien nous en avait pris, nous défiant des surprises de l’hiver, d’aller demander du secours dans le voisinage. Ce fut une journée qui ne se passa pas à rouler des cigarettes que celle du 9 novembre où Saint-Guillaume et le village de Quémené-en-Crossac nous avait envoyé une équipe de volontaires pour couler la terrasse du soubassement. On ne soufflait que pour compter les sacs de ciment que la pelle éventrait sur le gâchoir. En fin de journée, l’éventreur criait triomphalement le chiffre de cinquante-deux, ce qui représentait plus de sept mètres cubes de béton. Pour ne pas atteindre pareil chiffre, car il fallait hisser les seaux à la poulie à sept mètres de haut, le mardi 13 décembre, qui nous amenait une nouvelle équipe composée partiellement des mêmes travailleurs, ne connut pas davantage la grève sur le tas. Aussi inscrivons-nous avec reconnaissance au tableau d’honneur :
Joseph Allaire, Emile Bivaud, Louis Delahaye, Pierre Delahaye, Frédéric Lailler, Joseph Tual, de Quémené, — et Roger Barbin, Pierre Privé, de Saint-Guillaume; ceux-là deux fois présents.
Donatien Allaire, P.-M. Delahaye, Clément Mahé, Similien Tual, de Quémené; — et Pierre Chédotal, André Gourhand, C. Gourhand, Michel Gourhand, Pierre Guihéneuf, Henri Loreau, Joseph Mahé, Désiré Nicolas, de Saint-Guillaume.
Mérite bien aussi un remerciement spécial Pierre Joalland, fils, à qui nous dûmes principalement un coffrage d’une exécution rapide et impeccable. D’ailleurs, dans la petite équipe, tantôt de trois, tantôt de quatre, cinq ou six travailleurs, tous du proche voisinage, chacun avait le cœur à la tâche comme à un travail de famille.
Son ornementation.
Restait la décoration de l’intérieur du monument. Que les exégètes ne s’effarouchent pas en voyant, à droite et à gauche de la Pentecôte, la Cène et l’une des plus touchantes apparitions de Jésus à ses apôtres. On n’a pas eu la prétention de trancher une question historique.
Alors même qu’il serait sûr que du Jeudi-Saint à la Pentecôte les Apôtres aient changé de retraite et de salle de réunion, quelle inconséquence y aurait-il à représenter ces diverses salles par une salle unique où différentes scènes rappelleraient respectivement chacune d’elles et d’appeler tout bonnement ce local le Cénacle, puisque aussi bien, d’après le texte sacré lui-même, c’est le nom qui leur convient à toutes ?
Mais peut-être nos lecteurs seront-ils curieux de vérifier combien il est vraisemblable que le Cénacle de la Pentecôte n’est point différent du Cénacle de l’Eucharistie.
Le Cénacle de l’Eucharistie.
“Le premier jour des Azymes, où l’on immolait la Pâque, les disciples dirent à Jésus : « Où voulez-vous que nous allions vous préparer ce qu’il faut pour manger la Pâque ? » Et il envoya deux de ses disciples, et leur dit : « Allez à la ville; vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau, suivez-le. Quelque part qu’il entre, dites au propriétaire de la maison : Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée et toute prête : Faites-nous là les préparatifs. » Ses disciples partirent et allèrent à la ville: et ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. » (S Marc, ch. XIII, 12-17.)
Il ressort de là que la petite troupe apostolique n’avait pas encore de salle de réunion. Sans doute Jésus ne veut pas que Judas sache d’avance le lieu du dernier repas. C’est là, d’après tous les commentateurs depuis saint Cyrille d’Alexandrie, la raison de son langage mystérieux. Mais ce dont il s’agit, ce n’est pas de changer de salle; la question des disciples le prouve : c’est d’en trouver une.
Le local des apparitions.
Dans l’après-midi du samedi de la résurrection, Jésus se joint à deux de ses disciples sur le chemin d’Emmaüs. De l’hôtellerie où ils l’ont reconnu à la fraction du pain, ceux-ci reviennent en hâte à Jérusalem « où, nous dit saint Luc, ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux ».
Comme, ils achevaient de conter leur miraculeuse aventure, Jésus se tint au milieu de la petite assemblée, continue saint Luc. Et saint Jean note que c’était par crainte des Juifs que les disciples se tenaient là, tous ensembles, les portes bien closes.
Cette salle où les apôtres et un certain nombre de fidèles de Jésus se retrouvent ainsi spontanément après la dispersion des deux jours précédents, n’est-elle pas vraisemblablement celle que Jésus avait choisie lui-même pour le repas d’adieu ? Pourquoi eût-elle été par-là moins sûre qu’une autre ? Judas était mort. Lui seul des ennemis de Jésus avait connu l’endroit, sans songer à l’intérêt qu’il y aurait eu à le révéler. D’ailleurs il avait bien changé de sentiments à l’égard de ses complices.
Les apôtres ne quittèrent pas Jérusalem avant la fin des solennités pascales. On les trouve en effet réunis de nouveau dans cette même salle huit jours après la première apparition. Saint Thomas complète alors le petit groupe des onze. Il est probable qu’ils ne tardèrent pas davantage à partir pour la Galilée, rien ne les retenant plus dans la ville sainte. C’est en Galilée que Jésus leur avait donné rendez-vous.
Dix jours avant la grande fête de la Pentecôte nous les voyons de retour à Jérusalem. Quelle est cette salle où Jésus les trouve attablés, s’assoit avec eux, et qu’il ne quitte que pour les conduire sur la montagne des Oliviers où il va s’élever au ciel ? Nulle raison de supposer que ce n’est pas la même que précédemment ?
Le Cénacle de la Pentecôte.
Le livre des Actes des Apôtres nous montre les témoins de l’Ascension rentrant immédiatement à Jérusalem, pour y attendre, conformément aux ordres de leur Maître, « ce que le Père avait promis ». Saint Luc précise le lieu de leur retraite. Ils montèrent dans le Cénacle, la chambre haute, là où ils se tenaient d’ordinaire. « C’étaient Pierre et Jean, Jacques et André, etc. Tous dans un même esprit persévéraient dans la prière avec quelques femmes et Marie, mère de Jésus, et sa parenté. »
La salle aussi est vaste; elle peut contenir au moins cent vingt personnes, le chiffre des fidèles réunis lors de l’élection du nouvel apôtre Mathias.
Saint Luc continue : « Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. »
Peut-on hésiter à identifier cette salle avec celle qu’ils ont quittée quelques heures auparavant pour assister à l’Ascension de leur Maître, la salle où se tenaient d’ordinaire les onze et où Jésus leur apparaissait ?
+
On refait donc ainsi la chaîne : le Jeudi-Saint, réunion dans une vaste chambre haute pour le repas pascal. Le dimanche soir, apparition de Jésus aux apôtres dans un local qu’on ne précise pas. Quarante jours après, dernière apparition dans un local qui n’est pas déterminé davantage, mais où les apôtres sont attablés et qui ne peut être que le Cénacle où s’accomplira le prodige de la Pentecôte, la demeure ordinaire du collège apostolique, dit le texte des Actes.
Aussi la tradition la plus ancienne est-elle unanime à ne voir sous ces indications diverses qu’un seul et même lieu, une chambre haute, un cenaculum, comme traduit la Vulgate, ce sens secondaire de chambre haute étant devenu en latin le sens usuel du mot cenaculum, cénacle, premièrement et étymologiquement une salle à manger.
Sans doute ce sentiment fût-il resté unanime au cours des siècles si certains commentateurs n’avaient prétendu identifier le Cénacle de la Pentecôte avec la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où saint Pierre délivré miraculeusement de sa prison vint frapper de nuit, alors que plusieurs personnes y étaient assemblées et priaient. On leur objecta que dans ce cas cette maison qui a une femme pour propriétaire ne pouvait être le Cénacle de la dernière Cène dont le propriétaire est un homme. « Vous direz au maître de la maison… »
C’est là-dessus que l’attention fut attirée sur les deux mots grecs différents d’origine bien que synonymes dont saint Luc, dans son Evangile et dans le livre des Actes, se sert pour désigner le Cénacle de l’Eucharistie et le Cénacle de la Pentecôte, mots qui signifient également chambre haute. On crut voir dans ce changement de termes l’indication de locaux distincts.
Faible argument, car les premiers écrivains ecclésiastiques qui parlaient grec ne furent nullement impressionnés par cette variété d’expressions, si facilement explicable.
Si l’on veut ensuite que la maison de Marie, mère de Jean-Marc, n’ait pas été le Cénacle de l’Eucharistie, quelle nécessité d’en faire le Cénacle de la Pentecôte ? Ce n’est en effet qu’à la Pâque de l’année suivante que saint Pierre fut incarcéré sur l’ordre d’Hérode. Depuis la Pentecôte dix mois s’étaient écoulés de persécution violente. S’il est vrai que les Apôtres durent changer le lieu des assemblées générales, comment ne pas croire que ce fut plutôt pendant ces dix mois où ils furent sans cesse en butte aux tracasseries policières ? D’ailleurs, le nombre des fidèles s’étant considérablement accru jusqu’à atteindre le chiffre de plusieurs milliers, il semble très probable qu’à Jérusalem même les lieux de réunion durent se multiplier, aucun local n’étant assez spacieux pour contenir même les seuls fidèles résidant dans la ville sainte. Ce qui paraît le plus naturel, c’est que saint Pierre, désireux de rassurer au plus vite sur son sort, sera allé frapper à la première maison amie. C’était la maison de Marie, mère de Jean-Marc, maison dont on ne connaît pas l’emplacement.
De toute façon il semble donc prudent de ne pas rejeter la tradition primitive et de penser que les Apôtres n’eurent jusqu’à la Pentecôte inclusivement d’autre retraite que le Cénacle de l’Eucharistie, si cher à leur mémoire. S’ils en changèrent, ce ne fut qu’après.
Ainsi notre modeste monument a-t-il chance, du moins par les scènes qu’il évoque, d’être entièrement conforme à la vérité historique. Trois grandes fresques en effet y rappellent les événements essentiels. On y voit au fond la descente du Saint-Esprit; à droite la dernière Cène; à gauche Jésus apparaissant aux siens, saint Thomas à genoux devant lui et portant la main sur la plaie du côté. La scène émouvante du lavement des pieds, peinte à l’huile sur le devant de l’autel, complète la série.
+
Ce sont, on le devine, ces belles peintures qui donnent sa valeur au petit édifice : valeur spirituelle et valeur artistique. Elles sont signées, naturellement, Paul Lemasson. C’est l’après-midi qu’il faut venir les voir, au déclin d’une journée lumineuse, quand le soleil, suspendu comme une lampe au-dessus de l’hôtellerie, darde ses rayons bien en face, dessinant la baie d’entrée en un rectangle éblouissant sur le dallage de la salle. Regardez à travers l’élégante grille en fer forgé, ouvrée de main de maître par M. Guitton: ou plutôt une clef complaisante va faire tomber la chaîne du cadenas. Entrez… Est-ce frais ? Est-ce délicat ? Au temple, c’était la chaude et pathétique tonalité de l’ocre jaune. Ici, dans ce petit sanctuaire, se répand du plafond et des plates-bandes un reflet rose qui donne à tout ce décor, où la Vierge à genoux occupe le point central et fixe tous les yeux, une grâce vraiment printanière. Et est-ce trouvé ces rayons qui descendent, géométriques, de la symbolique colombe figurant le Saint-Esprit, traversent le cadre en flammes ondoyantes et se fondent en larges gouttes de feu qui sont bien des langues ? Et ces tapisseries qui fleurissent les coins ? Je ne parle pas des personnages traités avec cette même simplicité, le même sentiment du naturel, qui ne sont pas le moindre charme des fresques du temple. Mais quel jeu harmonieux de couleurs, quelle musique pour les yeux !
Chaque tableau, tant sur le devant de l’autel que sur les murs, est encadré de son texte, le propre texte des Ecritures, auquel, en somme, il ne fait que servir d’illustration. Nos touristes pourront prendre là encore une petite leçon d’histoire sainte. Les enfants des écoles libres s’intéressent à y contrôler l’exactitude de leurs souvenirs. Groupes de premiers communiants et de premières communiantes faisaient dernièrement leur pèlerinage d’actions de grâces, c’était à qui aurait le plus vite identifié les personnages et relevé la signification d’un geste, la raison de tel détail.
La fête de la bénédiction
Quel jour pouvions-nous mieux choisir que le lundi de la Pentecôte pour procéder à la bénédiction du petit sanctuaire ? Bonheur inespéré et lustre que l’on n’avait vu depuis longtemps, nous avions deux augustes présences. Son Exc. Mgr l’Archevêque de Rennes avait daigné accepter notre invitation; et Son Exc. Mgr l’Evêque de Nantes, exceptionnellement libre ce jour-là, s’était offerte à faire elle-même au Métropolitain de Bretagne, qu’elle recevait pour la première fois dans son diocèse, les honneurs du pèlerinage. Pourquoi faut-il qu’un contretemps domestique ne nous ait pas permis d’organiser des moyens de transport ? Un temps à souhait, un soleil radieux que modérait un léger souffle du nord. A Nantes, à Saint-Nazaire, à Chateaubriand, et au-delà de la Vilaine, les pèlerins alertés n’attendaient qu’un train commode ou des services d’autocars pour tripler le chiffre de l’assistance.
A 10 h. 20, les cloches sonnent à toute volée dans les pavillons haut-parleurs placés par M. Dréno sur la plate-forme supérieure du temple. Le cortège, la chorale de l’Ecole Apostolique en tête, conduit leurs Excellences au temple, où, à défaut d’ombrages assez fournis, la grande salle et le sanctuaire offriront un abri contre les ardeurs du soleil.
Mgr l’Archevêque de Rennes tient chapelle, assisté de M. le Chanoine Groult, un de ses vicaires généraux, et de M. le Chanoine Trochu, l’éminent directeur de la Semaine religieuse de Nantes et l’écrivain bien connu. Du côté de l’épître, MM. les curés de Pontchâteau et de Besné entourent Monseigneur de Nantes. Le B. P. Le Nours, supérieur de l’Ecole Apostolique, est à l’autel. Dans le sanctuaire, le B. P. Yves, gardien du couvent des Franciscains de Saint-Nazaire, MM. les curés d’Herbignac, de Muzillac, de la Chapelle-des-Marais, de Saint-André-des-Eaux, de Crossac; les RB. PP. Bigaré et Nicolas, M. l’abbé Rivière…
Après l’Evangile, Son Exc. Mgr Villepelet s’avance vers le micro. Ses premiers mots sont pour évoquer le souvenir et l’œuvre du bienheureux de Montfort, et pour exprimer à Mgr l’Archevêque de Rennes l’unanime reconnaissance des pèlerins :
« Si par miracle le bienheureux Père de Montfort revenait ce matin au milieu de nous, il se réjouirait grandement, et de voir cette belle assistance de pèlerins, et de contempler, auprès de son Calvaire tant aimé, ce Cénacle qui évoque la Pentecôte. Prédicateur insigne de l’Esprit-Saint, il n’a pas voulu donner à la Congrégation des religieuses qu’il a fondée d’autre nom que la Sagesse, l’un des noms appliqués au Verbe Incarné, mais qui aussi désigne un don du Saint-Esprit, le dernier de ses dons parce que le plus sublime. Il eut aimé particulièrement le pèlerinage d’aujourd’hui, présidé par Son Exc. Mgr l’Archevêque de Rennes : il passa six années au célèbre collège des Jésuites de cette ville ; chaque jour il s’agenouilla aux pieds des trois madones les plus priées en ces lieux : Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Notre-Dame des Miracles, devant laquelle un appel mystérieux décida de son avenir. Il revint encore à Rennes en la pleine maturité de sa vie apostolique; à son déclin, il voulut revoir une dernière fois une cité si chère.
« Votre présence ici, Excellence, nous pouvons bien l’interpréter comme un geste de reconnaissance de votre archidiocèse, qui réjouit grandement les Fils de Montfort, gardiens fidèles de son œuvre de Pontchâteau. Elle honore grandement tout ce peuple de Nantes venu pour vous saluer. Elle honore grandement l’Evêque lui-même, heureux de vous redire encore une fois, et publiquement, ses sentiments faits de sa respectueuse sympathie pour votre personne et de son admiration pour votre belle activité apostolique. »
Après une allusion délicate à notre artiste, M. Paul Lemasson, Son Excellence, d’une voix grave, bien posée, qui s’adapte avec une justesse admirable au micro, évoque le Cénacle de Jérusalem, lieu de prière, de retraite et de sainte attente, et ce matin de la Pentecôte où l’Esprit-Saint y fit irruption comme un souffle de tempête. C’est ce souffle sorti du Cénacle qui continue à circuler par le monde, sans se ralentir ni s’apaiser jamais, suscitant d’âge en âge des merveilles d’héroïsme, d’apostolat et de sainteté; c’est aussi le souffle dont parle la Bible, ce murmure doux et léger auquel Elie le prophète reconnut le passage du Seigneur…
La messe achevée, le cortège se reforme au chant des cantiques et se dirige vers le Cénacle. Les grilles sont ouvertes, le clergé pénètre dans le petit sanctuaire que Mgr Mignen asperge d’eau bénite. Puis l’on chante le Veni creator.
L’après-midi, c’est le Chemin de croix, avec son déploiement habituel, ce flot humain roulant le long de la Voie douloureuse, ces chants qui montent et qui s’éteignent, ce murmure de prières, ces bras qui s’étendent. Des touristes se sont mêlés aux pèlerins et suivent. Des retardataires qui n’ont su où remiser leurs bicyclettes rejoignent, la main au guidon. Des morbihannaises, pressées sans doute par l’heure du départ, gravissent, chargées de leur sac à provisions, les abrupts lacets du Calvaire. Le P. Joret entraîne tout ce peuple.
De retour au prétoire, la pieuse assemblée reçoit des mains de Mgr l’Archevêque de Rennes la bénédiction du Saint-Sacrement, et Mgr Mignen termine cette belle journée par un mot bien senti d’édification et de remerciement.