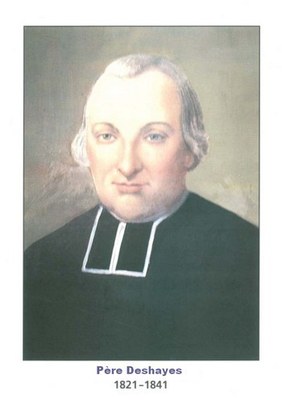
Les Frères montfortains de Saint-Gabriel, que l’on appelle plus simplement aussi les Frères de Saint-Gabriel, se rattachent par leurs origines à saint Louis-Marie de Montfort (1673-1716). A sa suite, quatre premiers frères prononcèrent leurs vœux en juin 1715. Cette communauté de pères et de frères est nommée indifféremment Compagnie de Marie ou Communauté du Saint-Esprit. Pères, frères et sœurs dépendaient d’un seul supérieur général qui réside à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) où est inhumé le père de Montfort.
Le père Gabriel Deshayes (1767-1841), est élu à 53 ans, en 1821, septième supérieur des congrégations montfortaines, sur la demande instante de son prédécesseur qui voyait en lui un sauveur de la congrégation masculine qui se réduisait fortement. Grâce à son zèle, le nombre de pères augmente. Et plus encore, celui des frères ; à tel point qu’il décide de les diviser en deux groupes. : les uns restant avec les pères, et sont leurs auxiliaires pour des tâches temporelles ou pastorales, les autres, plus nombreux, sont destinés à l’enseignement.
La maison principale qu’il leur donne, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, est appelée Saint-Gabriel en son honneur. On prend vite l’habitude d’appeler ses habitants Frères de Saint-Gabriel. Ce nom vint à remplacer leur première appellation de Frères du Saint-Esprit et deviendra officiel quand les frères sont autorisés à enseigner dans toute la France par un décret de l’empereur Napoléon III, le 3 mars 1853.
En septembre 1842, quelques mois après la mort du P. Deshayes, le frère Augustin est nommé supérieur général. Ce changement amorce l’autonomie des frères enseignants par rapport à la Compagnie de Marie.
Au 19e siècle, les frères de Saint-Gabriel affichent une progression régulière de leurs effectifs. Ils resteront surtout cantonnés dans l’Ouest de la France. C’est en 1888 qu’ils partent pour la première fois à l’étranger : au Canada.
Avec la Troisième République et sa politique à l’égard des congrégations enseignantes, la congrégation des Frères de Saint-Gabriel est dissoute en 1903. Certains frères restent en France, plus de 400 quittent l’institut ou sont contraints de se séculariser : suppression de l’habit et du nom religieux, interdiction de vivre en communauté. D’autres partent pour l’étranger, l’administration générale de la congrégation se fixe en Belgique. En Italie et en Espagne, elle a donné naissance à des provinces. Celle d’Espagne existe encore, malgré ses épreuves, comme la mort violente de 49 frères en 1936 pendant la guerre civile espagnole.
En Afrique, si la guerre italo-éthiopienne met fin en 1935 à la présence des frères en Ethiopie, leur mission au Gabon et à Madagascar ne s’est jamais interrompue depuis un siècle. En Asie, il en est de même pour les deux pays, la Thaïlande et l’Inde, où ils arrivent respectivement en 1901 et 1903. La dimension internationale donnée ainsi à la congrégation a eu pour conséquence de modifier son statut : de droit diocésain jusqu’alors, elle devient de droit pontifical en 1910.
En 1936, l’institut s’installe dans deux autres pays : le Congo belge (l’actuelle République démocratique du Congo) et Singapour.
De 1946 à 1965, la congrégation prend en charge une moyenne de dix écoles par an d’un continent à l’autre ; elle s’implante dans onze nouveaux pays : le Brésil (1949), le Sénégal (1954), la Malaisie (1955), le Sri-Lanka (1956), l’Irak (1957), le Congo (1957), le Centrafrique (1957), la Colombie (1961), le Pérou (1962), le Cameroun (1964), le Rwanda (1965), auxquels on peut ajouter en 1968, la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Depuis les années 1970, plus de la moitié des frères sont désormais asiatiques. En Thaïlande, un élève sur cinq dans l’enseignement catholique est éduqué par les frères de Saint-Gabriel. L’Inde compte plus de 600 frères, présents dans la plupart des états et appartenant à huit provinces religieuses. Elle est devenue à son tour « missionnaire« , en envoyant des frères hors de ses frontières. Les provinces occidentales voient naître des communautés interculturelles.
Les Frères de Saint-Gabriel sont aujourd’hui 1100 répartis en 33 pays, 16 provinces religieuses et une vice-province : une en Amérique, cinq en Afrique, deux en Europe et neuf en Asie.
Les frères travaillent en priorité auprès de la jeunesse des milieux scolaires.
Ils ont une prédilection pour les handicapés sensoriels.
Frères montfortains de Saint-Gabriel, nous serons une présence prophétique montfortaine au 21e siècle, dans la mesure où, comme Montfort, notre « apostolat sera nourri par une profonde vie de prière, par une foi inébranlable en Dieu Trinité et par une intense dévotion à la Très Sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur ». (Jean-Paul II à la famille montfortaine, 21 juin 1997)
(Extrait des Actes du 33e Chapitre général)










